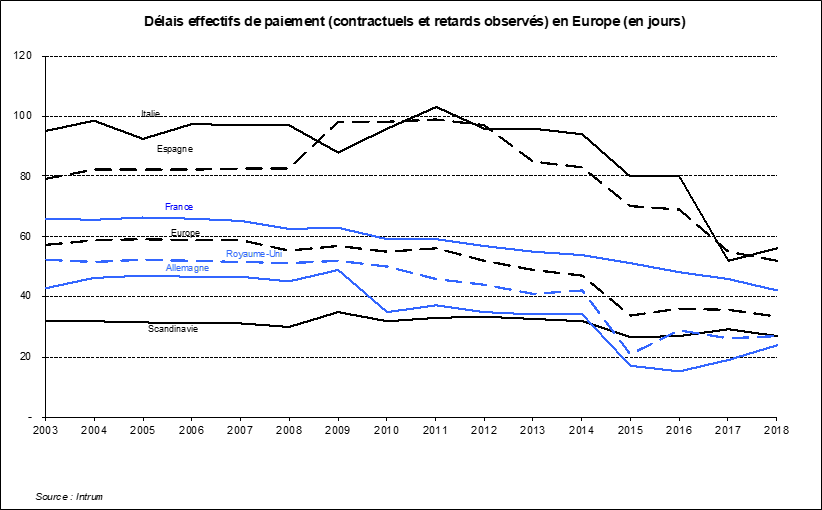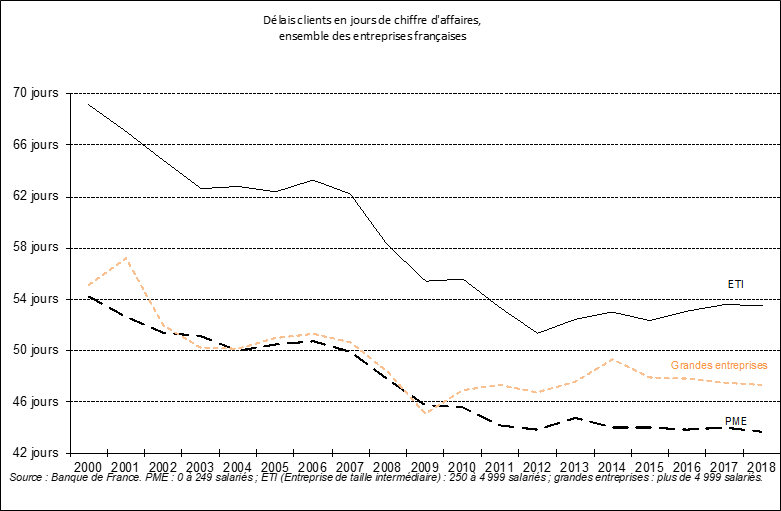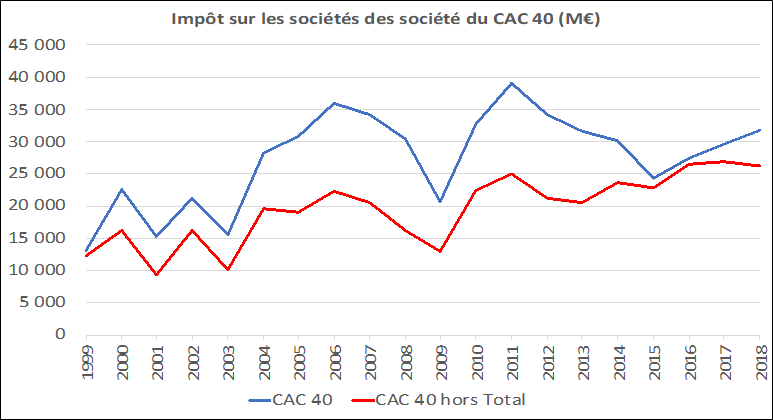La Lettre n°176 de Février 2020
Actualités : Reprendre le mouvement de réduction des délais de paiement
Si la décennie des années 2000 a vu une sérieuse diminution des délais de paiement inter-entreprises, qui sont passés, par exemple pour les ETI, de 69 jours de chiffre d’affaires en 2000 à 53 jours en 2011, on peut dire que la décennie des années 2010 est, à cet égard, une décennie perdue : le chiffre de 2018 était de 54 jours, quasiment le même qu’en 2011. Et au niveau global, la tendance est identique : 55 jours en 2000, 45 jours en 2011 et 44 jours en 2018[1].
Les délais de paiement inter-entreprises représentent en France, hors secteurs financier et agricole, des sommes considérables : 638 Md€ pour l’encours clients et 555 Md€ pour les fournisseurs[2], à comparer à 216 Md€ de crédits de trésorerie à court terme. Et les délais de paiement effectifs (les délais contractuels + les retards) sont encore en France (42 jours) largement supérieurs à la moyenne européenne (34 jours) ou à celle de notre principal partenaire commercial,
l’Allemagne (24 jours)[3] .
On connaît la raison historique de ces délais plus longs en France que dans le reste de l’Europe : l’encadrement du crédit qui rationnait les entreprises afin, pensait-on, de lutter contre l’inflation. Les entreprises non contraintes en crédit (parce qu’elles exportaient ou construisaient des logements) finançaient par le crédit inter-entreprises celles qui étaient contraintes. Il a été supprimé en 1984, quand 46 % des crédits étaient devenus désencadrés et que l’exception était devenue quasiment la norme ! Puis l’inflation a baissé. Mais le crédit inter-entreprises n’a pas disparu pour autant.
Il est vrai qu’il a deux fonctions économiques : permettre de résister à un choc en mutualisant une partie de son impact, et permettre à l’acheteur d’avoir le temps de vérifier la qualité des produits ou marchandises qui lui ont été livrés. Avouons que cette seconde fonction tend à perdre de son intérêt avec l’importance décroissante de l’industrie et l’efficacité considérablement accrue de la chaîne logistique.
* * *
La baisse des délais de paiement a été enclenchée en France par la loi NRE de 2001 qui prévoyait un délai de 30 jours en cas d’absence de dispositions contractuelles, puis par la loi LME, entrée en vigueur en 2009, qui limite les délais de règlement convenus entre les producteurs, prestataires de services, grossistes ou importateurs agissant en qualité de clients ou de fournisseurs, à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture (et par dérogation à 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture).
Depuis, diverses mesures ont été prises pour lutter contre des manœuvres de contournement de la loi LME (pression du client pour que l’émission de la facture soit retardée, etc.) ou de retards abusifs : obligation de facturer les intérêts et des pénalités de retard, obligation de publier les délais de paiement dans le rapport de gestion, amendes renforcées[4], publication officielle du nom des contrevenants[5]. Force est de constater que ces différentes mesures sont à ce stade inopérantes au niveau macro-économique avec des délais de paiement qui ne se réduisent plus.
On paie le personnel à la fin du mois (avec donc un délai moyen de 15 jours pour un salarié qui a travaillé tout au long du mois), les impôts sur le revenu au fur et à mesure où ils sont générés (avec le prélèvement à la source), les impôts sur les profits au fur et à mesure où ils sont dégagés (avec une estimation qui est le niveau de l’année précédente). Au nom de quoi faudrait-il faire attendre ses fournisseurs 45 jours ou 60 jours, voire davantage, avant de les payer ?
On transforme ainsi les fournisseurs, à leur corps défendant, en banquiers court terme de l’entreprise, ce qui n’est ni leur vocation, ni leur compétence, et en les fragilisant au passage, car il est bien établi par la recherche scientifique et les praticiens que plus les délais de paiement sont longs, plus la probabilité que l’entreprise connaisse des difficultés financières, voire fasse faillite, est importante[6]. La Banque de France estime que 32 % des entreprises supportent des paiements à plus de 60 jours. A-t-on oublié les propos du médiateur des relations inter-entreprises : « Les grandes entreprises se permettent, exprès ou pas, de ne pas payer en temps et en heure leurs fournisseurs et les mettent en difficulté » ?[7]
On pouvait comprendre ces délais de paiement importants quand le crédit était rare et cher ; il est aujourd’hui abondant et peu coûteux. On pouvait le comprendre quand les valorisations des entreprises étaient basses ; elles sont aujourd’hui au plus haut historique pour celles non cotées ou proches des plus hauts historiques pour celles cotées.
Rappelons en effet que la généralisation de la valorisation des entreprises par une approche indirecte (par la différence entre la valeur de l’actif économique et de la valeur de l’endettement net) a pour effet indirect d’exercer une pression sur les délais de paiement, car tout euro de délai supplémentaire réduit la dette nette d’autant et améliore donc la valeur des capitaux propres d’autant. Nulle autre raison probablement au fait qu’en 2018, 15 des 38 groupes non financiers présents dans l’indice Euro Stoxx 50 avaient un BFR négatif, alors qu’aucun ne ressort spontanément des groupes que l’on imagine à BFR négatif : Unilever, Airbus, AB InBev, Orange, etc.
Si au niveau de certains groupes, l’impact peut être significatif, il est beaucoup plus faible au niveau macro-économique, puisque la Banque de France estimait à 11 Md€ le transfert de trésorerie pour 2018, dont bénéficiaient ainsi les grands groupes, soit 0,6 % de la capitalisation boursière de Paris. Mais pour les PME, qui sont structurellement plus faibles que les grands groupes, le déficit de liquidité induit par les délais de paiement est estimé par la Banque de France à 19 Md€. Et pour elles, c’est loin d’être négligeable !
On paie les intérêts et le remboursement du capital d’un emprunt bancaire le jour J, et bien peu d’entreprises prennent le risque qu’il en soit autrement. On paie les coupons et le remboursement du capital d’un emprunt obligataire le jour J et bien peu d’entreprises prennent le risque qu’il en soit autrement. Pourquoi doit-il en être autrement pour ses fournisseurs ? La Banque de France estime que plus de la moitié des grandes entreprises règlent leurs fournisseurs avec retard, alors que plus de 70 % des PME respectent les délais. Est-ce normal ? Non.
* * *
Pour poursuivre le mouvement de baisse des délais de paiement, afin que tout fournisseur soit moins le banquier de son client au-delà du délai normal de vérification de la réception du bien ou du service et de la mise en œuvre du paiement, afin d’éviter de fragiliser les entreprises par ce canal, afin de reprendre aux grands groupes ce qu’ils ont indûment arraché aux entreprises plus petites, nous voyons deux pistes.
Celle de la voie législative qui abaisse de nouveau les délais maximums en les faisant passer de 60 jours, à compter de la date d'émission de la facture, à 30 jours. La mesure pourrait être votée en 2020, en prévoyant une application 24 à 30 mois plus tard, afin de laisser le temps nécessaire aux drogués des retards et des paiements longs pour se préparer à entrer dans la modernité. Et la mesure ne devrait pas concerner que les entreprises, mais aussi l’administration et les collectivités locales, aux appels d’offre desquels 56 % des PME ne répondent plus à cause des difficultés à se faire payer[8].
À ceux qui craindraient qu’une accélération des paiements aux fournisseurs ne soit que partiellement compensée par une accélération des paiements des clients, et que certaines entreprises en souffrent, une étude de la Banque de France[9] montre qu’il n’en est rien. Les 10 % des entreprises qui ont eu à réduire le plus leurs délais de paiement fournisseurs, entre 2005 et 2015, ont réussi à maintenir leur rentabilité et à sauvegarder leur structure financière qui ne sont pas différentes de celles des autres entreprises.
L’autre voie, beaucoup plus longue à mettre en place, consisterait à s’inspirer de la pratique américaine qui veut qu’automatiquement un client qui paye dans les 10 jours reçoit un escompte de 2 % ; à défaut, il paie à 30 jours. Ce qui montre qu’avec un peu de temps de préparation, et les logiciels en place de nos jours, on peut parfaitement faire face à des délais de paiement substantiellement plus courts. De surcroît, de façon intelligente, le client qui ne saisit pas le rabais de 2 % pour un paiement à 10 jours signale sa piètre liquidité financière, ce qui est toujours une information intéressante pour un fournisseur[10].
Le temps est venu, là aussi, de bouger et d’abandonner les reliques d’une époque révolue.
[1] Ces chiffres, et ceux cités plus loin, proviennent de l’étude annuelle de la Banque de France publiée dans son Bulletin de janvier-février 2020, n° 227/6, et repris dans le chapitre 12 du Vernimmen.
[2] Selon les statistiques de l’INSEE mises à jour chaque année et présentées au début du chapitre 51 du Vernimmen consacré à la gestion du besoin en fonds de roulement.
[3] Contrairement à ceux de la Banque de France, dont les chiffres proviennent de l’exploitation statistique de tous les bilans des entreprises avec un chiffre d’affaires supérieur à 0,75 M€, ceux de Intrum résultent d’enquêtes sur une base déclarative et sur un périmètre plus petit, ce qui explique les petites différences (42 jours versus 44).
[4] 263 sanctions ont été prononcées par la DGCCRF en 2018 pour un total de 17,2 M€ d’amendes (155 et 8,6 M€ en 2017).
[5] La RATP, Huawei, Amazon, DHL, MMA IARD, Ciments Calcia, France Manche, La Poste, La Française des Jeux, notamment.
[6] 25 % des défaillances d'entreprises seraient dues à des retards de paiement, ce qui en ferait la première cause de faillite, selon Pierre Pelouzet, le médiateur des relations inter-entreprises et de l’innovation, déclaration du 21 janvier 2015.
[7] Sur RTL, le 8 avril 2019.
[8] Baromètre 2019 du cabinet ARC.
[9] A. Boileau et O. Gonzalez, « Réduire les délais de paiement de ses fournisseurs fragilise-t-il une entreprise ?», , Bloc-notes Éco, 11 octobre 2018.
[10] Refuser du 2 % sur 10 jours équivaut à refuser un placement rapportant en actuariel du 44,6 % …
Tableau : L'impôt sur les sociétés payé par les groupes du CAC 40 depuis 1999
L’impôt sur les sociétés (IS) payé par les sociétés du CAC 40[1] (en consolidé, c’est-à-dire au niveau mondial, et donc pas seulement perçu par l’État français) s’élève à 31,7 Md€ en 2018, dernière année où les chiffres sont disponibles. Soit un taux d’imposition d’environ 23 % qui correspond, sans surprise, au taux moyen des taux d’impôt sur les sociétés au niveau mondial[2]. En effet, il y a belle lurette que les groupes français ou d’origine française, membres du CAC 40, ont un champ d’activité qui va bien au-delà du territoire qui les a vu naître. Rappelons d’ailleurs que les grands groupes français sont probablement les plus internationaux des grands groupes européens et que leur capitalisation boursière cumulée dépasse celle des groupes allemands (alors que le PIB de l’Allemagne est supérieur de 42 % au PIB français) et anglais (niveau de PIB similaire).
Les montants retenus ne prennent en compte que l’impôt sur les sociétés et n’incluent pas les innombrables taxes (sur les salaires, les jeux, les droits d’accise, les carburants, les dépenses publicitaires, les bureaux, les parkings, etc.), cotisations (sur la valeur ajoutée, foncière des entreprises), ni les charges sociales payées par les entreprises, ni encore moins, bien évidemment, la TVA qui n’est que collectée pour le compte de l’État et payée par le consommateur final, et non les entreprises.
On peut remarquer que le montant de l’impôt sur les sociétés des groupes du CAC 40 est en croissance plus ou moins régulière, en moyenne de 5 % par an (soit à peu près autant que l’économie mondiale sur la même période) ; et ce alors même que les taux d’impôt sur les sociétés moyens mondiaux ont baissé d’un quart sur la même période, de 32 à 24 % [3]. Ce qui veut dire implicitement que leurs résultats ont crû plus vite que ceux de l’économie mondiale. On retrouve ainsi l’idée triviale que les meilleurs font mieux que la moyenne en matière de croissance.
On remarque aussi que ces montants ne croissent pas linéairement, mais sont très liés à la conjoncture économique, et au prix du pétrole.
En effet, Total, à lui seul, a pu représenter jusqu’à 47 % des impôts payés par le CAC 40 (en 2008, alors que les prix du baril étaient au plus haut et les résultats des autres secteurs fléchissant avec l’entrée en crise). L’évolution de l’IS, hors Total, montre d’ailleurs une beaucoup plus faible volatilité.
Le CAC 40 est donc un gros contributeur au budget des États, et c’est bien normal, puisqu’il s’agit, grosso modo, des 40 groupes les plus florissants de France ! Par leurs impôts, ils rémunèrent ainsi les infrastructures au sens large du terme (équipements routiers, formation des hommes et des femmes, sécurité, etc.) mises à leur disposition.
[1] Le calcul est fait sur la base d’un échantillon constant : les entreprises constituant le CAC 40 aujourd’hui.
Recherche : Erreur sur les dividendes : les professionnels aussi !
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à l’Université de Cergy-Pontoise
Les enseignants en finance sont bien placés pour savoir que les dividendes sont mal compris du grand public. L’idée selon laquelle le dividende serait la rémunération de l’actionnaire, comme le salaire est la rémunération de l’employé, est largement répandue. Cette erreur de raisonnement, désignée dans le monde académique par l’expression dividend fallacy, peut conduire l’investisseur individuel à des comportements irrationnels.
Les professionnels de la finance (du moins les lecteurs de la Lettre Vernimmen.net[1]) savent qu’un dividende est davantage comparable à un retrait de cash au distributeur qu’à la réception d’un salaire, et que tout raisonnement fondé sur les dividendes doit prendre en compte l’effet mécanique de leur versement sur le cours de bourse.
Pourtant, deux chercheurs américains ont publié récemment un article[2] qui montre que beaucoup de fonds d’investissement, d’investisseurs institutionnels et d’analystes financiers semblent commettre la même erreur dans leur comportement d’investissement : les plus-values et les dividendes sont traités comme s’ils étaient indépendants.
Les auteurs de l’article utilisent des biais de comportement déjà largement documentés dans la littérature. Par exemple, l’effet de disposition est un comportement consistant à vendre excessivement les actions, dont la valeur a récemment augmenté, et à refuser de vendre celles dont la valeur a baissé. L’article montre que ce biais porte en fait sur le prix de l’action et non sur sa performance, ignorant les dividendes.
Pour être clair : si deux actions A et B voient leur prix passer de 5 € à 6 € sur la même période, mais que l’action A a versé 1 € de dividende (et que B n’a rien versé), alors l’effet de disposition sera observé dans les mêmes proportions sur l’action A et sur l’action B, comme si les deux actions avaient eu la même performance. Autrement dit, à l’effet de disposition (déjà connu) s’ajoute un biais lié à une séparation artificielle entre plus-value et dividende dans la mesure de la performance.
Un autre résultat spectaculaire porte sur le comportement de réinvestissement des dividendes. Les actionnaires individuels ont tendance à utiliser les dividendes reçus pour leur consommation (au lieu de les réinvestir).
Étonnamment, le réinvestissement des dividendes est aussi très rare de la part des fonds et des institutionnels. Sur une large période (entre 1980 et 2015), l’ajustement du nombre d’actions par ligne ne dépend pratiquement pas du versement ou non de dividendes. Tout se passe comme si les fonds (et les institutionnels) souhaitaient diminuer leur participation dans ces actions exactement du montant correspondant au dividende reçu. Pour les auteurs, c’est en réalité une preuve supplémentaire d’un traitement différencié entre dividendes et plus-values de la part des professionnels.
Cette erreur entraîne des conséquences négatives pour les investisseurs. La recherche de rendement sur dividende crée une pression à la hausse sur les prix des actions à fort dividende, en particulier en période de taux bas (les dividendes étant assimilés à un revenu stable). Les auteurs mesurent une perte de performance annuelle moyenne de 2,4 % pour les investisseurs qui achètent ces titres au moment où ils sont le plus demandés. Ils paient trop cher les dividendes, au détriment de la performance.
Les auteurs remarquent avec un certain humour que si la compagnie US Airways avait nommé son programme de fidélité Dividend Miles, ce n’était pas pour indiquer que ces miles seraient non pertinents ou fiscalement désavantageux, mais bien parce que les dividendes étaient largement perçus par le public comme une rémunération. La littérature académique sur les dividendes est très vaste depuis les articles fondateurs de F. Modigliani et de M. Miller[3], mais il reste du travail de pédagogie à faire !
[1] En particulier le numéro annuel de janvier dont la dernière version est consultable ici.
[2] S. M. Hartzmark et D. H. Solomon, « The dividend disconnect », Journal of Finance, vol. 74-5, 2019, p. 2153 à 2199.
Q&R : Trois questions sur la consolidation, le BFR et l'évaluation et leurs réponses
Elles ont été posées sur le site Vernimmen.net, sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen, par nos étudiants en salle de classe ou par internet dans la formation ICCF@HEC Paris.
Sur la consolidation
« La présentation des comptes consolidés en normes IFRS par intégration globale modifie la structure de l'actif et du passif en particulier les capitaux propres (CP) qui sont augmentés des CP de la société fille. Cependant, lors d'une acquisition d'une entreprise, les CP de la société mère restent inchangés en comptes consolidés alors que les CP de la société acquise aurait dû les influencer. Comment cela se justifie ? »
Il est normal, si l'acquisition est financée sans émission de capitaux propres, mais par nouvel endettement ou prélèvement sur la trésorerie de l'acheteur, que les capitaux propres comptables de l'acheteur ne varient pas du fait de l'acquisition ainsi financée. Sinon, on aurait trouvé le moyen de créer des capitaux propres à partir de rien : sympathique mais irréaliste.
En fait, ce qu'il faut bien voir et ne pas perdre de vue, c'est que si la première étape du processus de consolidation par intégration globale conduit à ajouter les capitaux propres de la filiale acquise à ceux de la société mère, c'est pour dans un second temps retrancher le prix d'acquisition des titres de la nouvelle filiale des capitaux propres de la mère, afin de les faire disparaître au bilan consolidé. Dès lors que prix d'acquisition et capitaux propres comptables de la nouvelle filiale coïncident, les capitaux propres du groupe ne sont pas modifiés. Il en est de même lorsqu'il y a un écart qui se résout par du goodwill ; sur ce dernier point, voir le chapitre 7 du Vernimmen 2020.
Sur le BFR
« Considérant l'investissement comme une privation immédiate de liquidité dans l'attente d'une liquidité plus importante dans le futur, comment cette idée s’applique-t-elle au BFR ? En l’occurrence, une créance gelée dans le poste client (élément du BFR) peut-elle générer plus de liquidité que le montant de la créance affichée ? »
Cela est plus simple à comprendre avec un exemple. Vous achetez 100 de matières premières le mois 1 que vous payez comptant. Vous transformez ces matières premières le mois 2 avec 60 de frais de personnel que vous payez comptant, et vous vendez le mois 3 pour 180 qui vous sont réglés le mois 4.
Vous avec donc dû investir 100 le premier mois, investissement porté à 160 le second mois, et vous touchez 180 le 4e mois. Le BFR correspond donc bien, dans cet exemple, à une renonciation immédiate à une liquidité imminente au profit d’une liquidité supérieure et ultérieure. Ce qui vous empêchait de voir cette situation était le niveau trop fin de votre analyse, au niveau des composantes du BFR et non au niveau global de celui-ci.
Sur l’évaluation
« Pourriez-vous me dire comment déterminer le taux d'actualisation de la VAN ? Est-ce le coût des capitaux propres ou le coût du capital ? »
Le choix du taux d’actualisation à utiliser dans le calcul d’une valeur actuelle nette dépend de la nature des flux que vous allez actualiser : des flux de trésorerie disponible ou des dividendes.
Dans la mesure où vous voulez actualiser des flux de trésorerie disponible, le taux d’actualisation que l’on utilise est nécessairement le coût du capital (coût moyen pondéré du capital) et non pas le coût des capitaux propres. En effet, les flux de trésorerie disponible, qui reviennent à la communauté des actionnaires et des prêteurs, ne peuvent pas être actualisés au coût des capitaux propres, qui ne concerne que les actionnaires. Ils ne peuvent l’être qu’au coût moyen pondéré du capital qui est le taux commun à la communauté des actionnaires et des prêteurs.
Si maintenant vous calculez la valeur actuelle nette d’un flux de dividendes pour déterminer la valeur d’une action en utilisant une approche directe, le taux d’actualisation à utiliser est le coût des capitaux propres, puisque les flux que vous actualisez (les dividendes) reviennent aux actionnaires et uniquement à eux.
Autre : FORMATIONS
Voici les dates des prochaines formations que nous avons conçues pour Francis Lefebvre Formation, avec des enseignants que nous avons sélectionnés pour l’excellence de leur pédagogie :
- « Ingénierie financière » le 12 mars et le 16 octobre 2020, à Paris.
- « Définir la structure de financement adaptée à votre entreprise » le 4 mai et le 17 novembre 2020, à Paris.
- « Les mécanismes du LBO et l’environnement du Private Equity » le 23 avril et le 22 octobre 2020, à Paris.
- « Gestion de la trésorerie et des risques financiers : quelles priorités en 2020 » le 23 mars et le 30 septembre 2020, à Paris.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière.
IBM
Un remplaçant vient d'être trouvé à sa présidente qui partira dans quelques mois, âgée de 62 ans(âge moyen des dirigeants de IBM quand ils quittent volontairement l'entreprise). IBM est l'entreprise qui se cache derrière le pseudonyme E10 du cas d'analyse financière qui est disponible, parmi les cas que nous soumettons à votre sagacité, sur le site Vernimmen.net[2] et sur lequel vous pouvez exercer vos talents.
Face à une baisse régulière de son chiffre d'affaires, IBM a investi dans de nouvelles activités et dans de nombreuses acquisitions sans pour autant, à ce jour, retrouver la croissance (-3 % en 2019). Pour faire patienter ses actionnaires, IBM a eu une politique de versements de dividendes et de rachats d'actions, bien au-delà de ses flux de trésorerie disponible, conduisant l'endettement bancaire et financier net (54 Md$ fin 2019) à augmenter très significativement à 3 fois l'EBE 2019.
L'annonce du départ de la présidente a été salué par une progression du cours de bourse de 5,1 %, que l'on peut difficilement prendre pour autre chose qu'un soulagement, d'autant que le marché baissait de 2,1 % ce même jour. Il est vrai que durant son mandat, le cours de IBM a reculé de 23 %, contre une progression de 131 % pour le Dow Jones.
Ceux d'entre vous qui ont un peu de cheveux blancs ou aiment l'histoire économique se rappellent que dans les années 1970 et 1980, IBM était la première capitalisation boursière mondiale. On en est très loin aujourd’hui, avec seulement 130 Md€, soit le dixième d’Apple. Sic transit gloria mundi.
BlackRock et la transition énergétique
Elle n’est simple pour personne, y compris pour le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, BlackRock (7 200 Md$ d’actif sous gestion, dont 429 Md$ arrivés en 2019) qui annonce via son président dans sa lettre annuelle parue mi-janvier : « Companies, investors, and governments must prepare for a significant reallocation of capital », en raison bien sûr du changement climatique.
Rappelons qu’à ce jour la gestion passive (60 % des nouveaux encours de BlackRock en 2019) ne discrimine pas entre les entreprises vertueuses ou non en matière ESG, dès lors qu'elles font partie des principaux indices que duplique la gestion passive, et que les indices ESG sont encore peu utilisés dans ce domaine. Or, BlackRock est le plus grand gestionnaire passif du monde.
Par ailleurs, les bonnes idées du PDG de BlackRock mettent du temps à se diffuser dans son entreprise. Ainsi, un directeur financier du CAC 40 nous confiait avoir eu un rendez-vous en tête-à-tête avec le responsable durabilité de BlackRock, avant une seconde réunion avec les analystes de BlackRock suivant son secteur. Quand ces derniers sont entrés dans la pièce, ils ont demandé lequel des deux était le directeur financier, montrant ainsi qu’ils ne connaissaient pas leur propre responsable durabilité… à laquelle ils devaient donc attacher une importance somme toute limitée.
[1] Que vous pouvez consulter ici pour Facebook, et là pour LinkedIn.
[2] Et que vous trouverez en cliquant ici.