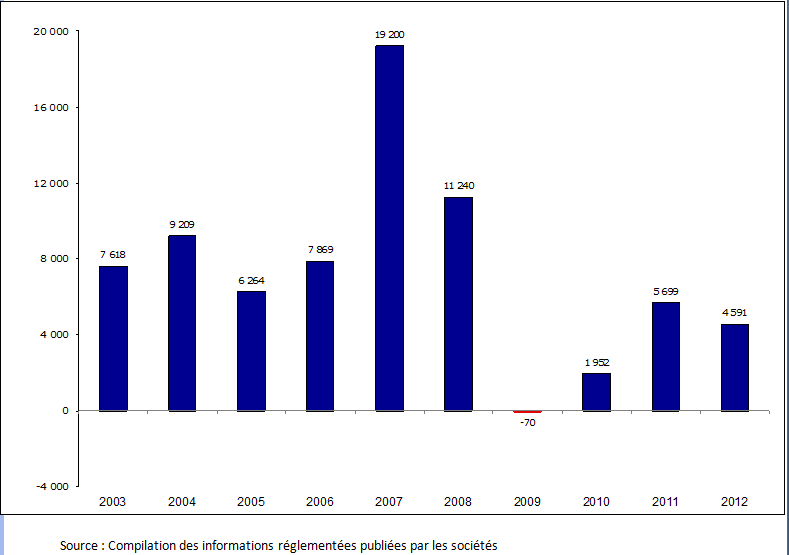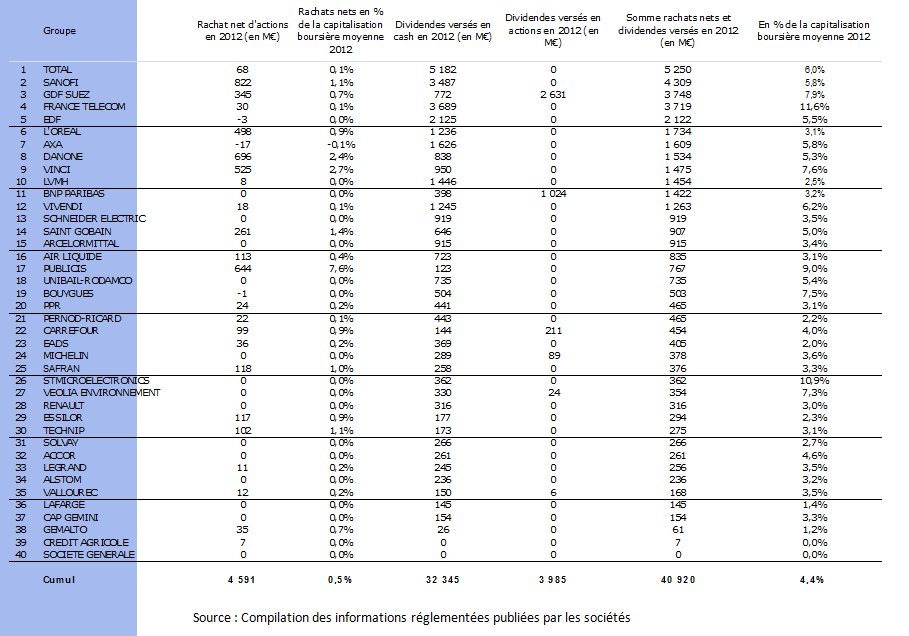La Lettre n°112 de Janvier 2013
Actualités : La Bourse joue-t-elle son rôle de financier de l'économie ?
La Bourse a principalement cinq rôles :
- Offrir une liquidité à des investisseurs qui peuvent, à un moment donné ou dans le temps céder tout ou partie des leurs actions dans une société cotée. Cette liquidité est fondamentale car une action, contrairement à un titre de dette, n’offre pas contractuellement un remboursement. La liquidité ne peut donc venir que d’une revente à un moment donné à un autre investisseur. Dès lors la possibilité d’une cotation en Bourse même dans un futur indéterminé, est un frein de moins à l’investissement en capitaux propres.
- Afficher régulièrement le prix des actifs qui y sont cotés. Que ce prix plaise ou non est un autre sujet. Il a le mérite d’exister, c’est le prix du marché et le prix auquel il est possible de céder très vite un paquet d’actions. Les alternatives permettant d’obtenir un prix plus élevé existent mais sont aléatoires. Elles prennent du temps et peuvent n’être que partielles : vente du contrôle, sortie de l’investisseur minoritaire par rachat d’actions, attente de jours meilleurs.
- Donner un brevet de respectabilité aux entreprises qui sont cotées car toutes ne sont pas cotées, il faut respecter des conditions. Le régulateur boursier s’assure que des vérifications ont été faites au moment de l’introduction en bourse sur la situation de l’entreprise et en fait régulièrement par la suite, ce qui est loin d’être sans coût pour les émetteurs surtout quand les IFRS s’en mêlent[1]. Seules normalement les meilleures entreprises sont donc susceptibles d’être cotées.
- Offrir une protection aux actionnaires minoritaires car les règles boursières concernant l’information et les changements de contrôle offrent souvent de bien meilleures protections que celle permises un pacte d’actionnaires.
- et enfin faciliter le financement par capitaux propres, car la cotation qui donne un prix à l’action et une liquidité favorise considérablement la levée de fonds : un prix de référence existe aux yeux de tous et à tout moment une action achetée peut être revendue. La bourse est de fait un moyen pour l’entreprise de toucher un nombre beaucoup plus important d’investisseurs potentiels et donc théoriquement de lever plus de fonds.
C’est justement sur ce dernier point que la Bourse est critiquée. Le montant des dividendes versés et des rachats d’actions est supérieur, et de loin, à celui des augmentations de capital, le nombre des sociétés qui s’introduisent en Bourse s’est réduit, en particulier en France, comme une peau de chagrin, le nombre de radiations volontaires par retrait de bourse[2] ou involontaire suite à un changement de contrôle est largement supérieur à celui des introductions.
Tout ceci est statistiquement vrai, mais nous semble relever financièrement d’un effet d’optique.
Les sociétés cotées qui versent des dividendes copieux ou procèdent à des rachats d’actions ne sont pas les mêmes que celles qui font des augmentations de capital. Il est normal que des sociétés arrivées à maturité procèdent à des rachats d’actions et/ou à des versements de dividendes copieux afin de restituer à leurs actionnaires des capitaux propres dont elles n’ont plus ou pas l’usage. A l’inverse, il est normal que des sociétés en forte croissance ou en restructuration sollicitent auprès des investisseurs de nouveaux capitaux propres. Le fait que le solde des appels aux actionnaires moins les restitutions aux actionnaires soit négatif ne change rien à l’affaire : les entreprises cotées qui ont eu besoin de capitaux propres ont pu en trouver en bourse comme Arcelor Mittal (4 Md$), Peugeot (1 Md€) ou Technicolor (190 M€) pour se restructurer, Alstom (350 M€) ou CGG Veritas (414 M€) ou Vranken Pommery (42 M€) pour financer des opérations de croissance externe ; Energie Partagée (3 M€) ou GL Events (70 M€) pour financer des investissements ; en se limitant à des opérations datant de moins d’un an.
Par ailleurs, dans ces calculs on oublie facilement les augmentations de capital cachées : dividendes payés en actions (4,6 Md€ en 2012 pour les entreprises du CAC 40, voir l’article suivant), conversion d’obligations convertibles en actions, exercice d’options de souscription accordées aux salariés.
Il ne faut cependant pas se leurrer. En Europe au moins, l’année 2012 n’a pas été très propice à des augmentations de capital : cours bas qui peuvent poser des problèmes de dilution du contrôle pour des actionnaires ne pouvant pas souscrire pour leur part[3], structure financière saine pour de nombreuses entreprises cotées qui n’ont pas besoin de capitaux propres supplémentaires, peu d’opérations de croissance externe à financer, flux de trésorerie disponible élevés et investissements industriels peu dynamique dans une zone économique flirtant avec la récession.Mais il n’y a pas que la France et l’Europe dans le monde. Ainsi l’AMF estime à 270 Md$ le montant des augmentations de capital dans le monde pour les neufs premiers mois de 2012 contre 280 pour l’ensemble de 2011 et 350 en 2010.
Enfin et surtout, il ne faut pas oublier qu’il y a les flux mais aussi les stocks. Les flux ce sont les augmentations de capital, les stocks la masse de capitaux propres comptables apportés depuis la création des entreprises par les actionnaires non contrôlant ou laissés à leur disposition sous forme de bénéfices non distribués. En Europe compte tenu d’une capitalisation boursière des sociétés de l’ordre de 11.000 Md€, d’un PBR bien pesé de 1,5 et flottant moyen pondéré de 80%, on peut estimer ce stock d’investissements financés par la Bourse à environ 6.000 Md€ en montant comptable donc historique.
Certains de ces capitaux propres ont été apportés à l’entreprise lorsqu’elle était cotée, d’autres lorsqu’elle ne l’était pas encore. Mai en tout état de cause le relais a été pris à un moment donné pour de l’ordre de 6.000 Md€ en Europe par des investisseurs actifs en Bourse car ils savaient qu’ils pourraient revendre les titres qu’ils achetaient à d’autres investisseurs qui eux aussi savaient qu’ils pourraient en cas de besoin les revendre à d’autres investisseurs qui eux aussi. . . Pour 6 000 Md€, des actifs sont financés et portés par des investisseurs qui, individuellement, peuvent changer rapidement mais qui seront toujours remplacés, de sorte que collectivement ils et la Bourse portent ces actifs. L’oublier et dire que la Bourse ne finance plus les entreprises comme on l’entend d’ici et de là, c’est faire l’impasse sur 6.000 Md€ en Europe. 6.000 Md€, c’est 11 fois le montant des encours de crédits aux entreprises du monde entier accordés par la plus grosse banque européenne dans ce domaine (BNP Paribas). Ce n’est donc pas rien.
Il y a une corrélation forte en la vigueur d’un marché boursier, c’est-à-dire du public equity et celle du private equity, le monde du non coté. C’est un mécanisme vertueux qui s’auto-entretient. Dans certains pays tout créateur d’une nouvelle entreprise rêve d’atteindre la consécration que matérialise l’introduction en Bourse. Il n’a pas de peine à trouver des investisseurs en capital risque si son projet tient la route car ils savent que si le succès est au rendez-vous, leur investissement pourra trouver sa liquidité sur le marché boursier.
Dans d’autres pays, cela est beaucoup plus difficile car culturellement et fiscalement l’environnement n’est guère favorable à la prise de risques par capitaux propres. La Bourse est moins développée, moins dynamique et les entrepreneurs ont plus de mal à trouver des financements en capital risque. On créé alors moins d’entreprises et elles arrivent moins facilement au stade de l’introduction en Bourse.
On ne saurait trop insister sur les effets positifs indirects d’une Bourse dynamique sur le financement en capitaux propres de l’économie. Stade ultime de la liquidité, elle bénéfice au monde du non coté qui un jour ou l’autre l’utilisera et qui, en attendant, peut être plus actif car plus confiant dans sa liquidité à terme grâce à elle.
On terminera sur un clin d’œil. Les groupes dont la structure juridique ne permet pas la cotation en Bourse (les mutualistes) ont le plus souvent une ou plusieurs filiales cotées qui leur sert de pompe à financement en capitaux propres : Natixis pour BPCE, CASA pour le Crédit Agricole ou Vilmorin pour Limagrain. Quant à ceux qui ne veulent pas venir en Bourse, ils organisent souvent leur propre bourse interne comme le groupe Mulliez.
[1] En France, les sociétés non cotées établissent leurs comptes en normes françaises mais celles cotées sur Euronext doivent les publier en normes IFRS et celles sur Alternext ont le choix.
[2]Pour plus de détails, voir le chapitre 48 du Vernimmen
[3]Pour plus de détails, voir le chapitre 43 du Vernimmen 2013
Tableau : Rachats d'actions et dividendes en France en 2012
Avec 4,6 Md€ de rachats d’actions en 2012, les entreprises du CAC 40 ont réduit en 2012 de 20% les restitutions de liquidités sous cette forme à leur actionnaires, à charge pour eux de les investir auprès de sociétés qui ont besoin de capitaux propres. Ceci correspond bien à la nature totalement discrétionnaire de cette forme de distribution de liquidités aux actionnaires qui peut être arrêtée à tout moment[1].
Ce n’est donc pas en soi une bonne ou une mauvaise nouvelle. C’est un résidu de la conjoncture et vu son niveau actuel on reste, sans surprise, loin du plus haut de 2007 (19,2 Md€) et au troisième plus bas niveau sur les 10 dernières années.
12 groupes ont procédé à des rachats d’actions significatifs en 2012 contre 17 en 2011, en profitant de niveaux de cours perçus alors comme bas au premier semestre et créant autant d’opportunités pour neutraliser la dilution liée à la création récente de titres (Sanofi, le leader français de cette année avec plus de 800 M€) ou pour faciliter la sortie d’un actionnaire minoritaire et renforcer à bon compte la position d’un actionnaire principal mais loin d’être majoritaire (Publicis, qui est le champion cette année des rachats d’actions en pourcentage avec 7,6 % du capital et 644 M€).
Contrairement à l’an passé, aucun groupe du CAC 40 n’a procédé à des cessions significatives de titres auto détenus, reflet dans la plupart des cas d’une bonne situation financière des membres de l’élite françaises des groupes cotés comme, a contrario, Alcatel et Peugeot, qui ont quitté le CAC 40 et donc le périmètre de cette étude, peuvent en témoigner.
Coté dividendes, 40,9 Md€ ont été versés en 2012, soit une progression de 5% par rapport à l’an dernier. Sur cette somme, 10 % ont été versés en actions dont les deux tiers par GDF Suez et le quart par BNP Paribas. Les chiffres de cette année illustrent bien le coté roulette russe des dividendes en actions : là où GDF Suez, BNP Paribas et Carrefour ont convaincu plus de 60% de leurs actionnaires d’opter pour le dividende en actions, Vallourec, Véolia Environnement ou Michelin n’en ont convaincu que moins du quart. Non en raison de la pertinence de la stratégie suivie ou de la force de conviction des dirigeants, mais simplement en fonction de l’évolution à la hausse ou non du cours de bourse pendant la période de choix des actionnaires.
Rappelons en effet que le paiement du dividende en action s’apparente à une option d’achat à prix fixe pendant la durée laissée à l’actionnaire pour prendre sa décision. Comme l’an passé le trio de tête des versements de dividendes représente de l’ordre du tiers des dividendes versés, il est composé de Total, Sanofi et GDF Suez. Si on ajoute EDF et France Télécom, on atteint avec 5 groupes presque 50 % des dividendes. Comme quoi, même au sein du CAC 40, les inégalités sont criantes !
Crédit Agricole et Société Générale se retrouvent seuls cette année à ne pas verser de dividendes, Alcatel et Peugeot ayant quitté le CAC 40. Cela n’est pas dû à leurs mauvais résultats, mais à leur volonté de renforcer de façon certaine leurs capitaux propres pour des raisons prudentielles (Bâle III), ce que l’option du dividende en actions ne permet pas.
Le taux de distribution pour les entreprises du CAC 40 qui ont versé un dividende est de 54 %, au dessus de sa moyenne historique de 45%. Nous anticipons qu’il pourrait baisser un peu en 2013, car un certain nombre de gros payeurs de dividendes dans des secteurs à maturité ont atteint un niveau de taux de distribution trop élevé compte tenu de leurs investissements à venir et de leurs objectifs de structure financière.
France Télécom a déjà confirmé le principe d’une baisse de son dividende (de 43%) et d’autres groupes pourraient le suivre dans cette voie (GDF Suez ? EDF ?). Rappelons[2] à notre lecteur qui serait tenté de leur jeter la pierre que le seul critère financièrement pertinent d’appréciation d’une politique de distribution est le taux de rentabilité marginale des fonds réinvestis. Le dividende n’est ni une idole ni une icône ! A contrario, le Crédit Agricole et Société Générale pourrait reprendre en 2013 le paiement d’un dividende, mais probablement pas avec un taux de distribution de 50%.
[1] Pour plus de détails, voir le chapitre 42 du Vernimmen 2013
[2] Pour plus de détails, voir le chapitre 41 du Vernimmen 2013
Recherche : La création de valeur des LBOs secondaires
Parmi les bons mémoires de recherche réalisés l’an passé par des étudiants figurait celui de François Evers (HEC Paris). En voici le résumé, sachant que le texte intégral se trouve sur la page mémoires de recherche du site vernimmen.net
L’étude de F.Evers a pour objet d’analyser la création de valeur ainsi que les leviers des acquisitions avec effet de levier (LBO) secondaires (SBO) en France au cours de la période de l’après-crise financière. Deux ensembles de données sont utilisés : d’une part un échantillon unique regroupant 438 LBO menés par des fonds de private equity (PE) en France entre 2007 et 2011 et d’autre part un échantillon de 139 sorties du capital par ce même type de fonds pour la même période. La sortie du capital via SBO a été la voie préférée des fonds de PE en 2011: 52% des investissements en PE ont été sortis de cette façon.
Les SBO ont commencé à se multiplier au cours des années 2000 et depuis ils ont attiré de plus en plus l’attention des chercheurs. Si la recherche accepte, en général, trois leviers de création de valeur lors des LBO, à savoir la valorisation, l’optimisation opérationnelle et l’effet de levier, elle reste plutôt sceptique à l’égard du potentiel de création de valeur lors des SBO. Les SBO seraient plus chers que les LBO en raison de l’hypothèse du vendeur qualifié. De plus, l’essentiel de l’optimisation opérationnelle aurait déjà été réalisé lors des LBO. Par conséquent, il est souvent argumenté que le seul véritable levier de création de valeur lors des SBO consiste dans l’utilisation accrue de l’effet de levier. De plus, d’autres leviers, à part l’objectif traditionnel de la création de valeur, semblent encore jouer un rôle lors des SBO. En effet, les conditions de marché, tel que le coût de financement réduit avant la crise financière, sont souvent considérées comme primordiales. Le présent travail constitue l’une des toutes premières études des leviers des SBO pour la période de l’après-crise financière. En outre, il s’agit de la première étude qui se concentre exclusivement sur le marché français des SBO.
F. Evers montre que les SBO n’influencent pas significativement la valorisation des acquisitions. Le fait que les SBO soient en moyenne plus importants que les LBO et qu’ils soient plus fréquents dans des industries à multiples boursiers élevés semble plutôt affecter la différence de valorisation. De plus, si les fonds de PE sont plus aptes à augmenter les revenus des entreprises sous LBO que sous SBO, l’inverse est le cas pour l’optimisation opérationnelle. Une explication serait le phénomène de la sélection naturelle. Ainsi les entreprises sélectionnées pour un SBO ont déjà géré avec succès au moins un LBO précédent et la direction et les employés pourraient être plus aptes à réaliser des gains opérationnels. En combinant ces résultats, F. Evers conclue que les fonds de PE se concentrent sur l’expansion des activités d’entreprises plus petites et jeunes lors des LBO et sur l’optimisation opérationnelle d’entreprises plus importantes et matures dans le cas des SBO.
Finalement, les fonds de PE ne semblent pas favoriser de façon significative l’effet de levier lors d’un SBO plutôt que lors d’un LBO. Dans l’ensemble, F. Evers montre que tout le potentiel de création de valeur n’est pas réalisé lors des LBO de premier tour et qu’il reste de la marge pour la création de valeur au cours des tours ultérieurs.
Par ailleurs, il confirme l’existence d’autres leviers dans l’émergence récente des SBO. F. Evers montre qu’une sortie via SBO n’est pas seulement liée négativement à des marchés IPO actifs et au coût du financement, mais également positivement au capital engagé non tiré de l’industrie du PE et à la pression du fonds sortant de monétiser son investissement.
Finalement, F. Evers ne trouve pas de preuve concluante que la réputation du fonds de PE sortant ou la profitabilité de l’entreprise cible aient un impact significatif sur la probabilité d’une sortie de capital via SBO.
La contribution principale de la présente étude consiste dans le résultat que les SBO ne sont pas seulement motivés par les conditions macroéconomiques des marchés IPO et de la dette, mais également par la maximisation de profit microéconomique, c’est-à-dire l’objectif de la création de valeur. D’autre part il s’avère que les conditions structurelles de l’industrie du PE, par exemple la pression du fonds sortant de monétiser son investissement et le montant du capital engagé non tiré, jouent également un rôle non négligeable.
Q&R : Pourquoi les variations de stocks de produits finis apparaissent-elles en produits dans le compte de résultat ?
Notons tout d’abord que les variations de stock de produits finis n'apparaissent que dans le compte de résultat par nature qui classe les charges en frais de personnel, dotations aux amortissements, achats de matières premières, etc. Elles n'apparaissent pas dans le compte de résultat présenté par fonction où apparaissent des coûts des ventes, des frais commerciaux, des frais administratifs, etc. [1]
Le compte de résultat par nature enregistre les charges de l'exercice que celles-ci se rattachent ou non à des produits ou à des services vendus au cours de cet exercice. On est donc dans une logique de production et non de ventes.
Mais ne nous trompons pas, le résultat d'exploitation ou le résultat net donné par le format par nature correspond bien, comme il se doit, à la différence entre le chiffre d'affaires et la totalité des coûts directs et indirects supportés pour réaliser ce chiffre d'affaires.
Comment fait-on alors la réconciliation entre des charges enregistrées au compte de résultat quand elles sont contractées, indépendamment des ventes, et un résultat qui ne tient compte que des charges rattachables directement ou indirectement aux ventes de l'exercice ?
Par la variation des stocks de matières premières, encours de production et produits finis.
En effet, si on enregistre dans le compte de résultat par nature les achats de matières premières, la présence de la variation des stocks de matières premières qui vient en négatif juste en dessous fait apparaitre en global, non les achats, mais la consommation de matières premières de l'exercice. On se rapproche alors des consommations de matières incluses dans les produits vendus au cours de l'exercice, mais on n'y est pas encore tout à fait. En effet, si l'entreprise a stocké plus de produits finis qu'elle n'a déstocké dans l'exercice ou si elle a moins stocké de produits finis qu'elle n'en a déstocké, il y a alors un écart résiduel qui peut ne pas être négligeable.
Le correctif ultime est la variation des stocks de produits finis. Quand elle figure en positif en produits en dessous des ventes, cela veut dire que l'entreprise a plus produit durant l'exercice qu'elle n'a vendu. Comme un stock de produits finis est valorisé comme la somme des coûts de production qui l'ont emmené à son état actuel, il contient en autres les coûts de la matière première qu'il a nécessité.
Autrement dit en mettant les variations des stocks de produits finis en produits, c'est comme si on les mettait en négatif de la consommation de matière première pour obtenir, in fine, la seule consommation de matière première nécessitée pour produire les produits vendus dans l'exercice. En effet, accroitre les produits ou réduire les charges du même montant n'a pas d'impact sur le résultat qui en est le solde.
Il en est de même par exemple des frais de personnel qui sont enregistrés comme une charge de l'exercice même si une partie du travail a servi à fabriquer des produits qui seront vendus l'an prochain. Mais ce n'est pas grave car cette partie va se retrouver dans le stock de produits finis à la fin de l'exercice et donc dans les variations de stocks de produits finis qui viendront minorer les charges apparentes dans la détermination du résultat de l'exercice.
Cela serait pédagogiquement peut être plus simple de les mettre en moins des charges, et non de les faire apparaitre en produits, afin de bien faire comprendre qu'il ne s'agit pas de produits comme un chiffre d'affaires mais de charges "comptées" en trop. Mais c'est ainsi.
[1] Pour plus de détails sur ces différentes présentations, voir le chapitre 3 du Vernimmen 2013