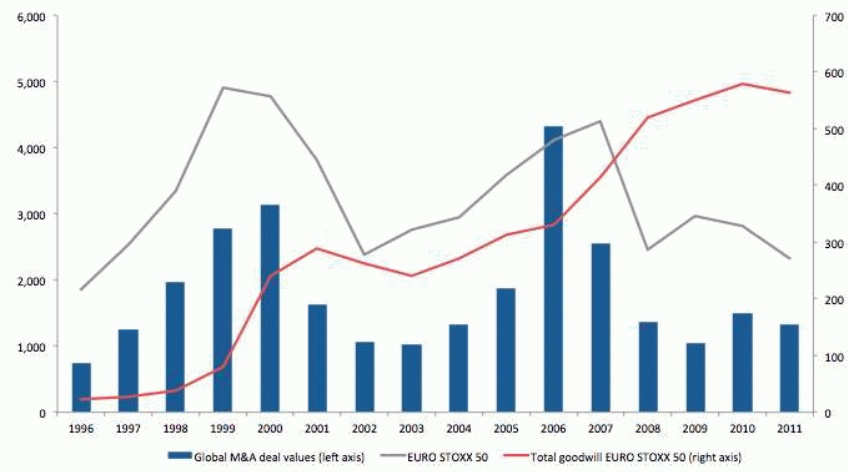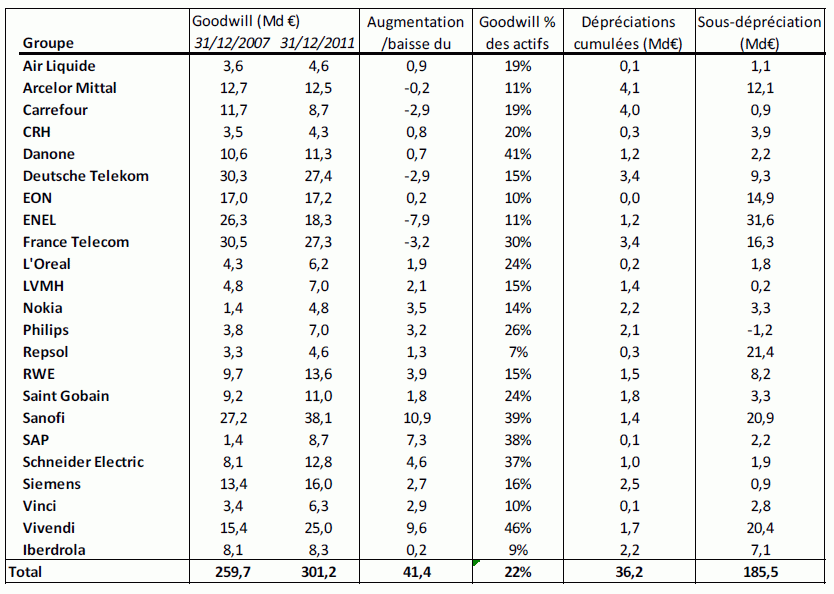La Lettre n°115 de Mai - Juin 2013
Actualités : Le manque de dépréciation du goodwill: Etude sur la situation des grands groupes européens
Par Claes Christiansen
Les intérêts du management et des actionnaires sur la comptabilisation du goodwill ne sont pas nécessairement alignés. L’annonce par un groupe d’une dépréciation importante de son goodwill est souvent perçue comme la constatation d’erreurs passées en matière de stratégie d’acquisition. Il parait alors naturel pour les dirigeants d’essayer d’éviter ou de différer les dépréciations du goodwill afin de protéger leur propre réputation (… et peut-être au passage leur rémunération).
La perspective des actionnaires est sensiblement différente, ils valorisent la justesse du reporting financier, justesse au sens de mesure pertinente et non de ric-rac. Le principe comptable de prudence dicte que lorsque la valeur d’un actif tombe en dessous de sa valeur comptable historique, celui-ci doit être déprécié. Si ce principe était parfaitement appliqué, les actionnaires pourraient considérer les capitaux propres comme un minimum de la valeur des capitaux propres. De plus, les dépréciations du goodwill étant de nature exceptionnelle et n’ayant pas d’impact cash, elles ne devraient pas avoir d’implications en termes de valorisation des capitaux propres. Tout pousse alors l’actionnaire à exiger du management une objectivité sur le montant du goodwill.
Notons néanmoins que la survalorisation potentielle du goodwill dans les comptes a un impact sur les prêteurs pour qui le montant des capitaux propres est fréquemment retenu pour évaluer la situation financière de la société et sa capacité à emprunter. Dans cette optique, la sous-dépréciation du goodwill pourrait également avoir pour but pour les managers de conserver de la flexibilité financière.
Résultats de l’étude
Le simple constat que les dépréciations du goodwill sont très largement déconnectées des mouvements sur les marches boursiers nous a invité à réaliser une petite étude. En effet, un raisonnement simple amènerait naturellement à conclure à l’inverse de ce constat : si en moyenne la valeur de l’ensemble des actifs baisse (baisse des indices boursiers), la valeur des actifs acquis par les groupes dans le passé devrait également baisser et tôt ou tard, une dépréciation du goodwill devrait donc être passée.
Le graphique ci-dessous montre que dans les 25 dernières années, le marché action a subi deux cycles (deux hausses importantes suivies de deux baisses), le marché des fusions et acquisitions a subi les mêmes cycles, malgré cela, le goodwill des groupes de l’Eurostoxx 50 a crû presque continuellement. A première vue, on pourrait donc penser que les goodwills enregistrés dans les années 1999-2001 et 2006-2008 n’avaient jamais été revus à la baisse par ces groupes.
L’étude vise donc à tester si les processus (y compris la revue par les auditeurs externes) pour s’assurer de la pertinence du reporting comptable a permis une comptabilisation correcte des dépréciations du goodwill… ou pas.
En se focalisant sur les sociétés ayant un niveau significatif de goodwill (en proportion de leur total d’actif), l’étude met en évidence tout d’abord le montant de dépréciation du goodwill par les sociétés de l’Eurostoxx 50 entre 2007 et 2011. Puis, sur la base de l’évolution des price-to-book ratios, un modèle simple a été développé pour mesurer le montant de dépréciation que ces sociétés auraient dû passer sur la même période.
Ce calcul a permis de conclure que 23 des 50 groupes ont de manière significative déprécié insuffisamment le goodwill. Selon notre modèle ces groupes auraient dû réaliser 185 milliards d’euro de plus de dépréciation, soit 8 milliards d’euros par groupe en moyenne ! Ce montant représente 22% de leur total d’actif. 87% de ce manque de dépréciation est concentré sur 10 groupes, 60% sur les 5 premiers « fautifs ». L’étude montre également (de manière peu surprenante) qu’aucun groupe n’a de façon significative sur-déprécié son goodwill.
NB : La présence de Sanofi pourrait paraître surprenante pour le lecteur qui a en tête que son cours de bourse est au plus haut historique. Mais le modèle s’arrête en 2011, le calcul actualisé à aujourd’hui donnerait pour cette société un résultat certainement sensiblement différent.
Afin de mieux comprendre les raisons qui ont guidé les managements à limiter fortement les dépréciations du goodwill nous avons cherché à mesurer la pertinence des annonces de dépréciations du goodwill pour les investisseurs. Ainsi, si la dépréciation du goodwill n’est pas pertinente pour les investisseurs, les managements ne peuvent justifier l’absence de dépréciation par leur souci de préserver la valeur. D’autres raisons les guident alors nécessairement (potentiellement la préservation de leur réputation et rémunération). Pour tester cette hypothèse, une étude d’évènement a été réalisée pour mesurer l’évolution des cours de sociétés qui ont significativement déprécié leur goodwill par rapport à des sociétés benchmark ayant fait des annonces de résultat comparables[1] sans dépréciation du goodwill. Un mois après annonce la performance des sociétés ayant réalisé un impairment était en moyenne de 3,8% plus élevé que les sociétés benchmark ; après un an la surperformance restait de 2,7%. Ces résultats laissent penser que l’annonce d’un impairment n’a pas un effet particulièrement négatif sur le cours.
Le timing des dépréciations est également intéressant à noter et tant à prouver que le manque d’impairment est certainement plus lié à des raisons personnelles du management qu’à un souci de préservation de la valeur pour l’actionnaire. Ainsi 60% des impairments ont été réalisés dans les 3 années qui ont suivi un changement de directeur général, et près de 40% dans les deux années. On peut également noter qu’aucune dépréciation n’a été réalisée par le directeur général ayant mené à bien l’acquisition…
Bien que les résultats de la recherche ne puisse pas être considérés comme totalement statistiquement significatifs (dû au nombre limité de données utilisées pour certaines analyses), l’étude montre clairement un écart entre le montant de goodwill dans le bilan des sociétés de l’Eurostoxx 50 et sa valeur réelle. L’étude conclue également à des intérêts divergents entre actionnaires et dirigeants sur cette problématique. Même si la European Securities and Market Authority semble avoir pris conscience de ce problème et exprimé son constat que « les sociétés cotées semblent adopter une vision trop optimiste de la valeur des acquisitions réalisées alors que les marches étaient nettement plus hauts »[2], les groupes ne semblent pas changer de politique. Les 5 premiers groupes qui représentaient 60% de la sous-dépréciation, n’ont déprécié que pour 6,3 milliards d’euros en 2012 soit moins de 6% de la sous-dépréciation.
Nous doutons fortement qu’une nouvelle rédaction des règles comptables de dépréciation du goodwill permette de résoudre ce problème. Mais nous espérons et sommes convaincus, que sur le long terme, les investisseurs valoriseront les managements sensés et crédibles plutôt que ceux qui essaient de masquer l’évidence.
* * *
Ce travail est disponible comme une cinquantaine d’autres écrits par nos étudiants depuis 2006 sur le site vernimmen.net en cliquant sur meilleurs mémoires de recherche.
[1] C’est à dire avec le même écart par rapport au consensus de marché
[2] “that listed companies were taking an excessively optimistic view of the value of takeovers agreed in more buoyant times” Jones, A.: EU groups face questions over goodwill, Financial Times, January, 2013.
Tableau : Part des dettes bancaires et des emprunts obligataires dans le financement des grandes entreprises
La part des emprunts obligataires dans les financements des grandes entreprises (plus de 500 M€ de chiffre d’affaires) dépend largement des spécificités nationales. Ainsi le financement obligataire est la norme aux Etats-Unis alors que les entreprises espagnoles se financent essentiellement auprès des établissements bancaires.
Plus étonnamment, ce graphe montre une prépondérance des financements obligataires en France alors qu’au Royaume-Uni, les financements bancaires sont majoritaires pour ce type d’entreprises.
a
Recherche : Fiscalité des actionnaires et investissement
avec la collaboration de Simon Gueguen - Enseignant-chercheur à Paris Dauphine
La distribution de cash aux actionnaires, qu’elle se fasse sous forme de dividendes ou de rachats d’actions, est soumise à l’impôt. Cette imposition augmente le coût des capitaux propres des entreprises qui se financent par augmentation de capital, par opposition à celles qui ont recours à l’autofinancement. Une variation des taux d’imposition affecte donc différemment les entreprises selon qu’elles disposent ou non du cash nécessaire pour le financement interne de leurs investissements. C’est ce que vérifie, à partir d’un échantillon de 7661 entreprises dans 25 pays différents sur la période 1990-2008, une étude publiée très récemment[1].
L’étude utilise une large base de données fiscales construite pour un article précédent[2]. Cette longue période et le grand nombre de pays couverts permettent de capter 15 réformes fiscales majeures et 67 modifications plus modestes, concernant la fiscalité des dividendes et des plus-values (pour les rachats d’actions). Ils mesurent le niveau de cash disponible pour l’autofinancement de trois manières : les flux de trésorerie générés par l’activité, la trésorerie disponible, et l’excédent brut d’exploitation (EBITDA), chaque fois en proportion du total des actifs. Les résultats obtenus avec les différentes mesures[3] sont similaires et confirment à chaque fois que les variations de la fiscalité sur la distribution impactent différemment les entreprises selon leur niveau de cash disponible.
Les auteurs se sont intéressé dans un premier temps aux changements de la fiscalité ayant entraîné une hausse ou une baisse du taux d’imposition de la distribution d’au moins trois points de pourcentage. Et ils ont classé les entreprises en quintiles suivant leurs flux de trésorerie. En cas de baisse de l’imposition, les entreprises à fort flux de trésorerie continuent d’investir davantage que celles à faible flux, mais l’écart se réduit de 31%. En cas de hausse, l’écart s’accroît de 42%. Autrement dit, lorsque la fiscalité sur la distribution s’alourdit, les entreprises qui doivent recourir au financement extérieur investissent moins. Une régression linéaire, portant sur toutes les années et toutes les entreprises de l’étude, vient confirmer cet effet. Lorsque la fiscalité augmente, les investissements effectués deviennent davantage dépendants des flux de trésorerie.
Par ailleurs, les auteurs vérifient que les augmentations de capital sont moins élevées lorsque la fiscalité sur la distribution augmente. Une hausse de 10 points de pourcentage de la fiscalité entraîne, sur l’échantillon étudié, une baisse de 9% des émissions d’actions. Ainsi, une fiscalité élevée est associée à la fois à moins d’investissement et à moins d’émissions d’actions. Dans le même temps, le levier financier des entreprises est faiblement modifié ; l’endettement ne constitue donc pas un substitue parfait aux capitaux propres, contrairement aux prédictions de Modigliani-Miller. Les entreprises qui ont recours au financement extérieur voient leur coût du capital augmenter.
Ces résultats peuvent avoir une conséquence intéressante en matière de politique économique ; une fiscalité de la distribution aux actionnaires plus élevée oriente les investissements vers les entreprises qui disposent de trésorerie, donc plutôt dans les secteurs déjà bien établis. Une fiscalité plus faible favorise les secteurs émergents.
[1] B.BACKER, M.JACOB et M.JACOB (2013), Payout taxes and the allocation of investment, Journal of Financial Economics, vol.107, pages 1 à 24.
[2] M.JACOB et J.JACOB (2013), Taxation, dividends, and share repurchases : taking evidence global, Journal of Financial and Quantitative Analysis, à paraître
[3] Les auteurs utilisent également différents indicateurs du niveau de la fiscalité (taux légal moyen, taux effectif moyen) et des investissements.
Q&R : Un euro de trésorerie d'Apple peut-il raisonnablement être valorisé pour un euro ?
Compte tenu de sa capacité phénoménale à dégager des flux de trésorerie disponible positifs, de l’ordre de 42 Md$ sur le dernier exercice (sic), d’une culture interne très forte qui ne la pousse pas à faire des acquisitions (sa plus grosse acquisition a été inférieure à 1Md$) et d‘une politique de distribution très parcimonieuse (en février 2012, Apple a annoncé vouloir reverser à ses actionnaires sur 3 ans 45 Md$), le groupe dispose fin mars 2013 d’une trésorerie nette de toute dette financière de 145 Md$.
Sous la pression de ses actionnaires, Apple a annoncé en avril vouloir leur restituer 55Md$ de plus pour porter les dividendes et rachats d’actions à 30 Md$/an pour les 3 prochaines années, dont une partie significative financés par endettement. On pourra s’étonner de voir un tel groupe s’endetter compte tenu de ses disponibilités de 145 Md$.
La réponse tient à une particularité de la fiscalité américaine qui, ignorant le régime mère-fille ou ses équivalents que l’on trouve dans la plupart des pays développés[1], taxe toute remontée de dividendes au taux normal d’impôt sur les sociétés de 35 %. Comme une partie significative des profits de Apple est réalisée et localisée hors des Etats-Unis, une partie significative de sa trésorerie y est aussi localisée ; le chiffre de 100 Md$ a été cité.
Apple, comme beaucoup d’autres multinationales américaines dans la même situation, attend que l’administration américaine « fasse des soldes » comme elle l’a déjà fait ponctuellement dans le passé, c’est-à-dire annonce que, pendant une période de temps limité, le rapatriement des bénéfices sur le sol américain ne sera taxé qu’à un taux réduit. La trésorerie non américaine serait alors rapatriée aux Etats-Unis et pourrait alors être redistribuée aux actionnaires d’Apple puisque ce groupe n’en a pas l’emploi de la plus grande partie.
En évaluation, il ne nous paraît pas raisonnable de valoriser un euro de cette trésorerie non américaine pour un euro. En effet un euro de trésorerie d’une entreprise ne vaut un euro que si l’entreprise est capable de les investir à son coût du capital ou à défaut de les rendre à ses pourvoyeurs de fonds par rachat d’actions ou dividendes ou remboursement par anticipation des dettes bancaires ou financière. La masse de la trésorerie d’Apple est telle que jamais le groupe ne trouvera dans son secteur d’activité des opportunités d’investissement rapportant son coût du capital. N’ayant pas de dettes bancaires et financières, il lui est assez difficile de les rembourser. . .
Reste la restitution aux actionnaires de cette ressource rare que sont les capitaux propres, ici oisifs car placés en trésorerie. Or là, l’absence de régime mère-fille américain fait qu’un coût fiscal significatif est alors à prévoir, 35 % en taux normal, pour que cette trésorerie quitte les coffres des filiales et atteigne ceux de la maison mère. Rappelons en effet que seule la maison mère peut verser des dividendes à ses actionnaires, même si ceux-ci proviennent des profits du groupe dans sa totalité. Il serait alors logique d’affecter d’une décote de 35 % la trésorerie non américaine d’Apple. On pourrait prendre un taux plus faible si l’on estimait probable que le Trésor américain ouvre bientôt une période de soldes avec un taux réduit.
On pourrait arguer que, tant que les dividendes remontant des filiales resteront imposés à 35 %, Apple continuera à parquer ses liquidités hors des Etats-Unis, et que cette décote est injustifiée. La situation, d’un point de vue de l’évaluation, nous paraît alors pire puisque dans le contexte actuel de taux d’intérêt très faibles, l’actualisation des produits de cette trésorerie non américaine au coût des capitaux propres d’Apple (taux de rentabilité exigé par l’investisseur sur ses capitaux propres), ferait apparaître une décote bien supérieure à 35 %. Il nous paraitrait en effet difficile d’évaluer autrement les liquidités destinées à être durablement placées à un taux d’intérêt faible sans pouvoir être remontées sans coût fiscal vers la maison-mère.
Au-delà de cet exemple contingent, l’évaluateur sera toujours bien inspiré, nous semble-t-il, de comprendre où se trouvent localisées dans les comptes consolidés les disponibilités du groupe. L’idéal bien sûr étant, comme tout directeur financier de groupe le sait, d’avoir une mère riche et des filiales pauvres plutôt que l’inverse ! Sinon il y a un coût, en gestion financière comme en valorisation.
[1] Pour plus de détails, voir le chapitre 42 du Vernimmen 2013