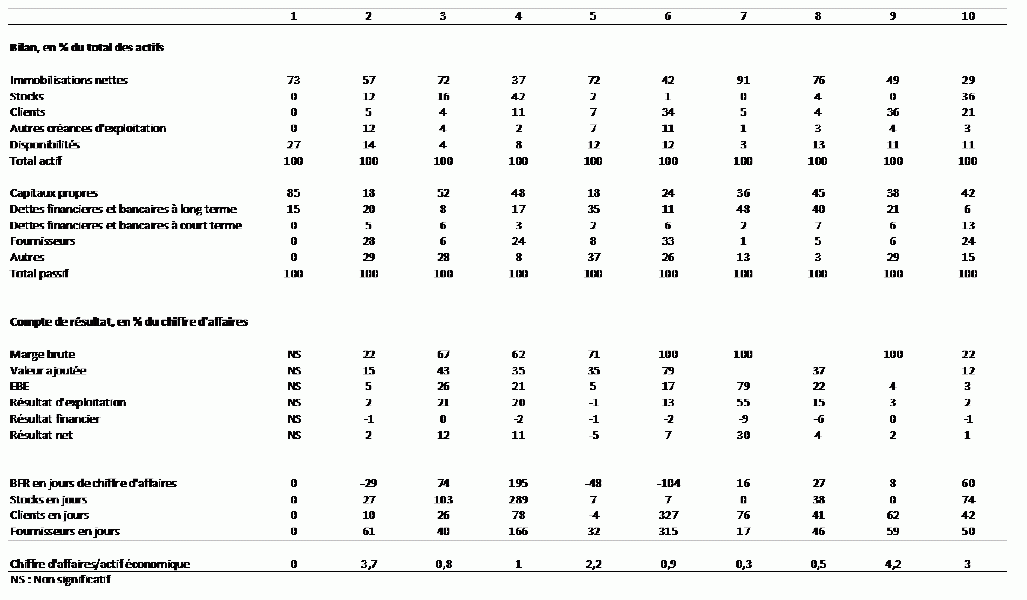La Lettre n°121 de Janvier 2014
Actualités : Les 4 erreurs à ne pas commettre pour financer une start-up
Il est extrêmement difficile de créer ex-nihilo une entreprise et de l’emmener au succès. A coté de réussites brillantes (Free, Price Minister, etc.) combien d’échecs ? Enormément. Des 293 571 entreprises créées en France en 2003, seules 48 388 (16%) étaient encore en vie en 2013. Les autres ont disparu, la plupart corps et bien. Et seulement 467 ont dépassé un chiffre d’affaires de 15 M€ par an. Une seule des entreprises créées en France entre 1995 et 2004 a rejoint le CAC 40 (Gemalto). Une seule sur plus de deux millions.
Dès lors, même si les aspects financiers de la création d’entreprise ne sont pas les importants dans ce processus, il est important de ne pas se tromper dans ce domaine.
L’un des traits caractéristiques de l’entrepreneur est l’optimisme, parfois poussé jusqu'à l’inconscience. Un autre est de se focaliser à l’extrême sur son projet. La conjugaison des deux l’amène souvent à négliger les aspects financiers de son entreprise d’autant que la finance est rarement sa matière préférée. Voici quatre erreurs financières majeures qu’un entrepreneur devra éviter dans la création et le développement de sa start-up.
1/ Croire qu’un seul tour de table sera suffisant. Les investisseurs financent rarement une start-up pour plusieurs années. Tout au plus financent-ils les besoins des 12-18 prochains mois, c’est-à-dire la réalisation de la prochaine étape, comme par exemple la mise au point d’un prototype. Si l’entrepreneur réussit cette étape, les actionnaires accepteront de financer, seuls, ou avec de nouveaux investisseurs, l’étape suivante. Sinon, le plus probable est qu’ils arrêteront là les frais. Et la start-up mourra de sa belle mort comme c’est malheureusement le cas le plus fréquent. Faire plusieurs tours de financement est la façon pour les investisseurs de contrôler que l’entrepreneur ne s’entête pas inutilement. Celui-ci n’est pas nécessairement perdant car s’il réussit à passer les étapes, la valeur de son entreprise augmentera à chaque fois et il en bénéficiera sous forme d’une dilution moindre de sa part dans le capital.
Ces remarques sont d’autant plus importantes qu’une levée de fonds prend généralement de l’ordre de 6 mois (entre sa phase de préparation, l’approche des investisseurs et sa mise en œuvre). Pendant cette période l’entrepreneur est fortement mobilisé (au moins le tiers de son temps), et à raison d’une levée de fonds tous les 12-18 mois cela devient rapidement une de ses tâches principales ! Mais c’est le signe que l’aventure continue !
2/ Croire que l’on peut se financer par endettement. L’endettement permet de réduire la part des capitaux propres dans le financement du projet et donc de maximiser la part du capital que l’entrepreneur détiendra. Mais que l’entrepreneur en herbe ne se leurre pas : une banque ne financera pas une entreprise ayant des flux de trésorerie négatifs, ce qui est le lot commun des start-up, car elle n’aura pas démontré qu’elle est viable et peut rembourser par des flux de trésorerie positifs son endettement. Tout au plus l’entrepreneur ayant besoin de financer des équipements pour lesquels il existe un marché secondaire (véhicules, bac congélateurs, etc.) pourra trouver des solutions de type crédit-bail dans lesquelles le prêteur minimise son risque en gardant la propriété du bien. Mais les start-up d’Internet, des biotechnologies, des télécoms, etc. n’ayant pas ce type d’actifs devront se financer intégralement par capitaux propres.
C’est d’ailleurs beaucoup mieux pour elle car l’endettement s’accompagne d’échéances régulières qui sont antinomiques avec l’incertitude et la flexibilité requise propres à l’aventure entrepreneuriale. Rares sont les entrepreneurs qui n’ont pas dû changer de modèle économique en phase de création, c’est d’ailleurs une preuve d’intelligence.
3/ Croire que l’obligation convertible est la panacée. Elle présente pourtant le grand avantage de pouvoir émettre (potentiellement) des capitaux propres futurs avec une prime de 20 à 50 % par rapport à la valeur aujourd’hui de ces mêmes capitaux propres et réduit d’autant la dilution potentielle de la part de l’entrepreneur. Mais quelle erreur la plupart du temps ! L’entrepreneur ne voit que la conversion et oublie que le remboursement de l’obligation convertible s’effectue en cash si la valeur son entreprise n’a pas suffisamment progressé. Dans ce cas, c’est le scénario catastrophe à la puissance deux. L’entreprise n’a pas tenu son plan d’affaires, d’où des flux de trésorerie disponible plus faibles que prévu au moment où elle doit rembourser en cash une dette qui devait normalement l’être par simple remise d’actions nouvelles. C’est la faillite assurée ou au mieux un refinancement en catastrophe auprès de nouveaux investisseurs qui vont diluer massivement l’entrepreneur. Adieu veau, vache, cochon, couvée.
L’obligation convertible est un bon produit pour les entreprises à un stade de développement leur permettant de dégager des flux de trésorerie positifs, et non pas pour les start-ups qui sont condamnées pour quelques années aux tourments de flux de trésorerie négatifs[1].
4/ Croire que l’optimisme n’a pas de limite. Le naïf pourrait penser qu'un plan d'affaires très très optimiste lui assurera la meilleure des positions futures, c'est à dire qu'il maximisera ainsi le prix d´émission des actions nouvelles souscrites par les investisseurs et réduira ainsi la dilution qu'il supportera à l'entrée d'investisseurs dans son capital. Vrai à court terme, mais quel risque pris au-delà !
Sans le savoir le plus souvent, il vient de dégoupiller une grenade et de s'assoir dessus...
Comme il a été très très optimiste dans son plan d'affaires, il va lui être d'autant plus difficile de le réaliser. Si, comme cela est le plus probable, il est en retard sur son plan d'affaires, il va lui être particulièrement difficile de convaincre les investisseurs du second tour de financement de payer les actions plus cher qu'au tour précédent. Le plus probable est que le prix d'émission sera plus faible. La clause de ratchet[2] que les premiers investisseurs auront pris soin d'introduire dans le pacte d'actionnaires se déclenchera alors. Les investisseurs du premier tour auront le droit de souscrire à de nouvelles actions émises à un prix symbolique pour, au final, que leur prix de revient moyen soit le même que celui payé par les investisseurs du second tour, ce qui amoindrira la valeur de l'action et nécessitera d'en émettre plus pour lever au second tour le même montant. D'où une dilution substantielle pour l'entrepreneur qui peut se retrouver ne plus détenir que quelques pourcents dans son entreprise. De plus sa crédibilité sera largement écornée et les investisseurs des tours précédents seront peu enclins à participer aux tours suivants, rendant les levées de fonds bien plus compliquées.
De l'optimisme, oui. Un prix d'émission pour les investisseurs supérieur à celui payé par l'entrepreneur, oui. Mais point trop n'en faut. Idéalement, la valeur de l'action doit progresser à chaque tour de financement pour que tout le monde soit content et éviter que la clause de ratchet ne joue. Cela suppose de la modération dans l'optimisme, du doigté et un peu de chance !
Mais n'est-ce pas de toute façon des qualités dont l'entrepreneur doit faire montre dans son aventure entrepreneuriale ?
Tableau : Rachats d'actions et dividendes en 2013
Avec 6,6 Md€ de rachats d’actions en 2013, les entreprises du CAC 40 ont accru en 2013 de 43 % les restitutions de liquidités sous cette forme à leur actionnaires, à charge pour eux de les investir auprès de sociétés qui ont besoin de capitaux propres. Ceci correspond bien à la nature totalement discrétionnaire de cette forme de distribution de liquidités aux actionnaires qui peut être arrêtée à tout moment[1]. On reste, sans surprise vue la conjoncture économique, loin du plus haut de 2007 (19,2 Md€) :
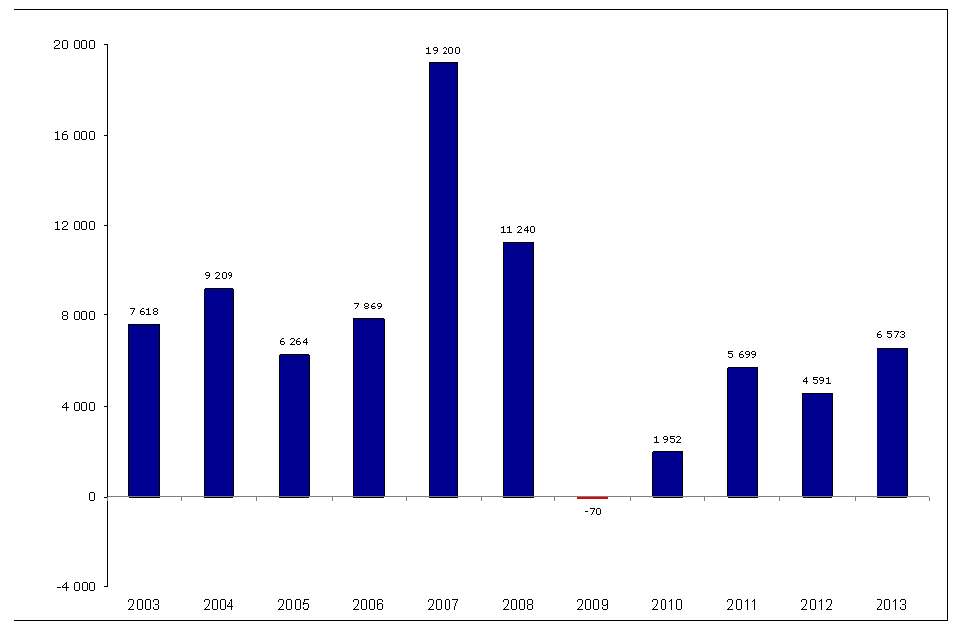
Source : Compilation des informations réglementées publiées par les sociétés
13 groupes ont procédé à des rachats d’actions significatifs en 2013 contre 12 en 2012 et 17 en 2011. Mais deux trustent 56 % du volume (Airbus et Sanofi), et en ajoutant Danone et L’Oréal on obtient 80 %. Airbus est un nouveau venu dans ce club, probablement de façon transitoire car son programme de rachat d’actions a essentiellement servi à faciliter la sortie de Lagardère et de Daimler de son capital. Publicis y a aussi eu recours en 2013 pour 181 M€ pour parachever la sortie de Dentsu de son capital.
Comme l’année passée, aucun groupe du CAC 40 n’a procédé à des cessions significatives de titres auto détenus, reflet dans la plupart des cas d’une bonne situation financière des membres de l’élite françaises des groupes.
Coté dividendes, 36 Md€ ont été versés en 2013, soit un retrait de 1% par rapport à l’an dernier qui peut s’expliquer par un effet changement de la composition du CAC 40 puisqu’Alcatel qui ne verse pas de dividende a fait son retour au détriment de STMicroelectronics qui en avait versé 362 M€ en 2012. 10 groupes ont choisi cette année de proposer un paiement en tout ou en partie de leurs dividendes en actions, ce qui montre qu’ils estiment avoir besoin de capitaux propres complémentaires sans néanmoins oser faire une augmentation de capital classique.
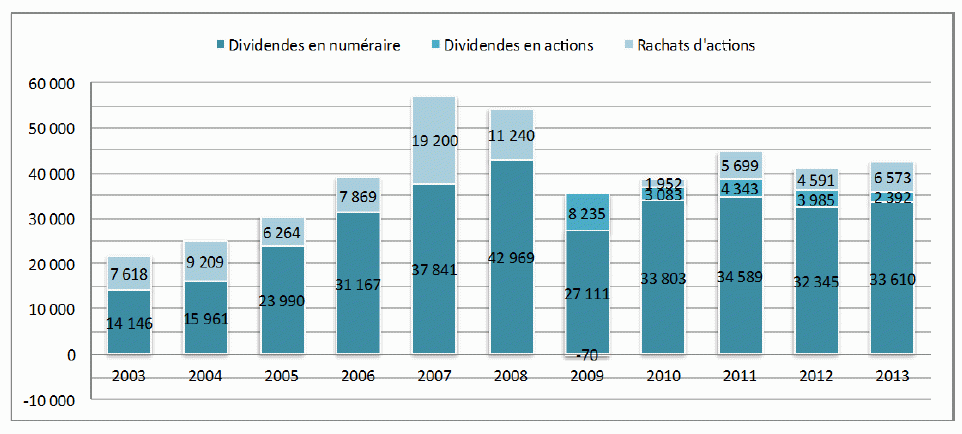
Source : Compilation des informations réglementées publiées par les sociétés
Comme les années précédentes, le trio de tête des versements de dividendes représente de l’ordre du tiers des dividendes versés, il est composé de Total, Sanofi et GDF Suez. Si on ajoute EDF et BNP Paribas, on atteint avec 5 groupes presque 50 % des dividendes. Comme quoi, même au sein du CAC 40, les inégalités sont criantes ! Orange disparaît de ce quintet, ayant (enfin) décidé d’adapter sa politique de dividendes à ses moyens.
Crédit Agricole et Alcatel Lucent se retrouvent seuls en 2013 à ne pas avoir versé de dividendes, mais ils étaient tous les deux en perte en 2012.
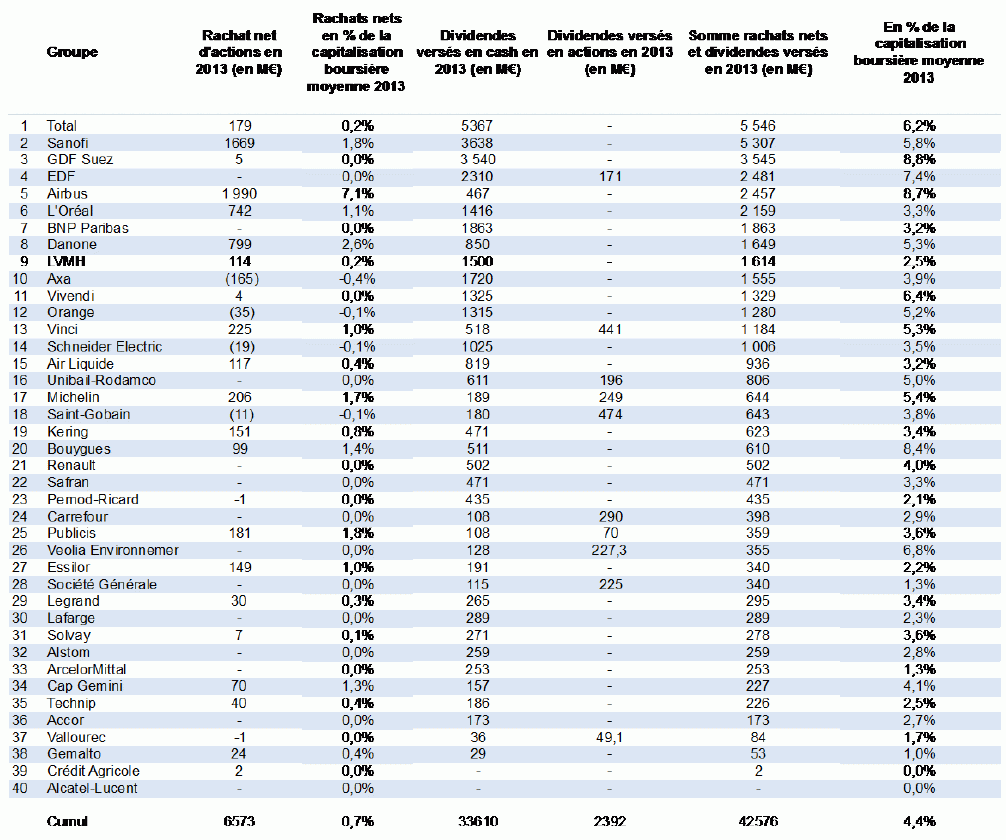
Source : Compilation des informations réglementées publiées par les sociétés
Comme nous l’anticipions[2], le taux de distribution pour les entreprises du CAC 40 qui ont versé un dividende est de 46 %, au niveau de sa moyenne historique de 45 %, contre 48 % l’année précédente. Cette légère baisse résulte moins de la progression des résultats que de la modération dans la progression des dividendes, ce qui est normal à ce stade du cycle, voire dans leur baisse à des niveaux plus réalistes (Orange, Arcelor Mittal).
Rappelons[3] à notre lecteur qui serait tenté de leur jeter la pierre que le seul critère financièrement pertinent d’appréciation d’une politique de distribution est le taux de rentabilité marginale des fonds réinvestis, sans parler de la capacité des entreprises à en verser un compte tenu de leur objectif de structure financière. Le dividende n’est ni une idole ni une icône !
Recherche : Crise du crédit ou choc de demande ?
avec la collaboration de Simon Gueguen - Enseignant-chercheur à Paris Dauphine
La crise financière débutée en 2007 a vu à la fois l’effondrement du crédit et la chute des investissements des entreprises. Le mécanisme de transmission de la crise le plus souvent avancé par les économistes est le suivant : la crise des subprimes a entraîné des pertes pour les banques sur les actifs toxiques, ce qui a réduit la capacité du système bancaire (ou plus généralement des marchés du crédit) à prêter aux entreprises, ce qui a eu pour conséquence une baisse des investissements. La baisse des investissements doit donc être plus marquée pour les entreprises les plus dépendantes du financement bancaire. Nous présentons ce mois-ci une autre théorie, défendue dans une publication récente[1] : la crise des subprimes a provoqué un choc de demande négatif sur les ménages américains, qui a entraîné des révisions à la baisse des anticipations des entreprises, qui ont donc coupé leurs investissements et en conséquence leurs demandes de financement. La causalité est inversée : c’est la baisse des investissements qui explique la baisse des emprunts.
Les auteurs analysent un échantillon large de données trimestrielles d’entreprises non financières américaines entre juillet 2007 et mars 2010. Ils montrent que les dépenses d’investissement des entreprises évoluent pendant la crise de la même façon selon que les entreprises se financent, avant la crise, par dette ou par capitaux propres. Les entreprises dépendantes du crédit bancaire ne voient pas leurs investissements diminuer davantage que les autres. Pour identifier les entreprises « dépendantes du crédit bancaire », les auteurs utilisent plusieurs critères : les entreprises ayant contracté deux emprunts auprès de la même banque dans les années précédant la crise, celles à fort levier financier, et les petites entreprises sans notation de crédit. La théorie de la crise du crédit voudrait que ces entreprises voient leurs investissements baisser davantage que les autres pendant la crise ; ce n’est pas le cas.
Selon la théorie dominante, les entreprises dépendantes du crédit devraient subir une baisse de leurs emprunts en début de crise, et tenter de compenser cette baisse par des émissions de capitaux propres ou par l’utilisation de leurs réserves de cash. Ce n’est pas non plus ce qui est observé. Lors de la « première année de la crise » (de mi-2007 à mi-2008), donc avant que les effets sur la demande ne soient matérialisés, ces entreprises ont vu (comme les autres) une baisse de leurs émissions de capitaux propres. Dans la période suivante, celle qui suit la faillite de Lehman Brothers (les auteurs ont retenu le dernier trimestre de 2008 et le premier de 2009, laissant le troisième trimestre de 2008 hors de leur champ d’analyse) le comportement d’investissement des entreprises dépendantes du crédit bancaire n’est pas différent de celui des autres entreprises. De façon surprenante, ils trouvent même l’inverse selon le critère du levier financier : les entreprises non endettées avant la crise voient leurs dépenses d’investissement baisser de 39%, alors que les endettées ne connaissent une baisse que de 29%. Si la crise du crédit était l’élément moteur, on pourrait s’attendre à voir une chute des investissements plus marqué dans les entreprises dépendantes, d’autant plus que les dépréciations d’actifs ont rendu plus difficile les mises en garantie. Pour les auteurs, la similarité des comportements des entreprises est davantage compatible avec une explication de la crise par un choc de demande, qui touche toutes les entreprises indépendamment de leur mode de financement.
Enfin, lors de ce que les auteurs désignent avec un brin d’optimisme comme « dernière année de la crise » (les trois derniers trimestres de 2009 et le premier de 2010), alors que les tensions baissent sur les marchés du crédit et que les marchés actions rebondissent, les investissements des entreprises continuent de baisser. Ce ne serait donc pas un problème d’accès au crédit qui ferait chuter les investissements, mais les anticipations négatives sur les débouchés.
Cet article a le mérite de proposer un autre canal de propagation de la crise que celui généralement avancé, le choc de demande plutôt que la crise de crédit. Il reste toutefois confiné au marché américain ; la question du canal de transmission de la crise aux marchés mondiaux reste ouverte.
[1] K.M.KAHLE, R.M.STULZ (2013), Access to capital, investment, and the financial crisis, Journal of Financial Economics, vol.110, pages 280-299
Q&R : Qui est qui ? (réponses)
Nous vous avions soumis à votre sagacité cette enquête policière digne des meilleurs analystes financiers comme des débutants. Qui est qui ? vous invitait à découvrir quels secteurs économiques se cachent derrière la série de chiffres qui suit. Le corrigé est donné ce mois-ci.
On cherchait :
Un distributeur généraliste,
Un groupe de luxe,
Une agence de publicité,
Un cimentier,
Un négociant de produits sidérurgiques,
Un groupe de travail temporaire,
Un opérateur de satellites,
Une compagnie aérienne
Un producteur de cognac
Une société holding.
C’est ici que se termine le suspens :
Qu’est-ce qu’une société holding sinon une entreprise qui n’a pas d’activité propre et donc pas de besoin en fonds de roulement. C’était donc le numéro 1.
Qu’est-ce un producteur de Cognac sinon une marque (qui ne figurera parmi les immobilisations incorporelles que si elle a été acquise[1] ), des chais et des stocks car il faut 7 ans pour faire un Cognac. C’était donc le numéro 4. Rappelons que comme les stocks sont évalués en prix de revient et non en prix de vente, un stock représentant 289 jours de chiffre d’affaires en représenterait beaucoup plus en jours de prix de revient.
Qu’est-ce qu’un opérateur de satellites sinon une entreprise qui loue un satellite en orbite vers lequel sont envoyées des ondes montantes ensuite renvoyées vers la Terre ? Autrement dit une entreprise avec des immobilisations très importantes, peu de stocks, probablement une marge d’excédent brut d’exploitation très importante (il y a peu de frais d’exploitation). C’était le numéro 7.
Qu’est-ce qu’une compagnie aérienne sinon un métier où les clients paient le plus souvent en avance, avec peu de stocks et beaucoup d’immobilisations. C’était le numéro 5.
Qu’est-ce qu’une affaire de luxe sinon une entreprise avec un niveau de résultat d’exploitation élevé (quand elle marche bien), des ventes le plus souvent en direct aux clients finaux, donc un poste clients faible ? C’était le numéro 3. Ses nombreuses immobilisations s’expliquent par les non moins nombreuses acquisitions de marques faites.
Qu’est-ce qu’un distributeur généraliste sinon une entreprise avec un besoin en fonds de roulement négatif (les stocks tournent vite, les clients paient comptant ou fin de mois avec une carte bancaire et les marges sont faibles ? C’était le numéro 2.
Qu’est-ce qu’un négociant de produits sidérurgiques si ce n’est un distributeur comme le précédent mais avec des stocks importants qui tournent beaucoup moins vite ? C’était le numéro 10.
Qu’est-ce qu’une agence de publicité sinon d’un point de vue financier une entreprise qui collecte des fonds de ses clients les annonceurs et qui les reverse quelques temps après aux media qui ont diffusé le message qu’elle a conçu ? Elle a un petit coté centrale de paiements ou banque à tel point que les frères Saatchi, du temps de leur splendeur, avaient sérieusement envisagé de racheter la Midland Bank. C’était donc le numéro 6.
Qu’est-ce qu’un groupe de travail temporaire sinon une entreprise sans stock, sans achat (donc avec une marge brute de 100%) et des faibles marges car il n’y a pas beaucoup de capitaux investis. C’était donc le numéro 9.
Quant à un groupe cimentier, c’est une entreprise avec beaucoup d’immobilisations (rappelez-vous la dernière fois où vous avez vu une cimenterie), donc probablement avec un volume d’endettement conséquent avec une faible rotation du chiffre d’affaires par rapport à l’actif économique. Un sac de ciment ne vaut pas très cher (pour moins de 10 € vous avez un sac de 35 kg ; pour ce prix chez Vuitton, vous n’avez même pas 2 cm carré d’un sac !). C’était donc le numéro 8. Accessoirement c’était le dernier de notre liste.
[1] Voir le chapitre 8 du Vernimmen 2014.