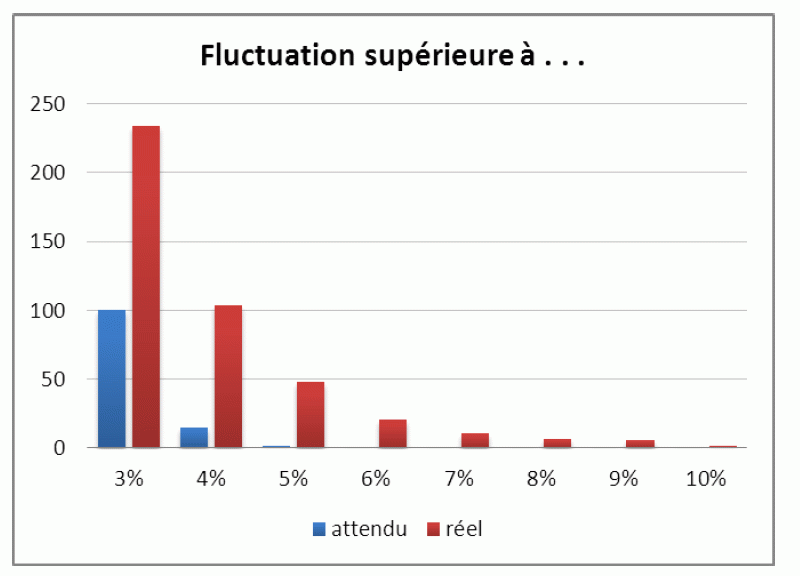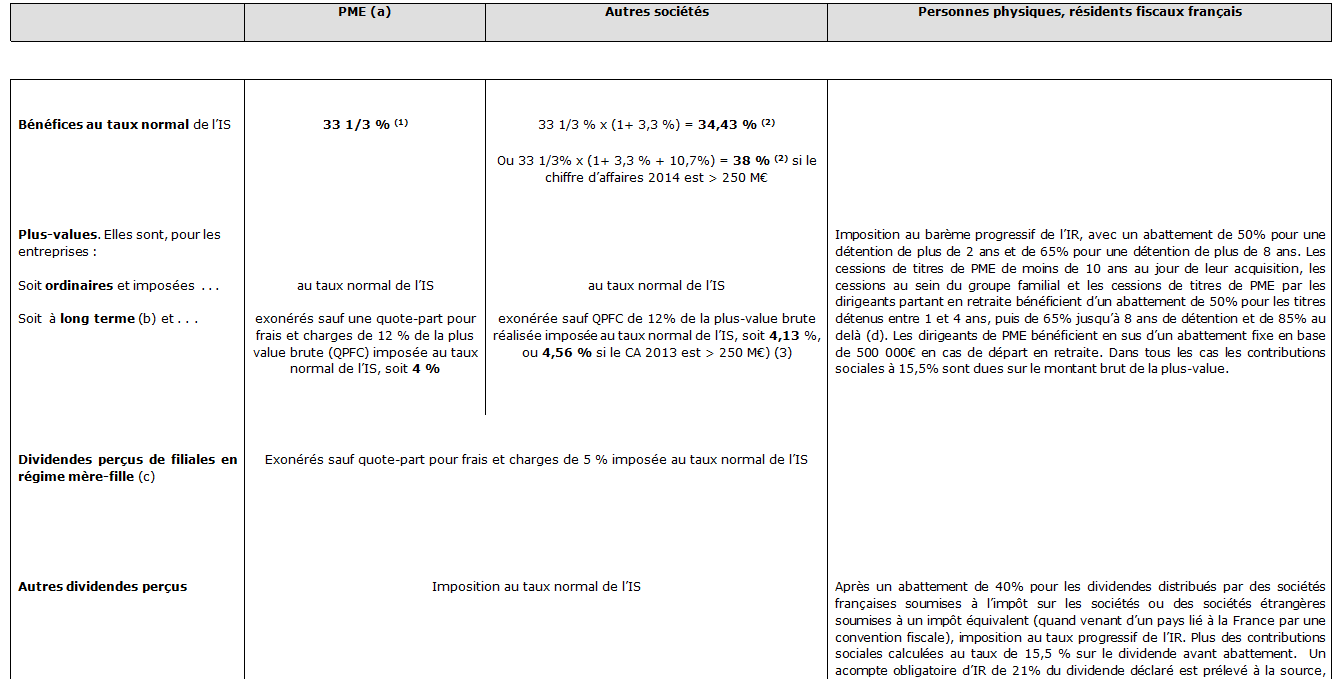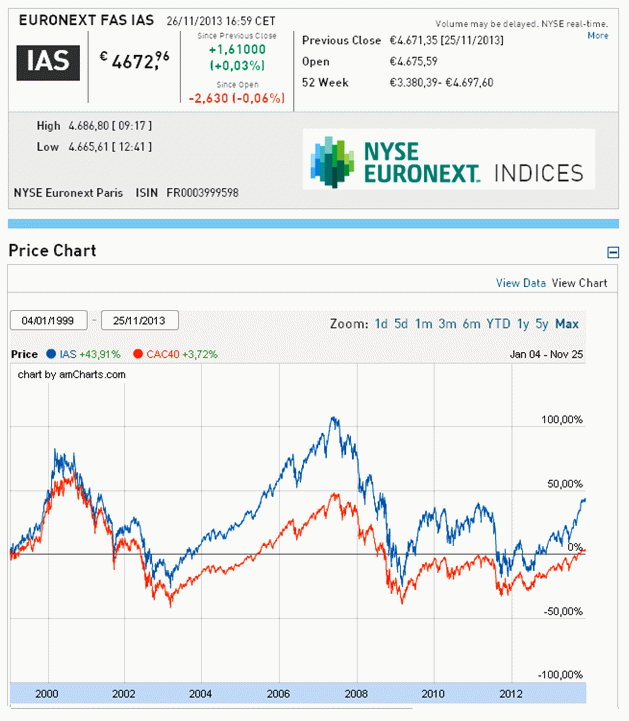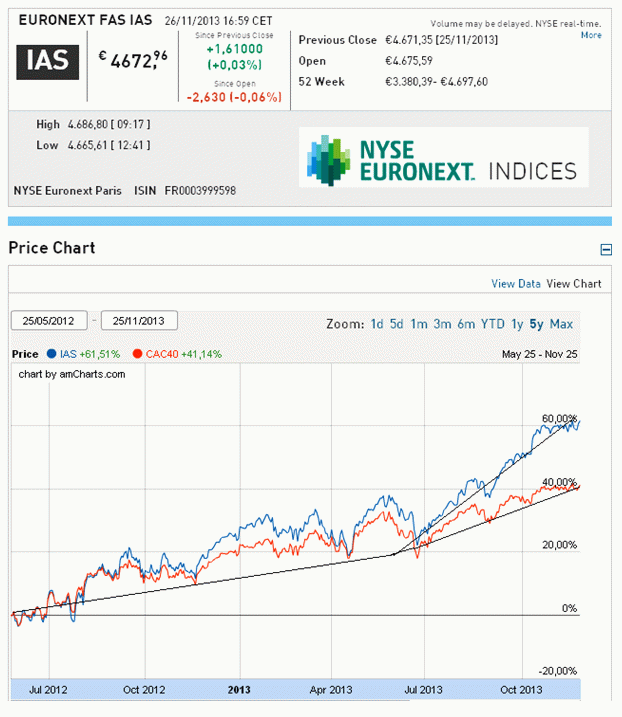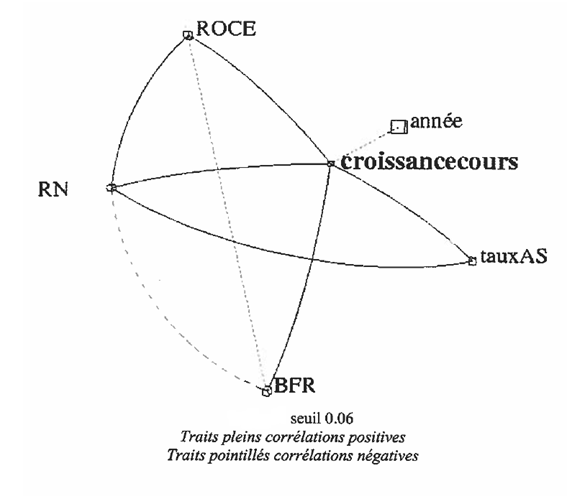La Lettre n°122 de Février 2014
Actualités : Six ans après la crise de 2008, quels sont les piliers de la théorie financière qui ont été gravement atteints ?
La crise financière de 2008 n’a pas fait qu’ébranler Lehman Brothers, Bear Stearns, Wachovia, Washington Mutual, Merrill Lynch, Citigroup, UBS, RBS, ING, RBoS, IKB, Northern Rock, Dexia, Fortis, Commerzbank, Bank of Ireland, et bien d’autres. Elle a durablement remis en cause, nous semble-t-il, quatre croyances ou postulats utilisés par la théorie financière :
-
la croyance selon laquelle, à condition d’offrir le bon couple risque/rentabilité, il est toujours possible de trouver de la liquidité sur le marché ;
-
la croyance selon laquelle les marchés donnant à tout moment une juste valeur, celle-ci peut être reprise largement dans les bilans des entreprises ;
-
la croyance en l’existence d’un actif financier sans risque ;
-
la croyance que la loi normale représente bien la distribution des taux de rentabilité sur le marché.
1/ La croyance en une liquidité toujours présente
Elle a été démentie le 9 août 2007 quand BNP Paribas a suspendu temporairement la valorisation et donc la commercialisation de 3 fonds partiellement investis en titres subprime[1] suite à un arrêt brutal des transactions sur subprimes depuis le 6 août. Certains ont voulu y voir le début de la crise, voire sa cause de la même façon que lorsque le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt.
Dans un autre registre, nous nous rappelons d’un directeur financier d’un grand groupe du CAC 40 qui, à la mi-novembre 2008, déclarait devant une centaine de nos étudiants qu’il ne savait pas comment son groupe allait faire à la fin du mois pour payer les salaires de dizaines de milliers de salariés. Nous ne nous rappelons plus si nous fûmes plus stupéfaits par le fait qu’une telle confidence puisse être faite en public dans un contexte financier explosif ou par le fait qu’un groupe si puissant en soit à racler les fonds de tiroirs et quémander des liquidités comme César Birotteau après la fuite du notaire Roguin.
Les nombreux financiers d’entreprise qui ont alors passé des nuits banches ne sont pas prêts d’oublier la leçon : la liquidité est comme l’eau sur le sable de la plage : elle est là tant qu’elle est là, mais elle peut disparaître à tout moment en un instant. D’où le développement des produits d’assurance contre le risque d’illiquidité : cash maintenu à l’actif du bilan pour les entreprises et en dépôt à la Banque centrale pour les banques, voire pour les très grands groupes acquisition d’une banque pour pouvoir déposer à la Banque centrale leurs liquidités (Siemens, Airbus), lignes de crédit confirmées mais non tirées, etc.[2]
2/ La croyance en la suprématie systématique de la juste valeur
Si les marchés sont capables à tout moment de donner une juste valeur pour tout actif, il n’est pas insensé de vouloir dans certains cas de figure la faire figurer au bilan de celui qui détient cet actif. En effet, il est possible de céder cet actif à tout moment pour une valeur de marché. Certes cela introduit la volatilité des marchés financiers dans le bilan, voire le compte de résultat si la contrepartie de la fluctuation de la valeur n’est pas un poste de l’état de résultat global[3]. En contre-partie, on pourrait plaider que ces actifs ne sont inscrits au bilan que pour la valeur qu’il est possible d’obtenir d’eux et non une valeur théorique, historique comme un coût d’acquisition amorti ou provisionné.
Mais si, à un moment donné, les marchés financiers sont en panne et ne peuvent plus donner une évaluation fiable pour ces actifs, cet avantage disparaît, la juste valeur devient aussi théorique qu’un prix de revient comptable et la volatilité qu’elle a introduite n’a plus de contrepartie positive.
La chute du domino de la liquidité entraine celui de la juste valeur.
3/ La croyance en l’existence d’un actif financier sans risque
Son existence est centrale dans le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF) qui reste, à ce jour, parmi les praticien de la finance le seul outil d’évaluation du taux de rentabilité à exiger de tout actif[4], alors que parmi les chercheurs, le modèle de Fama French est de loin le plus utilisé[5]. Mais ce dernier est plus compliqué à mettre en œuvre et est peu enseigné. La dichotomie actuelle pourrait donc perdurer.
Nous avons déjà[6] indiqué notre conviction qu’il n’était plus possible de se comporter comme des autruches face à la détermination de l’actif sans risque, souvent retenu comme une obligation d’Etat à 10 ans sous prétexte de leur plus grande liquidité et d’une duration longue, similaire à celle des actions. Que l’on passe sur le risque de fluctuation de valeur d’une obligation à 10 ans (qui n’est pas théorique compte tenu de sa duration), sur le risque d’inflation, sur celui de réinvestissement des coupons, soit.
Mais la découverte du risque de solvabilité d’un certain nombre d’Etats, anciennement notés AAA ou d’autres dont les dettes étaient cotées comme si elles étaient notées AAA, fait qu’il n’est plus raisonnablement possible de considérer comme un taux de l’argent sans risque une obligation d’Etat de longue durée. Trop c’est trop !
Ne soyons pas naïf. Nous écrivons depuis des années que le concept d’actif sans risque est une vue de l’esprit. Croire qu’il n’y a pas de risque, c’est faire preuve soit d’une confiance excessive en soi, soit d’une incapacité à penser l’avenir, deux défauts très graves pour un financier.
Aussi préconisons-nous de retenir comme taux de l’argent sans risque pour la détermination du taux d’intérêt à exiger sur un actif un taux à court terme, comme ceux des bons du Trésor à un mois pour lesquels les risques de solvabilité, de fluctuation de la valeur, d’inflation et de réinvestissement des coupons sont négligeables ou nuls.
4/ La croyance que la loi normale représente bien la distribution des taux de rentabilité sur le marché
Une loi normale ou loi de Gauss est séduisante par bien des aspects : simple de représentation (une courbe en cloche symétrique), ne se définit que par sa moyenne et sa variance et décrit bien de nombreux faits de la nature ou de la vie humaine.
Cependant en matière de comportements boursiers, elle sous-estime nettement la probabilité des évènements extrêmes. Ainsi une variation de 5% ou plus des cours ne devrait se produire qu’une fois tous les 15 ans. Elles ont été de 48 sur le CAC 40 sur les 20 dernières années. Il ne devrait y avoir qu’une fluctuation supérieure à 6% tous les 260 ans. Il y en a une en moyenne une par an.
Autrement dit, la répartition réelle des taux de rentabilité montre des queues de distribution beaucoup plus épaisses que celles que suppose la loi normale. D’où le développement de lois alternatives comme la loi de Fréchet ou l’approche par les fractales de Benoît Mandelbrot.
[1] Pour plus de détails sur les subprimes, voir la Lettre vernimmen.net n° 60 d’octobre 2007
[2] Pour plus de détails, voir le chapitre 43 du Vernimmen 2014
[3] Pour plus de détails sur l’état de résultat global, la Lettre vernimmen.net n° 108 de juin 2012
[4] Pour plus de détails sur le MEDAF, voir le chapitre 22 du Vernimmen 2014
[5] Pour plus de détails sur le modèle de Fama French, voir le chapitre 23 du Vernimmen 2014
[6] Dans la Lettre vernimmen.net n°111 de décembre 2012
Tableau : Les taux d'impôt en France en 2014
Taux d’impôt sur les bénéfices, les plus-values, les dividendes et intérêts reçus, réalisés en France par les sociétés et les personnes physiques[1] :
(1) 15 % sur les premiers 38 120 € de résultat imposable. Les charges financières nettes ne sont déductibles qu’à hauteur de 75% à partir de 2014 (contre 85% en 2013) de leurs montants lorsque celui-ci dépasse 3M€ (seuil et non franchise). De plus les bénéfices distribués supportent une contribution supplémentaire de 3% (disposition ne s’appliquant ni aux succursales de sociétés établies dans l’Union européenne ni aux « PME communautaires », i.e. les sociétés exploitantes qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43M€).
(2) La contribution sociale de 3,3 % est assise sur l’IS de référence sous déduction d’un abattement de 763 000 € par période de 12 mois (lorsqu’un exercice est différent de 12 mois, l’abattement est ajusté en conséquence) ; d’où un taux de 33,40% seulement si l’IS de référence est inférieur à 763.000 € (CA < 250 M€) et de 36,90% (CA >250 M€)
(3) 19 %, 15 % ou 4 % (ou 4,43 % si le CA 2013 est > 250 M€) sur la fraction d’IS inférieure ou égale à 763 000 € ;
(a) Sociétés dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 7,630 M€ et dont le capital, entièrement libéré, doit être détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques (ou des sociétés qui satisfont aux conditions).
(b) Bénéficient du régime des plus-values et moins-values à long terme les cessions de titres de participation détenus depuis au moins deux ans qui revêtent ce caractère au plan comptable ainsi que ceux considérés comme tels par la loi fiscale : (i) titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, voir c), prévu aux articles 145 et 216 du CGI si inscription à une subdivision spéciale d’un compte de bilan correspondant à leur classification comptable (ii) actions acquises en exécution d’une OPA ou OPE par l’entreprise initiatrice.
La moins-value constatée lors de la cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans à une société liée est mise en suspens. Le régime et la date d’imposition de ce résultat dépendent du maintien ou non des titres dans le groupe économique.
Sont imposables au taux réduit de 15% (hors majorations applicables) les plus-values de cession de parts de FCPR et d’actions de SCR lorsque ces titres sont détenus depuis plus de 5 ans (avec, sous certaines conditions, application de l’exonération avec quote-part de frais et charges de 12 %).
Sont taxables au taux réduit de l’IS de 19%, les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées réalisées par une société relevant de l’IS. Celles provenant de titres non cotés sont taxables au taux normal de l’IS.
Les cessions de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif ne relèvent pas du régime long terme.
(c) Participation d’au moins 5 % du capital conservés pendant au moins deux ans. Concerne aussi les titres dépourvus de droit de vote (actions de préférence) si la société mère détient globalement au titre de cette participation au moins 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice. Sont exclues de ce régime les participations dans des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés (notamment SIIC pour les dividendes prélevés sur des bénéfices exonérés, SICAV…). De même, le régime mère-fille n’est pas applicable aux distributions réalisées par les sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI.
(d) Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année et des 10 années suivantes.
[1] Hors régimes spéciaux et plus-values immobilières.
Recherche : Credit Default Swaps : un rôle positif pour le financement des entreprises
avec la collaboration de Simon Gueguen - Enseignant-chercheur à Paris Dauphine
Les Credit Defaults Swaps (ou CDS) ont mauvaise presse. Le principe de ces instruments dérivés de crédit est de permettre à l’acheteur de transférer un risque de défaillance auquel il est exposé au vendeur, en échange d’un flux de trésorerie régulier[1]. Ils ont parfois été accusés d’avoir favorisé l’extension de la crise financière, sans que le lien de causalité ne soit clairement établi.
Nous avons présenté lors de la dernière édition de la Lettre Vernimmen un article qui montrait que la crise dite des subprimes était probablement une crise provoquée par un choc de demande, plutôt qu’une crise du système financier ou liée aux innovations financières. L’article que nous présentons ce mois[2] montre que les CDS ont des effets vertueux sur le financement des entreprises et favorisent les investissements dans l’économie réelle.
Les auteurs de l’article ont étudié les conséquences de l’existence d’un marché des CDS pour les entreprises non financières américaines présentes dans l’indice S&P500, entre 2002 et 2010. Leur intuition est que les CDS favorisent le financement pour les raisons suivantes :
-
s’il existe une séparation entre le fournisseur potentiel de crédit et celui qui accepte de porter le risque, l’existence de CDS permet d’augmenter le nombre d’investisseurs du côté de l’offre de crédit ;
-
les investisseurs institutionnels soumis à des exigences de fonds propres (Bâle II, Solvabilité II) voient ces exigences réduites lorsqu’ils couvrent leurs positions de crédit par l’achat de CDS ; ils peuvent donc prêter davantage ;
-
les banques peuvent utiliser les CDS pour fournir du crédit aux entreprises avec un objectif de relation commerciale de long terme sans supporter le risque de crédit ;
-
même avant que le prêteur n’achète de CDS, l’existence d’un tel marché lui offre une porte de sortie sur son risque ; cet effet anticipé peut l’inciter à prêter davantage.
Une étude précédente, citée dans l’article[3], a montré que l’impact d’un marché de CDS sur le coût du crédit était à peine perceptible. L’article que nous présentons montre qu’il y a pourtant un impact, mais que celui-ci porte sur la quantité de crédit accordée (hausse du levier financier) et sur la maturité de la dette (un élément non-prix du contrat de dette). Selon les résultats empiriques, l’introduction d’un marché de CDS :
-
augmente le levier financier mesuré en valeur de marché (mesuré comme le ratio du montant total de la dette sur la valeur totale de l’entreprise) de 3,1 points de pourcentage, soit 19% du montant moyen du levier (16%) ;
-
augmente la maturité de la dette d’environ une année (selon les spécifications des tests), ce qui est très significatif économiquement (la maturité moyenne de la dette de l’échantillon est de 8,68 années).
Enfin, les auteurs montrent que ces effets sont renforcés en cas de rationnement du crédit. En résumé, les CDS aident les entreprises à trouver du crédit, surtout en période de crise.
[1] Pour plus d’informations sur les CDS, voir le chapitre 54 du Vernimmen 2014.
[2] A.SARETTO et H.TOOKES (2013), Corporate leverage, debt maturity and credit supply : the role of credit default swaps, Review of Financial Studies, vol.26(5), pages 1190-1247
[3] A.B.ASHCRAFT et J.A.C. SANTOS (2009), Has the CDS market lowered the cost of corporate debt?, Journal of Monetary Economics, vol.56, pages 514-523
Q&R : Quel traitement réserver en analyse financière aux subventions d'investissement ?
Une subvention d’investissement est une somme versée par un tiers, souvent les Pouvoirs Publics, à une entreprise pour l’aider à acquérir ou créer un actif immobilisé.
Comptablement en normes françaises, la subvention d’investissement peut être comptabilisée immédiatement en produits ou inscrite à un poste de capitaux propres et reprise progressivement par le compte de résultat (en produits exceptionnels) au même rythme et sur le même durée que l’amortissement de l’actif immobilisé ainsi financé.
En analyse financière, nous conseillons d’inscrire cette subvention d'investissement en minoration du montant de l'immobilisation.
Ni les actionnaires, ni les prêteurs n'ont apporté cet argent, c’est un tiers pour des raisons qui lui sont propres qui l’apporté et qui, en contrepartie, n'a rien obtenu de particulier en terme de droits à des flux de l’entreprise. Il a simplement obtenu que cet investissement soit réalisé. Dans une optique financière, cette subvention d’investissement n'a rien à faire au passif de l’entreprise.
De surcroit le montant investi par l’entreprise correspond bien au montant de l'investissement moins cette subvention, investissement que n'aurait (probablement, peut-être) pas été réalisé si la subvention n'avait pas été versée. C'est d'ailleurs comme cela que la comptabilité traite l'investissement au compte de résultat puis que la dotation aux amortissements annuels trouve en parallèle une contrepartie partielle dans la reprise progressive, au même rythme, de la subvention. Donc, en net, sur la durée d’amortissement, il y a bien une charge d'amortissement qui correspond au montant de l'investissement sous déduction de celui de la subvention d'investissement.
Ce n'est pas parce que la comptabilité française ne permet pas aux comptables d’aller au bout du raisonnement, que les analystes financiers doivent faire de même ! Les normes IFRS autorisent l’inscription au bilan de la subvention d’investissement avec une reprise progressive en parallèle de l’amortissement de l’actif ainsi financé, ou l’inscription en déduction du montant comptable de l’actif en question.
En matière d’évaluation, dans l’actualisation des flux de trésorerie disponible, il conviendra de correctement modéliser l’impôt sur les sociétés et de neutraliser, au même titre que la dotation aux amortissements, la reprise progressive de la subvention d’investissement au compte de résultat, qui est tout sauf un flux. En matière de méthodes relatives et en prenant l’hypothèse que seule l’entreprise à évaluer a reçu une subvention d’investissement, il conviendra pour le PER de soustraire du résultat net la reprise de la subvention d’investissement nette d’impôt. Pour le multiple du résultat d’exploitation, on réduira la dotation aux amortissements du montant de la reprise sur subvention. Aucun redressement n’est requis pour le multiple de l’excédent brut d’exploitation qui est avant ces écritures purement comptables.
Dans le passage de la valeur de l’actif économique à la valeur des capitaux propres, on retirera le solde de la subvention d’investissement non virée au compte de résultat, multiplié par le taux d’impôt sur les sociétés pertinent afin de tenir compte de la fiscalité future qu’induira son virement au compte de résultat.
Autre : NOS LECTEURS ECRIVENT : L'actionnariat salarié, puissant moteur de création de valeur
par Laurent Legendre[1]
L’actionnariat salarié en France pèse 38 Md€ à fin 2012 (38 % des en-cours d’épargne salariale détenus par 3,7 millions de salariés). Au-delà de ces chiffres, l’actionnariat salarié développe l’engagement des salariés et l’amélioration de leur connaissance des enjeux économiques stratégiques et financiers de l’entreprise. La France est le pays le plus avancé en Europe avec un taux moyen de l’ordre de 3,8 % du capital des entreprises, qui atteint 8,3 % au sein du capital des 26 entreprises qui composent l’indice NYSE EURONEXT FAS IAS[2], ce qui en fait un actionnariat stratégique.
Les entreprises trouvent dans cette épargne plus qu’une simple contribution à leur financement. C’est au sein de l’entreprise, un facteur d’alignement des intérêts entre le management, l'actionnariat de contrôle et les salariés.
En 1999, la FAS, Fédération Française des Actionnaires Salariés et Anciens Salariés[3], a développé avec NYSE EURONEXT un indice spécifique pour les entreprise dont le capital contient plus de 3% d'actionnariat salarié détenu par plus de 25% de l'effectif des entreprises en France et plus de 15% au niveau mondial. Cet indice surperforme son benchmark de référence ainsi que le CAC 40 depuis près de quinze ans :
En juin 2013 la FAS a décidé de remplacer la pondération classique de cet indice (par le flottant) par une pondération par le taux d'actionnariat salarié afin de mettre en valeur les politiques de développement de cet actionnariat dans l'indice. Le résultat sur la performance de l'indice est étonnant car il amplifie la surperformance de l'indice FAS IAS par rapport aux autres indices : sur 6 mois l'écart est de l'ordre de 20% par rapport au CAC40.
Une analyse statistique via une iconographie des corrélations menée sur les données financières des sociétés du CAC 40 entre décembre 1998 et décembre 2004 a montré que développer son taux d'actionnariat salarié avait un impact sur la création de valeur des entreprises aussi important que l'amélioration du BFR réalisée par ces sociétés sur la même période et venait juste après d'autres facteurs comme le ROCE.
Sur cette même période, les entreprise sans actionnariat salarié significatif pesant 45% de la valorisation du CAC 40 avaient détruit près de 116 Md€ de capital alors que celles qui étaient éligibles à l'IAS et pesaient 55% de cette capitalisation avait créé 108 milliards d'euro de capital.
Si l'on porte sur un même graphe la création de valeur sur la période d'étude de l'ensemble de ces sociétés en fonction de leur taux d'actionnariat salarié, il semble même y avoir une proportionnalité entre ces deux variables :
Les entreprises françaises ont développées plus fortement l'actionnariat salarié que leur concurrentes étrangères, en raison de l'histoire économique du pays (privatisations et contexte fiscal de l'épargne salariale), il semble bien qu'elles aient trouvé une des clés de la création de valeur qui contribue à porter nos champions du CAC 40 en bonne position sur l'échiquier mondial des titres cotés.