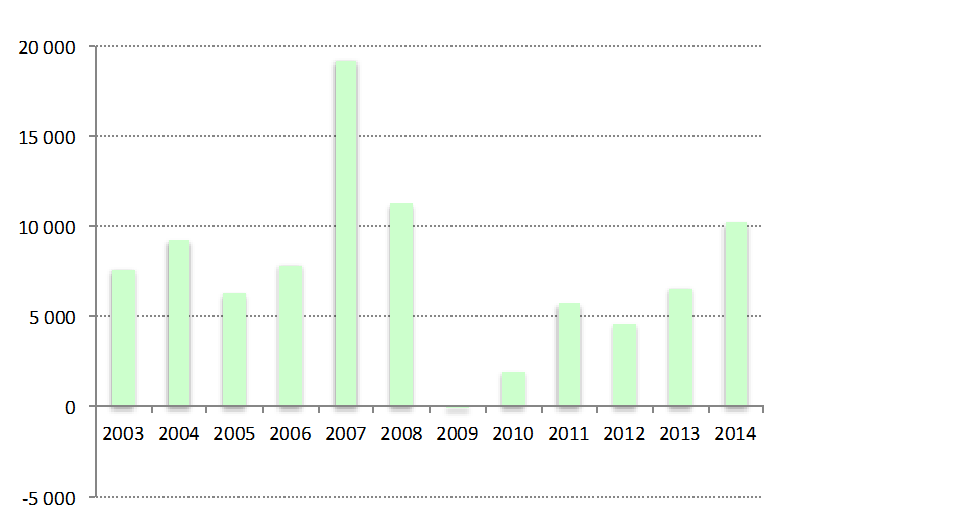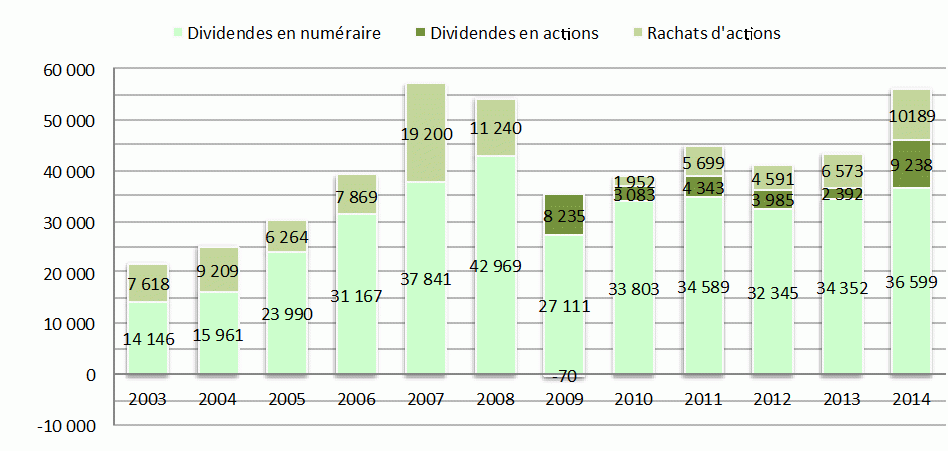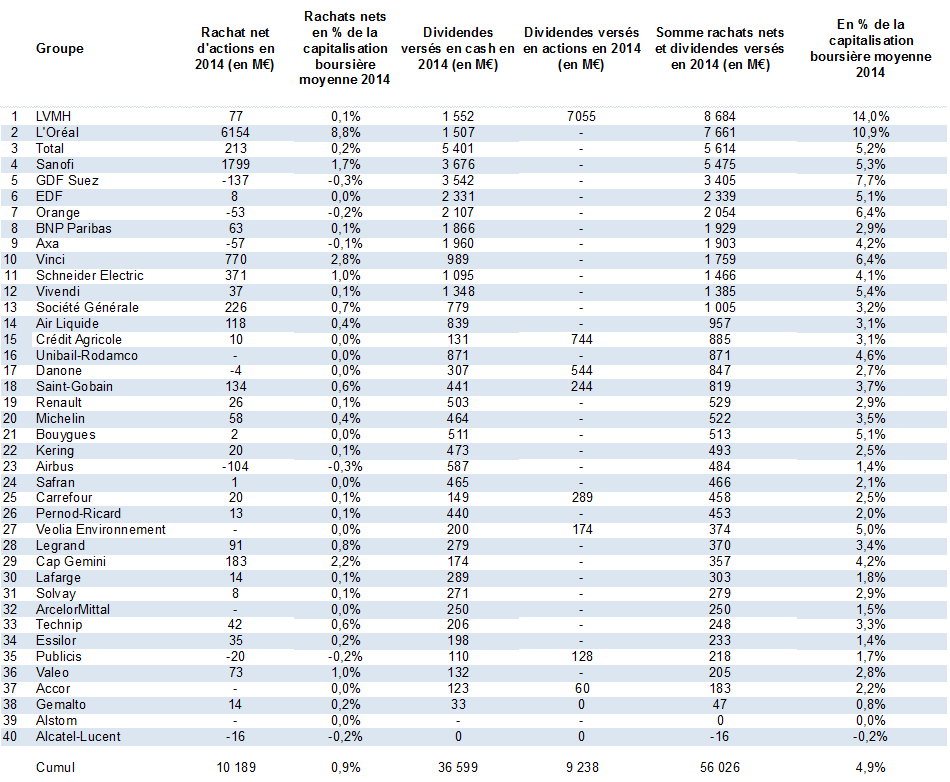La Lettre n°129 de Janvier 2015
Actualités : Financement des start-ups : il y a capitaux propres et capitaux propres !
D’un point de vue financement on peut répartir les start-ups en deux catégories : celle qui peuvent se financer pour partie par endettement et celles que ne le peuvent pas du tout.
Les premières peuvent recourir pour partie à la dette car elles utilisent des actifs tangibles ou intangibles qui ont une valeur indépendante de l’exploitation qui leur en est actuellement donné par la start-up avec un marché secondaire actif : camions ou voitures, immobilier, fonds de commerce ou droit au bail, etc.
Dès lors que le modèle économique d’une nouvelle entreprise n'est pas nettement établi et que son exploitation ne requiert pas la détention d'actifs ayant une valeur indépendante de son activité, la seule façon raisonnable pour elle de se financer est par capitaux propres.
Par ses échéances régulières de versements d'intérêts et de remboursements du capital, la dette est totalement antinomique d'une génération de flux de trésorerie aléatoires et négatifs pendant une période indéterminée. L'entrepreneur a besoin de temps pour tester son produit ou son service, corriger le tir, s'adapter aux retours des premiers clients, laisser tomber 80 % de ce qui a été fait le cas échéant et repartir dans une autre direction. L'entrepreneur a l'esprit entièrement tourné vers son aventure, il ne doit pas se laisser perturber ou dicter son tempo par une dette qui, comme une bombe à retardement, fait tic-tac, tic-tac[1].
Le plus souvent les capitaux propres prennent la forme classique d’actions ordinaires et c’est beaucoup mieux ainsi. Les intérêts des dirigeants fondateurs et des investisseurs en capitaux propres sont ainsi alignés au mieux possible avec pour seul écart la différence des prix de revient de leurs actions correspondant à des moments différents d’investissements et à des rôles différents.
Ils prennent parfois la forme d’actions de préférence qui sont des vrais capitaux propres, sauf si le contrat d’émission contient des clauses en pervertissant la nature. Ce n’est heureusement pas le cas le plus fréquent. Mais la très grande liberté contractuelle qui caractérise les actions de préférence[2] peut conduire à des montages les transformant en dettes. Ainsi certains intermédiaires, dont le fonds de commerce repose principalement sur la déductibilité fiscale d’investissements en PME au titre de l’ISF (loi Tepa), proposent aux entrepreneurs un investissement en capitaux propres par actions de préférence ainsi structurées :
L’action de préférence bénéficie au bout de cinq ans d’un dividende prioritaire calculé sur le montant de l’investissement au taux d’Euribor + 15 %. Ce dividende prioritaire est versé dès lors qu’il y a au bilan des bénéfices distribuables et même si l’entreprise n’a pas l’intention de distribuer des dividendes pour privilégier son autofinancement. Ce dividende est de surcroit cumulatif, c’est-à-dire que s’il n’est pas versé une année donnée, faute de résultat distribuable, il est reporté dans le temps, et capitalisé à 15 %. Ainsi au bout de 8 ans, c’est 52 % de l’investissement que l’entreprise doit verser en dividende.
L’entrepreneur bénéficie d’une option de rachat des actions de préférence à un prix pour partie fixe, pour partie fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise avec un plafond qui donne un coût de ces actions de préférence, en cas d’exercice de l’option, compris entre 3,5 et 14 % par an. Ces taux ne tiennent pas compte des commissions dont l’entreprise doit s’acquitter au profit de l’intermédiaire et qui ne sont pas négligeables puisque nous avons vu des taux de l’ordre de 5 % par an (sic).
Pour les entrepreneurs qui échouent complétement - rappelons que 76 % des entreprises françaises créées en 2004 ont disparu dix ans après - peu importe. Elles feront faillite ou seront proprement liquidées et l’histoire s’arrêtera là pour elles. Les actions de préférence seront traitées comme des actions ordinaires et ne vaudront rien.
Pour l’entrepreneur qui réussit très bien, l’action de préférence ainsi structurée est un produit sympathique, puisqu’il lui permet de sortir les investisseurs au bout de 5 ans à un prix plafonné et inférieur à la valeur de l’action, le tout pour un coût annuel de l’ordre de 20 %, inférieur au coût des capitaux propres.
Mais pour un entrepreneur qui réussit très bien, combien d’autres réussissent correctement, sans plus, ou médiocrement ?
Dans ce cas, au bout de 5 ans, dès lors que l’entreprise fait un bénéfice distribuable, elle est obligée de verser une rémunération aux porteurs d’actions de préférence, réduisant d’autant le montant des investissements qu’elle peut vouloir faire. L’objectif des détenteurs d’actions de préférence est bien sûr d’exercer ainsi une pression forte sur l’entrepreneur pour qu’il rachète ou fasse racheter les actions de préférence, et le plus tôt possible compte tenu du caractère cumulatif et capitalisé de ce dividende.
Les porteurs d’actions de préférence et leur représentant éventuel au sein du conseil d’administration ne sont intéressés à la création de valeur que jusqu'à hauteur du plafond prévu dans l’option de rachat. Au-delà, leur intérêt est que les investissements soient limités pour maximiser les résultats et la liquidité de l’entreprise, d'où une source de conflits d'intérêts entre les porteurs des différentes catégories d’actions.
Par construction, un entrepreneur est optimiste et pense souvent créer dans son secteur un nouvel Iliad ou Gemalto. Dès lors, il peut être attiré par l’apparence de ce type d’actions de préférence, qui en cas de grande réussite lui est plutôt favorable. Qu’il sache que c’est une catégorie où, du fait de la grande liberté contractuelle, le meilleur peut côtoyer le pire sous une appellation commune. Nous ne saurions donc trop lui conseiller d’examiner de près les clauses d’un contrat d’actions de préférence et de réfléchir aux conflits d’intérêts potentiels qu’elles portent en leur sein.
Il nous est arrivé de voir un cas où un entrepreneur ayant fait cette analyse, a décliné une telle proposition d’investissement. Il s’est vu immédiatement proposer par le même intermédiaire une augmentation de capital par actions ordinaires avec un engagement à prendre par l’entrepreneur de rachat de ces actions à 140 % du montant souscrit au bout de 5 ans.
On n’est plus là dans le domaine des capitaux propres, mais clairement dans celui des dettes, non pas au niveau de la société, mais au niveau personnel de l’entrepreneur.
Dans un premier temps, comme ce n'est pas l’entreprise qui s'endette, ses capitaux propres sont renforcés et sa capacité éventuelle d’endettement n’est pas en apparence obérée. Cette nouvelle dette au niveau de l’entrepreneur est en quelque sorte junior par rapport aux dettes éventuelles de la société.
Le taux d’intérêt de cette dette (7 % hors commissions) est relativement faible pour ce qui est en fait une dette junior, mais ne doit pas faire oublier le risque pris par l’entrepreneur. Si tout va très bien, il n'y aura pas de sujet, il remboursera cette dette en faisant verser par son entreprise un dividende à son profit et, si besoin est, pour le financer il fera entrer de nouveaux actionnaires à ce moment-là.
Mais si dans 5 ans l’entrepreneur fait face à des difficultés, par exemple car son concept n’aura pas été prouvé ou aura vieilli, ou parce qu'un concurrent plus efficace sera apparu, etc., il aura plus de mal à se faire verser un dividende ou à faire entrer de nouveaux actionnaires. Il y a de fortes chances qu’il soit alors contraint de vendre tout ou partie de l’entreprise pour rembourser sa dette personnelle. Ne parlons pas du cas où l’entreprise ne vaudrait rien mais où la dette serait toujours à rembourser.
Bien évidemment comme il s’agit d’une dette déguisée en capitaux propres, l’entrepreneur ne bénéficiera pas d’un accompagnement de la part de ces investisseurs, à la différence de celui apporté par des business angels ou fonds d’investissement apportant des vrais capitaux propres, des conseils et un réseau.
En fait, nous avons du mal à voir dans quel cas un entrepreneur bien conseillé financièrement pourrait accepter un tel schéma. En effet si le niveau de maturité de son entreprise lui permet de prendre le risque de la dette, l’entrepreneur trouvera, dans les conditions actuelles de marché, des prêts sur 5 ans à moins de 7 % par an hors frais. Et si le niveau de maturité de son entreprise ne lui permet pas de prendre le risque de la dette, un recours au financement participatif, à des business angels ou à des fonds d’investissement ne dévoyant pas les actions de préférence est beaucoup plus indiqué.
Mais tous les entrepreneurs ne sont pas bien conseillés. Nous ne saurions donc trop leur suggérer de toujours demander à un tiers (avocat, conseiller patrimonial, banquier, professionnel de l’investissement, etc.) un second regard et d’analyser un outil de financement sous ces conséquences les plus pessimistes : seuls les paranoïaques survivent ! (Andrew Grove fondateur d’Intel).
Des capitaux propres devenant des dettes est une dérive bien connue d’investissements réalisés, non en raison de leurs caractéristiques propres, mais par un intérêt fiscal, ici réduire l’ISF dû. Le processus est rodé. Il y a d’abord un avantage fiscal consenti par les Pouvoirs Publics en contrepartie d’un risque pris. Puis, devant la matérialisation des risques, des intermédiaires et ou des investisseurs mettent au point des schémas pour réduire le risque sans que l’avantage fiscal ne soit remis en cause.
Le produit est dévoyé : l’entrepreneur inconscient qui devait bénéficier de capitaux propres s’est en fait endetté, l’investisseur prend un risque minimisé et bénéficie d’un avantage fiscal massif (réduction d’impôts de 50 % de son investissement), et l’intermédiaire prélève des commissions non justifiées par sa prise de risque ou son ingénierie. Nous les avons observées dans les années 1990 pour les Sofica dans le financement des films. Elles sont à l’œuvre dans le capital risque français. Un nouvel effet pervers de l’ISF.
Pour terminer, évoquons l’obligation convertible qui ne prétend pas être des capitaux propres, sauf dans l’esprit de l’entrepreneur novice en finance qui veut limiter sa dilution en capital et pense émettre aujourd’hui des actions à un prix supérieur à leur valeur, tant leur conversion va pour lui sans dire. C’est confondre miracle et mirage !
L’obligation convertible est un produit utile et intelligent dans un certain nombre de circonstances, mais qui n’est pas adapté à des entreprises à un stade trop précoce de leur développement lors que leur modèle économique n’est pas encore démontré avec certitude. A ce stade, l'enjeu n'est pas d'éviter la dilution ou de la minimiser, mais de démontrer que l'entreprise est viable. Mieux vaut une plus petite part dans une entreprise qui a eu le temps nécessaire pour démontrer sa viabilité qu'une grande part dans une entreprise qui court à la faillite ou dont le passif doit être restructuré, car dans ce cas la dilution sera massive.
Dans quelques années, lorsque la génération de flux de trésorerie disponible positifs ne fera plus de doute, il sera temps de réfléchir à émettre des obligations convertibles.
* * *
Formation à la gestion de trésorerie et des risques financiers
La fonction Trésorerie a connu une double révolution depuis la fin des années 1990. Elle est très impactée par la mise en place de S.I de gestion de trésorerie, rendus indispensables pour l’intégration et l’automatisation croissante des données. D’une fonction d’expertise, elle devient une fonction stratégique, de plus en plus ouverte sur les autres métiers de l’entreprise.
En partenariat avec le Vernimmen, Francis Lefebvre Formation vous propose une journée de formation consacrée aux chantiers 2014 et 2015 de la fonction Trésorerie : la gestion du risque de change dans un contexte d’euro faible, la gestion des flux et des risques associés dans les pays émergents, l’impact des aspects réglementaires.
Objectifs de la formation
-
Savoir identifier les points de vigilance en matière de gestion des risques de liquidité, de change, de taux, et de fluctuation des cours de matières premières.
-
Mesurer les impacts comptables des risques financiers et de la mise en œuvre des instruments de couverture.
-
Appréhender la fonction trésorerie au sein d’une entreprise internationale en tant que véritable fonction de « risk management ».
Programme de la formation
-
L’évolution des sources de financement des entreprises et la gestion du risque de liquidité depuis la crise de 2008 : quel impact sur la fonction Trésorerie aujourd’hui ?
-
La recherche de sources de financement diversifiées.
-
La nécessité d’assurer une adéquation avec des besoins business à court terme difficilement prédictibles.
-
Le rôle des partenaires financiers.
-
La bonne utilisation des S.I de gestion de trésorerie évolutifs permettant de gérer les nouveaux risques financiers
-
La mise en place de solutions de cash management (cash pooling, netting, payment factory) :
-
Caractéristiques de chacune des solutions.
-
Comment faut-il analyser les avantages et inconvénients des solutions de cash management eu égard au contexte considéré.
-
En quoi la centralisation du risque de taux et de change peut-elle constituer une pratique intéressante pour les groupes ?
-
L’intérêt d’adopter une gestion différenciée du risque de change selon le secteur d’activité ou le niveau de risque
-
La comptabilisation des opérations de couverture en normes IFRS : quels sont les impacts au compte de résultat et au bilan ?
-
Une préoccupation croissante : la gestion des flux dans les pays émergents (contraintes de liquidité, contrôle des changes...)
Pédagogue
Benoit ROUSSEAU, Directeur de la Trésorerie et des Assurances de la société Fromageries Bel. Après un début de carrière dans les activités de marché d’un groupe bancaire, Benoit ROUSSEAU rejoint le monde de l’entreprise dans les années 90. Il devient VP Group Treasurer de EADS en 2002. Il bénéficie d’une solide expérience des fonctions de trésorerie au sein de multinationales et maitrise les problématiques liées à cette fonction aussi bien dans les pays « développés » que dans les pays « émergents ».
Prochaines sessions
Les 12 mars et 12 juin 2015 à Paris.
Pour s’inscrire et plus de détails, cliquez ici.
Tableau : Rachats d'actions et dividendes en 2014
Avec 10,2 Md€ de rachats d’actions en 2014, les entreprises du CAC 40 ont accru de 55 % les restitutions de liquidités sous cette forme à leur actionnaires, à charge pour eux de les investir auprès de sociétés qui ont besoin de capitaux propres.
Ce montant s’explique à hauteur de 6 Md€ par la sortie partielle de Nestlé du capital de l’Oréal (de 29 à 24 %). Sans celle-ci, le montant 2014 des rachats d’actions aurait été de 4,2 Md€, soit sensiblement égal aux 4,4 Md€ de 2013 retraités de deux opérations similaires de sortie d’actionnaires significatifs par rachat d’actions.
On reste, sans surprise vue la conjoncture économique, loin du plus haut de 2007 (19,2 Md€) :
Source : Compilation des informations réglementées publiées par les sociétés
9 groupes ont procédé à des rachats d’actions significatifs en 2014 contre 13 en 2012 et 12 en 2012. Mais deux trustent 78 % du volume (L’Oréal et Sanofi), et en ajoutant Vinci on obtient 86 %. Sans surprise, Airbus qui avait effectué en 2013 un rachat d’actions de 2 Md€ pour faciliter la sortie de Lagardère et de Daimler de son capital, s’est abstenu en 2014. De même pour Publicis qui y avait aussi eu recours en 2013 pour 181 M€ pour parachever la sortie de Dentsu de son capital. Ceci correspond bien à la nature totalement discrétionnaire de cette forme de distribution de liquidités aux actionnaires qui peut être arrêtée à tout moment[1].
Comme l’année passée, aucun groupe du CAC 40 n’a procédé à des cessions significatives de titres auto détenus, reflet dans la plupart des cas d’une bonne situation financière des membres de l’élite françaises des groupes.
Coté dividendes, 46 Md€ ont été versés en 2014, soit une progression de 25 % par rapport à l’an dernier, mais de 5,5 % une fois neutralisée la distribution d’actions Hermès par LVMH. Avec l’exemple de L’Oréal, celui de LVMH nous rappelle que le dividende ou les rachats d’actions peuvent avoir une autre utilité que de transférer des liquidités aux actionnaires.
7 groupes (hors LVMH) ont choisi cette année de proposer un paiement en tout ou en partie de leurs dividendes en actions, ce qui montre qu’ils estiment avoir besoin de capitaux propres complémentaires sans néanmoins oser faire une augmentation de capital classique. On remarquera que Danone en fait partie pour 544 M€, alors qu’il avait procédé à des rachats d’actions pour 799 M€ en 2013. Les politiques financières peuvent évoluer avec l’environnement et la conjoncture…
Source : Compilation des informations réglementées publiées par les sociétés
Comme les années précédentes, le trio de tête des versements de dividendes (hors LVMH) représente de l’ordre du tiers des dividendes versés, il est à l’identique de l’an dernier composé de Total, Sanofi et GDF Suez. Si on ajoute EDF, Orange et BNP Paribas, on atteint avec 6 groupes presque 50 % des dividendes. Comme quoi, même au sein du CAC 40, les inégalités sont criantes !
Alcatel Lucent et Alstom se retrouvent seuls cette année à ne pas verser de dividendes au titre de 2013, mais l’un était en perte et l’autre avait une structure financière à la limite de la zone investment grade et a donné rendez-vous à ses actionnaires en 2015 pour le paiement d’un dividende exceptionnel très important après la cession de ses activités Equipement Electriques à General Electric.
Source : Compilation des informations réglementées publiées par les sociétés
Le taux de distribution des entreprises du CAC 40 qui ont versé un dividende (et hors LVMH) est de 50 %, un peu au-dessus de la moyenne à 5 ans (47 %) ou à 10 ans (45 %), et contre 45 % l’an passé. La moitié de la hausse du taux de distribution est à mettre sur le compte du retour en meilleure forme de la Société Générale et du Crédit Agricole qui avaient, l’an passé, fait baisser temporairement la moyenne.
Rappelons[2] à notre lecteur qui serait tenté de leur jeter la pierre que le seul critère financièrement pertinent d’appréciation d’une politique de distribution est le taux de rentabilité marginale des fonds réinvestis, sans parler de la capacité des entreprises à en verser un compte tenu de leur objectif de structure financière. Le dividende n’est ni une idole ni une icône !
Recherche : Détention de liquidités et risque de refinancement
avec la collaboration de Simon Gueguen - Enseignant-chercheur à Paris Dauphine
Entre le milieu des années 80 et la fin des années 2000, les entreprises américaines ont très substantiellement augmenté le niveau de leur trésorerie (le ratio trésorerie-sur-actif a doublé), sans que ce phénomène soit clairement expliqué par la recherche. Dans un article récemment publié[1], trois chercheurs constatent que, durant la même période, la maturité de la dette des entreprises s’est fortement réduite. Une maturité de la dette plus faible signifie un refinancement plus fréquent et un risque de refinancement plus élevé. En détenant plus de cash, les entreprises parviendraient à réduire ce risque. Les auteurs de l’article établissent le lien de causalité suivant : les entreprises décident de détenir davantage de cash afin de réduire leur risque de refinancement.
Sur un échantillon large d’entreprises américaines utilisé pour l’étude, la maturité moyenne de la dette bancaire et financière est passée de 10,9 ans à 5,6 ans[2] entre 1985 et 2008. Dans le même temps, les caractéristiques des entreprises ont changé. Les auteurs montrent d’abord que le niveau de trésorerie n’est pas lui-même un facteur explicatif de la baisse de la maturité. Au contraire, après prise en compte des autres facteurs, une trésorerie plus élevée a tendance à augmenter la maturité de la dette[3].
L’étude peut ensuite évaluer l’impact d’une variation de la maturité de la dette sur le niveau de la trésorerie. Sur l’échantillon testé et toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de 1 % du taux de dette ayant une maturité inférieure à 3 ans entraîne une augmentation de 2,4 % du ratio trésorerie-sur-actif. Sur la période étudiée, la diminution de la maturité explique le tiers de l’augmentation de la trésorerie, et constitue le meilleur facteur explicatif.
Un autre résultat intéressant de l’étude concerne la valeur de ce cash. Pour les entreprises se situant dans les 20 % ayant la plus faible maturité, un dollar de cash contribue à 1,14 dollar de valeur pour l’entreprise, alors que pour les autres la contribution est de 0,89 dollar. Le raisonnement est le suivant : pour les entreprises ayant un faible de risque de refinancement, détenir du cash est destructeur de valeur en raison de problèmes d’agence. Mais pour celles qui ont un risque de refinancement, le cash peut contribuer à réduire ce risque et devient créateur de valeur. L’effet est encore plus net lorsque les conditions sur le marché du crédit sont difficiles.
Le canal de transmission privilégié (et vérifié) par les auteurs entre maturité de la dette et niveau de trésorerie est la politique d’investissement. Les entreprises qui présentent un risque de refinancement ont tendance à renoncer à de bons projets. Un niveau de trésorerie élevé permet d’atténuer le sous-investissement de ces entreprises.
Au-delà de l’argument technique permettant d’expliquer la tendance à la hausse du niveau de trésorerie des entreprises américaines, cet article (qui n’inclut pas dans sa période d’analyse la dernière crise) confirme l’interdépendance des différents aspects de la politique financière.
Q&R : Qu'est-ce qu'une dette portable ?
Une dette portable est une dette pour laquelle un changement de contrôle de l'emprunteur ne déclenche pas un remboursement par anticipation de la dette. Classiquement les prêteurs se protègent d’un changement d’actionnaires, qui peut résulter en un changement de stratégie d’entreprise et donc de risque de leurs crédits, par un clause d’exigibilité anticipée de leurs créances.
Les dettes portables sont apparues en Europe en 2013, pour des emprunts obligataires high yield d'entreprises sous LBO. Cette technique facilite le changement de contrôle d'une entreprise sous LBO puisque l'acheteur peut de ce fait n'avoir aucun financement nouveau par dettes à monter, réduisant ainsi son incertitude et ses frais, quitte à ultérieurement refinancer cette dette.
La portabilité de dettes, qui est favorable aux prêteurs et moins aux investisseurs, est apparue en raison d'un afflux massif d'investisseurs cherchant du rendement dans un contexte de baisse des taux d'intérêt.
Autre : NOS LECTEURS ECRIVENT : DCF, EVA et OI : trois approches de la valeur de l'entreprise
Par François Meunier
On utilise en général, pour évaluer une entreprise, l’approche par les flux de trésorerie actualisés (DCF). On rencontre aussi la notion de création de valeur (EVA ou economic value added), qui jouit d’une certaine popularité. Moins connue enfin, on trouve la notion d’opportunités d’investissement ou d’options de croissance (OI). Ces trois approches donnent des résultats identiques, ce qui est heureux mais pas forcément intuitif. Le rapprochement entre elles trois est très utile parce qu’à chaque fois un regard particulier est offert sur l’entreprise et la marche de ses affaires. Si l’on retourne aux papiers fondateurs de Modigliani-Miller[1], ces concepts étaient parfaitement en place dès le début des années 1960 et les analystes qui viennent sur le marché avec une prétendue nouvelle formule pour l’évaluation des entreprises ne font, souvent sans rendre crédit, que reprendre l’une ou l’autre des notions figurant dans ces travaux. La pièce jointe au présent article [disponible sur le site vernimmen.net en cliquant ici] donne une présentation qu’on espère à la fois simple, rigoureuse et euristique de l’équivalence entre ces trois notions, avec un formalisme mathématique minimal. On se contente ici de rappeler les trois définitions.
-
Approche DCF
Elle définit la valeur de l’entreprise comme la somme actualisée des flux nets de trésorerie de l’entreprise. Il s’agit du flux que l’entreprise est en mesure d’extraire de son exploitation au profit de ses investisseurs en conservant son chemin de croissance[2].
Le flux net de trésorerie pour une période donnée s’obtient comme la différence entre le résultat d’exploitation et le flux d’investissement net. Le résultat d’exploitation est corrigé de l’impôt à dette nulle (on parle aussi de REMIC) de façon à bien isoler ce qui relève de l’exploitation de ce qui relève du financier. L’investissement est en capital fixe et en capital circulant. Il est net de la dépréciation du capital. Le cout du capital est homogène aux flux ainsi définis, en particulier à un cout net de la dépréciation du capital.
-
Approche par les opportunités d’investissement
La présentation sous forme de flux de trésorerie est immédiate pour un directeur financier, et aujourd’hui pour une population plus large sachant la diffusion de la culture financière. Mais très souvent l’investisseur qui acquiert une entreprise raisonne différemment. Il valorisera l’entreprise comme d’une part la valeur de l’actif à aujourd’hui, qui jouit donc d’une certaine rentabilité, à savoir le résultat d’exploitation des équipements et autres actifs en place ; de l’autre le revenu d’exploitation tiré de chaque nouvelle tranche d’investissement qu’il aura ou non la possibilité de faire dans le futur. C’est l’approche en opportunités d’investissement.
Pour faire le lien avec l’approche en DCF, il est nécessaire de raisonner en « génération d’investissement », c'est-à-dire de considérer que le résultat d’exploitation obtenue à une période donnée est la somme des rentabilités que chaque génération d’équipements réalisée lors des années passées permet d’obtenir. Quand la DCF actualise le résultat d’exploitation obtenue chaque année, l’approche en OI valorise d’abord le flux net tiré d’une génération d’investissement, puis en fait la somme en prenant en compte l’actualisation. Le résultat est identique.
-
Approche EVA
L’EVA ou economic value added est le gain – ou la perte si c’est négatif – dont bénéficie l’entreprise à disposer d’une rentabilité de son actif économique supérieure (pour une génération donnée d’investissement) au cout d’opportunité de ce même actif, le cout d’opportunité étant naturellement le cout du capital de l’entreprise. La notion remonte à l’article de 1961 de Modigliani-Miller (où elle est désignée comme la « stream of earnings approach »). Un cabinet d’analyse financière américain, Stern Stewart & Co, a eu le toupet au début des années 90 de s’attribuer cette notion et a même réussi à faire enregistrer des droits d’auteur sur elle, sous le terme EVA®. La dénomination est d’ailleurs malheureuse, sachant la confusion possible avec la notion comptable de valeur ajoutée. Les termes de surprofit, sur-rentabilité, création de valeur ou rente économique seraient plus appropriés. Mais l’acronyme EVA est passé dans le langage courant des financiers.
L’entreprise tire en effet un avantage compétitif à maintenir une rentabilité des capitaux engagés supérieure à son cout du capital. Beaucoup de facteurs peuvent y contribuer : des positions de monopole, des brevets et licences, des rendements d’échelle non constants[3], une avance dans l’innovation par rapport aux concurrents, etc. De là, on tire une présentation de la valeur de l’entreprise comme étant la somme actualisée de ces EVA ou gains d’opportunités, à laquelle s’ajoute la valeur initiale de l’actif économique à son cout de remplacement[4].
Là encore, la décomposition de l’actif économique en générations successives d’investissement permet de relier cette notion aux deux précédentes. On renvoie à la note sur le site vernimmen.net pour un exposé plus précis. Mais il suffit de noter que l’EVA actualise non pas les flux nets de trésorerie comme dans la DCF, mais les flux bruts, à savoir les résultats d’exploitation, y compris sur l’équipement en place au moment t=0 de la valorisation. Il faut donc pour compenser retrancher le cout d’opportunité du capital à chaque période.
[1] Notamment : « Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares », The Journal of Business, vol. XXXIV, oct. 1961, n°4.
[2] Si l’entreprise ne distribue pas effectivement ce résultat à ses investisseurs, elle le garde sous forme de trésorerie à son bilan, c'est-à-dire, financièrement et comptablement, en réduction de sa dette et en augmentation de ses fonds propres.
[3] En cas de rendements d’échelle constants, un résultat standard de microéconomie montre que la maximisation du profit ou de la valeur de l’entreprise conduit à un profit net nul, c'est-à-dire après rémunération du capital à son cout d’opportunité. La valeur de l’entreprise est alors égale à la valeur de son actif économique à son cout de remplacement.
[4] Ce que certains appellent MVA, ou market value added.