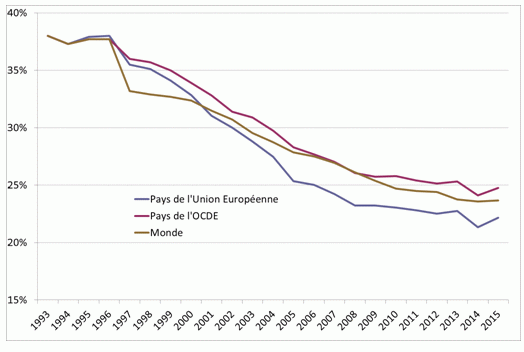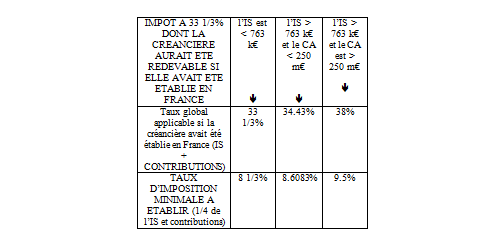La Lettre n°133 de Août 2015
Actualités : Le reporting intégré une solution à l'avalanche d'information ?
Vous cherchiez une lecture pour finir l’été ? Si vous avez quelques semaines, vous pouvez vous attaquer aux rapports annuels des sociétés du CAC 40, un bel opus de plus de 14 000 pages (soit 6 fois plus long qu’A la recherche du temps perdu, 10 fois Le seigneur des anneaux, 12 fois le Vernimmen 2015 ou 2016…). Il aurait fallu à notre lecteur environ 3 fois moins de temps il y a une vingtaine d’années pour se délecter de ces rapports annuels. On a vu en effet passer le rapport annuel moyen de quelques 100 pages à 350 pages aujourd’hui. Le passage aux IFRS (et l’évolution de ces normes) est certainement responsable d’une part importante de cette augmentation mais le nombre croissant de données non comptables à intégrer (données environnementales, corporate governance) a également joué dans le même sens.
Il n’en fallait pas tant pour qu’une part importante des utilisateurs naturels de ces documents (investisseurs, analystes, banquiers, …) se considèrent maintenant exonérés de la lecture de ces rapports pourtant toujours très instructifs. Il est vrai que nombreux sont ceux qui avaient démontré dès les années 2000 que la lecture des rapports annuels était optionnelle pour eux, souvent à leurs dépens au demeurant.
Au-delà des rapports annuels et autres documents périodiques, les entreprises cotées (et en particuliers les grands groupes) disposent aujourd’hui de nombreux moyens de communication à commencer par leur site internet, les réseaux sociaux ou encore les présentations aux analystes.
La qualité, quantité et l’ordonnancement de l’information périodique écrite varie d’une entreprise à l’autre. Le niveau d’information périodique est très variable. Cette disparité pourrait s’accroître alors que la diffusion d’information trimestrielle n’est plus obligatoire depuis fin 2014. En termes d’information annuelle, au-delà du document de référence ou son équivalent, certains groupes publient un rapport annuel, d’autres un rapport d’activité et de développement durable, ou encore un rapport sociétal, un rapport environnemental et social…
La quantité d’information disponible est donc aujourd’hui à la fois beaucoup plus importante et plus difficile à saisir et à synthétiser.
Cette surabondance d’information est un sujet pour les autorités réglementaires. Dès 2012, l’ANC avait publié des recommandations sur le volume d’annexe en normes IFRS. En 2013, l’IASB a lancé le projet Disclosure Initiative qui a abouti dans un premier temps à la modification de l’IAS 1 mais qui doit se prolonger[1]. L’AMF a publié en juillet 2015 un « Guide sur la pertinence, la cohérence et la lisibilité des états financiers »[2] .Ces recommandations sont focalisées sur les états financiers mais ne traitent pas des informations extra-comptables.
Un nouvel outil de communication des entreprises est en train d’émerger : le reporting intégré. C’est un document de synthèse permettant d’appréhender le modèle économique de l’entreprise, (en pratique les grands groupes), et donc son mode de création de valeur.
Le développement de ce projet s’est (très) structuré autour de l’International Integrated Reporting Council[3] (IIRC) et d’entreprises partenaires. La démarche se veut consensuelle avec la mise en avant de propositions et la publication des réactions à ces propositions. Un certain nombre de grands groupes se sont engagés au niveau mondial dans la réflexion, quelques-uns ont publié leurs premiers rapports Intégrés (ENI, Akzo Nobel, Novo Nordisk, …). En France Engie a publié en 2015 son premier rapport, d’autres y travaillent (Danone).
Les deux objectifs du reporting intégré sont :
-
d’une part d’inclure dans un seul et même document des données financières, économiques, des éléments de stratégie et des engagements et réalisations sociales et environnementales,
-
d’autre part d’aboutir à un document synthétique et donc court.
A titre d’exemple, le document d’Engie (Rapport intégré 2015) comporte 50 pages réparties en 8 chapitres :
-
Vision
-
Enjeux
-
Stratégie et objectifs
-
Analyse des risques
-
Gouvernance et processus de décision
-
Performance
-
Indicateurs
-
Perspectives
Très œcuménique, le rapport se veut donc utile à un très large éventail d’intervenants : investisseurs, partenaires, clients, fournisseurs, autorités. Les apôtres de l’<IR>[4] mettent en avant qu’au-delà de l’information des parties prenantes, la démarche permet également de décloisonner l’entreprise et d’imposer un dialogue entre les différentes équipes (RH, Finance, CSR). Mais à vouloir tout regrouper de manière synthétique, ne perd-on pas l’intérêt pour la plupart des lecteurs ? L’<IR> n’est-il alors qu’une brochure de « chiffre clés » ou de « faits essentiels » qui existait déjà mais dans un format plus moderne ?
Certains mettent en avant le formalisme des rapports annuels pour éviter de les ouvrir. Ou pour se contenter de documents plus synthétiques. Ce n’est certainement pas une solution ! Les rapports intégrés ne peuvent être considérés par la sphère financière que comme un complément au document de référence. Les promoteurs de l’<IR> le revendiquent d’ailleurs comme tel. C’est donc bel et bien un rapport de plus !
L’intérêt du rapport intégré semble donc résider dans son approche de la stratégie de l’entreprise mais alors soit le document reste très général et il ne sert alors pas à grand-chose, soit il en dévoile plus et il risque alors d’être très utile à la concurrence. Mais n’est-ce pas là l’équilibre à trouver de toute communication financière ?
Notons que nous sommes dans un monde à deux vitesses (voire trois) : les sociétés ayant émis un instrument coté (action ou obligation) diffusent une information pléthorique alors que les sociétés non cotées protègent jalousement leurs informations. C’est là bien un frein à la cotation ou à l’émission d’obligations.
Le marketing autour de l’<IR> est important ce qui nous rend naturellement méfiant… il nous rappelle un peu celui autour de l’EVA[5] qui avait eu ses afficionados avant de retomber dans l’oubli ! Si le concept d’<IR> prend effectivement, il va certainement générer sa propre économie (terminologie politiquement correcte pour dire des coûts) : consultants (les grands cabinets comptables avancent déjà leurs pions), mobilisation de ressources internes à l’entreprise. Néanmoins, l’intérêt exprimé par un grand nombre de grands groupes indique que les entreprises y voient une utilité et donc un intérêt potentiel (meilleure valorisation de leur titre, plus grande adhésion des employés et autres stakeholders). Ne soyons donc pas catégoriques. Le temps dira si ce document est utile à certains, s’il viendra se substituer à d’autres ou se rajouter. Une chose est sûre, pour l’analyste financier, le document de référence restera le document essentiel !
[1] http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Disclosure-Initiative/Pages/Disclosure-Initiative.aspx
[2] http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/867e30e0-807f-437c-af31-ee2686d81c4e_fr_1.0_rendition).
[4] Integrated reporting bien sûr !
[5] Voir le chapitre 31 du Vernimmen 2015
Tableau : Les taux d'impôt sur les sociétés dans le monde
Le taux moyen d’impôt sur les sociétés dans le monde s’établit en 2015 à 23,68 % en légère hausse (de 0,11 point), la première depuis 1995. Dans l’Union Européenne, la moyenne est à 22,15 % grâce à la Suède 22 %, le Royaume-Uni à 20 %, la Pologne à 19 %. L’an prochain l’Espagne sera à 25 % niveau actuel des Pays–Bas. A côté de chez nous, la Suisse est à 18%, la Russie à 20 %. Et la France est à 38 %, sans compter les impôts locaux et les prélèvements sociaux et divers.
Taux faciaux d’impôt sur les sociétés dans les pays de l’Union européenne, de l’OCDE et dans le monde (Source : KPMG)
L’écart entre la France et le Royaume-Uni est maintenant pour les groupes de 18 points. Autrement dit le même bénéfice avant impôt se traduit par un résultat après impôt de 29 % supérieur outre-manche à ce qu’il est ici, et donc par un autofinancement supérieur. Et comme on croit comprendre que le projet du gouvernement de réduire le taux de l’imposition sur les sociétés français à 30 % sera à coût budgétaire nul, de nouvelles taxes étant créés pour compenser, cet écart n’est pas prêt de se réduire, malheureusement pour la compétitivité des entreprises françaises.
Comme Henri Lagarde l’a très bien montré [1] ces taux ne sont que des taux faciaux qui cachent des modalités d’application qui, en France, ont tendance à alourdir le taux effectif.
[1] Voir La Lettre Vernimmen.net n°110 d’octobre 2012
Recherche : Agences de notation : plus sévères pour les entreprises !
avec la collaboration de Simon Gueguen - Enseignant-chercheur à Paris Dauphine
Les agences de notation font régulièrement l’objet de critiques, parfois légitimes. Il leur fut reproché récemment d’avoir favorisé la crise des subprimes[1] en notant de manière trop indulgente les produits structurés. L’article que nous présentons ce mois[2] va à l’encontre de l’idée reçue selon laquelle ces agences attribueraient systématiquement des notes complaisantes à tous leurs clients en raison de leur modèle économique. Du moins, la tendance de long terme est-elle à plus de sévérité pour ce qui concerne les dettes d’entreprises.
L’essentiel de l’étude porte sur les notes attribuées par Standard & Poor’s, mais la corrélation avec les notes de Moody’s et Fitch est énorme (94%). La grille de note de cette agence est constituée de 21 niveaux, de AAA à C. Entre 1985 et 2009, le nombre de bonnes notes a diminué et le nombre de mauvaises augmenté. Dans le même temps, les taux de défaut d’entreprise à note équivalente ont diminué. Ainsi, la cause du phénomène n’est sans doute pas à chercher dans des conditions macroéconomiques plus difficiles mais plutôt dans le mode de notation des agences. Surtout, des entreprises de caractéristiques équivalentes (niveaux de dette court terme et long terme, niveau de cash, profitabilité, taille, tangibilité des actifs, etc.) sont notées plus sévèrement. La différence est notable, la note baisse en moyenne de 3 crans ! Une entreprise se situant dans la moyenne de celles qui obtenaient AAA en 1985 n’obtiendrait plus que AA- en 2009.
Dans la suite de l’article, les auteurs mesurent la « sévérité » par l’écart entre la note obtenue et la note théorique si le modèle de 1985 avait été maintenu. Cela leur permet de mesurer empiriquement les conséquences de ce conservatisme sur le comportement des entreprises d’une part, et sur le marché de la dette d’autre part. Ils montrent qu’une entreprise notée un cran plus sévèrement émet substantiellement moins de dette. La différence correspond à 0,2 % du total des actifs (pour une émission moyenne de 2,6 %). De même, le montant des acquisitions diminue et le niveau de cash détenu augmente. Voici peut-être une explication alternative à l’augmentation de la trésorerie des entreprises américaines que celle que nous avons présentée dans le numéro 129 de janvier 2015 (Détention de liquidité et risque de refinancement) !
Concernant les marchés du crédit, sans surprise la note a un impact sur le prix. A un cran de notation de perdu correspond une augmentation de la marge de 74 points de base (pb). Plus intéressant, à note équivalente, le spread est plus faible (de 9,5 pb) pour les entreprises qui sont notées sévèrement (et auraient donc obtenu une meilleure note en 1985). Autrement dit, les marchés compensent légèrement les effets de cette plus grande sévérité.
Très complet sur le plan de l’analyse empirique, l’article montre que les agences ont noté de plus en plus sévèrement les entreprises entre 1985 et 2009, et que les entreprises et les marchés en ont tenu compte. Pourquoi cette tendance ? Un effet d’apprentissage des erreurs passées ? Et qu’en est-il des notations des produits structurés ? Et des dettes souveraines ? Autant de questions pour de futurs travaux !
Q&R : Les ordres de Bourse
Les ordres de Bourse sont en général transmis par des prestataires de services d’investissement (PSI) qui peuvent ou pas être membres du marché. Les ordres sont définis par les caractéristiques suivantes :
▪ le nom du titre à traiter et son code (que l’on appelle code ISIN) ;
▪ le nombre de titres à traiter ;
▪ le sens de l’opération à réaliser (achat ou vente) ;
▪ la durée de validité de l’ordre ;
▪ le prix ;
▪ éventuellement la modalité de règlement si l’ordre est passé pour les titres éligibles au service règlement différé (SRD).
Si les trois premières caractéristiques sont évidentes, l’investisseur pourra choisir différentes options pour la durée de validité de son ordre et le prix auquel son ordre pourra être exécuté.
Lorsqu’un investisseur donne un ordre de Bourse, il doit préciser si son ordre est valable :
▪ « jour » : soit uniquement durant la journée de Bourse au cours de laquelle il est passé ;
▪ « à date déterminée » : autrement dit l’investisseur fixe une durée de vie pour son ordre (généralement quelques jours). Si l’ordre n’a pas pu être exécuté durant cette période, il sera annulé ;
▪ « à révocation » : l’ordre (sauf contre-ordre de l’investisseur) restera valable pendant toute la durée du mois (mois boursier pour les actions négociées avec le Service de règlement différé, mois calendaire pour les autres actions).
Suivant que l’investisseur veuille vendre ou acheter immédiatement et à n’importe quel prix, ou se soit fixé des objectifs de prix minimum ou maximum, il utilisera différents types d’ordre de Bourse :
▪ « l’ordre à cours limité » : un ordre de vente limité à 100 € ne pourra être exécuté que si le cours de l’action dépasse 100 €. Il pourra n’être exécuté que partiellement (si les quantités dans le livre d’ordre sont insuffisantes) ;
▪ « l’ordre à la meilleure limite » : l’ordre se transforme immédiatement en cours limité au prix actuel de l’action (ou au prix d’ouverture s’il est passé avant l’ouverture de marché). Si la liquidité est faible ou la quantité à traiter importante, cet ordre peut ne pas être exécuté totalement (si peu de personnes souhaitent traiter au prix actuel) ;
▪ « l’ordre au marché » est un ordre prioritaire, il est exécuté à n’importe quel prix. Ainsi, si l’investisseur souhaite acquérir 100 titres et que le carnet d’ordres fait apparaître un vendeur à 50 € pour 50 titres, un vendeur à 51 € pour 20 titres et un vendeur à 52 € pour 30 titres, l’investisseur va se porter contrepartie pour tous et obtiendra un prix moyen de 50,80 € pour ses 100 titres ;
▪ « l’ordre à seuil de déclenchement » ne commence à être valable que si le cours de l’action franchit à la hausse ou à la baisse (« stop loss ») un certain seuil, il devient alors un ordre au marché. Il permet notamment aux investisseurs de se protéger contre un krach ;
▪ « l’ordre à plage de déclenchement » (« stop limit ») ne s’active, tout comme le précédent, qu’à partir d’un certain seuil, mais il devient alors un ordre limite. Il permet donc de fixer une fourchette de prix pour l’exécution ;
▪ depuis l’ouverture à la concurrence en matière d’exécution d’ordre de bourse (conséquence de la directive « Marchés d’instruments financiers », MIF), un nouveau type d’ordre est apparu : « ordre meilleure place », qui doit permettre de diriger l’ordre vers la place de négociation offrant le meilleur prix.
Autre : NOS LECTEURS ECRIVENT : Les intérêts d'emprunt acquittes par les entreprises sont-ils toujours déductibles ?
La saga sur la déductibilité fiscale en France des intérêts s’est étoffée d’un nouvel épisode: le dispositif dit « anti hybride » sur charges financières. Qu’elle en est la logique ?
Par Christine Servey Chassaigne,
Enseignant associé, EM Strasbourg
RESUME DE L’ARTICLE
Une règle interne conditionne désormais en France la déductibilité fiscale des intérêts à la preuve de leur assujettissement à une imposition minimale chez l’entreprise bénéficiaire. En parallèle une règle européenne applicable depuis 2015 prévoit que les dividendes ne sont plus exonérés chez la bénéficiaire lorsqu’ils ont été déduits par l’entreprise débitrice. Ce dispositif européen taxant les flux «entrants» aurait suffi à lutter au sein de l’UE contre certains abus des groupes multinationaux, notamment en cas de recours à des instruments financiers hybrides pour déplacer la base taxable vers des juridictions à fiscalité « clémente ».
Dans un article précédent de la lettre Vernimmen.net n°116 de juillet 2013 nous avions détaillé les six dispositifs légaux, limitant en France pour les entreprises, la déductibilité fiscale des intérêts financiers.
Mais aux yeux du législateur, ces règles pourtant déjà complexes demeuraient insuffisantes! Elles ont ainsi été complétées en 2013 par une septième disposition, conditionnant la déductibilité des intérêts versés, à leur assujettissement à une imposition minimale au niveau de l’entreprise bénéficiaire (dispositif dit « de lutte contre LES INSTRUMENTS FINANCIERS HYBRIDES »).
Nous détaillons ci-après les règles correspondantes en précisant leur articulation séquentielle avec les dispositions préexistantes.
Nous établirons ensuite un parallèle avec le «nouveau dispositif applicable aux flux entrants» et prévoyant désormais, la taxation systématique en France des bénéfices distribués par les filiales d’entreprises françaises, dans la mesure où ces sommes auront été déduites par la distributrice. Ce dernier texte s’inscrit en effet lui aussi, dans le dispositif « de lutte contre les instruments financiers hybrides ».
Nous nous interrogerons alors sur la légitimité économique de cette double riposte française.
-
Le dispositif « anti hybride » sur les flux entrants : pour déduire des intérêts, l’entreprise française qui les verse doit démontrer l’imposition minimale de ces sommes chez la bénéficiaire
Comme le rappelle l’édition 2015 du VERNIMMEN dans son chapitre 37 (Structure financière, fiscalité et théorie des organisations), le traitement fiscal des intérêts afférents à la dette financière est sensiblement plus intéressant que celui des dividendes correspondants aux fonds propres, puisque les intérêts réduisent la base imposable.
Ce principe a toutefois été remis en cause en France à de nombreuses reprises avant 2013, par le biais d’un durcissement graduel de la loi fiscale. Ainsi, fin 2012, les entreprises avaient-elles déjà l’obligation de combiner six mesures complexes pour déterminer le montant des charges d’intérêts demeurant fiscalement déductibles
Mais un schéma d’optimisation fiscal subsistait: le recours aux instruments financiers hybrides, tels que les obligations remboursables en actions, ou les prêts participatifs. Ces instruments financiers, se caractérisent notamment, par une qualification juridique et/ou fiscale, souvent différente, selon que l’on se place du point de vue du débiteur (où ils sont assimilés à des titres de dette générant des intérêts), ou du créancier (où ils constituent souvent des titres de participation, rémunérés par des dividendes).
De nombreux groupes multinationaux avaient, dès lors, mis en place des schémas optimisants: une société créancière, résidente fiscale d’un état à fiscalité « forte » (par exemple française) choisissait de se financer auprès d’une autre entité du groupe, en recourant à des instruments financiers hybrides, qualifiés en France de dette financière. Mécaniquement, la base imposable de l’entreprise française se voyait réduite à concurrence des intérêts financiers connexes à cette dette. A l’inverse, l’entreprise créancière, opportunément située dans une juridiction où la fiscalité des produits financiers afférents à l’instrument hybride, était nulle ou très faible (par exemple du fait de leur qualification de « dividendes »), percevait des sommes en quasi exonération d’impôt.
In fine, un tel schéma laissait l’endettement financier net du groupe inchangé, mais permettait de réduire sensiblement l’impôt global acquitté auprès des administrations compétentes.
Qualifiant ces situations « d’abusives », le législateur français s’est emparé de cette question en intégrant un nouveau texte dans la Loi de Finances pour 2014.
Ainsi, pour les exercices clos à compter du 25 septembre 2013, la déduction des charges financières dues par une entreprise débitrice résidente française passible de l’IS à une entreprise créancière qui lui est liée, qu’elle soit ou non résidente française, est subordonnée à la démonstration par la « débitrice » que les produits correspondants, sont soumis à une imposition minimum, entre les mains de la « créancière », correspondant au quart au moins du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés français (CGI art. 212, I-b)., auquel s’ajoutent des contributions additionnelles (BOI-IS-BASE-35-50 n° 40).
Ce taux minimal constitue la référence, mais le produit financier en cause, ne doit pas nécessairement donner lieu au versement d’un impôt, et ce notamment en cas de charges déductibles venant diminuer le résultat taxable de l’entreprise créancière. En particulier, le fait que l’entreprise créancière soit déficitaire n’est pas rédhibitoire, pour la déductibilité fiscale des intérêts versés. En pratique, dans l’hypothèse (courante) où l’entreprise créancière est établie fiscalement hors de France, l’IS minimum à considérer, pour la comparaison, correspond à celui dont cette dernière aurait été redevable en France, sur de simples produits d’intérêts, si elle y avait été établie. Ceci revient à comparer le taux d’imposition applicable sur les produits perçus, à l’étranger par l’entreprise bénéficiaire des intérêts (quelle que soit la qualification des sommes et compte tenu des règles spécifiques d’assiette, des abattements, réfactions etc.), avec un quart du taux d’imposition français.
Compte tenu des taux actuels d’IS et de contributions, selon la situation de la société créancière, le taux minimal d’imposition à démontrer s’établit à :
Cette nouvelle mesure est couramment qualifiée de « dispositif anti hybride ». Pour autant il ne faut pas se méprendre: il s’agit là d’une disposition générale. Dans l’hypothèse, où la société débitrice des intérêts, ne peut pas démontrer l’imposition minimale au niveau de l’entreprise créancière, les intérêts sont non déductibles et ce, même en l’absence d’utilisation de produits financiers hybrides. Par exemple, les transferts de base taxable vers un pays à fiscalité privilégiée par recours à l’endettement sont clairement visés par le texte.
Les sommes correspondantes, ne sont toutefois, pas constitutives de revenus distribués, et échappent en conséquence à la taxe de 3% sur les distributions instaurée en 2012 (BOI-IS-BASE-35-50 n°230, 05-08-2014).
Comment ce nouveau dispositif se combine-t-il aux nombreuses règles déjà existantes, limitant la déductibilité des charges d’intérêts ? L’administration a précisé l’ordre d’application de ces mesures comme suit:
-
dispositifs relatifs au taux d'intérêts limite, rémunérant les sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée ou de limitation applicable aux intérêts servis aux associés, en fonction des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et non déductibilité des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des produits correspondants (dispositif « anti hybride ») ;
-
dispositif de lutte contre la « sous-capitalisation »;
-
dispositif de limitation de la déduction des charges financières afférentes à certains titres de participation (dispositif « Carrez ») ;
-
mécanisme du plafonnement général de déduction des charges financières nettes (dispositif du « rabot fiscal »).
Chacun des dispositifs mentionnés doit être appliqué successivement. Ils s'appliquent "nets" des charges financières à réintégrer en application du ou des dispositifs appliqués précédemment (BOI-IS-BASE-35-10 n° 70 et 80).
Pour plus de précisions sur la logique des mesures pré existantes nous vous invitons à vous référer à la lettre Vernimmen.net n°116 de juillet 2013.
-
Le dispositif anti hybrides sur les flux « entrants » : pour les « dividendes » perçus, provenant de France comme de l’étranger, l’exonération prévue par le régime mère-fille, est désormais subordonnée à la condition expresse que ces sommes n’aient pas été déduites du résultat de la filiale
Lorsqu’une entreprise dont les résultats ont été imposés, distribue des dividendes à ses associés passibles de l’IS, il y a un risque de double imposition. Heureusement des mécanismes permettent d’éviter cette « avalanche fiscale ». Au sein de l’UE, la Directive-Mère Fille évite la double imposition en exonérant purement et simple les dividendes. Ainsi, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont remplies (pourcentage et durée de détention) et sous réserve de la réintégration de certaines montants (quote-part de frais et charges), les entreprises françaises à l’IS sont exonérées sur les dividendes qu’elles perçoivent de leurs filiales (article 145 du CGI transposant les dispositions de la directive en droit interne).
Mais comme on l’a vu, certaines multinationales ont tiré profit de ces dispositions en recourant à des instruments financiers hybrides permettant de réduire la charge fiscale globale sans modifier l’endettement total.
Face à ces situations abusives, la France n’avait pas été la seule à réagir. La Commission Européenne avait également identifié cette problématique et avait annoncé la riposte qu’elle allait mettre en œuvre: la Commission a ainsi modifié la Directive Européenne « Mère Fille » courant 2014, en refusant l’exonération des dividendes chez la bénéficiaire, lorsque les sommes correspondantes ont été déduites par l’entreprise débitrice. Le législateur français a alors « fait diligence » à son obligation de transposition en droit interne et a complété la loi française en ce sens. L'article 145, 6-b du CGI exclut ainsi désormais pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, l’application du régime mère-fille par une entreprise française bénéficiaire, aux «produits des titres d’une société», dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ».
-
Conclusion: deux nouvelles mesures anti abus applicables en France, n’est-ce pas excessif ?
Comme nous l’avons expliqué, le recours à des instruments hybrides a par le passé, largement permis à certains groupes, sans modifier leur endettement global, de réduire leur charge fiscale. L’union Européenne a donc réagi et la France a adapté en conséquence, son droit interne pour application à compter de 2015.
Ces nouvelles dispositions anti abus, auraient tout à fait suffi à faire échec aux schémas d’optimisation visés.
Mais le législateur français s’était empressé d’anticiper, en se dotant dès 2013 de ses propres mesures répressives (cf. I ci-dessus), et ce alors même, que la Commission de Bruxelles avait annoncé son initiative de modification de la directive mère fille, dans un projet en date du 25 novembre 2013.
Y avait-il urgence?
Sous couvert de mesures anti abus, la France taxe maintenant non seulement certains flux « entrants » (dividendes reçus en France ayant fait l’objet d’une déduction en France ou à l’étranger) mais aussi certains flux « sortants » (intérêts français ne subissant pas une taxation minimale chez la bénéficiaire et ce, en France ou à l’étranger). Le législateur a ainsi augmenté doublement les recettes d’IS pour l’administration fiscale française.
On comprend aisément la logique budgétaire de ces initiatives. Mais on ne peut tout à fait adhérer aux justifications économiques mises en avant. L’initiative européenne de modification de la directive mère fille suffisait à faire échec aux schémas abusifs au sein de l’UE. Elle présentait de surcroit le grand avantage de constituer une réponse globale et coordonnée au sein des vingt-huit états de l’Union.