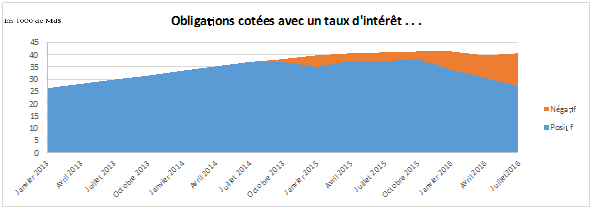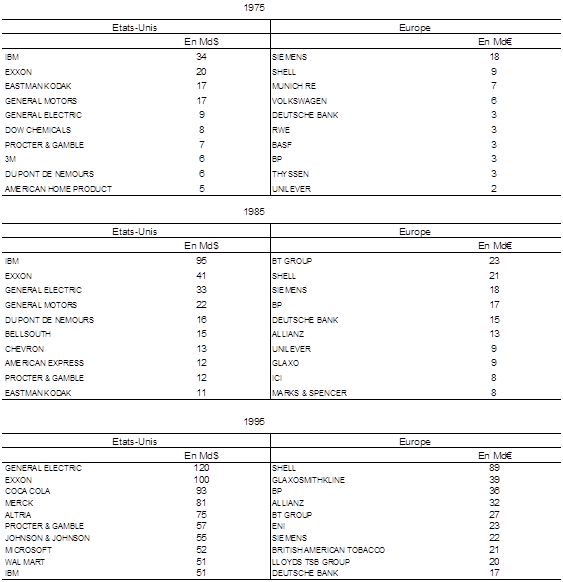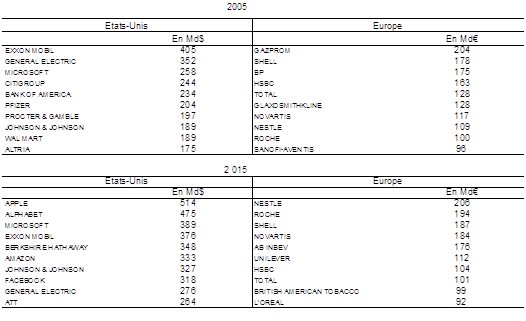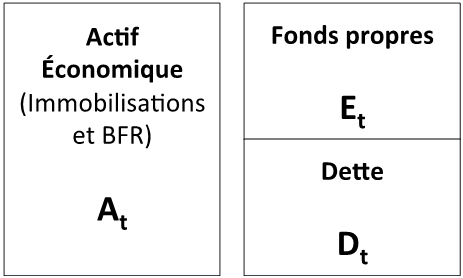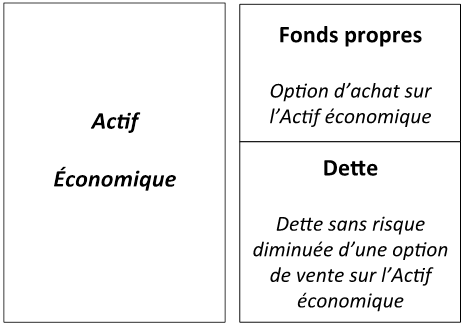La Lettre n°143 de Octobre 2016
Actualités : Des nouvelles de notre dernière initiative pédagogique
1200 personnes déjà formées à la finance grâce au digital
Nous avons conçu pour HEC Paris et First Finance un programme certifiant de finance d’entreprise entièrement digital qui permet à ceux d’entre vous qui veulent rafraichir leurs connaissances en finance d’entreprise, ou acquérir un niveau similaire à celui que nous transmettons à nos étudiants d’HEC Paris, de pouvoir le faire à leur rythme sur 5 mois.
En 18 mois, 1200 personnes ont suivi avec un haut niveau de satisfaction cette formation innovante qui débouche sur une certification d’HEC Paris en finance d’entreprise : l’ICCF @ HEC Paris.
Le programme couvre l’essentiel de la finance d’entreprise : analyse financière, évaluation de société, choix d’investissement et de financement. Il s’articule autour de sessions de cours par vidéos, d’études de cas d’application, d’échanges en direct avec Pascal Quiry à travers des « classes virtuelles » hebdomadaires ainsi que d’échanges actifs sur le forum entre les participants et Pascal Quiry. Ce programme est donc aussi un lieu unique d’interactions riches entre professionnels et passionnés de finance d’entreprise.
Chacun des trois thèmes traités se termine par l’étude d’un cas réel et récent ; l’ensemble du programme se termine par un test final.
La troisième promotion commence le 25 octobre 2016.
Pour en savoir plus sur ce programme, écouter les témoignages des participants, voir http://hecparis.ff.institute/fr/ ou la boîte aux lettres du site vernimmen.net pour échanger avec nous sur ce programme, destiné à partager efficacement les connaissances et pratiques accumulées, selon un format adapté à votre agenda professionnel ou privé.
Actualités : Gérer avec des taux d'intérêt nuls ou négatifs
A la fin de l’été 2016, le tiers des obligations cotées dans le monde, soit 13 700 Md$, qui rapportaient un taux de rentabilité inférieur à zéro :
Source : Bank of America Merrill Lynch
Même à dix ans, les emprunts d’État allemands rapportent un taux d’intérêt négatif (– 0,13 %). Quant à ceux de la République française, ils rapportent un microscopique 0,15 %. Ce phénomène n’est pas propre à la zone euro car on observe des taux d'intérêt négatifs aussi en Suisse, au Japon, au Danemark. Autrement dit, dans bon nombre de pays, le temps n’est plus rémunéré.
Regardons déjà le pourquoi des taux d’intérêt négatifs, le comment et les conséquences à en tirer pour la gestion financière de l’entreprise.
Pourquoi des taux d’intérêt négatifs ?
Parce que la Banque centrale européenne le veut. Et pourquoi le veut-elle ? Pour soutenir l’activité économique, permettre à des États très endettés de se financer et de rendre leur dette soutenable pendant qu’ils procèdent aux réformes tant de fois repoussées, voire organiser des transferts non-dits entre pays de la zone euro pour éviter qu’elle n’éclate.
La première raison est de façade. Il y a longtemps que la littérature académique a démontré que le vrai déterminant de l’investissement est la demande anticipée par les entreprises, et non le niveau de taux d’intérêt qui ne joue qu’en variable secondaire. Si la demande est faible, vous n’allez pas construire des usines parce que les taux d’intérêt viennent d’être divisés par deux. C’est d’ailleurs ce que l’on voit tous les jours. S’il suffisait de baisser les taux d’intérêt pour faire redémarrer l’économie, la zone euro n’aurait pas mis huit ans pour retrouver en 2016 son niveau de PIB de début 2008.
Les deux autres raisons sont très fortes. Pour se limiter à la France, la baisse des taux d’intérêt sur ses 2 135 Md€ de dettes lui a fait économiser 40 Md€ d’intérêt, soit deux points de PIB. On vous laisse faire le calcul pour l’Italie qui a actuellement des taux à 1,5 % contre plus de 6 % en 2012 sur une dette de plus de 2 200 Md€.
Enfin, les économistes pensent qu’une zone avec une monnaie unique ne peut être viable que si des transferts sont organisés au profit des parties les plus faibles, car la tendance naturelle du marché est de renforcer les forts et d’affaiblir les faibles. La Corse, l’Auvergne, la Corrèze seraient-elles ce qu’elles sont aujourd’hui au sein de la République française sans les transferts nets dont elles bénéficient ? Non.
Comme la charrue européenne a été mise avant les bœufs, en créant une monnaie unique sans convergence des politiques économiques ni budget spécifique à la zone euro permettant des transferts internes à la zone, la BCE agit par le canal des taux d’intérêt pour préserver l’euro, dans le droit fil de la déclaration de Mario Draghi du 26 juillet 2012 : « Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. » Autrement dit, les taux d’intérêt actuels, en dessous des taux normaux, sont une forme de transfert des fourmis de l’Europe du Nord vers les cigales de l’Europe du Sud. Il n’y a qu’à entendre les cris des épargnants allemands qui ne sont plus rémunérés pour s’en convaincre.
Mais cette situation ne pourra pas durer indéfiniment car elle a des effets secondaires nocifs (laminage des marges des banques, donc de leurs résultats et de leur capacité à faire croître les capitaux propres pour accompagner la demande de crédits qui commence à redémarrer, bulles sur certains actifs financés par des taux d’intérêt anormalement bas). Soit les États de la zone euro font converger rapidement leurs politiques économiques, budgétaires et fiscales, créent une solidarité et des transferts au sein de la zone, soit celle-ci éclatera. Et à côté, on jugera le Brexit comme une aimable plaisanterie.
Comment des taux d’intérêt peuvent-ils être négatifs ?
Il ne s’agit pas de demander aux prêteurs de verser chaque année des intérêts à l’emprunteur, car cela poserait des problèmes juridiques et matériels complexes (en particulier pour les obligations cotées, détenues par des centaines ou des milliers d’investisseurs).
Dans la pratique, on émet un titre pour un nominal de 100 qui rapporte par exemple du 0,2 % ou du 0 %, mais qui est vendu à 103 et remboursé à 100. Au Danemark, c’est le montant à rembourser qui a été réduit, par exemple à 97 et le prix d’émission correspond au nominal de la dette.
Ainsi dans notre premier exemple et avec une durée de cinq ans, on a un taux d’intérêt actuariel de – 0,3 % pour un coupon nominal de 0,2 %.
Outre l’ancrage dans l’opinion des investisseurs que produisent ses annonces, la BCE procède de différentes façons pour parvenir à ses fins : abaissement en mars 2016 de son taux directeur à 0 % (celui auquel les banques peuvent se refinancer), taux de dépôt à – 0,4 %, achats d’actifs de 80 Md€ par mois, soit toute la dette d’État allemande émise et 45 à 50 % de la dette française émise, y compris acquisition d’obligations d’entreprises bien notées, refinancement des banques à – 0,4 % pour celles qui accroissent leurs crédits. Et tout ceci jusqu’en mars 2017, voire au-delà.
En achetant ainsi pour des montants très significatifs des titres sur le marché secondaire, la BCE fait monter leurs prix et abaisse mécaniquement leur taux de rentabilité, y compris en dessous de 0 %.
Quelles conséquences pour la gestion financière de l’entreprise ?
Il ne faut pas se le cacher, la notion de taux d’intérêt négatif est pour le moins surprenante en plus d’être inhabituelle pour nombre de financiers d’entreprise, voire carrément perturbante. Les rares cas connus (Suisse en 1979, Allemagne et France dans un contexte quasi apocalyptique de dislocation des marchés financiers à l’automne 2008) ont été trop furtifs pour servir de référence.
Aussi, on ne sera pas surpris qu’un financier d’entreprise anonyme ait pu s’exclamer « Aujourd’hui, je suis payé par les investisseurs pour emprunter leur argent alors que je dois en donner pour pouvoir placer ma trésorerie sans risque. C’est le monde à l’envers ! »
Du coté des actifs
Le principal danger, nous semble-t-il, se trouve du côté de la gestion de trésorerie de l’entreprise.
En effet, un trésorier pourrait être tenté d’aller chercher du rendement que ne lui offrent plus du tout, voire même lui coûtent, ses SICAV monétaires habituelles ou ses certificats de dépôt favoris. On a ainsi pu voir des banques proposer à des entreprises de la zone euro des dépôts en livres sterling à un an rapportant 1 % et 1,2 % en dollars (début mars 2016). Certains trésoriers sont allés chercher du rendement sur des placements d’une durée supérieure à l’année, sur les émetteurs de la périphérie (banques italiennes, États espagnol ou portugais), voire dans les pays émergents ou sur le marché du high yield[1].
Ils ont alors oublié qu’un surcroît de rentabilité n’est possible qu’au prix d’un surcroît de risque. Notre trésorier novice, inconscient ou cupide, qui avait placé une partie de sa trésorerie en dépôts en livres sterling pour gagner 1 %, et non 0,01 % comme sur un dépôt en euro, avait belle mine fin juin quand, suite au Brexit et à la chute de la livre, son dépôt affichait une perte de 13 %. Tout cela pour 0,99 % de plus…
On ne répétera jamais assez qu’un surcroît de rentabilité n’est possible qu’au prix d’un surcroît de risque, et qu’en matière de gestion de trésorerie, les priorités absolues sont la liquidité et la préservation du capital, pas de réaliser des performances sur les placements de trésorerie.
Eh bien oui, il est tout à fait justifié pour un trésorier de préférer placer à – 0,4 % (taux de dépôt auprès de la BCE) plutôt que d’investir dans une SICAV de trésorerie rapportant du 0 %. Car 0 %, c’est 0,4 % de plus que le taux sans risque et c’est donc une prise de risque qui n’est ni connue précisément ni généralement contrôlée par le trésorier.
Après tout, l’entreprise paie bien une commission d’engagement sur ses lignes de crédit autorisées, mais non tirées. La liquidité a maintenant un coût explicite. Elle en aurait bien un si elle prenait la forme primitive de billets déposés dans un coffre-fort (location, assurance, manipulation).
Le trésorier ne doit pas, nous semble-t-il, avoir l’œil rivé sur l’actif du bilan de son entreprise, en bas, mais prendre de la hauteur. Il découvrira alors que la plupart des entreprises sont endettées pour un montant supérieur aux placements. Autrement dit, la perte de rendement qui pourrait le désoler sur des placements est largement inférieure au gain que la baisse des taux d’intérêt permet d’enregistrer sur le passif financier de l’entreprise. L’entreprise n’est pas pénalisée dans son compte de résultat en passant d’une trésorerie rapportant, par exemple, du 1 % et d’une dette coûtant du 3 %, à une trésorerie coûtant du 0,4 % avec une dette coûtant du 1,6 % ; la marge entre les deux est la même.
Quant à l’entreprise qui aurait des liquidités en excédent de ses dettes bancaires et financières brutes, elle supportera un coût. Mais est-elle à plaindre ? Elle pourra toujours, pour la partie surexcédentaire de sa trésorerie nette, la redistribuer à ses actionnaires en dividendes ou rachats d’actions[2], payer comme nous l’avons vu faire ses impôts en avance, voire payer ses fournisseurs en avance pour obtenir des escomptes pour paiement rapide. Dans ce dernier cas, il faudra s’assurer que les fournisseurs n’y prennent pas goût, c’est-à-dire ne viennent pas considérer ces délais de paiement raccourcis comme un droit et ne soient pas fragilisés lorsque l’on reviendra à des pratiques plus orthodoxes.
Du coté des passifs
Un second danger, mais qui nous paraît bien moindre, serait celui de vouloir s’endetter au seul prétexte que les taux d’intérêt sont très bas. Certes ils sont très bas, mais rien ne vous dit qu’ils ne le seront pas encore plus l’an prochain comme ils l’ont été quasiment chaque année depuis 1981[3]. Par ailleurs ce serait oublier que si les taux sont bas, c’est que la conjoncture est morose et les risques multiples. Enfin, rappelons que, taux bas ou pas taux bas, le service d’un emprunt en trésorerie c’est d’abord et avant tout son capital, pas l’intérêt. Ainsi sur une dette de 100 à 3 % sur cinq ans, les intérêts auraient beau être divisés par 3 à 1 % par exemple, le service de l’emprunt ne baisserait que de 9 % et pas des deux tiers.
Par ailleurs, si le coût de la dette a beaucoup baissé depuis 3 ans (2 % pour les OAT 10 ans), n’oublions pas que le coût du capital qui est l’outil servant à apprécier la pertinence financière des investissements, lui a beaucoup moins baissé : - 0,8 % sur la même période. Pourquoi ? Parce que sa seconde composante, le coût des capitaux propres dépend beaucoup (surtout quand le taux sans risque est nul)[4] de la prime de risque du marché actions qui, elle, reste élevée et a plutôt eu tendance à progresser un peu : environ 7,3 % en ce moment.
***
Cet article constitue une version légèrement remaniée d’une partie de l’introduction du Vernimmen 2017, que nous ouvrons comme chaque année depuis 2008 par 6 à 8 pages de développements consacrés à l’actualité de la finance d’entreprise et à ce qui nous semble être les traits déterminants de son évolution future.
[1]. Pour plus de détails, voir le chapitre 24 du Vernimmen 2017
[3]. Voir le graphique du paragraphe 24.23 du Vernimmen 2017.
Tableau : L'évolution des 10 premières capitalisations boursières aux Etats-Unis et en Europe depuis 1975
Il y a 40 ans le plus grand groupe européen par sa capitalisation boursière était Siemens. Aujourd’hui c’est Nestlé, 11 fois plus gros avec une capitalisation boursière de 206 Md€. Et Gazprom qui était le premier européen avec 204 Md€ en 2005 en vaut aujourd’hui 4 fois moins avec seulement 46 Md€ de capitalisation boursière (et n’est même plus le premier groupe dans son pays, sic transit gloria).
Mais aucun de nos 10 européens ne rentreraient dans le classement des 10 premiers américains, qui est dominé par Apple (avec 514 Md$ de capitalisation boursière), lointain successeur de IBM le leader de 1975 avec 34 Md$, ce qui ne manquera pas de faire sourire nos lecteurs férus d’informatique.
Si Shell, General Electric et Exxon ont toujours fait partie de ce classement depuis 1975, le classement américain de 2015 fait apparaître 6 nouveaux groupes (sur 10 . . . illustrant ainsi la création/destruction schumpétérienne) dont les 4 GAFA, contre 2 en Europe (AB INBEV et L’Oréal).
Notons que si la capitalisation boursière des 10 premiers groupes américains progresse de 12,9 % par an en moyenne depuis 1975, cette même progression en Europe n’est que de 8,5 %.
Le recul historique permet enfin de constater la mutation des tissus économiques avec 7 groupes de l’industrie lourde européenne dans les 10 premiers en 1975 contre 2 en 2015, et 1 de l’industrie légère en 1975 contre 6 en 2015. Ceci explique aussi pourquoi l’Allemagne qui trustait 7 des 10 places en 1975 (sic, et 0 à la France) n’en a plus aucune aujourd‘hui (contre 2 à la France) et que les groupes suisses occupent 3 des 4 premières places.
Recherche : Value ou growth : les facteurs explicatifs du style d'un investisseur
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à Paris-Dauphine
Il est usuel de séparer les styles d’investissement en deux grandes catégories : value et growth. L’investissement value consiste à repérer les entreprises dont les ratios de valorisation sont peu élevés, en espérant détecter des actions dont la valeur de marché est plus faible que la valeur intrinsèque. L’investissement growth privilégie pour sa part les actions des entreprises à fort potentiel de croissance, qui investissent beaucoup en recherche et développement, et qui présentent par conséquent des ratios de valorisation élevés. Nous présentons ce mois-ci un article qui tente de repérer les facteurs spécifiques aux investisseurs qui influencent leur style[1].
Dans cet article, les auteurs n’hésitent pas à proposer une explication partiellement biologique aux comportements d’investissement. Ils se fondent pour cela sur une méthodologie de recherche qui a été développée à la frontière de la biologie et des sciences sociales pour expliquer les comportements humains. Les démarches utilisées pour ces études et leurs conclusions ne font pas l’unanimité dans la communauté scientifique ; nous nous contenterons ici de décrire la méthode employée et ses résultats, laissant le soin au lecteur de se forger son opinion. L’autre partie de l’explication des comportements est recherchée dans les expériences de vie des investisseurs.
Pour la partie biologique, la méthode consiste à s’intéresser au comportement des jumeaux. Les jumeaux monozygotes (populairement appelés « vrais jumeaux ») partagent 100% de leur patrimoine génétique, alors que les jumeaux dizygotes (« faux jumeaux ») ne partagent en moyenne que 50%. Si l’on suppose que l’entourage (par exemple les parents) se comportent de la même façon avec les jumeaux monozygotes et dizygotes, et si les monozygotes ont un style d’investissement plus similaire entre eux que les dizygotes, alors on estimera qu’il y a une part biologique dans ces comportements. C’est effectivement ce qu’obtiennent les auteurs de l’étude. Pour y parvenir, ils s’appuient sur des données détaillées disponibles sur les jumeaux en Suède (Swedish Twin Registry). Leur base de données comporte plus de 10 000 jumeaux monozygotes et plus de 24 000 hétérozygotes, tous investisseurs sur les marchés d’actions. Ils utilisent comme indicateur du style d’investissement le ratio price-to-earnings (PER) moyen du portefeuille d’actions de l’investisseur. Un faible ratio est indicateur d’un style value, un ratio élevé d’un style growth. Ils obtiennent un coefficient de corrélation des PER de 0,49 pour les monozygotes et de 0,35 pour les dizygotes. D’autres mesures sont effectuées avec le ratio price-to-book (PB) et avec les investissements en fonds mutuels, avec des résultats semblables. Les auteurs concluent à l’existence d’une composante biologique dans les styles d’investissement.
Le reste de l’article s’intéresse aux caractéristiques individuelles (genre, âge, statut économique…) ainsi qu’à la partie acquise des comportements, liée aux expériences de vie. L’article est vaste et les résultats nombreux, citons ici simplement les plus notables. Le ratio PER moyen des investisseurs de 65 ans est 6 points plus faible (soit 39% de la médiane) que celui des investisseurs de 25 ans. Cet écart est considérable et compatible avec l’idée que les investisseurs jeunes ont un horizon d’investissement plus long, et que le style growth a tendance à être privilégié en cas d’horizon long. Concernant les expériences de vie, les individus qui ont grandi durant la Grande dépression (ceux qui sont nés dans les années 1920) ont une approche plus orientée value (ratio PER inférieur de 1,7 point).
Finalement, cet article tente de repérer un très grand nombre de facteurs explicatifs du comportement d’investissement. Il est difficile de conclure et de mesurer séparément chacun d’entre eux, mais les résultats indiquent que des facteurs spécifiques aux investisseurs peuvent contribuer à expliquer leur style, et que ces facteurs sont extrêmement nombreux. Il y a quelques années nous avions présenté dans cette chronique un article[2] établissant le lien entre le caractère des dirigeants d’entreprise et leur choix de financement. L’approche ici est comparable, mais porte sur les investisseurs individuels. Dans les deux cas, un lien statistique est établi entre caractéristiques individuels et comportement économique.
[1] H.CRONQVIST, S.SIEGEL et F.YU (2015), Value versus growth investing: Why do different investors have different styles ?, Journal of Financial Economics, vol.117-2, pages 333 à 349.
[2] « Choix de financement : une question de caractère ? » Lettre n°113 de mars 2013
Q&R : QCM
A l’occasion de la sortie du Vernimmen 2017, nous vous avions envoyé un petit QCM fait de 4 questions. Il est encore possible de le faire en cliquant ici.
Vous êtes 2110 à vous être essayés à l’exercice, et voici les réponses commentées.
Que veut dire NEU CP ?
- New European Union Call Put, les options qui seront cotées en Europe post Brexit
- European Negociable Commercial Papers, les anciens certificats de dépôts et billets de trésorerie,
- Nouvelles Emissions d’Unités de Compte en Prêts, les investissements des contrats d’assurance en crowdlending
- Notation Economique Universelle des Capitaux Propres, acronyme pour rating dans les projets de Bâle IV
La bonne réponse est European Negociable Commercial Papers, c’est une conséquence de la loi Sapin 2 et c’est page 1091 du Vernimmen 2017.
Quel est le taux d’imposition des résultats des entreprises en Allemagne ?
- 25 %
- 29,65 %
- 33 %
- 34,43%
La bonne réponse est 29,63%. 25% c’est en Espagne, 33% en Belgique et 34,43 % en France. Et c’est page 752 de votre Vernimmen 2017. En 2016, c’était respectivement 28 %, 29,58 %, 33,99% et de 34,43 % à 38%.
Qu’est-ce que les actions de performance ?
- Ce sont des actions qui font mieux que le marché boursier à long terme
- Ce sont des actions qui font mieux que le marché boursier à court terme
- Ce sont des actions attribuées à des salariés et définitivement acquises si certaines conditions de performance sont remplies
- Ce sont les actions qu’entreprend le super héros qui illustre la couverture du Vernimmen 2017
En fait, ce sont des actions attribuées à des salariés et définitivement acquises si certaines conditions de performance sont remplies. C’est dans le Vernimmen 2017 aux pages 613 et 913.
Un groupe européen cède sa filiale vénézuélienne et utilise le produit de la vente pour rembourser intégralement sa dette. Son coût du capital :
- Augmente
- Reste stable
- Diminue
- Je ne sais pas
La bonne réponse est qu’il diminue. En effet, vendant sa filiale vénézuélienne, le groupe réduit son périmètre d’activités à l’Europe et donc à ses actifs les moins risqués car il est très peu probable que le risque de ses activités européennes soit plus fort que celui de sa filiale vénézuélienne. Donc ceci abaisse son coût du capital puisque le coût du capital est déterminé par le risque de l’actif économique de l’entreprise. Trop souvent l’erreur est faite au niveau de la visualisation du coût du capital de se focaliser du côté des ressources de l’entreprise à cause du mode de calcul du coût du capital (coût moyen pondéré du coût des dettes et du coût des capitaux propres), en oubliant de voir que le coût du capital est fonction du risque de marché des emplois de l’entreprise. Et que faire varier la structure financière d’une entreprise n’a jamais modifié le coût du capital. C’est dans les chapitres 33 et 37 du Vernimmen 2017.
Autre : NOS LECTEURS ECRIVENT : Le théorème de Modigliani-Miller expliqué par la théorie des options
Par Thomas Bouvet (AMF) et Henri Philippe (Accuracy)
Modigliani et Miller ont apporté à la théorie financière un des théorèmes majeurs de la finance : en l’absence d’opportunité d’arbitrage, de coûts de friction (coûts de transaction, coûts d’information…) et d’impôt sur les sociétés, la valeur d’une entreprise est indépendante de la structure de son financement et est donnée par la valeur actuelle de ses revenus futurs actualisés au taux approprié à sa classe de risque. (Proposition (I) de Modigliani Miller [1958]).
Il en résulte (Vernimmen p.736) qu’ « il n’existe pas de structure financière optimale, le taux de rentabilité exigé et donc la valeur de l’actif économique étant constants quel que soit le niveau de l’endettement de la firme ». Dit autrement, les valeurs de marché des dettes et du capital d’une société sont certes fonction du levier financier de l’entreprise, mais leur somme est indépendante du levier et est toujours égale à la valeur de l’actif économique.
La démonstration du théorème de Modigliani Miller repose sur un raisonnement d’arbitrage qui, malgré sa simplicité de démonstration (Vernimmen pp. 737 et 738) n’a pas convaincu immédiatement l’ensemble de la communauté financière. Encore aujourd’hui, et même si ce théorème n’est plus remis en question, ses conséquences sont souvent ignorées. Certains oublient qu’il n’y a pas de repas gratuit, que la magie de l’effet de levier occulte le coût du risque…
La théorie des options, par le regard complémentaire qu’elle offre sur le bilan d’une entreprise, apporte une autre manière de vérifier ce théorème.
Partons d’un bilan économique simplifié, avec seulement deux catégories de ressources pour l’entreprise : les fonds propres et les dettes financières. Les dettes d’exploitation sont extraites du passif et sont prises en considération dans l’actif économique.
Le bilan économique simplifié
Pour simplifier, les dettes financières ont une échéance unique T, date à laquelle devra être remboursée la somme contractuellement due (N). La valeur à l’instant t de cette dette Dt dépend du risque qu’elle supporte et correspond à la valeur actualisée à un taux intégrant le coût du risque (r) de la somme due (N)[1] (VAr(N)T–t).
Si cette dette ne supportait pas de risque, son rendement serait plus faible, égal au taux sans risque rf (r > rf). La différence entre la valeur de la dette sans risque et la dette portée par l’entreprise correspond au coût du risque Rt. Nous pouvons donc retrouver la valeur de la dette risquée par différence entre la valeur de la dette risquée et le coût du risque.
Dt = VAr(N)T–t = VArf(N)T–t – Rt
Regardons ce bilan par le prisme des options (cf. Vernimmen – Chapitre 38 Endettement, capitaux propres et théorie des options) :
-
A l’échéance de la dette, l’actionnaire pourra obtenir la différence, si elle est positive, entre la valeur de l’actif économique et le montant à rembourser de la dette. Sinon, les fonds propres ne vaudront rien. L’actionnaire est ainsi le détenteur d’une option d’achat sur les actifs de la société à un prix d’exercice égal au montant de la dette à échéance. La valeur des fonds propres est égale à la valeur d’une option d’achat sur les actifs de la société à un prix d’exercice égal au montant de la dette à échéance Ct(N).
-
Les créanciers sont prioritaires sur les actionnaires. A l’échéance de la dette, ils seront remboursés du montant dû sauf à ce que la valeur de l’actif économique soit inférieure à ce montant, auquel cas le remboursement sera amputé de la différence entre le montant dû et la valeur de l’actif. La situation du créancier est celle d’un titulaire d’une créance certaine simultanément vendeur d’une option de vente sur les actifs de la société. La valeur de la dette est donc égale à la valeur actuelle au taux sans risque d’une dette sans risque diminuée de la valeur d’une option de vente sur les actifs de la société à un prix d’exercice égal au montant de la dette à échéance Dt = VArf(N)T–t – Pt(N).
La théorie des options permet de démontrer facilement qu’en l’absence d’opportunité d’arbitrage, à tout moment la valeur d’un actif S est égale à la valeur d’une option d’achat sur cet actif à un prix d’exercice quelconque K, diminuée de la valeur d’une option de vente sur cet actif à ce même prix d’exercice K et augmentée de la valeur actuelle au taux sans risque de ce prix d’exercice K.
St = Ct(K) – Pt(K) + VArf(K)T-t
Si cette égalité n’est pas vérifiée, il existe des opportunités d’arbitrage, c’est-à-dire la possibilité de réaliser des gains sans risque. Supposons par exemple que l’option d’achat est surévaluée par rapport aux autres éléments de l’égalité : Ct(K) > St + Pt(K) – VArf (K)T–t
L’arbitrage serait alors le suivant (vente de ce qui est surévalué et achat de ce qui est relativement sous-évalué) :
En t
Vente de l’option d’achat + Ct
Achat de l’option de vente – Pt
Vente à découvert de l’obligation +VArf(K)T–t
Achat de l’actif –St
_________
Gain >0 (par hypothèse)
en T
Si ST < K si ST > K
Exercice de l’option
d’achat vendue en t ? 0 –(ST – K)
Exercice de l’option
de vente achetée en t ? K–ST 0
Achat de l’obligation
vendue à découvert en t – K – K
Revente de l’actif
acheté en t + ST + ST
_________ _________
Gain 0 0
Au cours de cette opération, l’investisseur pourrait donc réaliser en t un gain, sans prise de risque, puisque quelle que soit l’évolution du cours de l’action, le résultat est le même. Lors du débouclage du portefeuille en T, il réalisera une opération blanche. Une telle opportunité d’arbitrage n’a pas vocation à perdurer…
La démonstration de Modigliani Miller repose sur l’arbitrage, ce qui a fait dire à Merton Miller 30 ans après avoir publié en 1958 la première version de leur théorème, que la relation de parité Put-Call n’est rien de plus que la Proposition (I) présentée différemment[2] : la valeur de marché des dettes et du capital d’une société sont certes fonction du levier financier de l’entreprise, mais la relation de parité montre que leur somme est indépendante du levier ; la somme des deux est toujours égale à la valeur de l’actif économique.
Il ressort en effet de la relation de parité, At = Ct(K) – Pt(K) + VArf(K)T-t, que si la valeur des fonds propres (Ct(N)) et la valeur des dettes (VArf(N)T-t – Pt(N)) sont fonction du levier financier (donc de N), leur somme est indépendante du levier puisque cette relation se vérifie quel que soit K. Si tel n’était pas le cas, un arbitrage rentable et sans risque serait possible.
Pour s’en convaincre, supposons un actif qui vaudra AT en T et dont la valeur présente est différente selon que la structure financière utilisée pour acquérir cet actif soit sans ou avec dette financière.
Le prix de revient de l’actif peut se déduire de la somme des valeurs des sources de financement, fonds propres et dettes.
-
Sans dette, le prix de revient de l’actif est égal à la valeur des fonds propres de la société qui les porte : At = Ct(0).
-
Avec une dette de valeur faciale N, le prix de revient de l’actif est égal à la somme des fonds propres et des dettes : A’t = Ct(N) + VArf(N)T-t – Pt(N).
Si A’t > At, alors il est possible de réaliser un arbitrage rentable et sans risque :
A’t > At signifie que Ct(N) + VArf(N)T-t – Pt(N) > Ct(0).
Le portefeuille d’arbitrage serait constitué de la vente d’une option d’achat de prix d’exercice N sur l’actif At, de la vente d’une obligation sans risque de valeur N à l’échéance (c’est-à-dire un emprunt au taux sans risque d’un montant dû à l’échéance N), de l’achat d’une option de vente de prix d’exercice N sur l’actif At et de l’achat d’une option d’achat de prix d’exercice nul sur l’actif At.
Ce portefeuille assure un gain certain immédiat sans coût ni risque puisque quelle que soit l’évolution de l’actif en T, il n’entrainera ni gain ni perte :
En t
Vente de l’option d’achat +Ct(N)
Vente à découvert de l’obligation +VArf(N)T–t
Achat de l’option de vente – Pt(N)
Achat de l’option d’achat +Ct(0) _________
Gain > 0 (par hypothèse)
en T
Si AT < N si AT > N
Exercice de l’option
d’achat vendue en t ? 0 –(AT – N)
Achat de l’obligation
vendue à découvert en t –N –N
Exercice de l’option
de vente achetée en t ? N – AT 0
Exercice de l’option
d’achat achetée en t ? + AT + AT
_________ ________
Gain 0 0
L’investisseur aurait à nouveau réalisé un gain sans risque à l’investissement. Or, en l’absence d’opportunité d’arbitrage il n’y a pas de gain certain à coût nul. Donc A’t=At.
Au final, la relation de parité Put-Call apparaît comme l’outil idéal pour comprendre la proposition de Modigliani-Miller : les hypothèses requises (l’absence d’opportunité d’arbitrage, de coûts de friction et d’impôt sur les sociétés) sont plus généralement respectées, les arbitrages peuvent être plus facilement mis en œuvre avec l’utilisation de produits dérivés.
Les conclusions de la Proposition (I) posée par Modigliani et Miller dès 1958 sont bien confirmées via la relation de parité : la valeur d’une société ne dépend pas de la manière dont elle est financée. Il en résulte également que le coût du capital, considéré comme le taux de rendement attendu pour un actif économique, dépend uniquement du couple risque-rentabilité qui est propre à cet actif économique et pas de la manière dont il est financé.
* * *
Thomas Bouvet et Henri Philippe sont les auteurs chez Economica de Options et Finance d’entreprise que vous pouvez vous procurer en cliquant ici.
[1]À l’échéance, DT est égal à N si la société est effectivement en mesure de rembourser sa dette.
[2] « The familiar Put-Call Parity Theorem is really nothing more than the MM Proposition I in only a mildly concealing disguise », Merton H. Miller in “The Modigliani-Miller Propositions After Thirty Years”, Journal of economic perspectives, Vol. 2, N°4, pp 99-120, [1998].
Autre : RESEAUX SOCIAUX : Facebook
Nous alimentons maintenant Facebook quotidiennement avec une réflexion sur l’actualité.
N’hésitez pas à aimer à la page et à réagir ! C’est ici : https://www.facebook.com/Vernimmennet-256624997745305/