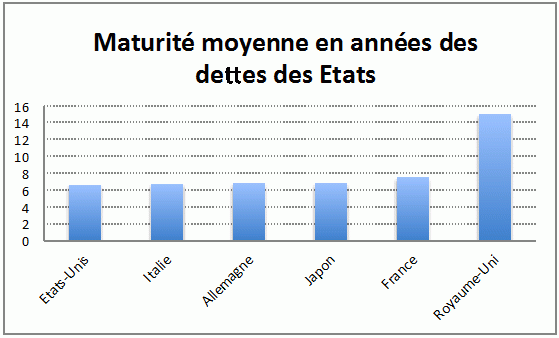La Lettre n°150 de Juillet 2017
Actualités : Applications blockchain pour la finance : effet de mode ou révolution ?
Les chaînes de blocs ou blockchains sont tour à tour présentées comme une révolution, à même de bouleverser le fonctionnement de l’industrie financière dans son ensemble, ou comme une solution, certes élégante, à un problème qu’il reste cependant à identifier. Qu’en est-il vraiment ?
Qu’est-ce donc ?
Dans la lignée des protocoles TCP/IP (communications internet), SMTP (email), ou FTP (transfert de fichiers), les blockchains pourraient s’imposer comme le support des transferts de propriété sur Internet.
En effet, les blockchains peuvent être assimilées à des livres comptables publics, horodatés, et immuables (en perpétuelle expansion avec l’ajout de nouvelles informations). Ces livres comptables présentent néanmoins une différence majeure avec les systèmes classiques : ils sont validés et mis à jour sans aucune autorité centrale. Le contrôle et la validation des livres s’effectuent à travers un réseau distribué d’ordinateurs pair à pair, ce qui leur confère une résilience inégalée.
Il existe aujourd’hui deux grands types de protocoles blockchain :
- Les blockchains publiques, comme Bitcoin ou Ethereum, ouvertes à tous ;
- Les blockchains de consortium, dont l’accès est restreint à certains membres.
Les blockchains publiques portent une promesse de désintermédiation complète, mais souffrent en conséquence d’insécurité juridique. Les blockchains de consortium, auxquelles on se réfère également par le terme DLT (Distributed Ledger Technology), peuvent, quant à elles, simplifier le fonctionnement des places de marché et réduire les coûts de transaction, dans un cadre juridique plus clair. Toutefois, le choix du modèle de gouvernance de ces blockchains reste une question délicate.
Les principales applications des blockchains aujourd’hui définies sont :
- le transfert de valeur, sans duplication de propriété (monnaie, titre financier, vote, etc.) ;
- la preuve d’existence (enveloppe soleau, acte notarié, droits d’auteur, etc.) ;
- l’encodage de logiques métiers, par des « smart contracts », de façon à automatiser des processus.
Mais à quoi ça sert ?
C’est le Bitcoin, la première monnaie numérique décentralisée apparue en 2009, qui a introduit le concept de blockchain. L’innovation majeure du Bitcoin : il permet le transfert de propriété digitale, sans duplication possible de cette propriété. En ce sens, le Bitcoin est et reste la première application des blockchains.
Les institutions financières ont été parmi les premières à s’intéresser aux blockchains, dans une logique de rationalisation de leurs coûts. Elles pourraient ainsi économiser jusqu’à plus de 100 Md$ de coûts de structure, selon certains grands cabinets de conseils.
Les premières applications du protocole blockchain dans ce domaine concernent aujourd’hui essentiellement les infra-structures de marché et sont portées par des blockchains de consortium. Nous avons sélectionné quelques applications qui nous semblent prometteuses :
Tenue de registre de sociétés non cotées
Si le Bitcoin utilise un registre blockchain pour le transfert de valeur monétaire, une blockchain pourrait également servir de registre de titres. Comme les obligations financières des sociétés non cotées sont allégées, les institutions financières se sont intéressées de près à l’utilisation d’une blockchain pour leur émission de titres et leur tenue de registre.
Grâce à la réduction des coûts de transfert et au gain de transparence, l’objectif est de fluidifier le financement des PME, et de favoriser l’émergence d’un marché secondaire plus liquide. En France, sept grandes institutions financières s’unissent ainsi pour développer une architecture post-marché pour les PME[1].
Règlement-livraison de titres
Un achat/vente d’actions sur un marché organisé implique de nombreux inter-venants (donneur d’ordre, teneur de compte conservateur, négociateur, marché, chambre de compensation, dépositaire central). Le système actuel fonctionne de façon efficace, mais il présente néanmoins quelques limites : risque opérationnel lié à la réconciliation par les différents intervenants des enregistrements dans leurs propres systèmes, risque de règlement-livraison, ou encore conduite du changement longue et coûteuse.
La technologie blockchain pourrait modifier le traitement des opérations de marché en permettant leur gestion de bout en bout, du passage de l’ordre au règlement/livraison, sans rupture de charge. En effet, on peut imaginer une blockchain dont les nœuds rassemblent les donneurs d’ordres, les courtiers, le marché, les teneurs de compte conservateurs, le dépositaire central, les régulateurs, etc. Les détails de chaque transaction pourraient être partagés et confirmés directement par tous ces acteurs via un smart contract.
En janvier 2016, la plus grande bourse australienne, l’Australian Stock Exchange (ASX)[2], a annoncé qu’elle travaillait au remplacement de son système de compensation et de règlement-livraison actions CHESS, avec la start-up Digital Asset, par une blockchain privée. ASX estime la réduction de coût engendrée entre 2,5 et 3,2 Md€ pour les utilisateurs finaux.
Paiements interbancaires : vers une crypto-monnaie étatique ?
La Banque Centrale de Singapour (MAS) vient ainsi d’annoncer qu’elle travaillait sur une version blockchain de sa monnaie locale, le SGD. Avec le projet Urbin[3] réalisé avec le consortium bancaire R3, l’autorité centrale a émis un jeton, entièrement couvert par de la monnaie réelle, qui permet le règlement des paiements interbancaires de façon extrêmement rapide et transparente.
La première monnaie fiduciaire cryptographique pourrait ainsi voir le jour et démultiplier les possibilités d’usages concrets des blockchains.
Paiements internationaux
Une monnaie ne quitte pas sa zone monétaire d’origine : tout transfert moné-taire a sa contrepartie dans les livres de la banque centrale d’émission sous forme de transfert entre deux banques commerciales. Pour accéder aux marchés mondiaux, chaque banque va donc créer des relations commerciales avec un réseau de correspondants : c’est le correspondent banking. Il en résulte que les transferts internationaux sont lents, pas toujours fiables, et chers.
Le réseau blockchain Ripple[4], qui regroupe aujourd’hui plus de 75 banques, se propose de transformer les transferts de fonds aussi radicalement que l’email a transformé la communication, grâce à une infrastructure de paiement internationale en temps réel, dans laquelle le Ripple joue le rôle de monnaie pivot, connectée aux banques et aux teneurs de marché, qui doit apporter transparence, confiance, vitesse, et baisse des coûts.
Commerce international
La rationalisation en cours des processus liés au commerce international souffre de contraintes majeures principalement liées à l’emploi de documents papiers dans les chaînes logistiques. Une demi-douzaine d’acteurs est couramment impliquée dans l’achat ou la vente d’un bien (l’acheteur, la banque de l’acheteur, le chargeur, la compagnie de transport maritime, le vendeur, la banque du vendeur, etc.). De nombreux documents sont encore créés manuellement et saisis dans des systèmes différents, ce qui entraîne bien souvent erreurs et fraudes.
C’est pour remédier à ces problèmes que Natixis, Trafigura, et IBM[5] ont travaillé sur une solution blockchain applicable au commerce de pétrole brut aux États-Unis. En réunissant l’acheteur, le vendeur et leurs banques respectives sur un unique registre distribué, toutes les parties peuvent simultanément visualiser et partager les données relatives au statut de la transaction (de la confirmation et validation de la nouvelle transaction, en passant par le contrôle de la cargaison jusqu’à sa livraison finale, puis l’annulation de la lettre de crédit associée). Cette solution permet de réduire la durée du cycle de trésorerie, les frais de gestion de la transaction et offre une plus grande transparence sur les transactions, réduisant de facto les risques de fraude.
Financement
Par ailleurs, du côté des blockchains publiques, on assiste à une vague d’innovation technologique sans précédent, portée par un nouveau mode de financement : les ICOs (Initial Coin Offerings) ou Token Sales. Sur le même principe qu’une IPO (introduction en bourse), une ICO est un appel à l’épargne publique, sous forme de jeton. Le jeton a une double fonction : il sert à financer le projet, et il est le moteur endogène de l’application.
Par exemple, la blockchain Ethereum s’est financée par une ICO qui a consisté en l’émission d’Ether, des jetons qui servent de carburant pour faire fonctionner les programmes informatiques hébergés sur la blockchain. On a récemment assisté à de nombreux projets d’ICO, certains loufoques, d’autres plus intéressants : Sia[6] est une solution cloud décentralisée, BAT[7] est un projet porté par le fondateur de Mozilla qui s’appuie sur un navigateur internet dédié pour changer complètement le paradigme de la publicité en ligne, le projet Bancor[8] est porté par l’un des architectes de l’euro, etc.
Cette liste d’applications dans le domaine financier, loin d’être exhaustive, démontre bien le potentiel disruptif des blockchains. Cependant, de nombreux défis restent encore à relever.
Par exemple, les questions liées à la confidentialité des données enregistrées dans un registre partagé reste toujours en suspens, même si les travaux en cours sont prometteurs (MimbleWimble[9], Quorum[10], etc.).
Si les défis techniques trouveront leurs solutions, l’industrie a surtout besoin d’un cadre réglementaire clair. À ce titre, il est intéressant de noter que le législateur français joue un rôle pionnier dans ce domaine. Les régulateurs suivent également ces développements avec intérêt, car une architecture blockchain leur permettrait d’avoir une vision plus complète et transparente des marchés. Leur soutien sera crucial pour passer des expérimentations à l’industrialisation de solutions compétitives.
Alors, les blockchains : révolution ou effet de mode ? Il est encore trop tôt pour apporter une réponse définitive, mais le marché a souvent tendance à surestimer les conséquences des ruptures technologiques à court terme, et à sous-estimer leur impact sur le moyen terme.
L’équipe BELEM est quant à elle convaincue que le protocole blockchain va bouleverser le monde de la finance, et que les premières solutions viables commercialement vont émerger dans un délai de deux à trois ans, dans le domaine du post-marché. Nous pensons également que la transformation de l’industrie financière par la blockchain passera par une combinaison de blockchains de consortiums, partagées entre acteurs d’un même secteur, et de blockchains publiques, qui apportent un niveau de sécurité et de résilience inégalé.
-------------------
BELEM permet aux acteurs financiers de capitaliser sur la technologie Blockchain à travers une offre verticale : formation, idéation, prototypes, industrialisation. Notre valeur ajoutée repose sur la complémentarité de l’équipe en finance & en technologie.
Pour en savoir plus sur BELEM : http://www.belem.io
[1] https://www.euronext.com/fr/actualite/grandes-institutions-financieres-unissent-pour-developper-infrastructure-blockchain
[2] https://www.cryptocoinsnews.com/sydney-stock-exchange-building-public-blockchain-system/
[3] http://www.mas.gov.sg/~/media/ProjectUbin/Project%20Ubin%20%20SGD%20on%20Distributed%20Ledger.pdf
[4] https://ripple.com/
[5] https://www.natixis.com/natixis/upload/docs/application/pdf/2017-03/cp__blockchain_ibm_trafigura.pdf
[6] http://sia.tech/
[7] https://basicattentiontoken.org/
[8] https://bancor.network/
[9] http://www.coindesk.com/mimblewimble-silly-sounding-tech-seriously-reform-bitcoin/
[10] http://www.ibtimes.co.uk/quorum-j-p-morgans-ethereum-fork-could-eat-your-lunch-1625606
Tableau : La maturité moyenne des dettes des États
Le gouvernement américain réfléchit à émettre des dettes plus longues que son maximum actuel de 30 ans : 40, 50 ,voire 100 ans. Il y a longtemps que le Royaume-Uni est allé dans cette direction, ce qui explique une maturité moyenne de sa dette double (à 15 ans) de celle des autres grands pays (7 ans).
L’importance des retraites par capitalisation au Royaume-Uni n’est pas étrangère à cette situation.
Les émissions à très long terme ne sont pas l’apanage des pays occidentaux bien notés : comme nous le faisions remarquer sur Facebook (voir Commentaires page 8), l’Argentine vient d’émettre à 100 ans (le Mexique l’avait également fait)…
Recherche : Enfance et psychologie des chefs d'entreprise
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à Paris-Dauphine.
Nous avons présenté le mois dernier un article montrant l’influence des problèmes d’agence sur les décisions d’investissement prises par les dirigeants d’entreprise. Nous poursuivons ici notre analyse des comportements des chefs d’entreprise (CEO) par la présentation d’un article[1] sur la psychologie de ces derniers.
L’influence des traits psychologiques des dirigeants sur les politiques d’entreprise a déjà été largement documentée dans la littérature. Par exemple, les choix de financement dépendent de l’aversion au risque du dirigeant, elle-même influencée par le passé (militaire par exemple) de ces dirigeants[2]. L’originalité de l’article que nous présentons ici vient de la mise en lumière d’un effet non-linéaire des événements arrivés dans l’enfance du dirigeant : l’occurrence de catastrophes avec une forte mortalité conduit à une plus forte aversion au risque, alors que celles avec une faible mortalité réduisent au contraire l’aversion au risque.
La méthode de cette étude consiste à croiser trois bases de données principales :
- une base contenant la date et le lieu de naissance des chefs d’entreprises du S&P500 en poste entre 1992 et 2012 (au total 1 508 dirigeants nés aux États-Unis) ;
- une base historique de catastrophes naturelles sur le territoire américain, avec le nombre de victimes selon le comté[3] traversé par la catastrophe ;
- une base de données financières sur les entreprises concernées, avec en particulier l’évolution du levier financier[4].
L’analyse empirique indique que les dirigeants ayant connu dans leur enfance (entre l’âge de 5 ans et l’âge de 15 ans) une catastrophe naturelle, ayant entraîné une mortalité faible ou modérée, ont une plus faible aversion au risque que ceux n’ayant connu aucune catastrophe. Cela se traduit notamment par un levier financier plus élevé de 3,4 %. À l’inverse, ceux qui ont connu une catastrophe avec une forte mortalité[5] ont une plus forte aversion au risque, et un levier financier plus faible de 3,7 % (l’écart est donc de 7,1 % entre faible et forte mortalité).
Notons que les auteurs procèdent à l’inclusion de différentes variables de contrôle dans leur étude pour confirmer la causalité entre catastrophes naturelles et comportement des dirigeants : par exemple, la date et l’État de naissance, pour capter les possibles effets culturels et générationnels du comportement. Ils effectuent aussi un certain nombre de tests complémentaires, et montrent que les changements de chef d’entreprise liés à des causes exogènes entraînent bien une variation des politiques d’entreprise selon les catastrophes connues dans l’enfance par les deux dirigeants concernés.
Ce résultat présente un intérêt pour plusieurs raisons. D’une part, il confirme un effet déjà connu en psychologie (mais rarement utilisé en finance) : la non-linéarité des expériences passées sur le caractère. Le fait de connaître dans son environnement proche une catastrophe majeure a tendance à augmenter l’aversion au risque des individus ; mais, au contraire, lorsque qu’il s’agit de catastrophes ayant entraîné peu de conséquences graves, l’aversion au risque diminue. Les paramètres liés à l’histoire personnelle des dirigeants parfois retenus dans les études empiriques devraient donc prendre en compte cette non-linéarité, pour mieux expliquer ensuite les politiques d’entreprise.
[1] G. BERNILE, V. BHAGWAT et P.R. RAU (2017), What doesn’t kill you will only make you more risk-loving: Early-life disasters and CEO behavior, Journal of Finance, vol.72(1), pages 167 à 206.
[2] Voir à ce sujet « Choix de financement, une question de caractère ? » dans la Lettre Vernimmen n° 113, mars 2013.
[3] Division administrative locale, comparable à un département
[4] Mesuré dans l’étude comme le ratio de l’endettement sur le montant comptable des actifs
[5] Premier décile des catastrophes en mortalité par habitant
Q&R : Quelles sont les principales raisons de la variabilité d'un taux d'impôt apparent ?
Il peut y avoir plusieurs causes :
1/ Le taux lui-même bouge, comme dans les années à venir en France où il était planifié par le gouvernement Cazeneuve de passer progressivement de 33,3 % à 28 %.
2/ L’entreprise peut consolider des activités dans des pays différents avec des taux d’impôt différents (20 % au Royaume-Uni par exemple), et, si la proportion d’activités étrangères varie au cours du temps, le taux moyen apparent varie alors en conséquence.
3/ Toutes les opérations de l’entreprise ne sont pas imposées au même taux, par exemple les plus-values sur titres de participation le sont à 4 %, les revenus de brevets à 15 %. Cette hétérogénéité des produits peut faire varier le taux moyen apparent si elle n’est pas elle-même stable au cours du temps.
4/ Si l’entreprise a utilisé des reports fiscaux déficitaires, le taux moyen est réduit d’autant, jusqu’au jour où il n’y en a plus à utiliser car tous l’ont été.
Autre : Nos lecteurs écrivent
François Almaleh vient de publier aux Éditions AFNOR le « Grand livre des entreprises familiales ».
Ce livre présente les points essentiels pour structurer, faire évoluer, faire vivre mais surtout faire durer et réussir l’entreprise familiale. Les dirigeants, les actionnaires, les directeurs financiers, les investisseurs, etc. y trouveront des thèmes opérationnels.
L’on y présente des réflexions et des actions à mener, avec une hauteur de vue, sachant dissocier les strates de décision selon leur portée, locale ou stratégique.
Ce livre est ainsi un guide concret pour une culture d’entreprise ouverte. Il propose un parcours libre des chapitres qui concourent tous au même but : permettre de voir plus loin, éclairer pour mieux comprendre, et également pour s’enrichir et se former.
Cet ouvrage propose un éclairage unique pour dénouer et dissocier les fils complexes de la sphère privée et professionnelle.
Bon voyage dans le monde concret des entreprises familiales.
Pour en savoir plus : http://excerpts.numilog.com/books/9782124655687.pdf
Quelques réflexions sur le goodwill, la finance d’entreprise et les IFRS
Par Ali Saada, Professeur universitaire et expert-comptable.
Pour l’IASB, le goodwill n’est comptabilisé qu’à l’occasion d’un regroupement d’entreprises et seule-ment à hauteur de la différence entre le prix d’acquisition d’une entité et la juste valeur des actifs et passifs de l’entité acquise. Le véritable goodwill éco-nomique de l’acquise et le goodwill généré en interne par l’acquéreur ne sont pas comptabilisables en normes IFRS actuelles.
Le goodwill peut être positif (inscrit à l’actif du bilan consolidé) ou négatif (faisant partie du résultat consolidé global et réparti entre les actionnaires majoritaires et les actionnaires minoritaires).
Jusqu’à une époque récente, le goodwill actif des sociétés du CAC 40 représentait 50 % des actifs de ces sociétés, beaucoup plus si ces firmes appliquaient des règles comptables économiques différentes des IFRS. Cette importance du goodwill mérite qu’on lui consacre un ouvrage entier.
Dans cet ouvrage, nous avons étudié le goodwill sous tous ses aspects : au cœur des regroupements, en partiel et complet, sous l’angle de la dépréciation, en termes de politique comptable et de choix de présentation dans les états financiers. Une étude spéciale a été présentée sur le goodwill négatif et sa comparaison avec le concept de badwill.
Le bilan IFRS intégrant le goodwill se présente comme suit :
|
Goodwill |
Capitaux propres du groupe |
|
Actifs et passifs identifiables (API) |
Intérêts minoritaires |
|
VALEUR |
VALEUR |
Dans cette représentation, l’endettement financier est malheureusement noyé avec les API et le goodwill comptable ne correspond pas au goodwill économique du groupe. Il faut donc comptabiliser le goodwill financier et, pour cela, déroger au référentiel comptable international. Cette dérogation est possible dans les textes de l’IASB puisque la norme IAS 8 permet de procéder à un changement de méthode comptable lorsque la nouvelle méthode est fiable et plus pertinente, ce qui est le cas ici. La méthode du goodwill économique permet de refléter une meilleure image fidèle de l’impact des opérations de rapprochement sur les comptes.
Mais encore faut-il être en mesure de chiffrer le goodwill économique selon un modèle financier rigoureux et admis par les théoriciens et praticiens de la finance d’entreprise.
Selon Brealey & Myers, la valeur actuelle des opportunités de croissance (VAOC) correspond à la valeur actuelle nette (VAN) de tous les projets d’investissement futurs de l’entreprise. Selon cette vision, le bilan économique de la firme se présente comme suit :
|
VAOC |
Fonds propres |
|
Actifs en place |
Dette financière |
|
VALEUR |
VALEUR |
La valeur du goodwill comptable ne correspond pas à la valeur actuelle des opportunités de croissance et la valeur comptable des capitaux propres ne correspond pas à la valeur économique des fonds propres.
Même en normes IFRS, les comptes consolidés ne reflètent pas la réalité économique. Le modèle comptable doit s’aligner sur le modèle économique de la valeur. La norme IFRS 3 sur les regroupements d’entreprises n’est pas conforme à la théorie financière de la firme.
Le concept de juste valeur des API qui est introduit dans la valorisation et la règle de non-comptabilisation du goodwill généré en interne expliquent le manque de rigueur du modèle comptable international.
Le modèle comptable est également différent du modèle boursier : les capitaux propres comptables ne correspondent pas, pour les mêmes raisons, à la capitalisation de l’entreprise.
Pour toutes ces raisons, la norme IFRS 3 doit être révisée en profondeur et rapidement.
L’ouvrage de Ali Saada, Le goodwill, finance d’entreprise et IFRS, est disponible sur Amazon.fr. Pour l’obtenir cliquer ici.
Commentaire : COMMENTAIRES de l'actualité financière postés sur la page Facebook du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur la page Facebook du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière. Vous en trouverez quelques-uns publiés le mois dernier dans cette rubrique :
L’argentine émet 2,75 Md$ à ... 100 ans.
À un taux actuariel de 7,9 % (en dollar), et la demande a été 3,5 fois supérieure à l’offre.
Si on peut comprendre que la République argentine soit fière de montrer de façon aussi éclatante le succès de son redressement économique et financier en émettant sur la durée la plus longue possible (avant la perpétuité), on peut vraiment se demander si l’opération est financièrement intéressante pour elle. En effet, elle bloque pour 100 ans, sur une somme non négligeable, le coût de son emprunt à 7,9 %.
Ce taux correspond à sa notation, actuellement de B, ce qui n’est pas brillant. Mais on peut espérer que la poursuite des efforts initiés et le retour à un esprit d’entreprise permettront d’améliorer dans quelques années cette note et, ce faisant, le taux actuariel de cet emprunt. À titre d’exemple, sur cette durée, l’emprunt chinois rapporte lui du 4,25 %.
Mettons qu’il passe dans 2 ans à 5 %. L’emprunt vaudrait alors 157 % du pair. Si la République argentine voulait le refinancer en se finançant en émettant un nouvel emprunt à 5 % sur 98 ans, elle continuerait néanmoins de supporter pour les 98 ans qui viendront un coût de 7,9 %. Ce n’est que si elle était capable de racheter au pair, à 100 %, son emprunt, qu’elle pourrait alors bénéficier d’un taux réduit à 5 % pour les 98 dernières années. Illusoire, car qui voudra lui céder à 100 % une obligation qui vaudrait 157 % ? Personne naturellement.
Si cet emprunt a été émis, c’est naturellement qu’il y a une demande et une offre. Clairement, les investisseurs font le pari de l’amélioration rapide du crédit de l’Argentine. Par contre, du côté de la République argentine, on voit moins nettement l’intérêt financier, sauf à parier que le pays retombera vite dans ses travers précédents (8 faillites depuis l’indé-pendance de 1816), et que ce taux de 7,9 % ne durera qu’un temps. Mais pour un ministre des Finances, c’est un raison-nement osé !
Banco Popular vendu pour 1€ pour échapper à la faillite. Sic transit gloria mundi.
Banco Popular, qui capitalisa jusqu’à 19 Md€ dans ses belles années, était connu pour son efficacité opérationnelle reflétée par un coefficient d’exploitation[2] parmi les plus bas de toutes les banques européennes : 32 % en 2009, là où les banques françaises sont entre 60 et 70 %.
Après une baisse de son cours de bourse quasiment ininterrompue depuis 2007, il vient d’être racheté 1 € par Santander qui le recapitalisera de 7 Md€ pour faire face à des engagements dans l’immobilier espagnol qui ne seront jamais remboursés.
Plusieurs enseignements et une bonne nouvelle :
- Ce n’est pas parce qu’une société a déjà perdu 90 % de son cours de Bourse, que celui-ci ne peut pas encore baisser de 90 %.
- « La réussite est un état précaire qui exige de rester sur un qui-vive permanent. » (Maurice Lévy).
- Les contribuables espagnols n’auront rien à payer.
L’OCDE s’inquiète du niveau des commissions payées par les entreprises américaines aux banques d’investissement pour s’introduire en Bourse : 7 % contre 3 % en Europe.
Ce n’est malheureusement pas un sujet nouveau puisque l’on en parlait déjà dans les années 1990. Des chercheurs (Mark Abrahamson, Tim Jenkinson et Howard Jones dans Why don’t US Issuers Demand European Fees for IPOs?[3] ont montré que la convergence des méthodes d’introduction en Bourse des deux côtés de l’Atlantique aurait dû conduire à une convergence des taux de commissions sur le niveau européen.
S’il n’en est rien, c’est tout simplement que le niveau de compétition entre les banques aux USA est bien inférieur à la situation européenne. Il y a nettement moins d’acteurs outre Atlantique (les banques américaines, plus Deutsche Bank, Credit Suisse et Barclays) qu’en Europe, le marché le plus concurrentiel de la banque d’affaires où l’on retrouve les précédents et tous les acteurs européens (qui sont de surcroît plus nombreux que les acteurs américains) et Nomura.
On observe ces mêmes différences sur le marché obligataire et dans une large mesure en M&A.
Et ce n’est pas pour rien que les grands acteurs européens ont essayé, avec un succès limité sauf acquisition d’acteurs américains majeurs (Lehman par Barclays par exemple), de pénétrer ce marché bien lucratif.
Notons néanmoins que, sur le marché obligataire, certaines banques commencent à écorner les commissions standards auxquelles personne ne voulait toucher.
Nestlé annonce un programme rachat d’actions de 20 MdFS d’ici 2020.
Pour créer de la valeur pour ses actionnaires ajoute-t-il.
Que l’on nous permette d’en douter ! Un rachat d’actions ne crée de la valeur que dans l’un des trois suivants :
1/ L’action est sous-évaluée, et en l’achetant aujourd’hui à bon compte pour la détruire, on fait faire une bonne affaire dans la durée aux actionnaires qui ne vendent pas. À plus de 17 fois son résultat d’exploitation 2017 et avec un cours au plus haut historique, la sous-évaluation de Nestlé ne saute pas spontanément aux yeux.
2/ L’accroissement du poids de la dette va mettre une sympathique pression sur les dirigeants pour être plus efficaces dans la gestion de l’entreprise, car il va falloir faire face aux échéances contractuelles de la dette. C’est le principe des LBO. Avec un ratio dettes nettes/EBE de 1,5 en 2020, dans un secteur où les flux de trésorerie sont peu volatiles, la pression sera inexistante. Il faudrait qu’il soit au moins du double, pour qu’elle commence à se faire sentir.
3/ Les fonds ainsi rendus aux actionnaires avaient une rentabilité très inférieure au coût du capital au sein de l’entreprise qui gaspillait ainsi les ressources financières qui lui avaient été confiées. C’est loin d’être le cas de Nestlé qui n’a pas de cash net (dettes nettes/EBE 2016 de 0,8) et dont la rentabilité économique après impôt est de 13 % largement supérieure à son coût du capital de 6 %.
Cela nous semble cependant être une bonne décision, mais pas à l’aune de la création de valeur.
Les capitaux propres existent par construction en quantité finie, ils doivent servir à financer en priorité les projets risqués. Puis, quand le risque diminue, la part de l’endettement peut s’accroitre, libérant ainsi des capitaux propres pour aller financer d’autres projets risqués dans d’autres secteurs comme en ce moment l’impression 3D, l’internet des objets, les biotechs, etc.
Le niveau de risque dans l’agroalimentaire étant ce qu’il est, faible, Nestlé ne prend pas un risque inconsidéré en doublant à 1,5 son ratio dettes nettes/EBE. La bonne nouvelle c’est donc 20 MdFS qui vont d’ici 2020 pouvoir financer des secteurs et des entreprises qui ont besoin de capitaux propres.
D’autant que 20 MdFS correspond à peu près à la participation résiduelle de 23 % de Nestlé dans l’Oréal, qui fut une excellente diversification financière (initiée en 1974) pour les actionnaires de Nestlé, qui apporta probablement beaucoup à L’Oréal, quand celui-ci étaient encore un petit groupe prometteur, mais avec qui les synergies industrielles semblent, de l’extérieur, inexistantes.
Pour plus de détails sur rachat d’actions et création de valeur, voir le chapitre 41 du Vernimmen 2017.
[2] Le coefficient d’exploitation est le rapport entre les coûts d’exploitation d’une banque et le produit net bancaire (sorte de chiffre d’affaires d’une banque).
[3] Que nous avions présenté dans La Lettre Vernimmen.net de septembre 2010.