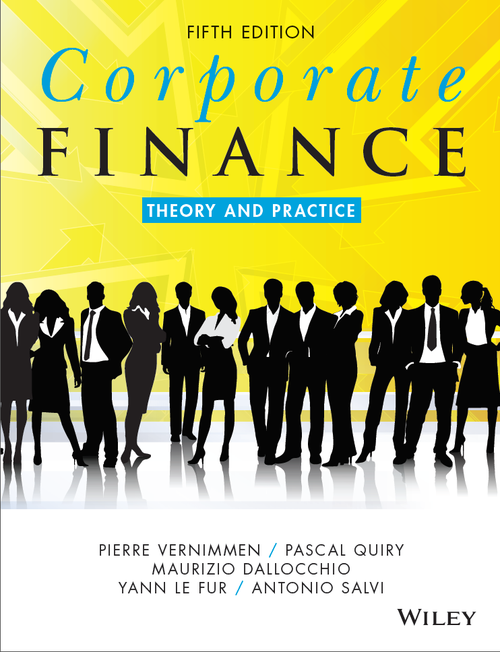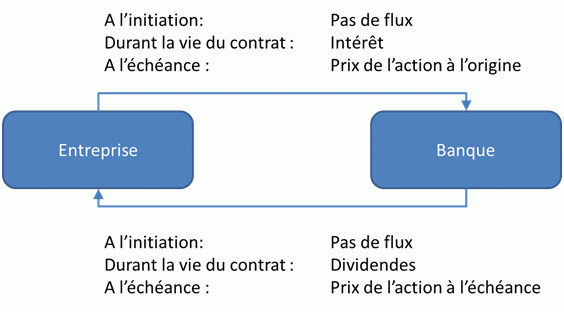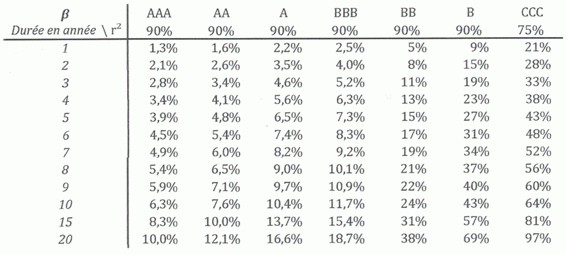La Lettre n°154 de Décembre 2017
Actualités : La nouvelle édition du Vernimmen en anglais
Envie d’améliorer votre anglais financier ? La 5e édition du Vernimmen anglais que nous venons de publier chez Wiley est faite pour vous ! Elle a plus qu’un air de ressemblance avec la version française, même si elle est plus courte (seulement 993 pages !).
Naturellement totalement mise à jour des exemples, statistiques, dispositions comptables, réglementations fiscales, juridiques et autres, elle contient un nouveau chapitre pour vous aider à comprendre s’il vaut mieux pour vous louer ou posséder l’immobilier d’exploitation.
Pour la découvrir, cliquez ici et la commander là.
Actualités : Des nouvelles de notre formation totalement digitale à la finance d'entreprise
2200 Personnes déjà formées en 36 mois à la finance grâce au digital avec un haut niveau de satisfaction pour cette formation qui débouche sur une certification d’HEC Paris en finance d’entreprise : l’ICCF@HEC Paris.
Nous avons conçu pour HEC Paris et First Finance Institute un programme certifiant de finance d’entreprise entièrement digital, qui permet à ceux d’entre vous qui veulent rafraîchir leurs connaissances en finance d’entreprise, ou acquérir un niveau similaire à celui que nous transmettons à nos étudiants d’HEC Paris, de pouvoir le faire à leur rythme sur 5 mois.
Le programme couvre l’essentiel de la finance d’entreprise : analyse financière, évaluation de société, choix d’investissement et de financement. Il s’articule autour de sessions de cours par vidéos, d’études de cas d’application, d’échanges en direct avec Pascal Quiry à travers des «classes virtuelles» hebdomadaires ainsi que d’échanges actifs sur le forum entre les participants et Pascal Quiry. Ce programme est donc aussi un lieu unique d’interactions riches entre professionnels et passionnés de finance d’entreprise.
Chacun des trois thèmes traités se termine par l’étude d’un cas réel et récent ; l’ensemble du programme se termine par un test final.
La sixième promotion commence le 9 janvier 2018.
À titre d’illustration, voici le témoignage d’Alexandre Lemoues, directeur financier d'Inwi, opérateur internet et téléphonie mobile au Maroc, qui a suivi cette formation.
« Étant directeur financier, mais ayant un parcours antérieur quasi-exclusivement dans le contrôle de gestion, je devais faire face à des enjeux et problématiques pour lesquels je manquais d’expertise ou de connaissances. Il me fallait combler des lacunes et mieux appréhender un certain nombre de mécanismes.
L’ICCF@HEC a été un excellent moyen de faire cela. D’une part j’avais accès à un professeur remarquable tant par ses qualités pédagogiques que techniques, d’autre part je pouvais suivre à un rythme qui pouvait prendre en compte mes contraintes professionnelles et personnelles (dans un certain cadre bien sûr). Le support riche et téléchargeable me sécurisait en cas de besoin ultérieur. Les exercices pratiques étaient basés sur des cas réels donc plus parlants, et les examens permettaient de valider ma bonne compréhension des cours et des concepts, mais aussi de garantir que ce n’était pas juste un morceau de papier accordé à tous les participants, mais bien une formation certifiante de qualité.
J’en suis ressorti conquis et surtout convaincu que je pouvais recommander cette formation dans mon entreprise, à la fois à des collatéraux non financiers devant monter en compétence sur le sujet, mais aussi à des collaborateurs devant élargir et/ou approfondir leurs compétences. Mes collaborateurs du contrôle de gestion seront ainsi surtout intéressés par l’analyse financière et les mécanismes d’évaluation d’entreprise pour comprendre les leviers d’amélioration de la valeur et voir comment l’intégrer dans leurs analyses et leurs indicateurs de performance. Mon collègue de la stratégie regardera plutôt les grands concepts et messages clefs pour pouvoir orienter sa réflexion et ses analyses en intégrant une dimension financière plus exhaustive.
Cela a eu plusieurs bénéfices. En effet nous avons maintenant un socle commun de connaissances et pouvons échanger sur des bases et références communes, mais cela nous a aussi réunis en tant que groupe autour de cas ou sujets, créant une dynamique et complicité nouvelle. Évidemment, ma collaboratrice qui a bénéficié de cette formation se sent valorisée, ce qui est un bonus managérial non négligeable.
Par ailleurs, l’ICCF m’a aussi permis de rencontrer des personnes en-dehors de mon entreprise, qui m’auront aidé, stimulé et que pour certaines, je pourrai recruter par la suite. Je ne les ai pas vues juste une heure en entretien d’embauche, je les ai suivies (et réciproquement) pendant 6 mois dans leurs efforts, leurs réflexions et leur implication.
In fine donc, beaucoup de gains directs et indirects grâce à cette formation qui sait exploiter les bénéfices de l’internet tout en conservant une part importante de collectif et d’humain. J’attends maintenant la suite avec impatience.»
Pour en savoir plus sur ce programme, écouter les témoignages des participants, voir http://hecparis.ff.institute/fr/ ou la boîte aux lettres du site vernimmen.net pour échanger avec nous sur ce programme, destiné à partager efficacement les connaissances et pratiques accumulées, selon un format adapté à votre agenda professionnel ou privé.
Actualités : Gérer le risque, la rentabilité et les droits de vote d'une participation cotée
La détention de participations cotées offre l’avantage d’un investissement dans un actif avec une liquidité réelle, un suivi de performance immédiat, et avec la possibilité d‘une influence dans la gouvernance en fonction de la taille de la participation et de l’actionnariat. Ce type d’investissement présente naturellement les inconvénients de ses avantages, notamment les évolutions du cours pouvant imposer le cas échéant la constatation de moins-values latentes (mais non réalisées).
Mais de telles participations cotées permettent également un financement plus aisé ainsi qu’une gestion dynamique de l’exposition économique.
Le financement
Comme pour tout actif ayant une valeur objective sur un marché liquide, les banques seront disposées à prêter plus facilement en prenant en gage des titres d’une société cotée. C’est un produit simple et souple, la transposition du prêt hypothécaire aux titres cotés en quelque sorte ; on parle de margin loans[1]. La banque prête une somme inférieure à la valeur des titres cotés en demandant que la valeur des titres représente à tout moment par exemple 150 % du montant du prêt (on parlera de surcollatéralisation). Si le cours baisse et que la valeur des titres donnés en gage chute en dessous de 150 % du montant du prêt, l’entreprise devra soit gager plus de titres (si elle dispose encore de titres libres de gage et nantissement), soit apporter du collatéral en cash, soit rembourser (en tout ou partie) le prêt, soit laisser la banque céder des titres pour rembourser le prêt (ou au moins reconstituer le niveau de couverture).
Prenons l’exemple d’un actionnaire d’Orange qui détient 1% du capital (soit 26,2 millions de titres). Le titre Orange cote 14,5 € et la capitalisation boursière du groupe télécom est de 38 Md€. Cet actionnaire pourra négocier avec une banque un prêt de 200 M€ assis sur des titres Orange. Admettons que la banque demande une surcollatéralisation à hauteur de 150 %. L’actionnaire mettra en nantissement 20,7 millions de titres (20,7 x 14,5 = 300 soit 200 x 150 %). Si le cours chute à 12 €, l’actionnaire devra nantir 4,3 millions de titres en complément pour que la valeur du collatéral du prêt conserve une valeur de 300 M€. Si le cours chute à 10 €, l’actionnaire n’aura plus assez de titres pour constituer la garantie (en effet, il en faudrait 30 millions et il ne dispose que de 26,2 millions de titres). Il devra alors choisir entre apporter du cash collatéral, rembourser son prêt (s’il dispose d’autres ressources) ou céder les titres.
Pour la banque ces prêts présentent l’avantage (comme tout prêt sur actif) de limiter le risque[2], du fait de la capacité à liquider une sûreté liquide et elles peuvent donc proposer des conditions plus attractives. Ce type de produits permet à certaines sociétés qui ne pourraient pas emprunter avec leur propre signature (dégageant des flux de trésorerie trop limités ou trop aléatoires) d’avoir accès au marché bancaire. Notons enfin que le margin loan peut être mis en place à la constitution de la participation ou dans un second temps (permettant ainsi à l’entreprise de financer une prise de participation complémentaire ou un autre projet).
Conceptuellement, l’equity swap[3] est un autre moyen de financer une exposition sur une participation cotée. Dans l’equity swap, la banque acquiert les titres, mais noue un contrat avec l’investisseur pour échanger la performance du titre (hausse/baisse et dividendes éventuels) contre un intérêt. Ainsi, l’investisseur est exposé économiquement comme un actionnaire, mais ne participe pas à la gouvernance (il n’exerce pas les droits de vote car il n’est pas propriétaire des titres). Comme pour le margin loan, l’equity swap nécessite de mettre en place un mécanisme d’appels de marge réguliers afin que la banque ne soit pas en risque « en blanc » sur sa contrepartie. Notons que le contrat peut prévoir qu’à l’échéance l’equity swap soit dénoué en titres (c’est-à-dire que la banque livre effectivement les titres à l’entreprise contre paiement de leur valeur initiale) ou en cash (le dénouement du contrat ne sera alors qu’un échange de performance).
Notons bien pour conclure que ni le margin loan ni l’equity swap ne modifie l’exposition économique portée par l’investisseur.
La gestion dynamique de la performance
Le détenteur d’une participation a généralement des objectifs de risque/rendement en lien avec la valeur fondamentale des titres. Il peut s’être fixé un objectif de cours ou de performance annuelle compte tenu des fondamentaux de l’entreprise dans laquelle il a investi. L’utilisation d’options permet de modifier le profil d’exposition économique sur une participation afin de répondre à d’éventuels anticipations ou objectifs de sécurisation (partielle) de taux de rentabilité de l’investissement. Ces instruments permettent par exemple de :
· Sécuriser tout ou partie d’une plus-value avec l’achat d’options de vente (put). Si le cours baisse, l’entreprise sera compensée par la hausse de la valeur de ses options. À l’échéance des options, elle pourra alors décider de vendre sa participation au prix sécurisé ou simplement de recevoir en cash la baisse de l’action constatée et conserver ses titres.
· Mettre en place un effet de levier avec des options d’achat (calls) ou une combinaison d’options. Ainsi une hausse de 1 % du titre sera démultipliée.
Notons que, par nature, la simple mise en place d’un prêt pour financer la prise de participation est en soi une gestion dynamique de la performance car elle permet de jouer l’effet de levier, mais dans des proportions moindres que l’achat d’un call et avec un risque à la baisse souvent plus important que la seule prime d’un call.
· Façonner un profil de performance. De manière plus sophistiquée, un actionnaire pourra combiner des options (achat ou vente) avec des prix d’exercice différents afin de déterminer le profil de rentabilité/ risque qu’il souhaite. La stratégie la plus simple étant un tunnel (collar) qui permet de définir une fourchette de cours où il accepte d’être en risque. Cette stratégie sera obtenue par la combinaison de l’achat d’un put (pour sécuriser totalement ou partiellement la baisse), financé par la vente d’un call à un prix d’exercice plus élevé. L’investisseur sera alors exposé à l’évolution du cours uniquement entre le prix d’exercice du put et celui du call. En-deçà du prix d’exercice du put, il sera protégé contre une baisse ; au-delà du prix d’exercice du call il ne bénéficiera pas de la hausse (coût d’opportunité).
· Bonifier sa performance en vendant des options de vente. Dans ce cas, l’entreprise prend le risque de devoir racheter des actions à un cours déprécié si l’acheteur des options de vente vient à les exercer. Remarquons néanmoins que l’entreprise sera contrainte d’acheter, mais à un prix qu’elle aura jugé ex-ante acceptable pour se renforcer, l’alternative étant de payer la baisse de l’action. La contrepartie est de toucher immédiatement une prime. Si l’option n’est pas exercée, le montant de la prime viendra accroître la performance liée à la détention de la participation.
· Dans une logique similaire, la vente d’options d’achat permet de bonifier la performance en prenant le risque de devoir céder sa participation si les options sont exercées (mais à un prix qu’il aura jugé attractif).
La gestion de l’influence dans la gouvernance
Ainsi que nous avons pu le décrire plus haut, certains instruments (l’equity swap, les options d’achat) peuvent permettre de prendre une exposition économique sans pour autant disposer des droits de vote. Mais réciproquement un investisseur peut conserver les droits de vote d’actions sur lesquelles son exposition économique est réduite et/ou encadrée. Ainsi, par exemple, le détenteur d’une participation qui l’a sécurisée par l’achat de puts verra son exposition économique protégée, mais pourra toujours exercer ses droits de vote en assemblée générale[4].
Pour pousser le raisonnement plus loin, l’investisseur pourrait décider de couvrir entièrement le risque économique à travers une vente à terme de sa participation : il conservera alors les titres tant que la vente à terme ne sera pas débouclée, tout en ayant figé son risque économique. Ici encore, il pourra donc continuer à exercer ses droits de vote. La banque avec laquelle il a contracté pourra également lui proposer de lui prêter les fonds qu’il est sûr de toucher à l’échéance[5]. On parlera alors de prepaid forward. Le même résultat peut être obtenu en utilisant un equity swap, mais cette fois-ci, l’investisseur abandonne la performance du titre à la banque. Cette opération avait été mise en place par Sofina pour sécuriser la plus-value sur une participation d’une valeur d’1 Md€ sur ses actions Richemont, ou plus récemment par la BPI dans sa sortie de Valeo. Ce type de structure est également celle mise en œuvre dans les plans d’actionnariat salarié à capital garanti et effet de levier mis en œuvre par les émetteurs afin de permettre à leurs salariés d’être exposés à la performance de l’action de l’entreprise, mais avec un capital garanti et une incessibilité de 5 ans par exemple.
S’il n’est pas utilisé dans le cadre de la gestion économique d’un risque économique, le marché du prêt-emprunt pourrait à l’extrême être utilisé théoriquement par quelqu’un voulant renforcer son poids dans la gouvernance. Il pourrait ainsi emprunter des titres à un actionnaire spécifique ou sur le marché du repo afin de renforcer son nombre de droits de vote en assemblée générale, puis rendre les titres après, sans risque économique. C’est par exemple ce que l’État a fait sur Alstom, où il a exercé les droits de vote sur 20 % du capital, prêtés par Bouygues entre février 2016 et octobre 2017.
Notons que ces opérations peuvent être attaquées car elles dissocient le lien entre le droit de vote et de l’action. C’est pour cela que les actionnaires ayant emprunté des actions doivent maintenant le déclarer publiquement, via l’émetteur et préalablement à l’assemblée générale, à la suite du rapport publié par l’AMF sur ce sujet en 2008. Mais si l’alignement des intérêts économiques avec la gouvernance paraît en effet sain, il n’enlève rien à la légitimité pour un investisseur de gérer son exposition économique et son profil de risque/investissement.
Le rôle de la banque
Pour l’ensemble de ces produits dérivés – equity swap, calls, put, prepaid forward – la banque qui met en place l’opération couvre son risque action tout au long de la durée de l’opération sur les marchés. Cette gestion dynamique de sa couverture « en delta-neutre » la protège contre l’évolution du cours de l’action. Son risque va donc être principalement sur la gestion de position sur le long terme (donc principalement de volatilité et de liquidité). Le savoir-faire de la banque dans la gestion d’une position optionnelle construite sur-mesure et sur des notionnels relativement importants par rapport aux produits existants dans le marché lui permettra de proposer à ses clients des structures adaptées à leurs objectifs à des prix attractifs.
C’est un peu différent pour le margin loan : dans ce cas, les titres servent de sûretés et donc d’amortisseurs de risque, la banque prenant un risque sur l’emprunteur garanti par des titres. Elle pourra alors potentiellement céder un bloc (avec potentiellement une décote, compensée par le ratio de surcollateralisation) si l’emprunteur fait défaut.
Merci à l’équipe Strategic Equity Transactions de Natixis pour sa relecture de cet article
[1] Le terme fait référence aux appels de marge qui seront nécessaires dans la vie du prêt en cas de baisse importante de l’action.
[2] Et souvent de nécessiter moins de mobilisation de capitaux propres pour satisfaire les contraintes réglementaires de solvabilité, même si ceci dépend de l’éligibilité des titres (liquidité, diversification du risque par rapport à l’emprunteur, etc.).
[3] Pour plus de détails sur l’equity swap, voir le chapitre 53 du Vernimmen 2018.
[4] Sous réserve qu’il n’ait pas prêté les titres à la banque assurant la gestion du put.
[5] En cas de dénouement à terme en titres et non par le solde de la différence de prix.
Tableau : Le bêta des dettes obligataires
Peu utilisé, car le plus souvent non significativement différent de zéro, le bêta des dettes des entreprises mesure leur volatilité par rapport à celle du marché, tout comme le bêta des actions mesure leur volatilité par rapport à celle du marché.
Le bêta des dettes est utile pour déterminer le bêta désendetté dans le calcul du coût du capital par la méthode directe[1]. Comme le tableau ci-dessous, établi par Roland Clère et Stéphane Marande[2], le montre, le bêta des dettes peut être considéré comme quantité négligeable dès lors que l’entreprise est notée au moins BBB (investment grade), pour une durée moyenne de la dette jusqu’à 8 ans. Au-delà de cette durée ou en-deçà de cette notation, le bêta de la dette dépasse 0,1 et commence à ne plus être négligeable. Mais s’il est rare d’avoir une dette bancaire et financière nette totale avec une durée moyenne de plus de 8 ans, des notations explicites ou implicites de BB ou moins ne sont pas rares, en particulier pour les ETI ou les PME.
[1] Pour plus détails sur son utilisation, voir le chapitre 31 du Vernimmen 2018.
[2] Dans l’article « Risque de défaut et valeur des actions : grand oublié ou révolution culturelle », disponible sous www.ssrn.com.
Recherche : Des administrateurs vraiment indépendants ?
Avec la collaboration de Simon Gueguen, Maître de Conférences à l'Université de Cergy-Pontoise
La présence d’administrateurs indépendants de la direction dans les conseils d’administration est souvent considérée comme favorable à la bonne gouvernance de l’entreprise. Dans les entreprises à capital dispersé, ils ont pour mission de protéger les intérêts des actionnaires face aux dirigeants ; dans les entreprises contrôlées par un actionnaire majoritaire, celle de protéger les intérêts des minoritaires. Mais sont-ils vraiment indépendants ? Dans un article publié par une célèbre revue de droit[1], les professeurs Bebchuk et Hamdani remettent en cause l’efficacité des procédures de nomination aux États-Unis et ailleurs dans le monde, et formulent des propositions.
Les auteurs s’intéressent particulièrement aux entreprises contrôlées par un actionnaire majoritaire. Le problème provient du fait que les administrateurs « indépendants » doivent leur élection et leur reconduction essentiellement au majoritaire, et de ce fait ne jouent pas pleinement leur rôle de protection des minoritaires. Ils proposent de soumettre la nomination d’une partie des administrateurs au vote des seuls actionnaires minoritaires. Ces derniers pourraient, sinon choisir directement les administrateurs indépendants, du moins détenir un droit de veto sur leur nomination et leur reconduction. Les auteurs prennent comme exemple le plan de recapitalisation adopté par Google en 2012. Il s’agissait d’une émission d’actions sans droit de vote, permettant d’augmenter le capital sans réduire le contrôle des majoritaires. Pour l’occasion, Google a constitué un comité d’administrateurs indépendants chargé de négocier les termes de l’opération. La proposition de Bebchuk et Hamdani aurait probablement permis de lever les doutes sur la réelle indépendance dudit comité, et donc sur l’opération elle-même.
La question reste toutefois complexe. La situation d’un actionnaire majoritaire face aux minoritaires n’est pas celle d’un dirigeant face à un actionnariat clairsemé. Dans ce dernier cas, le problème classique du passager clandestin s’exprime par le fait qu’aucun actionnaire n’a intérêt à contrôler le dirigeant. La pression exercée par les actionnaires consiste alors à menacer de vendre leurs titres, mais ce mécanisme de marché n’est généralement pas suffisant. Une meilleure protection des actionnaires est nécessaire pour permettre à l’entreprise de se financer dans les meilleures conditions. Le cas de l’actionnaire majoritaire est différent ; celui-ci est par définition fortement investi dans l’entreprise, et a intérêt à la création de valeur. Sa possibilité d’orienter la stratégie de l’entreprise en sa faveur, et même de capter des bénéfices privés au détriment des minoritaires, est en partie justifiée par le fait qu’il supporte l’essentiel des coûts de la gouvernance. Bebchuk et Hamdani proposent que les administrateurs nommés par les minoritaires ne jouent un rôle significatif que pour les transactions présentant un risque pour les minoritaires (comme dans le cas de Google), préservant le contrôle du majoritaire pour les autres décisions.
Un autre article récent sur le sujet peut alimenter notre réflexion[2]. Il s’agit d’une tentative de modélisation du marché des administrateurs. L’article montre qu’un administrateur vraiment indépendant de la direction n’est récompensé que si les autres entreprises ont mis en place de bonnes pratiques de gouvernance. Ainsi, il existerait des externalités dans la gouvernance des entreprises : la présence d’administrateurs indépendants dans une entreprise aurait tendance à se propager dans les autres entreprises, et la question de leur réelle indépendance n’en est que plus cruciale.
La proposition de Bebchuk et Hamdani fait avancer le débat sur les administrateurs indépendants mais présente des limites. Il existe de multiples façons pour un majoritaire de capter des bénéfices au détriment des minoritaires. L’objectif de protéger les minoritaires sans altérer le contrôle du majoritaire est difficilement atteignable, et la question essentielle, celle du degré optimal de protection des minoritaires, reste ouverte.
[1] L.A.BEBCHUCK et A.HAMDANI (2017), Independent directors and controlling shareholders, University of Pennsylvania Law Review, vol. 165(6), pages 1271 à 1315
[2] D.LEVIT et N.MALENKO (2016), The labor market for directors and externalities in corporate governance, Journal of Finance, vol. 71(2), pages 775 à 808.
Q&R : Juger des activités économiques d'après le critère de leur rentabilité contribue-t-il positivement à l'intérêt général ?
Il existe dans l’économie, deux types d’entreprises au sens très large du terme :
1/ celles qui bénéficient de ressources financières dont le coût ne leur est pas facturé : associations, ONG, certaines firmes publiques car elles reçoivent des subventions, cotisations, dons, etc. à fonds perdus. Ceux qui les consentent n’en attendent aucun retour financier, mais des retours différents, car il n’y a pas que la finance dans la vie.
2/ celles qui bénéficient de ressources financières dont le coût leur est facturé d’une façon ou d’une autre sous forme d’intérêts, de dividendes ou d’espoir de plus-values.
Les deux types d’entreprises coexistent dans l’économie, ont des rôles différents, complémentaires et on ne peut pas dire que l’une va prendre le pas sur l’autre, que l’un va disparaître au profit de l’autre.
Factuellement la seconde catégorie regroupe aujourd’hui et depuis longtemps le plus grand nombre d’emplois, assure la plus grande partie de la valeur ajoutée et la plus grande partie des innovations.
Une entreprise de la seconde catégorie doit trouver des ressources financières qui lui permettront de financer ses investissements au sens large du terme : variation du BFR, couverture des pertes de départ pour une start-up, investissement dans un programme de R&D, construction d’une nouvelle usine, acquisition d’un réseau de distribution, etc.
Mais ceux qui lui confient des fonds, les investisseurs, qu’ils soient prêteurs, banquiers ou actionnaires, ne le font pas sans demander un taux de rentabilité minimum fonction du risque couru. Ceci pour une raison simple : il est toujours plus agréable d’aller dépenser 100 € ce soir dans un dîner à deux que d’épargner ces 100 € pour récupérer dans un an ou dans 10 ans 100 €, soit la même somme sans aucun intérêt. Avec un taux d’intérêt nul, l’immense majorité des humains va consommer tout de suite et ne rien épargner au-delà de quelques jours. C’est ce que l’on appelle la préférence pour le présent et qui est un trait du caractère humain bien établi, à travers les millénaires et à travers les continents. Le taux d’intérêt n’est donc fondamentalement au niveau de l’individu que la rémunération de la renonciation à une consommation immédiate au profit d’une consommation future espérée supérieure ; ce qui permet, au niveau de la société, de constituer des surplus permettant d’investir pour le futur et de permettre des progrès.
Donc ceux qui financent les entreprises du second type attendent un taux de rentabilité sur leurs investissements, sinon ils n’investiraient pas. Ce qui ne les empêche pas non plus de financer en parallèle les entreprises du premier type. Ainsi par exemple Warren Buffett, l’un des investisseurs les plus talentueux de notre époque, mais aussi l’un des plus grands philanthropes de tous les temps. Mais il ne peut le faire que parce que, parti de rien, ses financements des entreprises du second type ont été très avisés, ce qui lui a donné des moyens qu’il n’avait pas au départ.
De la même façon que l’entreprise acquiert des matières premières en les payant, qu’elle obtient de ses ressources humaines du temps de travail physique ou intellectuel en les payant, l’entreprise obtient des investisseurs des ressources financières en les payant (le taux d’intérêt est le prix de l’argent, comme le salaire est le prix du travail).
De la même façon qu’une entreprise, en tant qu’entité humaine, ne pourra pas survivre si elle n’est pas capable, dans la durée, de vendre ses biens et ses services à un prix supérieur à son prix de revient ; une entreprise ne pourra pas non plus survivre si elle n’est pas capable, dans la durée, de gagner sur ses actifs un taux de rentabilité au moins égal au coût des ressources financières qu’elle a demandées et obtenues. Ce n’est pas la dictature de la finance, c’est simplement une condition de survie. Si l’entreprise ne paie pas ses salariés, ceux-ci vont la quitter ; et on peut les comprendre. Il en est de même pour les investisseurs.
Comme tout facteur de production, le capital a un coût car il n’existe pas en quantité illimitée, infinie. Mais en face, les humains, de tout temps, ont beaucoup plus de projets que de moyens financiers (c’est-à-dire de surplus accumulés) pour pouvoir les réaliser tous à la fois : finir de faire disparaître la faim dans le monde, finir de faire disparaître l’illettrisme, vaincre le cancer et Alzheimer, conquérir Mars, réduire la pollution, etc.
Il faut donc faire des choix et pour faire des choix il faut des outils. Au cours du temps, deux grandes familles d'outils ont été testées :
1/ le fait du prince : construction des pyramides en Égypte ou plus récemment le président Mao (qui voulait que chaque commune de Chine ait sa propre mini-aciérie, d’où des dizaines de millions de mort de famine à cause d’un mauvais choix d’investissement/allocation de ressources, alors qu’il fallait investir dans la production agricole et jouer les effets d’échelle avec un petit nombre de grandes aciéries), sans parler de l’actuel dictateur nord-coréen. Que le prince soit un individu ou une petite clique qui a confisqué le pouvoir et essaie de le garder par la force ou la terreur ne change rien à l’affaire.
2/ la décentralisation et la responsabilisation des individus qui épargnent et, parce qu’ils sont formés, essaient de faire les meilleurs choix d’investissement possibles compte tenu des risques qu’ils sont prêts à prendre et du taux de rentabilité qu’ils espèrent. Au cours du temps, ces individus ont conçu des outils pour faire des choix d’investissement, qui ont été raffinés et qui sont enseignés aujourd’hui.
Factuellement, dans le temps long, ces outils sont nés pour l’essentiel en Europe au début de la révolution industrielle, à un moment où la Chine avait le même niveau de vie que l’Europe, c’est-à-dire à un moment où un Français sur deux mourrait avant 20 ans et que les autres dépassaient rarement 50 ans, à un moment où les famines épisodiques étaient en train de disparaître. La Chine ne les a pas conçus ni adoptés. Elle a entamé un long déclin relatif, puis absolu à partir de 1949, dont elle n’est sortie qu’il y a près de 40 ans quand elle a écarté la bande des 4 et a commencé à faire confiance aux individus.
En ce qui nous concerne, nous n’avons absolument pas envie de revenir à l’outil « fait du prince » en matière de choix d’investissement. Et rien ne nous laisse penser que les centaines de millions de Chinois, d’Ethiopiens, d’Indiens qui sont sortis de la pauvreté absolue depuis 40 ans envient beaucoup la Corée du Nord, le Vénézuela ou Cuba. En tout cas, nous ne les voyons pas se précipiter vers ces paradis putatifs.
Est-ce que ces outils imposent une prééminence de la finance au sein de l’entreprise ? Non, comme nous l’expliquons dans les chapitre 1 et 30 du Vernimmen, le directeur financier est là pour apporter un éclairage à la direction générale, que celle-ci a parfaitement le droit de choisir des investissements selon d’autres critères, mais que si la rentabilité de ces derniers est insuffisante, d’autres investissements faits ou à faire devront compenser cette rentabilité insuffisante pour couvrir le coût des fonds mobilisés pour faire ces investissements. À défaut, l’entreprise aura des difficultés sérieuses pour continuer d’accéder à des ressources financières, si elle n’est pas capable de satisfaire les demandes de rentabilité des investisseurs qui lui confient des fonds. De la même façon que si nous dépensons plus que nous ne gagnons, et sauf à avoir hérité ou thésaurisé par ailleurs, nous allons avoir de sérieux problèmes.
Est-ce que ces outils peuvent prendre en compte les externalités négatives que l’entreprise génère ? Oui techniquement, mais faut-il encore que la collectivité les mesure et les fasse payer à l’entreprise, car ce n’est pas par construction l’entreprise qui est capable de mesurer ses nuisances sur la collectivité. Lorsque l’on a créé une taxe sur les dépliants publicitaires des supermarchés qui encombraient les boîtes aux lettres, les calculs de rentabilité des entreprises ont été ajustés et elles ont vite arrêté le recours à ce media dont le coût était devenu supérieur au retour. L’instauration de crédits carbone a eu des effets similaires sur un secteur moins anecdotique que le précédent. C’est une affaire de démocratie, c’est-à-dire de capacité de la majorité des citoyens à convaincre les hommes et femmes politiques de pénaliser ainsi les créateurs de d’externalités négatives jugées collectivement comme non désirables et d’aider ceux qui vont souffrir du fait de ces restrictions (le mineur de charbon qui verra sa mine fermer avant qu’elle ne soit épuisée). On est assez loin du domaine de la technique qui est celui de la gestion financière des entreprises.
Est-ce que ces outils sont la garantie de toujours faire les meilleurs choix ? Non. Mais comme on n’a pas trouvé mieux pour l’instant on fait avec, comme l’homme a fait avec le cheval pour se déplacer jusqu’à l’invention des chemins de fer. Le jour où l’on trouvera quelque chose de mieux, comptez sur nous pour l’inclure au plus vite dans le Vernimmen.