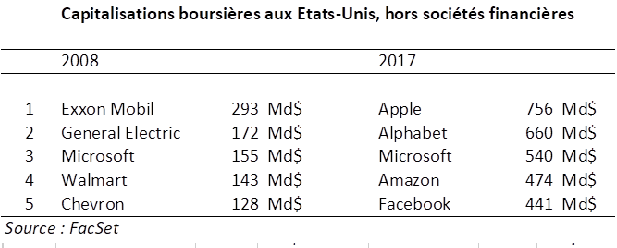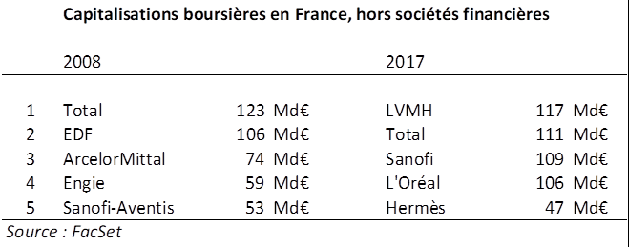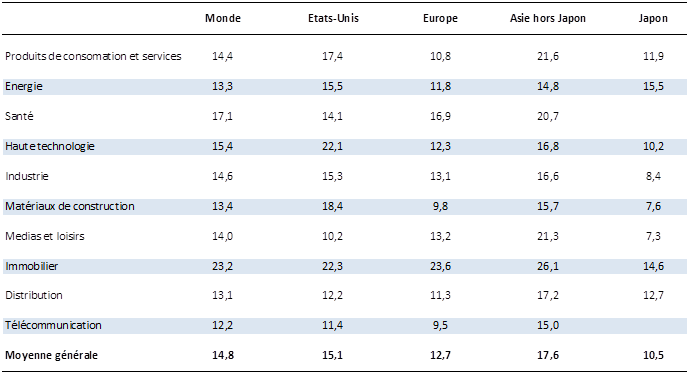La Lettre n°156 de Février 2018
Actualités : 2008-2018-2028, 10 ans de crise et après ? (1/2)
L’Association Française des Trésoriers d’Entreprise (AFTE) nous ayant demandé de faire une conférence lors de ses journées de novembre dernier consacrées à 2007-2017-2027, 10 ans de crises et après ?, en voici une retranscription[1] qui s’étendra sur cette lettre Vernimmen.net et la suivante.
Nous traiterons le sujet en sept points :
1/La liquidité
À la mi-novembre 2008, les étudiants du MBA d’HEC avaient organisé une conférence avec des directeurs financiers sur les difficultés du moment. L’un d’entre eux, Thierry Moulonguet, directeur financier de Renault, nous dit tout de go : « Je ne sais pas comment nous pourrons payer les salaires des employés de Renault à la fin du mois. »
Qu’un groupe aussi important que Renault ne sache pas comment assurer la paie de ses collaborateurs à la fin du mois et soit à court de liquidités était bien sûr pour bon nombre des participants à cette conférence une immense surprise. Que le directeur financier en fasse la confidence à une assemblée d’une centaine d’étudiants était un second sujet de stupéfaction. Mais quand tout s’effondre. . .
Ce n’était bien sûr pas un exemple isolé. La liquidité, qui était supposée être partout et tout le temps disponible (fondement de la volonté, depuis abandonnée, de la généralisation de la full fair value de l’IASB), montra alors son vrai caractère : cyclique et volatile.
Les trésoriers d’entreprise ont répondu à ce défi principalement de deux façons :
- En accroissant la part de liquidités et assimilées détenues à l’actif du bilan de 2,5 % du total des actifs en 2007 à 3,5 % en 2016 en Europe. Aux États-Unis de 4,5 % à 5,5 %. Au Japon de 4,5 % à 6,5 %. De 3,5 % à 4,5 % dans le reste du monde.
- Avec des lignes confirmées et non tirées pour lesquelles les statistiques sont rares.
- En diversifiant les sources de financement : affacturage (passé en France d’un volume annuel de 120 à 270 Md€ de 2007 à 2016, et auquel même les plus grands groupes ont recours comme Total ou Sanofi), marché obligataire, les placements privés (Micado, Euro PP, USPP, Schuldschein), crowdlending, etc.
La part des financements bancaires dans la zone euro est ainsi tombée de 85 % à 78 %. Aux États-Unis, elle est de 23 % contre 77 % pour les produits de marché.
Cette évolution va se poursuivre car c’est l’intérêt des entreprises, d’autant que la technologie et la réglementation s’adaptent pour faciliter cette évolution.
On pourrait penser que la technologie en permettant des paiements/virements instantanés pourrait permettre de réduire le poids des liquidités à l’actif des bilans. Toutefois, l‘exemple nord-américain (les liquidités y représentent 5,5 % des bilans) semble montrer que les financements de marchés requièrent des lignes de précaution renforcées. Donc, l’un dans l’autre, il est douteux que ces montants puissent être réduits significativement. Et quand on a vécu un épisode comme celui de l’automne 2008, on prend dorénavant des précautions. . .
Ceci n’a pas d’impact négatif sur la valeur des entreprises car le raisonnement très majoritaire en ce domaine est l’usage d’un multiple d’un résultat de l’actif économique (EBE, résultat d’exploitation), auquel on retranche l’endettement bancaire et financier net, pour trouver la valeur des capitaux propres[2], plutôt que par le PER.
Si la liquidité est actuellement très abondante pour les entreprises, il est clair que la situation est atypique et ne durera pas éternellement. Puisse les trésoriers ne pas prendre de mauvaises habitudes !
2/La recherche académique
Il y a 4 à 5 000 chercheurs en finance dans le monde qui enseignent un peu et cherchent beaucoup. Accessoirement, ils sont les principaux responsables de la hausse des frais de scolarité dans les écoles de commerce, avec la ponction par l’État des budgets des chambres de commerce qui les possèdent. Leur productivité est structurellement faible comme pour toute activité de recherche fondamentale. Parmi les principales avancées enregistrées sur les dix dernières années, on peut citer :
- John Graham, Thierry Philippon, et Heitor Almeida ont confirmé que la valeur de l’économie d’impôt due à la dette équivaut à la valeur du surcroit d’internalités négatives engendrées par un endettement significatif. S’endetter ne crée pas de valeur en soi, ni ne permet de réduire le coût du capital[3].
- Laurent Frésard a montré l’avantage stratégique des liquidités qui permettent de gagner des parts de marché sur les concurrents moins bien dotés dans ce domaine.
- Et la finance comportementale qui explique les anomalies des marchés efficients par le comportement réel des individus à la rationalité limitée (ayant besoin de liquidités, la plupart des trésoriers cèdent spontanément des OPCVM où ils sont en gain plutôt qu’en perte). Bien que plutôt centrée sur la finance de marché, la finance comportementale explique pourquoi les directeurs financiers qui ont vécu la crise de 1929 préfèrent les capitaux propres, ceux qui sont passés par les marines, la dette. Son père fondateur, Richard Thaler, a reçu le prix Nobel d’économie il y a quelques mois.
Les recherches actuelles en finance d’entreprise s’intéressent en particulier à l’influence des contrats (covenants) sur les opérations de l’entreprise et nourriront, à ne pas en douter, une autre conférence dans 10 ans.
3/Le coût du capital
À la conférence de mi-novembre 2008 que nous évoquions au début de cet article, le directeur financier de LVMH se montra, lui, fort peu disert. Il est vrai qu’il profitait du faible endettement de son groupe pour acheter des actions Hermès massacrées avec le reste du marché. Quelques années après, elles seront cédées, dégageant pour LVMH une plus-value après impôt de 2,7 Md€.
Cet exemple est une illustration parfaite de l’intérêt de la flexibilité financière, qui a beaucoup plus de prix pour un directeur financier plutôt qu’une illusoire et hypothétique baisse du coût du capital entraînée par un niveau d’endettement prétendument optimum auquel nous n’avons jamais cru[4].
En complément des travaux de recherche mentionnés plus haut, la baisse des taux d’impôt sur les sociétés de 38 % à 25 % en 2022 en France, de 30 % à 19 % au Royaume-Uni et aux USA (de 35 % à 21 %) et la faiblesse des taux d’intérêt font douter de la valeur de l’avantage fiscal de la dette. D’autant que la tendance est d’en limiter la déductibilité : la France à 75 % au delà de 3 M€, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et les États-Unis à 30 % de l’EBE.
Le problème d’aujourd’hui dans le domaine du coût du capital est celui de la persistance rétinienne qui fait que les entreprises ajustent leur coût du capital à la baisse des taux d’intérêt avec retard. Ainsi ce grand groupe de biens de consommation non cycliques dont le PDG déclare un coût du capital de 7,5 %, dont le rapport annuel affiche 6,9 % et pour lequel le calcul donne 5 à 6 %.
Le risque est de rater des opportunités d’investissement, même si on peut comprendre que les groupes soient réticents à baisser leur coût du capital craignant que les opérationnels parallèlement baissent les flux dans les plans d’affaires. C’est aussi celui d’être amenés à passer des dépréciations de goodwill dans quelques années en cas de remontée des taux.
Le premier risque est d’autant plus important que le monde continue de changer selon deux axes majeurs : digitalisation des entreprises et prise de conscience écologique des citoyens et des entreprises, ce qui crée des opportunités et des différenciations (acquisition par BNP Paribas du Compte Nickel, de WhiteWave par Danone).
4/L’économie
Notons, rapidement car cela est bien connu, la poursuite de l’émergence des pays émergents de 35 % du PIB mondial en 1990, à 50 % en 2010, puis 60 % en 2020.
Parallèlement, la nature des groupes dans les pays développés évolue comme en témoigne la composition des cinq premières capitalisations boursières aux États-Unis :
Les deux premiers de 2008, des groupes industriels, ne sont plus classés en 2017 que 7e et 11e respectivement.
En France, l’évolution est similaire :
Le luxe a remplacé l’industrie lourde aux premières loges et ce faisant, les actifs économiques comptables des cinq premières capitalisations boursières ont ainsi baissé de 37 %. Comme de surcroît les marges de ces industries sont généreuses, le besoin de financement externe est bien réduit. Si, en 2008, un seul groupe français du top 5 n’avait pas de dettes nettes significatives (Sanofi), ils sont quatre sur cinq dans cette situation en 2017 (Total étant l’exception avec des dettes nettes qui représentent un tiers de sa capitalisation boursière et 1,6 fois l’EBE).
Les investissements prennent de plus en plus la forme d’immatériels, la caricature étant les start-up, financées par capitaux propres et peu par dettes. D’où des besoins d’endettement plus faibles qui ne poussent pas à la hausse les taux d’intérêt dans les pays développés.
[1] Vous pourrez trouver la captation vidéo de cette conférence sur le site vernimmen.net en cliquant ici
[3] Pour plus de détails, voir le chapitre 35 du Vernimmen 2018.
[4] Pour plus de détails, voir le chapitre 37 du Vernimmen 2018.
Tableau : Multiples d'EBE payés lors des changements de contrôle en 2017
Publiés régulièrement par Thomson Reuters dans sa revue annelle des statistiques de fusions-acquisitions[1], les multiples de l’EBE payés lors des changements de contrôle de 2017 montrent des mondes à part et une segmentation nette en fonction des taux de croissance, un peu comme si le risque ne jouait plus qu’un rôle mineur dans la détermination d’un multiple de valorisation :
Ainsi le multiple moyen d‘EBE du Japon, de 10,5 (30 % plus faible que la moyenne mondiale à 14,8) est le reflet d’une atonie de la croissance économique en partie due à une démographie déclinante depuis 2005 et à une politique d’immigration restrictive. À coté, le reste de l’Asie est à 17,6, soit le plus haut niveau observé en 2017.
[1]Que vous pouvez consulter sur : https://www.thomsonreuters.co.jp/content/dam/openweb/documents/pdf/japan/market-review/2017/ma-4q-2017-e.pdf
Recherche : Taux d'impôt et décisions financières ?
Avec la collaboration de Simon Gueguen, Maître de Conférences à l'Université de Cergy-Pontoise
L’article que nous présentons ce mois[1] porte sur les taux d’impôts utilisés par les dirigeants d’entreprise dans leurs processus de décision. Les auteurs ont combiné une approche qualitative, consistant à interroger directement les dirigeants, avec une étude quantitative classique. Ils montrent que les taux d’impôts retenus sont souvent mal choisis, et que cela entraîne des choix sous-optimaux.
Théoriquement, le taux pertinent pour évaluer les conséquences d’une décision financière est le taux marginal d’imposition (TMI), c’est-à-dire le montant (actualisé) d’impôts additionnels payés sur un euro supplémentaire de bénéfice avant impôt. Dans leur étude qualitative, les auteurs ont interrogé 500 cadres dirigeants en charge de la fiscalité (tax executives) d’entreprises américaines, cotées et non cotées, au second semestre 2007. Ils leur ont en particulier demandé quel taux d’impôt ils utilisaient dans leurs prévisions et pour leur prise de décision. Moins de 13 % utilisent le TMI. Les taux le plus souvent retenus sont :
- le taux d’impôt légal (TIL), c’est-à-dire le taux d’impôt officiel (dans 20 % des cas pour les entreprises cotées et 34 % pour les non cotées) ;
- le taux d’impôt effectif moyen (TIE), c’est-à-dire le taux d’impôt payé globalement, et non marginalement, par l’entreprise (dans 27 % des cas pour les cotées et 21 % pour les non cotées).
Pour les auteurs, la principale cause de ces résultats provient de biais comportementaux des dirigeants. Ils remarquent d’abord que l’écart entre le TIL (environ 35 % aux États-Unis) et le TMI est souvent très faible, moins de 2 points de pourcentage. Un biais comportemental classique consiste à substituer une donnée facile à obtenir à une donnée plus complexe lorsque l’écart est supposé faible. Ensuite, ils constatent que le TIE, qui correspond au taux d’impôt publié dans les états financiers, est beaucoup plus souvent retenu dans les entreprises cotées que dans les non cotées. Là encore, le fait d’être influencé par des informations qui nous sont proches ou familières (on parle de « saillance ») est un biais de comportement bien identifié[2]. L’argument du biais de comportement est encore renforcé, selon les auteurs, par le fait que l’usage du « mauvais » taux est moins fréquent parmi les dirigeants les plus diplômés (ces derniers seraient-ils plus rationnels car mieux éduqués ?).
Ensuite, une étude empirique mesure les conséquences de ces choix biaisés. Elle se focalise sur les entreprises qui retiennent le TIE, au lieu du TMI recommandé par la théorie. Le choix de la structure financière est modifié lorsque l’écart entre le TMI et le TIE est significatif ; le levier financier s’éloigne du levier optimal. Les auteurs estiment que ce mauvais choix entraîne une perte de valeur pour l’entreprise de l’ordre de 0,25 % de la valeur comptable de ses actifs (ce qui correspond à 16 M$ en moyenne sur l’échantillon). La perte peut sembler faible, mais il faut lui ajouter d’autres conséquences potentiellement négatives de ce choix. Par exemple, les auteurs montrent que l’utilisation du mauvais taux entraîne une moins bonne réactivité face aux perspectives d’investissement. Ils évoquent également des conséquences possibles en matière de R&D et de fusions-acquisitions.
Retenons de cet article que l’évaluation des décisions marginales doit se faire avec des taux marginaux (d’impôt, en l’occurrence), et que ce n’est pas toujours le cas, même dans les très grandes entreprises !
[1] J.R.GRAHAM, M.HANLON, T.J.SHEVLIN et N.SHROFF (2017), Tax rate and corporate decision making, Review of Financial Studies, vol.30-9, pages 3128 à 3175.
[2] Un effet comparable peut-être retrouvé dans l’article de janvier dernier, « Catastrophes et psychologie des managers, Lettre Vernimmen.net n°146 de janvier 2017.
Q&R : Pourquoi surévaluer les stocks conduit-il à réduire des pertes ou à anticiper des profits ?
Pour bien comprendre le sujet, imaginez une entreprise dans laquelle les ouvriers ont passé un an pour produire des objets qui ne seront vendus que l'an prochain. Ils ont été payés 100. Par ailleurs, on a acheté pour 150 de matières premières intégralement consommées dans le processus de production. Enfin, il y a des frais généraux pour 20.
Quand la matière première a été achetée, le poste banque, qui est un poste du bilan, a diminué de 150 et le poste achat de matières premières, qui est un poste du compte de résultat, a augmenté de 150.
Quand les ouvriers ont été payés pour 100, le poste banque a diminué de 100 et le poste frais de personnel, au compte de résultat, a augmenté pour 100.
Quand les frais généraux ont été payés pour 20, le poste banque a baissé de 20, et le poste autres services externes au compte de résultat a augmenté de 20.
À la fin de l'année, au moment d'établir les comptes, on a des charges pour 150 + 100 + 20 = 270 et aucun produit en face puisque rien n'a été vendu. Donc une perte de 270.
Si au bilan on avait commencé l'année avec 270 de capitaux propres et 270 de liquidités au poste banque, on n'a maintenant plus rien. Les capitaux propres de 270 ont été mangés par la perte reportée à nouveau de 270 et le poste banque a supporté trois dépenses pour un total de 270, donc il est maintenant de 0.
Stop ! Ceci est superficiel et en apparence vrai. Mais on a oublié que quelque part on a produit des biens qui seront vendus au prochain exercice, mais qui ne sont pas encore vendus. Cependant ces biens existent et on ne les a vus nulle part dans les comptes à ce stade. Ce qui montre bien qu'il y a un problème.
On va donc corriger ce problème en reconnaissant que des biens ont été produits et qu'ils seront vendus au prochain exercice. Pour ce faire, on va créer au bilan un poste stock pour le prix de revient des stocks, ici 100 de salaires des ouvriers de production + 150 de matières premières = 250. Pour créer ce poste au bilan, on va transférer des charges de 250 que l'on a enregistrées à tort en charges au compte de résultat. À tort, car à la fin de l'exercice on se rend compte que ces charges se rattachent, non à des produits vendus au cours de l'exercice, mais au cours de l'exercice suivant. Sur le moment quand on les a enregistrées en charge, on ne savait pas encore qu'elles seraient intégrées dans des produits qui ne seraient pas vendus au cours de cet exercice, mais au cours du suivant. Donc sur le coup ce n'était pas une erreur. On ne fait que régulariser ex post à la clôture quand on sait si les stocks ont été vendus ou non.
Pour faire cette régularisation, on a créé au compte de résultat un nouveau poste, parmi les produits, production stockée pour 100 + 150 = 250 et sa contrepartie est le stock au bilan à l'actif, pour le même montant 250.
Au total, on a maintenant un compte de résultat avec un produit de 250 (production stockée) et des charges de 270, d'où une perte de 20 correspondant dans cet exemple simplifié aux frais généraux que l'on supporte chaque année quoiqu'il arrive et qui ne sont pas liés à la production. Et au bilan on a 250 de stocks, 0 de trésorerie et 250 de capitaux propres (les 270 apportés initialement réduits par la perte de 20). Donc c'est équilibré, et c'est bien ainsi.
Si maintenant vous aviez décidé, contrairement à toutes les règles comptables, de valoriser vos stocks 270 en incluant les frais généraux, vous auriez eu au compte de résultat un poste de production immobilisé de 270 et donc un résultat de l'exercice de 270 - 270 = 0 et des stocks au bilan de 270 avec des capitaux propres de 270.
L'an prochain quand vous vendrez vos stocks, si vous les avez valorisés pour 270 vous ferez un profit, différence entre le prix de vente et le prix de revient, qui sera de 20 plus petit que si vous aviez valorisé vos stocks pour 250.
Donc l'inclusion de charges excessives dans un stock conduit, pour autant que vos commissaires/auditeurs ne voient rien, ce qui est douteux, à transférer une perte d'un exercice actuel à un exercice futur car dans le premier vous avez retiré du compte de résultat grâce au poste production stockée 250 de charges et dans le second cas 270. Dans le premier cas vous avez une perte la première année de 20, dans le second cas de 0, mais vous réduisez dans ce second cas votre profit de l'an prochain de 20 (ou vous aggravez la perte de l'an prochain de 20).
Commentaire : Commentaires
Régulièrement, nous publions sur la page Facebook [1] et la page LinkedIn[2] du Vernimmen des commentaires que nous inspire l’actualité financière. Vous en trouverez quelques-uns publiés le mois dernier dans cette rubrique :
Rentabilité des capitaux propres tangibles
La plupart des banques, dans la publication de leurs résultats 2017, ont mis en avant le critère de la rentabilité des capitaux propres tangibles. Cette rentabilité est calculée sur les capitaux propres du groupe desquels sont défalqués les actifs incorporels. En matière prudentielle, les ratios de solvabilité des banques sont calculés incorporels déduits, ce qui est assez logique, car si une banque a des problèmes de solvabilité, il est douteux que ses actifs incorporels (goodwill et marques principalement) aient encore une valeur significative.
Calculer la rentabilité des capitaux propres de la même façon nous paraît abusif. En effet, ces capitaux propres qui disparaissent dans le calcul de la rentabilité sous prétexte qu’ils sont servis à financer des incorporels ont bien été apportés par des actionnaires, sont toujours au bilan de la banque et les actionnaires continuent d’attendre sur ces capitaux propres une certaine rentabilité.
Si ce calcul est fait et mis en avant, c’est bien sûr qu’il permet d’afficher des chiffres de rentabilité plus flatteurs que ceux résultant d’un calcul classique de la rentabilité des capitaux propres, classique mais surtout plus rigoureux et souvent relégué au second rang.
Sans esprit chagrin, on pourra noter que les banques qui ont perdu des milliards ou des dizaines de milliards d’euros de capital propres (Citi, UBS, Deutsche Bank, RBS, Bank of America Merrill Lynch, Unicredit, etc.) bénéficient déjà d’un effet puissant de dopage de la rentabilité de leurs capitaux propres, puisque ces capitaux ont disparu de leur bilan sans que pour autant les actionnaires doivent se contenter d’une rentabilité nulle sur ces fonds.
Être coté en bourse
L'étude de l'Observatoire des offres publiques publiée par Ricol Lasteyrie la semaine passée montre que le nombre de sociétés cotées en France continue de baisser.
Cette évolution nous paraît assez logique compte tenu de 4 facteurs lourds :
1/ La concentration des investisseurs qui réduit leur capacité à investir dans des petites capitalisations boursières. Quand vous gérez 100 M€ sur les petites capitalisations boursières européennes, il est difficile d'investir dans des entreprises au flottant de 20 millions, car 2 % de votre portefeuille investi dans une telle entreprise vous donne 10 % du flottant. La constitution de cette ligne risque de faire monter les cours et la vente de les faire baisser, tout en prenant du temps. Comme souvent ces entreprises sont contrôlées, vous ne vous intéresserez de ce fait qu'à des entreprises dont la capitalisation boursière est d'au moins 40 M€. Et quand vous gérez 500 M€, ayant fusionné ou racheté un confrère comme cela se fait toutes les semaines dans l'industrie de la gestion, le seuil passe quasi mécaniquement à 200 M€.
Si vous capitalisez moins que ces montants, vous aurez du mal à attirer des investisseurs, et donc il n'y aura pas d'analystes financiers vous suivant et s'il n'y a pas de recherche publiée, il n'y aura pas d'investisseurs qui s'intéresseront à votre entreprise, et s'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de recherche, et. . . .
2/ Certaines entreprises réussissent à échapper à cette situation à cause d'une equity story attractive : forte croissance, consolidation d'un secteur dont elles pourront être les consolidateurs, retournement. Mais beaucoup d'entre elles, qui sont venues en bourse il y 10-20 ans à un moment où c'était la mode, sont somme toutes banales, ne déméritent pas, mais ne font plus rêver.
3/ Le coût de la cotation n'a cessé de monter du fait des réglementations de protection des investisseurs, des normes IFRS de plus en plus complexes (cf. IFRS 16 sur les locations opérationnelles qui oblige à les inscrire au bilan en actifs et en dettes). Essayez donc de trouver un rapport annuel qui fasse moins de 150 pages, même pour une PME avec 20 M€ de chiffre d'affaires dans une seule activité ! On estime aujourd'hui le coût global de la cotation en bourse à au moins plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est beaucoup quand vous ne faites plus d'augmentations de capital car vous êtes arrivé à maturité, et que la liquidité de votre titre ne permet pas des échanges significatifs.
4/ La Bourse souffre d'une concurrence accrue de modes de détention du capital avec d'autres formes de gouvernance, souvent plus efficaces : fonds de LBO, fonds souverains, fonds de long terme comme les fonds de pension canadiens, family offices. C'est ainsi que des sociétés de taille moyenne, valant de 1 à 2 Md€ restent sous le contrôle de ce type d'investisseurs, passant d'un fonds de LBO à un fonds de long terme ou à un family office, au lieu de venir à un moment ou à un autre en bourse. Ainsi Sebia, Cerba, Fives, Kiloutou, OGF, etc…
Il n'y a donc pas que la Bourse dans la vie !
Notre interview par Le Monde sur ce thème est disponible sur le site vernimmen.net, en cliquant ici.
Impôts différés
Pourquoi les banques américaines annoncent-elles en ce moment des pertes liées à l’abaissement du taux d’impôt sur les sociétés alors qu’il s’agit d’une mesure qui leur est favorable ?
En fait, ce sont celles qui ont des reports fiscaux déficitaires et qui les ont activés à l’actif de leur bilan qui sont dans cette situation. En effet, quand elles ont enregistré dans le passé une perte avant impôt, de 100 par exemple, elles ont pu la réduire à 65 en comptabilisant un crédit d'impôt futur de 100 x 35 % = 35 (compte tenu du taux d’impôt sur les sociétés de 35 %). Ceci bien sûr sous condition d'estimer que, dans le futur, leurs résultats seraient suffisamment importants pour pouvoir être imputés contre cette perte de 100 fiscalement reportable, leur économisant ainsi des impôts futurs pour 35. Elles comptabilisaient alors à l'actif de leur bilan un impôt différé actif de 35.
Avec un taux d'impôt sur les sociétés qui tombe à 21 %, le montant des actifs différés d'impôts devient faux, puisque les pertes reportables ne généreront plus une économie d'impôt de 35 % de leur montant, mais simplement de 21 %. Donc il faut déprécier ces impôts différés actifs de 40 % de leurs montants (1- 21/35). D'où les pertes publiées en ce moment qui ne concernent que des estimations passées de gains futurs.
Pour plus détails sur les impôts différés, voir le chapitre 8 du Vernimmen 2018.