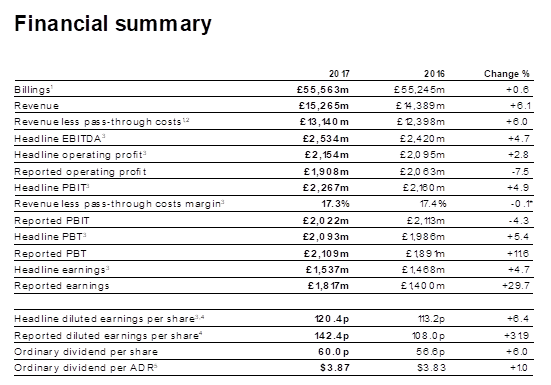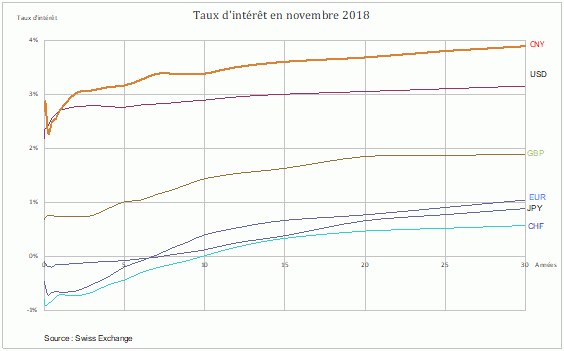La Lettre n°163 de Décembre 2018
Actualités : Les errements des IFRS
Partant de notre expérience pratique des IFRS en tant que pédagogues ou investisseurs, voici un certain nombre de points où l’on gagnerait à réformer les dispositions actuelles, ne serait-ce que pour respecter le principe comptable de la bonne information. Ce qui est un paradoxe, puisque les principes devraient guider les normes, et que le principe de la bonne information est quand même l’un des plus importants, si ce n’est le plus important (true and fair view).
1 -S’enrichir par le simple acte d’acheter à son prix
En 2017, le groupe britannique de tabac, BAT, cinquième capitalisation boursière de la place de Londres (61 Md£), a réalisé un chiffre d’affaires de 20,3 Md£ et un résultat net part du groupe de 37,7 Md£.
Oui, vous avez bien lu 37,7 Md£ pour seulement 20,3 Md£ de ventes. Vous saviez que le tabac était devenu très profitable, mais vous ignoriez qu’il l’était à ce point !
Le premier de nous deux qui a vu cette situation a pensé in petto que l’un des petits jeunes employés par les firmes de bases de données financières pour compiler les rapports annuels avait dû mal placer la virgule, que les systèmes de contrôle n’étaient pas assez fiables, et que le bon chiffre était certainement 3,77 Md£. Eh bien, non ! Le bon résultat net 2017 de BAT est bien 37,7 Md£.
Le second de nous deux a lui pensé que BAT avait dû vendre une filiale très importante, par exemple ses activités internationales, dégageant ainsi une plus-value exceptionnelle qui se serait retrouvée logiquement en bas du compte de résultat. Eh bien, non plus. BAT n’a rien vendu de significatif en 2017 lui permettant de réaliser une plus-value dopant son résultat net.
Par contre en 2017, BAT, s’il n’a vendu aucun actif significatif, a racheté le solde des actions qu’il ne détenait pas dans sa filiale à 42,2%, RAI.
Et alors ?
Et alors, en normes IFRS[1], dans ce cas, on réévalue les 42,2 % initialement détenus au prix d’acquisition des actions du solde du capital, un peu comme si BAT avait un instant de raison cédé ses 42,2 %, avant de les racheter dans une offre sur 100 % des actions de sa filiale. Et plus la prime de contrôle est importante, et plus l’enrichissement comptable des actionnaires est fort, puisque de toute façon le goodwill est inscrit la première année en valeur de marché et ne sera pas déprécié avant un certain temps, si ce n’est un temps certain[2]. Cela n’est pas sans rappeler l’ancienne règle IFRS qui voulait que lorsque la solvabilité de l’entreprise se dégradait et que la valeur de marché de sa dette baissait en conséquence, l’entreprise pouvait enregistrer un profit à hauteur de cette baisse de valeur. Là, on s’enrichissait de sa décrépitude[3].
On vous laisse conclure sur la pertinence d’une telle approche qui gonfle ainsi les capitaux propres comptables de BAT de 62 %, fait exploser les impôts différés passifs de 27,1 Md£ (sur un total de bilan d’ouverture de 40 Md£) contre 0,7 Md£ initialement, alors que trop de lecteurs des comptes croient encore qu’il s’agit de dettes exigibles, ce qui n’est pas le cas[4]. Comment alors calculer des rentabilités économiques ou des capitaux propres correspondant à une réalité, c’est-à-dire à ce qui a été investi par les investisseurs et à non à l’effet de réévaluations ?
Bon courage !
2 - Perdre sans perte
Un groupe a acquis une jeune société, comme cela se fait tous les jours, pour acquérir une nouvelle technologie qui paraissait particulièrement prometteuse. Dès lors, le goodwill représente la quasi-totalité du prix d’acquisition, ce qui n’est guère surprenant dans une économie où l’immatériel est de plus en plus important.
Malheureusement, des technologies concurrentes s’avèrent quelques années après plus efficaces. Le groupe décide alors de céder l’entreprise pour 3 francs 6 sous.
Qu’advient-il du goodwill généré par l’acquisition initiale ? La logique voudrait qu’on le déprécie totalement. Eh bien non, il va simplement être déprécié à hauteur du pourcentage que représente le prix de vente des actifs dans la valeur des actifs de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle il appartient. Autrement dit une poussière. Il va rester à l’actif du bilan alors que l’entreprise qui a justifié son inscription n’est plus dans le périmètre du groupe. Bizarre, non ?
3- Dégager des résultats en faisant du rachat d’actions
Un grand groupe fait des rachats d’actions et son courtier lui livre un bloc d’actions dès le début d’un programme de rachats s’étendant sur plusieurs semaines.
Eh bien, les auditeurs de ce grand groupe ont exigé que la variation de valeur sur la durée du programme des actions ainsi rachetées pour être annulées passe au compte de résultat, alors que les IFRS ne l’exigent pas.
On voudrait discréditer celui-ci que l’on ne s’y prendrait pas autrement.
4 – Inscrire des dettes en capitaux propres
C’est la situation actuelle des dettes hybrides dites perpétuelles[5], où la forme prend le pas sur le fond. Il suffit qu’il y ait une clause de majoration du taux d’intérêt payé par l’émetteur dans le cas où il n’exerce pas sa faculté de remboursement par anticipation (le plus souvent au bout de 5 ans) pour que, en normes IFRS, on puisse enregistrer ce produit de dettes en capitaux propres.
On rappellera qu’il existe pourtant un principe comptable de prééminence de la réalité sur l’apparence, que l’IASB a souvent mis en avant à juste titre pour montrer la qualité et la supériorité de ses normes[6].
Le rôle de pierre angulaire des capitaux propres dans le financement des entreprises est tel qu’il faut appeler un chat un chat, et des dettes des dettes. Les dettes hybrides dites perpétuelles sont souscrites par des investisseurs en dettes ; montées et placées par des équipes obligataires des banques ; dans l’immense majorité des cas les entreprises exercent leurs options de remboursement anticipé au bout de 5 ans. Ce sont donc des dettes, et non des capitaux propres quoiqu’en dise pour l’instant l’IASB[7].
A titre d’exemple, Volkswagen a pu inscrire fin 2017 3,5 Md€ de dettes hybrides parmi ses capitaux propres grâce à des clauses de majoration des intérêts payés de 0,25 % et de 0,75 % en cas de non exercice des clauses de remboursement anticipé, qui lui feront certainement opter le moment venu pour un remboursement de ces produits devenus trop onéreux.
L’IASB réfléchit actuellement à modifier la norme IAS 32 qui permet ce traitement, dans le sens que nous préconisons. Si l’IASB persiste dans cette voie, la comptabilisation de dettes hybrides pourrait effectivement changer vers 2025-2028. On aura le temps de vous en reparler . . .
5 – Inscrire des capitaux propres en dettes
C’est le cas des obligations remboursables en un nombre variable d’actions qui sont inscrites en dettes pour les intérêts et le capital. C’est contraire au bon sens le plus élémentaire puisque le capital ne sera jamais remboursé autrement qu’en actions, le fait qu’il puisse l’être en un nombre variable d’actions ne changeant rien à l’affaire.
Les émetteurs s’en sortent quand même car s’ils ont une option de conversion à leur main de ces ORA en un nombre fixe d’actions, ils peuvent alors les comptabiliser en capitaux propres. Tant pis pour les émetteurs étourdis ou mal conseillés ! Si l’IASB réfléchit aussi sur ce sujet, il ne semble pas pour le moment vouloir changer d’avis sur ce point.
6– Confondre exceptionnel et récurrent
Dans les normes IFRS, la notion d’exceptionnel a été supprimée au prétexte qu’elle relèverait d’un jugement, ce qui est vrai bien sûr, mais n’y a-t-il vraiment rien dans les normes IFRS, américaines ou françaises au demeurant, qui ne relève pas d’un jugement [8]?
Dès lors, comment communiquer sur ses résultats l’année où ils incluent de l’exceptionnel, et où il paraît logique de mettre en avant le résultat net courant ? L’exercice se complique par l’intervention de l’ESMA qui interdit aux entreprises de donner de la prééminence dans leur communication financière à des indicateurs non issus des états comptables.
Cette disposition part d’une bonne intention. Celle d’éviter que les entreprises ne mettent en avant des indicateurs ad-hoc, contingents et particuliers, qui enjolivent la réalité et trompent les lecteurs des comptes.
Résultat de cette démission, les entreprises augmentent de 50 % les données fournies, comme l’illustre cet extrait du rapport annuel 2017 du groupe britannique de publicité WPP :
Après c’est au lecteur de se débrouiller. Mais qui croire ? La comptabilité IFRS qui donne une progression du BPA de 31,9 % ou l’entreprise qui indique avec le qualificatif « headline » un simple et modeste + 6,4 % ? Et le résultat d’exploitation ? A-t-il crû de 2,8% comme l’indique WPP ou baissé de 7,5% selon les normes IFRS ? Et que vaut la progression de 4,7 % de l’EBE quand seule la société donne l’information, puisqu’il n’y a pas en effet de définition de l’excédent brut d’exploitation dans les normes IFRS [9]?
Probablement inconsciemment, l’IASB décrédibilise les normes comptables qu’elle a établies en poussant les entreprises à publier des résultats corrigés, avec la bénédiction du régulateur boursier européen, qui tel Ponce Pilate, ne veut pas juger et demande de mettre tout sur le même plan.
Espérons que l’IASB qui a annoncé vouloir se repencher sur le sujet de la présentation des comptes, revienne en arrière. Est-ce si difficile de demander aux dirigeants de distinguer le récurrent du non récurrent et de l’expliquer en annexe des comptes et aux auditeurs de l’auditer comme il y a quelques années ? En attendant, que de temps perdu et de lecteurs égarés inutilement !
* * *
Nous invitons nos lecteurs qui auraient repéré de leur côté d’autres incohérences, anomalies, ou errements liés aux normes IFRS, à utiliser la boîte aux lettres du site Vernimmen.net en cliquant ici, pour nous permettre de compléter le moment venu cet article d’une suite.
[4] Et si vous en faites partie, nous vous recommandons la lecture des paragraphes 8.57 à 8.63. du Vernimmen 2019 où vous verrez qu’il n’en est rien.
[5] Pour plus de détails sur les dettes hybrides, voir le chapitre 26 du Vernimmen 2019.
[6] Pour plus de détails, voir le chapitre 6 du Vernimmen 2019.
[7] Pour plus de détails, voir la Lettre Vernimmen.net n° 137 de janvier 2016.
[8] « Dans un bilan, il n'y a que la date qui n'implique pas un jugement ». Roman Weil.
[9] Alors qu’elle n’est pas très compliquée : La différence entre tous les produits et toutes les charges d’exploitation qui se traduiront tôt ou tard par un mouvement de trésorerie. Voir le glossaire du site vernimmen.net.
Tableau : La courbe des taux d'intérêt
10 ans. C’est la maturité de la première obligation de l’État suisse à taux d’intérêt positif. Pour les autres périodes plus courtes, il n'y a que des taux d'intérêt négatifs. Pour le Japon, c'est 8 ans, 7 ans pour l'Allemagne, 5 ans pour la France et 3 ans pour l'Espagne.
0,40% : c’est le coût de la dette à 10 ans pour l’Allemagne et ce que rapporterait une obligation à 20 ans en Suisse. Le chiffre est de 1,42% pour la France à 20 ans, contre 1,9% au Royaume-Uni, 3,25% aux États-Unis et 3,68 % en Chine. Comme quoi la zone euro a aussi du bon.
La pente des courbes de taux d'intérêt est normale et peu pentue pour la plupart des pays. Les investisseurs ne s'attendent donc pas à une très forte augmentation des taux d’intérêt bientôt, ni à une très forte baisse[1]. Ils peuvent avoir raison, ils peuvent avoir tort.
[1] Pour plus de détails sur la lecture des courbes de taux d’intérêt, voir le chapitre 21 du Vernimmen 2019.
Recherche : Evaluation d'actifs : le facteur taille réhabilité
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à l’Université
de Cergy-Pontoise
Les modèles d’évaluation d’actifs financiers les plus utilisés sont construits comme des extensions du Modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF), selon lequel la rentabilité espérée d’un actif dépend de la part non diversifiable de son risque. Ces modèles incluent des primes selon les facteurs identifiés comme ajoutant de la rentabilité espérée aux actifs. En particulier, E. Fama et K. French ont proposé en 1993 d’évaluer les actions par un modèle à trois facteurs, dans lequel les deux facteurs additionnels (en plus du risque non diversifiable) sont :
- un facteur de taille (SMB pour small minus big) selon lequel les petites capitalisations apportent une rentabilité espérée supérieure aux grandes ;
- un facteur de valorisation (HML pour High minus low) selon lequel les titres value (ceux dont le ratio book-to-market est élevé) sont mieux rémunérés que les titres growth.
D’autres facteurs sont parfois ajoutés, notamment le momentum.
Le facteur taille a souvent été critiqué. Sa mesure empirique donne des résultats peu convaincants : son impact sur la rentabilité espérée, une fois pris en compte le risque, apparaît faible. Par ailleurs, aucune explication théorique de ce facteur ne s’impose réellement. Dans un modèle standard de marchés sans friction, une prime selon la taille apparaît comme une anomalie. L’article que nous présentons ce mois[1] réhabilite le facteur taille et apporte un éclairage sur ses possibles sources.
L’idée de cet article est de mesurer l’importance du facteur taille en contrôlant l’impact d’autres facteurs. En particulier, les auteurs identifient une forte corrélation entre taille et « qualité » de l’action. Cette notion de qualité fait référence à un ensemble de caractéristiques de l’entreprise sous-jacente, en particulier : la croissance, la profitabilité, le taux de distribution de dividendes, la notation de crédit… Les auteurs ont recalculé l’importance du facteur taille une fois pris en compte ce facteur qualité, sur très longue période (actions américaines entre 1926 et 2012) et sur de nombreux marchés (données sur 23 autres marchés de pays développés entre 1983 et 2012). Les résultats sont très convaincants.
En ignorant le facteur qualité (mais en contrôlant l’effet value et l’effet momentum), le facteur taille fait ressortir un alpha de 14 points de base. Cela signifie que, toutes choses égales par ailleurs, les actions correspondant à de faibles capitalisations apportent une rentabilité espérée mensuelle supérieure de 14 points de base à celle des actions à forte capitalisation. Une fois pris en compte le facteur qualité, le même alpha passe de 14 à 49 points de base ! L’impact devient significatif et le facteur taille ne peut plus du tout être ignoré.
En plus de réhabiliter le facteur taille, cette étude permet d’en étudier la source. Les actions de petites capitalisations sont généralement moins liquides que celles des grandes. Une fois pris en compte un facteur lié à la liquidité du titre, le alpha du facteur taille redevient faible (quoique positif). Il semble donc que la rentabilité supérieure obtenue sur les faibles capitalisations s’explique en grande partie par une prime de risque d’illiquidité du titre.
Ces résultats sont importants pour les praticiens pour au moins deux aspects. Du côté de la finance de marché, ils nous disent que le facteur taille ne doit pas être négligé dans les modèles d’évaluation, et qu’il reste du travail sur l’étude de ses sources. Et du côté de la finance d’entreprise, une prime liée à la petite taille signifie pour l’entreprise un coût du capital plus élevé. Ceci peut contribuer à justifier des opérations de concentration.
[1] C.ASNESS, A.FRAZZINI, R.ISRAEL, T.J.MOSKOWITZ et L.H.PEDERSEN (2018), Size matters, if you control your junk, Journal of Financial Economics, vol.129, pages 479 à 509
Q&R : Heineken a-t-il raison de ne pas procéder à des rachats d'actions ?
Dans le secteur des biens de consommation où, compte tenu de l’importance des marges au plus haut historique actuellement et d’investissements limités dus à une croissance qui s’est ralentie, de nombreux groupes procèdent à des rachats d’actions : Unilever, Nestlé, L’Oréal, Diageo, etc.
Heineken indique de son côté ne pas vouloir procéder à des rachats d’actions, sauf pour rendre le produit d’une cession d’actifs significatifs comme il l’a fait en 2015 pour 365 M€. A-t-il raison ?
Comme nous l’indiquons au chapitre 39 du Vernimmen 2019, un rachat d’actions n’a de sens financier que lorsque :
· Le prix auquel le rachat s’effectue est inférieur à la valeur de l’action.
· L’accroissement du poids de la dette va se traduire par une meilleure performance des dirigeants.
· Les fonds ainsi rendus aux actionnaires ne trouvaient pas à s’employer au sein de l’entreprise dans des investissements pouvant rapporter au moins leur coût du capital.
Avec un consensus de cours cible des 27 analystes qui suivent Heineken de 92 € contre un cours actuel de 80 €, le cours de Heineken n’apparaît pas particulièrement sous-évalué quand on connaît la propension comportementale des analystes financiers à l’optimisme. Le PER 2018 de 21,3 fois, le multiple du résultat d’exploitation 2018 de 17,7, le PBR de plus de 3 n’apparaissent pas spontanément comme anormalement faibles pour une entreprise rentable dont on anticipe d’ici 2020 une croissance de 4,8 % du résultat d’exploitation et de 8,2 % du résultat net.
Avec un ratio de dettes bancaires nettes / EBE 2017 de 2,4, Heineken se laisse visiblement des marges de manœuvre pour faire le cas échéant des acquisitions sans avoir besoin de faire appel à ses actionnaires. Dans la mesure où la famille Heineken détient 50 % du capital via un holding, c’est elle qui décide si elle est confortable ou non avec cette structure financière, et il semble que ce soit le cas vu la stabilité de ce ratio depuis 2011. Notre second point est donc une question assez théorique au cas particulier.
La rentabilité économique de Heineken depuis 2011 est en moyenne de 10,6 %, donc supérieure au coût du capital qui est d’un peu moins de 7 %. La rentabilité économique marginale, c’est-à-dire celle des nouveaux investissements, est de 10,8%. Heineken est donc une entreprise qui crée de la valeur, comme en témoigne son cours de bourse sur le long terme : en croissance de 117 % depuis janvier 2007, contre 98 % pour Molson Coors, de 65 % pour Carlsberg, de 27 % pour AB InBev et de 134 % pour AmBev.
La croissance régulière du taux de distribution passé de 33 % en 2011 à 43 % pour 2017 montre que les flux de trésorerie excédentaires sont restitués sous cette forme aux actionnaires.
Aussi nous semble-t-il, tant que Heineken fera croître ses volumes de bières vendues (de 4,8 % par an depuis 2011), et que ce groupe continuera de trouver des investissements rapportant au moins leurs coûts du capital, que la réponse à la question posée est : oui.
Autre : Nos lecteurs écrivent : Abolition du carbone, abolition de l'esclavage : même combat ?
Par François Meunier
Risquons-nous à un parallèle intrigant et qui peut choquer. Abolir la traite des esclaves et l’esclavage n’a été possible que par un mouvement d’indignation né il y a presque trois siècles en Europe occidentale. Ce fut dans l’histoire le premier vrai moment où une opinion publique internationale s’est levée. Ce qui était presque dans l’ordre des choses vers 1750 allait devenir abject, puis criminel un siècle après. Ne doit-il pas en être de même s’agissant de la protection de la planète ? Les dégâts qu’elle subit ne doivent-ils pas susciter indignation et répulsion pour que les choses bougent vraiment ? La question n’a-t-elle pas une dimension morale et stigmatisante, usant comme pour l’esclavage du registre de l’émotion et de la justice envers la nature et les êtres vivants qui la composent ? En clair, faut-il un nouveau mouvement abolitionniste ?
D’où l’intérêt – que ce trop court article ne fait qu’ébaucher – à regarder comment a pu se construire ce basculement dans la psychologie collective au tournant du 18ème siècle.
Pour introduire, il faut se persuader que l’esclavage dans sa version occidentale, et les traites négrières qui le nourrissaient, répondaient à un impératif économique presque aussi vital à l’époque que l’énergie carbonée. Voir à cet égard les travaux décisifs de Kenneth Pomeranz ou encore la somme faite sur les traites négrières par Olivier Pétré-Grenouilleau. L’économie esclavagiste permettait l’afflux en Europe du tabac et du sucre, si importants pour la diète alimentaire des nouveaux travailleurs des usines, et du coton, qui a permis la structuration de l’industrie capitaliste au Royaume-Uni. Tant la traite et l’exploitation d’esclaves au sein de grandes plantations étaient des activités très rentables, tout autant que l’exploitation pétrolière aujourd'hui.
Très rentables, et surtout parfaitement acceptées, presqu’autant, pourrait-on dire sans chercher à provoquer, que l’acceptation du charbon dans le monde d’aujourd'hui. (Est-ce par prémonition qu’ Hergé osait le parallèle dans le célèbre album de Tintin, Coke en stock ?). La recherche historique est formelle : l’esclavage comptait encore parmi les normes sociales admises jusqu'au 17ème siècle en Europe. L’esclavage des temps antiques s’était poursuivi jusqu'au 12ème siècle, avec une transformation lente vers le statut à peine meilleur de servage, comme le montrent abondamment Marc Bloch ou Larry Siedentop. La traite négrière a commencé à grande échelle sur les plantations portugaises des côtes africaines, et ceci avant la découverte de l’Amérique. C’était bien en nature, c'est-à-dire avec de la marchandise humaine, que l’Espagne négociait alors le rachat des prisonniers des Ottomans. Les Bulgares (d’où vient le mot bougres), des chrétiens manichéens, faisaient l’objet de razzias de la part des chrétiens orthodoxes, pour être revendus à l’ouest, chez les chrétiens catholiques.
Le message chrétien, à une époque où le christianisme régissait encore en Europe l’ensemble des pratiques sociales, n’allait pas contre l’esclavage. Le texte biblique est ambigu et pouvait être convoqué tant par les opposants que par les partisans. Quand les Portugais ont industrialisé la traite sur leurs plantations d’Afrique, le roi a reçu en 1455 une bulle papale l’autorisant à utiliser des esclaves… à condition qu’ils soient noirs.
L’abolitionnisme est incontestablement venu des milieux chrétiens dès le 17ème siècle, mais du côté des puritains et quakers britanniques. Pour les catholiques, ce n’est qu’en 1814 qu’une lettre papale assez timide a été envoyée à Louis XVIII pour lui reprocher de rendre à nouveau légale la traite d’esclaves dans les colonies. Et on ne parle ici que de traite, déjà réprimée légalement par la Grande-Bretagne depuis 1807, et non d’esclavage. La condamnation absolue ne viendra qu’en 1888 avec une encyclique de Léon XIII, qui permit l’efficace participation de l’Église à la lutte contre l’esclavage en Afrique, hélas toujours présent à ce jour dans certains pays.
On aurait tort de mettre la seule Église en cause. L’opinion publique allait ainsi. Beaucoup d’esprits des Lumières étaient loin de suivre Condorcet ou Mirabeau dans leur condamnation explicite de l’esclavage. David Hume, d’Alembert ou plus tard Hegel étaient par exemple convaincus de l’infériorité naturelle du Noir (sans pour autant prôner l’esclavage).
Atout économique ou rejet moral ?
Les historiens débattent toujours du rôle respectif qu’ont joué le facteur économique, la résistance propre des esclaves par soulèvement ou par esquive, et la mobilisation de l’opinion occidentale dans la progressive disparition de la traite, puis de l’esclavage.
Clairement, les facteurs économiques ont joué, comme joue aujourd'hui dans la transition énergétique l’apparition de technologies propres en carbone. Il y a eu un élément de progrès technique dans le déclin économique des plantations, notamment l’acclimatation du tabac ou de la production de sucre aux climats européens. La généralisation du louage du travail puis du salariat à partir de la révolution industrielle britannique a aidé aussi. Il valait mieux payer au travailleur un salaire de subsistance, c'est-à-dire lui « sous-traiter » les charges de l’entretien de sa famille, plutôt que d’internaliser ces coûts dans l’entreprise. On se rappelle la célèbre remarque de Marx comparant le sort de l’ouvrier de l’East End de Londres à celui de l’esclave de Virginie, au détriment du premier. Mais aujourd'hui, une majorité d’historiens, dont le prix Nobel Robert Fogel dans des travaux de référence, considère que l’esclavage est resté très rentable jusqu'au bout.
On entend de la même façon que la transition énergétique pourrait très bien s’opérer de façon indolore, comme résultat de la montée en puissance des énergies propres devenues rentables grâce aux innovations techniques. Dit autrement, l’âge du pétrole ne cesserait pas du tarissement des puits mais de sa non-rentabilité, à l’image de l’âge de pierre qui ne s’est pas arrêté par épuisement du stock de pierres.
Or, le cas de l’esclavage montre que les seules forces économiques ne suffisent pas. Il faut une pression politique, d’autant plus que c’est cette pression qui pousse aux technologies de substitution, surtout aujourd'hui dans cette course contre la montre qu’impose le réchauffement climatique. De plus, le coût économique de la transition ne peut être politiquement entrepris qu’avec la pression d’une opinion publique moralement engagée. Lorsque le Danemark prit le premier, en 1772, l’initiative de prohiber la traite, il se coupait des importations de sucre et de tabac et se mettait en risque, perdant son autonomie alimentaire, vis-à-vis des puissances qui poursuivaient le trafic. De même, le sucre que produisait la Grande-Bretagne dans ses colonies après l’abolition de l’esclavage était 40% plus cher que celui qui provenait du Brésil.
On retrouve ainsi curieusement dans le mouvement vers l’abolition de l’esclavage les problématiques de la Conférence de Paris sur le climat. Il était et il est commode dans les deux cas d’être « passager clandestin », c'est-à-dire de laisser les autres faire le travail et d’en profiter sans effort. L’asymétrie de position des pays est analogue : les effets d’héritage, le poids des industries utilisatrices diffèrent selon les pays. S’agissant de l’esclavage, il était plus facile pour les puissances européennes d’abandonner la traite, de par leurs industries reposant sur le salariat, que pour l’Amérique latine ou le Sud des États-Unis qui vivaient des plantations. Et dans les deux cas s’introduit la question d’indemnités de compensation pour les pays en retard. Ainsi, la Grande-Bretagne s’est engagée dans des compensations financières vis-à-vis de l’Espagne et du Portugal lors des traités de 1817 et 1818. Il y eut une conférence internationale en 1841 pour qu’une convention internationale soit signée au sein d’un bloc de cinq puissances abolitionnistes, libres aux autres de se joindre au traité. L’économiste William Nordhaus, qui vient de recevoir le prix Nobel pour ses travaux, propose aujourd'hui, pour l’abolitionnisme carbone, la création d’un club de pays qui adopteraient en commun une forte pénalisation de l’énergie carbonée, club qui resterait ouvert à qui veut, mais pénaliserait lourdement par des taxes le commerce des pays restant en dehors.
Comment se construit l’opinion publique
Mais pour que la politique joue, il faut l’opinion publique. S’agissant de l’esclavage, le basculement des opinions s’est alimenté de plusieurs courants. Très certainement une tradition chrétienne d’égalité de l’homme devant Dieu, mais aussi l’émergence, à compter de l’âge classique, de l’idée de communauté politique au sein de laquelle les individus sont égaux en droits. L’égalité à l’intérieur de cette communauté, religieuse ou nationale, pouvait s’accommoder un temps – et même se nourrir – d’une soumission des hommes qui n’y appartenaient pas, mais la soumission résiste mal sur la durée au pouvoir dissolvant de l’idée d’égalité et de liberté.
Les campagnes abolitionnistes passaient par exemple par une culpabilisation des citoyens qui consommaient du sucre, un « acte de communion cannibale », disait Mirabeau. En 1791-92, 400.000 adultes, soit un sur onze parmi la population britannique, signèrent une pétition au Parlement, ce qui finalement poussa celui-ci à légiférer : un premier essai en 1791, jusqu'à la loi contre la traite en 1807 et sa désignation comme un crime en 1811. Sous la même pression quaker, le Congrès américain prit cette décision la même année.
Peut-on parler alors d’une abolition du carbone dans le sens moral qu’avait l’abolition de l’esclavage ? Le parallèle rencontre bien sûr des limites. L’enjeu climatique est beaucoup plus complexe ; la cible est moins immédiate et ne porte pas un visage humain comme celui qu’avaient les négriers et les planteurs. S’il y a souffrance humaine, elle est diffuse et éloignée dans le temps et l’espace. On ne peut pas légiférer de façon aussi lumineuse qu’avaient su le faire en quelques jours sous la Seconde République les rédacteurs du décret de 1848 sur l’abolition de l’esclavage.
Aussi, l’indignation et l’empathie sont des mobiles moins aisés à faire naître dans les populations. Il faut donner sens à une « souffrance » animale ou au-delà de tout le monde vivant, et ne pas s’en limiter à l’humain. Ceci pour marquer l’importance qu’a eu la récente encyclique papale Laudato Si. Elle a su porter cette thématique nouvelle, sous le chapeau de la « souffrance de notre sœur la Terre ». Celle-ci reste solide bien sûr, et du haut de ses milliards d’années voit sans doute avec dédain ce grouillement d’acariens à sa surface. Mais le mot porte comme une sonnette d’alarme, aidant à la mobilisation spirituelle des opinions en faveur de l’environnement. L’encyclique dit qu’il faut dépasser le langage rationnel, celui par lequel tout un chacun comprendrait qu’il n’est pas dans « son intérêt » de polluer, parce que cela abîme son cadre de vie et celui de ses enfants. C’est dans le registre de la norme de vie, de la conviction et de l’éthique qu’il faut se placer : il n’est tout simplement pas acceptable, il est « répugnant », de faire telle ou telle chose. Il doit devenir répugnant d’extraire du charbon ou des énergies fossiles du sol, dès lors qu’ils menacent la planète, de même qu’il est répugnant de voir abattre les derniers rhinocéros d’Afrique. La stigmatisation est de l’ordre du dégoût. L’indignation et l’instrument économique sont à ce titre complémentaires et non alternatifs[1].
De même, comme à l’époque de l’abolition de l’esclavage, le ou les pays qui s’engagent dans la lutte contre le carbone contre leurs intérêts économiques immédiats, peuvent bénéficier d’une prime morale. La Grande-Bretagne usait habilement de sa puissance navale pour mettre en force la prohibition de la traite, mais cette abolition lui a beaucoup servi comme argument de soft power et de légitimation de sa domination internationale. Elle était, sinon la nation des droits de l’homme, celle de l’abolition de l’esclavage, un thème récurrent dans le récit national britannique.
Un dernier enseignement est qu’il est parfois utile de cibler des objectifs intermédiaires dans une lutte aussi complexe que le climat. Les abolitionnistes anglais, dit Pétré-Grenouilleau, eurent l’habileté, dans la définition d’une cible politique, de s’attaquer au plus simple, à savoir la traite, plutôt qu’à l’esclavage lui-même pour ne pas immédiatement affronter le lobby des planteurs, autrement plus puissant que celui des négriers. En France, avant la Révolution, il s’agissait plutôt de remettre en cause l’esclavage dans sa généralité, prônant une transition progressive vers l’émancipation, avec indemnité aux planteurs et sans focalisation sur la traite ; en clair, des arguments rationnels à usage des élites, mais avec un poids politique plus faible.
Sur ce modèle, les mouvements écologistes, qui ont la légitimité d’avoir été les premiers, tels des quakers modernes, à dénoncer les gaz à effet de serre, pourraient accepter de remiser un temps leur objectif d’arrêt du nucléaire, une bataille qui, pour légitime qu’elle soit, rend moins lisible le basculement vers une indignation anti-carbone. L’indignation n’empêche nullement un peu de sens tactique.
[1] C’est à ce titre que le message de l’encyclique, si fort soit-il, est limitatif : elle oppose à tort une logique d’économistes dans la lutte pour le climat et une logique morale d’indignation et de respect de la nature. Voir à ce sujet : F. Meunier, « L’encyclique Laudato Si’ et l’économiste », Commentaire, 2015/4, n°152.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière. Vous en trouverez quelques-uns publiés le mois dernier dans cette rubrique :
IBM annonce l’acquisition de Redhat
Le 29 octobre IBM a annoncé une acquisition à 34 Md$, sa plus grosse jamais réalisée, entièrement payée en numéraire.
Avant cette acquisition IBM capitalisait 116 Md$, depuis il capitalise 107 Md$, soit une baisse de 7,5 %.
Il est vrai qu'avec une prime d'acquisition de 63 %, un prix d'acquisition représentant 11,4 fois le dernier chiffre d'affaires connu, et 70 fois le résultat d'exploitation de Red Hat, IBM n'y est pas allé avec le dos de la petite cuillère !
IBM était la quintessence de la multinationale américaine et le premier groupe au monde par sa capitalisation boursière dans les années 1960-1970. Après une mutation finalement réussie, passant de la fabrication des ordinateurs aux services informatiques, IBM souffre beaucoup depuis 2011 avec un chiffre d'affaires en recul constant (79 Md$ en 2017 contre 107 Md$ en 2011).
Présenter cette acquisition comme étant "This is all about growth" est un peu présomptueux, car même si le chiffre d'affaires de Red Hat continue sur sa lancée d'une croissance de 20 % l'an et que celui de l'actuel IBM est stabilisé, l'écart des ventes est tel (2,9 Md$ et 79 Md$) que le taux de croissance du nouveau groupe sera seulement de 0,7 %, la première année. Pas de quoi écrire à sa tante.
Par ailleurs la communication financière est assez malhonnête en soulignant : "Acquisition will be free cash flow and gross margin accretive within 12 months, accelerate revenue growth and support a solid and growing dividend". Ceci ne nécessite en effet aucun talent de management puisque Red Hat a des marges brutes plus élevées que celles de IBM et un flux de trésorerie disponible positif, et donc la croissance de ces deux agrégats, une fois IBM et Red Hat combinés, est aussi sûre que 2 et 2 font 4.
Si IBM a essayé de lutter contre la baisse de ses revenus depuis 2011 en procédant régulièrement à des acquisitions (pour quelques milliards de dollars par an), cette acquisition est beaucoup plus importante et va pousser son endettement net à 4,7 fois l'EBE contre 2,8 fois en 2017.
Si les actionnaires de Red Hat ont rougi de plaisir à l'annonce de cette acquisition avec une progression de 49 % de leur cours de bourse, les actionnaires de Big Blue semblent plutôt avoir une peur bleue en faisant perdre en deux jours les 2/3 de la prime de contrôle payée par IBM.
Maersk et Danske Bank
Le Danemark héberge le plus grand groupe de porte-containers du monde, Maersk, fondé par la famille éponyme qui est aussi la plus grande entreprise de ce pays de 6 millions d’habitants.
Depuis 1928, la famille Maersk est le principal actionnaire (21 %) de ce qui est devenu la principale banque du Danemark, la Danske Bank. Pas stupide en effet d’effectuer une diversification patrimoniale alors que Maersk est dans un secteur très cyclique, ni d’avoir un pied dans une banque qui vous connaît bien pour aider à financer des investissements lourds, un porte-container valant un peu plus cher qu’une trottinette.
La filiale estonienne de Danske Bank, visiblement bien mal contrôlée par sa maison mère, aurait en 9 ans blanchi plusieurs dizaines de milliards d’euros (on parle même de 200 Md€) venant des pays de l’ex-URSS.
La révélation de ce scandale a conduit les actionnaires de Danske Bank à se séparer de son directeur général en septembre, puis tout récemment du président de la banque. Le représentant de la famille Maersk a ainsi déclaré : « Nous sommes un grand actionnaire et nous avons de ce fait des obligations. C’est logique et équitable que nous suscitions de ce fait des attentes ».
A des siècles de distance, on peut répondre à Hamlet qu'au royaume du Danemark, tout n’est pas pourri, tant qu’il existera des actionnaires conscients de leurs responsabilités.
[1] Que vous pouvez consulter ici pour Facebook et là pour LinkedIn.