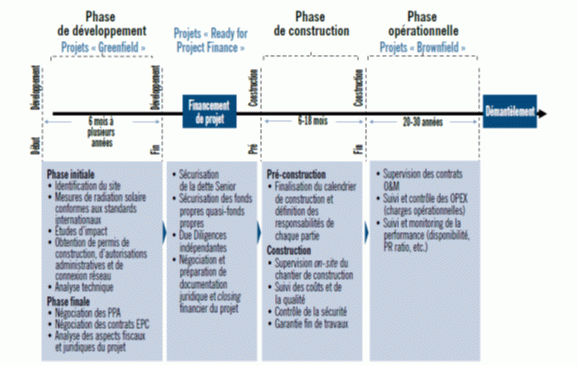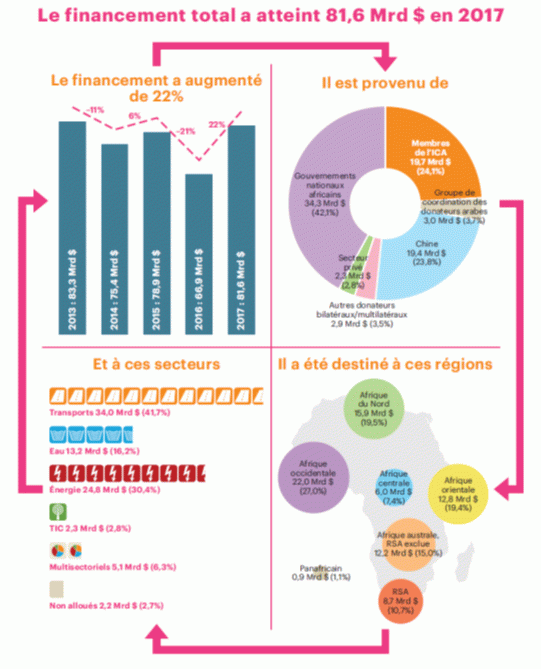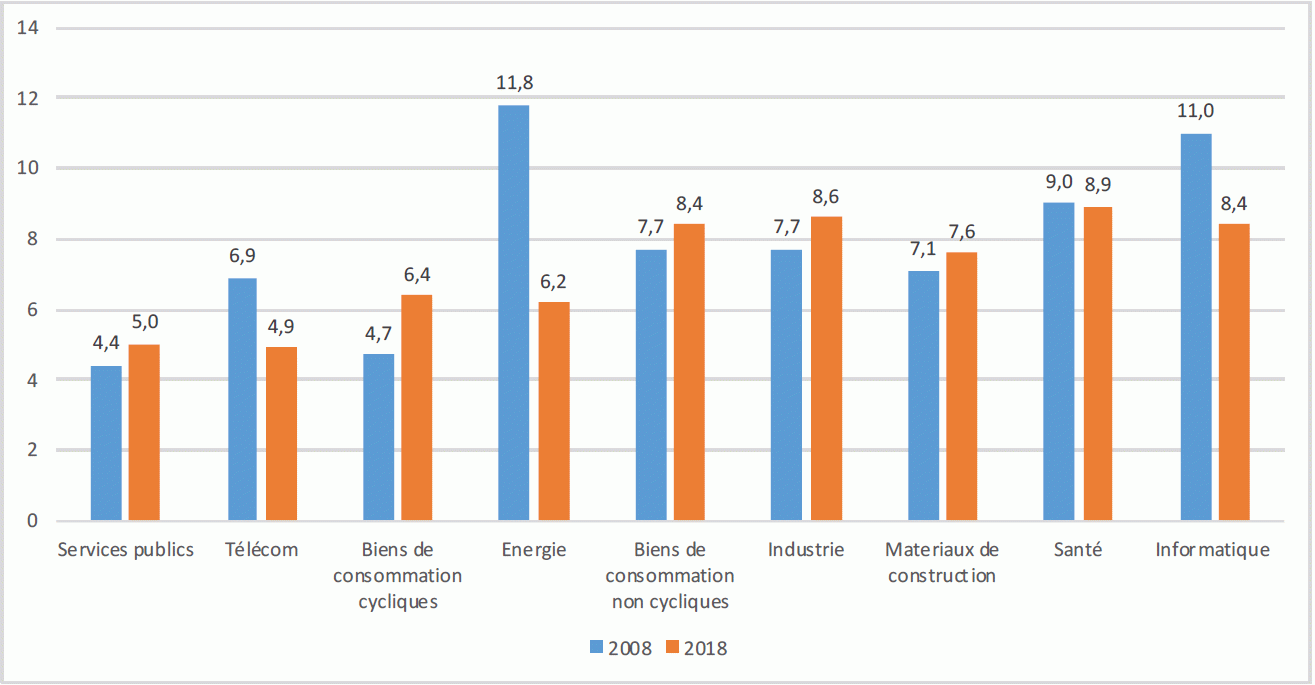La Lettre n°168 de Mai 2019
Actualités : Comment financer la construction au Mali de la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest Échange avec Olivier Leruste, responsable des financements chez Akuo Energy
Akuo a annoncé début mars 2019 le lancement des travaux pour une centrale solaire de 187 000 panneaux solaires (50 Mw) à Kita au Mali. Il nous a semblé intéressant de se pencher sur le financement d’un tel projet. Kita sera la plus importante centrale solaire en Afrique (hors Afrique du Sud). Le projet a été lancé sous la forme d’une concession « Build Operate Own and Transfer » (BOOT). Akuo sera donc opérateur de cette centrale sur une durée de 30 ans.
Le financement de projet est avant tout fondé sur une analyse des risques et leur allocation aux différentes parties prenantes :
Le risque de construction. Olivier Leruste nous indique qu’il est assez faible dans le cas de Kita. Il s’agit en effet d’une technologie éprouvée (ce n’est pas de l’éolien flottant), relativement simple à mettre en œuvre et qui ne nécessite pas d’ouvrage d’art particulier (barrage). Le risque de construction est très largement transféré aux entreprises auxquelles la construction est sous-traitée (à des entreprises spécialisées en « Engineering Procurement and Construction », EPC).
Le risque de volume de production. C’est bien l’exploitant qui prend ce risque, mais il est assez limité pour une centrale solaire (+/-5 %) et ce risque tend à disparaître avec les années de production. L’éolien, par exemple, est plus erratique et le risque de production est donc plus important.
Le risque de prix. Il convient de souligner tout d’abord que le prix de production de l’électricité par une centrale solaire est compétitif par rapport à une centrale thermique. Dans le cas de Kita, le prix est garanti par un contrat d’approvisionnement (Power Purchase Agreement, PPA) à prix fixe avec l’opérateur national, Électricité du Mali. Le contrat a une durée de 28 ans et garantit à Kita un prix d’achat pour tous les volumes produits. La ligne chiffre d’affaires du business plan ne devrait donc pas être compliquée à faire !
Le risque politique. Il peut apparaître significatif en Afrique sub-saharienne, mais il peut être circonscrit grâce à une assurance risque-pays proposée par des organismes spécialisés (Coface, Euler-Hermès, Lloyds, …). Akuo fait remarquer que l’intervention comme financeur d’un organisme multinational est un bon garant de la pérennité des accords noués avec le gouvernement malien et ses émanations.
Le risque de change peut être un vrai enjeu. Les contrats d’approvisionnement sont souvent libellés dans une devise forte (le dollar). C’est un enjeu politique important pour les États qui sont alors contraints d’engager sur le long terme des dépenses en devise. Dans le cas de Kita, le PPA est en francs CFA, dont la parité avec l’euro est fixe. Le risque est réduit, d’autant que le contrat prévoit une réévaluation du prix d’achat de l’électricité à la centrale en cas de dévaluation du franc CFA.
Akuo, pour chacun de ses projets, produit une matrice des risques avec pour chacun la partie qui l’assume et le risque résiduel assumé par l’apporteur en capitaux propres (c’est-à-dire Akuo ici). Olivier Leruste estime que le risque est le plus élevé pour Akuo la veille du closing bancaire. En effet des coûts d’étude importants ont alors été engagés, et ces coûts seraient passés par pertes et profits si le projet ne voyait pas le jour. Le risque se réduit fortement après deux à trois années d’exploitation quand la centrale a démontré sa capacité de production et que les coûts de maintenance sont bien maîtrisés.
La négociation du PPA est donc cruciale car c’est ce contrat qui, en grande partie, définit l’allocation des risques entre l’opérateur et l’acheteur d’électricité (c’est-à-dire en pratique l’État malien). Plus le contrat allouera les risques à l’État (prix, change, volume, droit compétent, cas de résiliation possible, clauses d’indemnité…), plus le projet sera « banquable », mais bien évidemment moins il sera favorable à l’État donneur d’ordre. L’équilibre est donc difficile à trouver.
Le coût total du projet Kita est d’environ 85 M€. Son financement est assez classique avec une tranche de dette senior, une tranche de dette junior et des capitaux propres. En France, en Europe ou en Amérique du Nord, la dette aurait été apportée par une banque commerciale. Dans les pays émergents, les banques commerciales locales sont souvent trop petites et ne disposent pas des compétences assez spécifiques pour analyser des financements de projet. Les banques occidentales sont la plupart du temps frileuses pour prendre le risque pays. Ce sont donc les banques de développement locales ou internationales qui prennent le relais.
Le financement senior a été dimensionné sur un business plan, dans une version bancaire robuste avec une probabilité de 90 %, ce qui est assez standard pour ce type de projet. La dette a alors été calibrée pour que son service représente les 2/3 des flux de trésorerie disponibles (Debt Service Cover Ratio, DSCR de 1,5). Ce chiffre est assez prudent ; dans des pays occidentaux, le DSCR serait plutôt de l’ordre de 1,15. Le levier financier senior sur le projet Kita est de 70 %.
La dette senior de 54 M€ sur 15 ans est apportée par Emerging Africa Infrastructure Fund Limited (un fonds dans l’orbite de la Banque Mondiale), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), la Banque Nationale de Développement Agricole du Mali (BNDA) et la Société néerlandaise pour le financement du développement (FMO).
Membres de l’ICA (Consortium pour les Infrastructures en Afrique) : les pays du G8, la République d’Afrique du Sud, le Groupe de la Banque mondiale (GBM), le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), la Commission européenne (CE), la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque de développement de l’Afrique australe (DBSA)
Source : ICA, Tendances du financement des Infrastructures en Afrique en 2017, 2018
Un financement junior est venu compléter le financement pour 10 % du montant de l’investissement. Il prend la forme d’une dette mezzanine de 8 M€ sur 20 ans, portée par Green Africa Power (GAP, fonds de développement des énergies renouvelables en Afrique financé par le gouvernement britannique).
À ces dettes vient se rajouter une garantie fournie par GuarantCo qui sécurise les paiements à un an (ce qui évite donc de devoir surfinancer pour créer une réserve de cash dans le projet).
L’ensemble des capitaux propres du projet est apporté par Akuo. Notons que le niveau de capitaux propres a été calibré sur un scénario sensiblement moins prudent que celui retenu pour les prêteurs (avec une probabilité de réalisation de 50 %). Le coût des capitaux propres élevé vient rémunérer ce risque !
Hormis Akuo, les financeurs sont publics ou multinationaux. Comme le montrent les données de l’ICA, les financements privés sont encore rares en Afrique, en particulier lorsqu’il s’agit de dette. Les banques de développement nationales ou multinationales n’en demeurent pas moins des banques. Non seulement elles disposent d’équipes particulièrement compétentes sur le financement de projet, mais leur objectif est bien également d’être rentables. On peut même noter que comme leur objectif n’est pas commercial, elles deviennent très exigeantes lors de la négociation contractuelle (et en particulier des PPA).
* * *
L’énergie solaire reste très peu développée en Afrique (hormis en Afrique du Sud). L’Institut Montaigne vient de publier un rapport[1] mettant en avant l’opportunité que représente le développement du solaire pour le développement en Afrique. Les centrales solaires sont rapides à construire (plus qu’une centrale thermique), leur maintenance est simple et peu onéreuse, l’électricité est produite à un coût compétitif, la taille des centrales est très adaptable aux besoins… Akuo a démontré que les projets bien ficelés pouvaient être financés et aboutir.
Sur le papier, rien de simple (géographie complexe, absence de banque commerciale importante sur la région, …). Cela a d’ailleurs été la réaction initiale d’Akuo qui s’est engagé dans ce projet initié par R20-Regions of Climate Action, ONG fondée par Arnold Schwarzenegger. Akuo a donc tout d’abord eu la simple ambition de conseiller R20 et le gouvernement malien sur la faisabilité du projet dans une optique plus d’aide au développement que commerciale sur cette mission. Lorsque le gouvernement a proposé à Akuo de prendre en concession (par adjudication directe dans le cadre de leur plan d'urgence suite à la signature des accords de paix), cette jeune entreprise française d’énergie renouvelable (mais le producteur d’énergie renouvelable indépendant leader en France) s’est dit pourquoi pas. Il faut dire qu’Akuo recule rarement devant les projets dans des zones géographiques a priori complexes (Monténégro, Indonésie…).
[1] Institut Montaigne, « Énergie solaire en Afrique : un avenir rayonnant ? », février 2019.
Tableau : L'endettement des groupes américains
Fruit des travaux de McKinsey[1], le premier graphique montre une montée de l’endettement, caractérisé par le ratio dette nette/EBE, pour à peu près tous les secteurs en revue entre 2008 et 2018 :
Cette montée est de l’ordre de 50 %.
Toutefois le second graphique, qui représente le ratio de l’EBE sur les frais financiers, donne une image différente de l’évolution entre 2008 et 2018 :
Il indique de combien devrait être divisé l’EBE pour ne plus permettre le paiement des frais financiers par l’exploitation de l’entreprise (en négligeant les variations du BFR). Là, la baisse moyenne est de l’ordre de 10 %.
Les messages apparemment contradictoires envoyés par ces deux graphiques s’expliquent par la baisse des taux d’intérêt depuis 2008 qui rend plus facile un endettement plus lourd qui coûte moins cher, d’autant qu’il est essentiellement à taux fixe (car essentiellement de nature obligataire) et sur des dettes dont la maturité moyenne s’est allongée.
[1] « Rising corporate debt: Companies are safe, for now », Mai 2019.
Recherche : De quelle manière les titres sont-ils alloués aux investisseurs lors des introductions en Bourse ?
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à l’Université
de Cergy-Pontoise
Généralement, les introductions en Bourse représentent une bonne affaire pour les investisseurs, en raison de la décote d’introduction. Cette décote varie selon les époques et les marchés ; dans les années 2010, elle est de l’ordre de 5 % en Europe, un peu plus de 10 % aux États-Unis[1]. La plupart du temps, la demande de titres est largement supérieure à l’offre, et la question de l’allocation entre les différents investisseurs se pose. L’article que nous présentons ce mois[2] soutient l’idée d’un donnant-donnant dans le processus d’allocation : les banques privilégieraient les investisseurs qui leur rapportent le plus en commissions perçues dans d’autres opérations.
Les auteurs utilisent pour cette étude une base de données originale, constituée à l’initiative de l’autorité de marché britannique (la Financial Conduct Authority, FCA) en 2014. Elle porte sur les introductions en Bourse mises en œuvre par des banques situées au Royaume-Uni entre 2010 et 2014. Au total, ce sont 220 introductions en Bourse qui sont étudiées, pour un montant d’environ 160 Md$ (les trois-quarts du marché européen des introductions en Bourse sur cette période).
Le premier résultat porte sur les offres formulées par les investisseurs. Toutes choses égales par ailleurs, les investisseurs qui formulent des offres à cours limité obtiennent davantage de titres que ceux qui formulent des offres en quantité (sans limite de prix). Ces offres fournissent à la banque plus d’information sur l’opération d’introduction ; le donnant-donnant porte donc ici sur la réussite de l’opération. Toutefois, cet effet n’est visible que sur une partie des banques de l’échantillon. D’autres caractéristiques des offres supposées apporter de l’information (offres précoces, offres révisées au cours de la procédure…) n’ont pas d’impact significatif sur l’allocation des titres aux investisseurs.
Un résultat plus spectaculaire est obtenu lorsque l’on s’intéresse aux liens entre les banques et les investisseurs. Les investisseurs qui se situent dans le premier quartile de ceux qui rapportent le plus à la banque, obtiennent (relativement à leur offre) 60 % de plus que ceux qui se situent dans le dernier quartile. Sur l’échantillon étudié, les recettes totales des banques en lien avec les investisseurs participant aux introductions en Bourse s’élèvent à près de 40 Md$. Sur ces 40 Md$, l’essentiel provient de commissions de courtage ; les commissions liées aux introductions elles-mêmes représentent moins de 400 M$. Pour cette raison, dans l’allocation des titres, les banques privilégient les investisseurs qui leur rapportent le plus de manière générale. C’est donnant-donnant !
Cette stratégie ne se fait pas nécessairement au détriment de l’émetteur. Il est possible que ce donnant-donnant se traduise partiellement par des commissions plus faibles (mais ceci reste à démontrer). Quoi qu’il en soit, les résultats de cette étude suggèrent un rôle important des autorités de marché dans le contrôle des introductions en Bourse. Entrée en vigueur en janvier 2018 (donc après la période retenue pour cette étude), la directive MiDIF 2 exige des banques d’investissement une justification de leur procédure d’allocation ; il serait intéressant d’étudier si cette plus grande transparence change quelque chose à la pratique du donnant-donnant.
[1] On mesure ici la décote par la performance du titre observée le premier jour de cotation. Voir aussi à ce sujet le Vernimmen 2019, chapitre 46, page 952.
[2] T. Jenkinson, H. Jones et F. Suntheim, « Quid pro quo? What factors influence IPO allocations to investors? », Journal of Finance 2018, vol. 73, pages 2303 à 2341.
Q&R : Question - Réponses
Si la valorisation obtenue via une actualisation des flux de trésorerie disponible (DCF) est une valorisation pré-money (c’est-à-dire avant prise en compte de l’augmentation de capital), celle obtenue avec une actualisation des flux de dividendes (DDM discounted dividend model) est-elle d'office post-money ?
Effectivement la valeur obtenue par actualisation des dividendes (DDM) est une valeur post-money des capitaux propres puisque les dividendes qui sont actualisés sont ceux du plan d’affaires de l’entreprise qui suppose la réalisation de l’investissement (comme pour un DCF) ET la réalisation du financement. On aboutit donc à une valeur post-money.
Si la valorisation obtenue via une actualisation des flux de trésorerie disponible (DCF) est une valorisation pré-money (c’est-à-dire avant prise en compte de l’augmentation de capital), celle obtenue avec une actualisation des flux de dividendes (DDM discounted dividend model) est-elle d'office post-money ?
Effectivement la valeur obtenue par actualisation des dividendes (DDM) est une valeur post-money des capitaux propres puisque les dividendes qui sont actualisés sont ceux du plan d’affaires de l’entreprise qui suppose la réalisation de l’investissement (comme pour un DCF) ET la réalisation du financement. On aboutit donc à une valeur post-money.
Autre : Formations
Voici les dates des prochaines formations que nous avons conçues pour Francis Lefebvre Formation avec des enseignants que nous avons sélectionnés par l’excellence de leur pédagogie :
- Ingénierie financière le 7 novembre 2019 à Paris
- Les mécanismes du LBO et l’environnement du Private Equity le 24 octobre 2019 à Paris
- Gestion de la trésorerie et des risques financiers : quelles priorités en 2019 le 2 octobre 2019 à Paris
- Définir la structure de financement adaptée à votre entreprise le 19 novembre 2019 à Paris
Autre : Nos lecteurs écrivent: Le « juste prix » médiéval et le fonctionnement des marchés
Par François Meunier
Pourquoi voudrait-on, autour de la notion de « juste prix », entraîner le bon lecteur de La Lettre Vernimmen.net dans les arcanes de la théologie médiévale ? Eh bien, parce que le débat qui a eu lieu à l’époque féodale et préclassique apparaît, pour qui s’intéresse à la finance, d’une modernité étonnante. Il enrichit à coup sûr nos discussions sur ce qu’est le fonctionnement d’une économie de marché dans sa capacité à fixer les prix. Voyons la chose.
Le « juste prix » a connu une histoire intellectuelle un peu curieuse sous l’influence de toute une école d’historiens, ramenant l’idée à quelque chose d’obscur, teinté de subjectivité, mise en place par les religieux de l’époque pour faire pièce aux forces aveugles du marché et limiter la concurrence qui tend toujours à affaiblir l’un ou l’autre des participants. On rattachait cette demande d’un prix juste à une société très hiérarchique et protectrice, reposant sur l’honneur plus que sur l’intérêt individuel, une société segmentée en guildes professionnelles dont le but était, entre autres, de protéger ses membres de la rugosité du marché. Il s’agissait, dans les échanges économiques, que les personnes puissent vivre correctement selon leur rang établi une fois pour toutes. Pour dire les choses de façon tranchée, mais qu’on trouve de façon plus élaborée chez Max Weber ou Werner Sombart, le juste prix, c’était dans cette vision une protection contre le marché. L’Église catholique, qui a poursuivi au moins jusqu'au XVIIe siècle une réflexion très intense sur ce qu’est une économie d’échange, est devenue curieusement silencieuse par la suite, et a aidé à propager cette idée d’un prix juste parce qu’opposé à la détermination aveugle du marché. Il faut attendre le XXe siècle pour retrouver chez elle une vision plus équilibrée.
On doit à un historien d’origine flamande, Raymond de Roover, d’avoir, par un article fameux publié en 1953[1], bousculé cette interprétation trop commode. Il commence par montrer qu’à l’origine de l’interprétation « anti-marché » du « juste prix », il n’y a qu’un seul texte, cité et re-cité, venant d’un théologien allemand assez mineur du XIVe siècle, Heinrich von Langenstein. Celui-ci indiquait, qu’à défaut d’une fixation du prix par les autorités publiques (sa préférence), un producteur ne pouvait fixer son prix au-delà de ce qui allait lui assurer un gain lui permettant de maintenir son statut. S’il allait au-delà, disait-il, ce serait de l’avarice. D’où une hiérarchie simple des valeurs : d’abord, l’autorité publique, ensuite et à défaut, des intervenants, artisans, ouvriers, guildes, etc., qui s’abstiennent de pratiquer des marges au-delà de ce qu’il est séant, dans cette société très ordonnée, pour chacun d’eux de gagner.
Or, les grands textes sur le sujet remontent à une époque bien antérieure et racontent tout autre chose. Le plus fameux est le capitulaire introduit par Charlemagne (le Pricuit) – un texte qui fut introduit au XIIIe siècle dans le droit canon – qui stipulait que le prêtre devait admonester ses fidèles afin qu’ils ne chargent jamais un prix au-delà de ce qui était pratiqué sur le marché local. Certes, en cas de plainte, le prêtre se chargerait lui-même de déterminer le prix « avec humanité ». Mais la règle était : marché local d'abord.
Les deux théologiens majeurs que sont Albert le Grand et Thomas d’Aquin se sont longuement exprimés sur le sujet. Albert indique notamment que le juste prix, « c’est ce qu’est la valeur d’une marchandise selon l’estimation du marché au moment de la vente ». Toujours la référence à l’échange prévalant sur le marché. À propos de Thomas d’Aquin, de Roover cite ce passage de la « Somme » pour le moins étonnant. Thomas évoque le cas d’un marchand qui arrive avec ses réserves de blé dans un pays qui vient de subir une grande disette, et qui sait pertinemment que de nombreux marchands lui font suite et pourront ainsi fournir du blé en abondance. Le marchand a-t-il le droit, demande Thomas, de vendre son blé au prix qui prévaut sur le moment, un prix évidemment gonflé par l’énorme demande de blé ? Ou doit-il annoncer que du blé arrive incessamment en grande quantité, ce qui fera chuter le prix ? Verdict : il peut vendre son blé au prix courant sans enfreindre les règles de justice. De Roover signale malicieusement que la plume de Thomas semble hésiter ici puisqu’elle se dépêche d’écrire que le marchand agirait toutefois vertueusement à donner la pleine information au marché. L’exemple choque nos yeux modernes. On assimile cette pratique à du « prix abusif ». C’est ce dont se plaignaient les habitants de Miami à qui l’on demandait de quitter la région devant l’avancée du cyclone Irma en septembre 2017 quand ils subissaient un doublement des tarifs aériens. Seuls les thuriféraires les plus extrêmes du marché iraient à dire qu’il est bon qu’il y ait des prix abusifs, puisque ce sont eux qui déclenchent un afflux de l’offre propre à rééquilibrer le marché à la baisse.
Quoi qu’il en soit, la primauté du marché dans la définition du juste prix est clairement affirmée, même s’il ne s’agit pas de n’importe quel marché, on va le voir très vite. Selon un exemple donné par un commentateur de Thomas dans le siècle qui a suivi, un producteur n’est pas en droit d’attendre de son produit une « juste » rémunération, à savoir une rémunération qui le paie de son travail et son effort, si par mégarde il n’arrive pas à vendre au même prix que ses concurrents. Il doit accepter le prix courant, même s’il ne couvre pas ses coûts, parce qu’il s’agit du prix déterminé collectivement, « par la communauté ». Le théologien dominicain Francisco de Vitoria, au début du XVIe siècle, était plus clair encore : les coûts de production, les salaires ou le risque encouru ne sont pas un critère pour juger du bon prix (ceci contre l’idée qu’un juste prix n’est qu’une marge raisonnable sur les coûts) : c’est l’offre et la demande qui dictent les conditions de la vente. Les producteurs inefficaces ou malchanceux n’ont qu’à assumer les conséquences de leur incompétence, malchance ou défaut de prévision.
Il y avait certes des exceptions. Les couvents bénédictins – un ordre qui produisait et vendait ses produits – avaient pour règle de ne pas respecter le marché local pour fixer les prix de vente de leurs produits. Il leur fallait toujours une décote, ceci pour ne pas dépendre du diktat du marché et pour faire montre de générosité. Ce faisant, ils respectaient d’un côté le marché, pour fixer leur décote, mais le perturbaient de l’autre, en détruisant la rentabilité pour les producteurs alentour, ce qu’en termes modernes on appelle la concurrence déloyale.
L’historienne Laurence Fontaine note à quel point la référence au marché était omniprésente à cette époque, ceci bien avant la rupture capitaliste que les historiens fixent au XVIIIe siècle[2]. Un instrument privilégié était celui des enchères, qu’on utilisait quasiment toujours s’agissant des biens de base tels que les céréales, le pain ou la bière, des biens dont on sait qu’ils sont marqués par une forte volatilité du prix (en cas de rupture de stock, le prix peut monter extrêmement vite et fort, parce que l’offre n’est pas rapidement adaptable). Et l’enchère – enchère en général ouverte, comme dans une criée aux poissons – était jugée efficace pour diffuser l’information et affecter le bien à celui qui en avait le besoin le plus grand (à revenu identique, nuancerait l’économiste moderne). Elle note que seuls les aristocrates et les ordres monastiques ne souhaitaient pas se lier aux prix de marché, en achetant à la fois à crédit et en dessous du prix affiché, parce que les codes d’honneur de l’époque impliquaient de ne pas se plier à des relations contractuelles anonymes comme celles du marché. Pour la citer : « Mais, à l’égal des nobles, (le) statut (des moines) leur impose de maintenir leur différence dans tous les actes de la vie et, ils refusent, eux aussi, le marchandage qui place vendeurs et acheteurs sur un pied d’égalité. »
Nos comptables modernes ont relancé fortement le débat sur ce que doit être le prix à prendre en compte pour mesurer les flux dans la comptabilité d’entreprise. Ils parlent de « juste valeur » comme du prix qui serait reçu pour la vente lors d’une transaction « normale » (orderly transaction) entre des participants de marché à la date d’évaluation. Notons qu’on parle de « valeur » plutôt que de « prix », pour aussitôt dire que la valeur…, c’est le prix. Il reste dans cet usage du mot valeur une sorte de vision essentialiste par laquelle le prix ne caractériserait que la surface des choses, soumis qu’il est aux hasards du marché, sans consistance ni rationalité. Il faudrait au contraire quitter cette « illusion » du prix, pour rechercher la vraie valeur de l’objet ou de l’actif. Cette vision n’a jamais été plus explicite que chez les économistes classiques, jusqu'à Marx compris, qui cherchaient dans le facteur travail le principe organisateur de la valeur, caché sous le phénotype du prix. Nos anciens du Moyen-Âge ne rentraient pas dans ce distinguo. Ils se reconnaîtraient dans ce qu’en disait Adam Smith pour qui la valeur est « ajustée non par une quelconque mesure, mais par la négociation et le marchandage du marché »[3]. Ou bien chez Hobbes qui disait plus d’un siècle avant Smith : « La valeur de toutes les choses soumises à contrat est mesurée par l’appétit des contractants, et ainsi la juste valeur est ce qu’ils sont disposés à payer. » Mais on va voir que nos théologiens allaient beaucoup plus loin que Hobbes.
Le marché, mais pas n’importe quel marché
En effet, ils étaient avertis des limites que rencontrait fréquemment le marché. Une des voix les plus écoutées au XVIe siècle, le cardinal Cajetan, un thomiste averti, indiquait ainsi ce qu’il fallait entendre par la notion de juste prix : « il s’agit du prix qui, à un moment donné, peut être obtenu des acheteurs, à la condition d’une information partagée et d’une absence de fraude et de coercition ».
Nous y sommes. Le juste prix, c’est le prix de marché, mais d’un marché qui fonctionne bien, à tout le moins dans son partage de l’information et dans la mise en relation de participants libres et non contraints. La très grande école jésuite espagnole, celle que moquait brillamment mais bien à tort Pascal dans ses Provinciales, ajoutait une notion supplémentaire et toute nouvelle à l’époque, celle de « concurrence ». Pour que le marché exprime bien le prix, il fallait une multiplicité d’acheteurs et de vendeurs, permettant une bonne circulation de l’information, non soumis à l’obstruction de monopoles. On s’insurgeait par exemple contre le monopole qu’avaient acquis les marchands de Séville dans l’offre de métaux précieux en provenance des Amériques : ils faussaient le prix de rien moins que l’argent ou l’or, c'est-à-dire de la monnaie. Un monopole empêche de disposer de la bonne information, il exerce une coercition sur les acheteurs ou les vendeurs. On voit alors s’avancer alors la notion chère aux économistes de la fin du XIXe siècle, et bien sûr idéalisée, d’un prix normatif qui s’établirait dans les conditions épurées d’un marché de concurrence pure et parfaite. Les rentes acquises par des positions de force ou par de l’information cachée éloigneraient de ce « bon » prix.
Pour ces commentateurs médiévaux, la solution était immédiate : si le marché ne fonctionne pas bien, c’est aux autorités de prendre la main, de décréter ce que sera le « juste prix ». D’où d’ailleurs l’assimilation, souvent faite par les historiens, du « juste prix » au « prix administré », ce qu’on appelait la « taxation » du prix. De fait, le prix de beaucoup de marchandises était « taxé » et, s’agissant du blé, quand il a été trop rapidement libéralisé avant la Révolution française, sous l’impulsion des économistes des Lumières, les conditions d’un marché libre étaient loin d’être réunies, de sorte que le marché a été livré à moult « accapareurs », « agioteurs » ou « regrattiers ».
La fixation du prix par un expert ou par le Prince est un moyen rudimentaire, mais elle évoluera vers ce qu’il est devenu au XXe siècle, à savoir une régulation des marchés, à la fois des biens et services, du travail et des actifs financiers. Il s’agit d’assurer que le jeu concurrentiel s’exerce pleinement, notamment par une action aussi rigoureuse que le jeu politique le permet. Mais nos théologiens touchaient déjà le point : le marché est la bonne référence de la valeur, mais s’il s’agit d’un marché mis dans les bonnes conditions de fonctionnement.
Prolongeant cette discussion, on peut s’interroger sur la notion de « valeur fondamentale » utilisée en finance. Elle dit cette chose simple que la valeur d’un actif – et au demeurant de tout bien – est la somme en date d’aujourd'hui des services, pécuniaires ou non, qu’il peut rendre dans le futur. Elle inspire les techniques d’évaluation des actifs financiers. Mais comme le note Eugène Fama[4], la définition est quelque peu tautologique. On peut tout aussi bien dire que la valeur à aujourd'hui des services futurs rendus est mesurée par la valeur présente de l’actif. Car il faut un modèle, MEDAF ou autre, et il faut une prévision de flux futurs, pour faire cette évaluation. Que dit alors le test ? Mesure-t-on l’écart du prix à la valeur ou bien la pertinence même du modèle, ce que Fama appelle le « dilemme de l’hypothèse jointe » ? Le vrai test de mesure de la valeur de l’actif est celui où le marché qui fixe son prix fonctionne de façon idéalement concurrentielle. C’est la leçon, certes pas toujours opératoire, qu’apportent les débats médiévaux dont on se fait ici l’écho.
[1] Raymond de Roover, « The Concept of the Just Price: Theory and Economic Policy », The Journal of Economic History, Vol. 18, n° 4,1958, pages 418 à 434. Malheureusement, non disponible en accès libre sur internet.
[2] Voir : Laurence Fontaine, L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Paris, Gallimard, 2008.
[3] Et qui pourtant s’est essayé parmi les premiers économistes à expliquer la valeur à partir de la quantité incorporée de travail dans la production du bien.
[4] Dans le discours de réception de son Prix Nobel.
Commentaire : Commentaires
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière.
Et des actions peuvent avoir une valeur négative !
C’est toujours un sujet d’étonnement pour nos étudiants, mais il peut arriver que parfois le vendeur soit obligé de payer l’acheteur pour que l’acheteur accepte de lui acheter ses actions. Autrement dit, on aboutit à un prix de vente négatif pour les actions de la société cédée.
On en a encore eu un exemple la semaine passée lorsque le groupe de distribution Auchan a vendu sa filiale italienne (3,6 Md€ de ventes et 14 600 personnes employées), en perte depuis 2011, pour un prix négatif représentant, selon les déclarations du dirigeant d’Auchan, 2,5 années de pertes de sa filiale italienne.
Techniquement, le vendeur recapitalise la société à vendre par une augmentation de capital qui porte, dans cet exemple, les liquidités nettes de tout endettement financier et bancaire à 2,5 fois les pertes de l’exercice. Puis, il cède les actions pour un euro. L’acheteur trouve alors dans la société acquise les moyens financiers de financer une partie du redressement.
En recapitalisant la filiale en perte, le vendeur fait un investissement dont le délai de récupération est court (2,5 ans pour Auchan). Ce type d’issue est souvent préféré à une liquidation qui pourrait lui coûter moins cher, mais qui ne serait pas sans conséquence sur son image et serait en contradiction avec un comportement social responsable, surtout si le groupe est par ailleurs profitable.
Il va sans dire que ceci n’est possible que lorsque la société à vendre est une entreprise non cotée, comme dans le cas de la filiale italienne d’Auchan.
Vodafone réduit son dividende de 40 %
Encore un exemple qui montre, que non, les entreprises confrontées au choix entre faire des investissements et verser des dividendes ne font pas le choix du dividende au détriment de l’investissement, n’en déplaise à tous ceux qui considèrent l’économie comme un champ de déploiement de leurs idéologies et non comme celui des faits.
C’était l’avant-dernier opérateur téléphonique européen à ne pas avoir réduit son dividende, Swisscom est le dernier. Vodafone pourra ainsi plus aisément financer le déploiement de la 5G en Allemagne et en Italie, de ses acquisitions en Allemagne et en Europe de l’Est (les actifs câble de Liberty Global pour 17,5 Md€), tout en faisant face au poids d’une dette nette qui va devenir plus importante de ce fait (actuellement 27 Md€, soit environ 2 fois l'EBE).
Les investisseurs savaient que ce choix serait fait, car quand une entreprise présente, comme Vodafone, un taux de rendement (dividende/cours) de 9 %, on se doute bien que le dividende n’est pas maintenable, sauf à rentrer dans un processus de liquidation qui n’est pas celui choisi par Vodafone, ni par ses actionnaires.
Mais au Royaume-Uni où les investisseurs sont très attachés au dividende, car cela finance les retraites (système par capitalisation et non par répartition), couper un dividende est toujours compliqué, surtout quand il représente le 7e plus gros dividende britannique.
Pauvres milliardaires britanniques
Le Sunday Times vient de publier sa liste des milliardaires britanniques qui débute cette année avec les frères Hindujan, actifs dans la banque, l’énergie et l’informatique (25 Md€), puis les frères Reuben (21,5 Md€ dans l’immobilier) et Jim Ratcliffe (21 Md€ dans la chimie). Si l’on établissait la liste commune des milliardaires français et britanniques, les 6 premiers seraient des milliardaires français et les 3 milliardaires britanniques cités seraient respectivement en 7°, 9° et 10° derrière la famille Pinault (en 6° position avec Gucci, Saint-Laurent, Christies) et Dassault (en 8° position).
Curieux alors que la France et le Royaume-Uni sont assez proches par la taille et le PIB, de voir une telle disparité. Elle peut s’expliquer par la fiscalité britannique quasi confiscatoire des années 1970 (avec un taux marginal d’impôt de 98 %), le Brexit qui a fait baisser la livre de 13 %, et la place prise par la finance au Royaume-Uni qui, à PIB constant, laisse moins de place au reste de l’économie. Or, comme un financier ne crée pas de valeur mais la répartit[2], il est plus difficile d’y trouver des milliardaires que dans . . . le luxe par exemple, secteur de 5 des 6 premiers milliardaires français.
Bitcoin et crypto-monnaies
Ces jours-ci, nous avons encore lu un article assez creux sur le bitcoin. Beaucoup de spécialistes autoproclamés indiquent où ils voient le cours du bitcoin dans un an : 3 000 $ pour certains, 10 000 $ pour d'autres. Ils n'avancent aucune justification, ce qui n’est pas étonnant : sans économie sous-jacente (comme pour une devise) ou une entreprise (comme pour une action ou une obligation), le cours du bitcoin a une vie largement autonome, résultante d’un nombre limité de bitcoins pouvant être émis... Bien que le concept de blockchain soit intéressant (même si son efficacité économique reste à prouver compte tenu de ses coûts énergétiques), nous sommes beaucoup plus circonspects sur l'utilité des crypto-monnaies. Celles-ci ressemblent plus à ce stade à un artifice, pour cacher des transactions financières parfois douteuses, qu'à une réelle avancée.
Myopie
Vigéo Eiris a été vendue à Moody’s. C’est une nouvelle bien triste et même affligeante.
Vigéo Eiris est une agence internationale indépendante de recherche et services ESG (Environnement, Social et Gouvernance) à destination des investisseurs et des organisations privées, publiques et associatives. Fondée par l’ancienne dirigeante de la CFDT, Nicole Notat, co-auteur avec Jean-Dominique Sénard, du rapport sur l’entreprise et l’intérêt général, qui a très tôt compris l’importance que les thématiques ESG allaient prendre.
Détenue à 91 % par la quasi-totalité des principaux gestionnaires d’actifs français (Amundi, AXA, BNP Paribas, CDC, CNP, Lazard, Natixis, etc.), Vigéo a réalisé un chiffre d’affaires 2017 de 9,7 M€ en progression de 25 % avec une perte réduite de 5,2 M€ à 3,4 M€. Moody’s a publié quant à lui des ventes 2018 de 4 442 M$ en progression de 5 % et un résultat net de 1 309 M$. Rien à voir bien sûr.
Financer pour encore quelques années de quelques millions d’euros par an une agence de notation ESG européenne est-il vraiment hors de la portée des principaux investisseurs institutionnels français qui gèrent collectivement plusieurs milliers de Md€ ? N’y a-t-il pas d’autres solutions que de vendre Vigéo Eiris à une entreprise d’un pays qui a quitté les Accords de Paris et dont les notations des véhicules investissant dans les crédits sub-prime[3] ont contribué à la violence de la crise de 2008 ?
Si Moody’s réalise cette acquisition, c’est bien sûr que cette agence n’a pas développé d’expertise ESG, et que le marché décollant, Moody’s veut rattraper son retard par une acquisition. Mais ne nous leurrons pas. Vigéo Eiris sera absorbé, broyé au sein de Moody’s, si ce n’est tout de suite, au bout de quelques années ; et les quelque 150 salariés de Vigéo Eiris pèseront peu face aux 12 000 de Moody’s. C’est un nouveau pouvoir normatif, dont l’importance va croître, qui quitte le giron de l’Europe pour rejoindre un pays dont le slogan est devenu America First.
[1] Que vous pouvez consulter ici pour Facebook, et là pour LinkedIn.