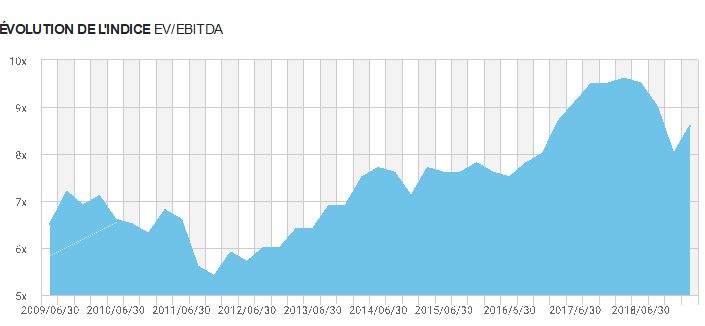La Lettre n°169 de Juin 2019
Actualités : Le pacte d'actionnaire d'une jeune pousse
Le club d’entrepreneurs français « The Galion Project » a eu l’excellente idée de proposer un modèle de term sheet de pacte d’actionnaires pour le premier tour d’investissement d’une jeune pousse avec des fonds de capital risque (« Série A »). Ce document bénéficie de l’expérience d’une soixantaine d’entrepreneurs ainsi que de deux avocats renommés dans ce domaine.
Ce squelette de pacte a plusieurs mérites :
- Il est équilibré entre intérêts des entrepreneurs et des investisseurs.
- Il permet d’éviter certains écueils et est adapté à l’environnement et au droit français.
- Il a été validé par des grands fonds de capital risque de la place.
Ces auteurs le précisent bien, il s’agit là d’un point de départ pour la discussion, chaque situation est unique et il sera nécessaire de l’adapter en fonction des particularités du projet et des investisseurs.
Le document est disponible (et commenté) ici :https://thegalionproject.com/term-sheet.
Le pacte d’actionnaire d’une jeune pousse régit la gouvernance de la société au cours de sa vie, mais aussi les droits et les devoirs des actionnaires lors des levées de fonds suivantes, en cas de cession ou de liquidation de l’entreprise. Ceci est assez standard dans un pacte d’actionnaire, mais pour une start-up, les enjeux de valorisation sont plus importants que dans une entreprise classique (car les entrepreneurs cherchent à valoriser un important goodwill et parce que la valorisation est beaucoup plus incertaine).
Le document est en anglais… bien qu’il soit spécifiquement ciblé sur des sociétés françaises, les auteurs anticipent que tôt ou tard des investisseurs étrangers pourront s’y intéresser, d’où la recommandation de préparer dès le premier tour une documentation dans la langue de Shakespeare.
Le plan est le suivant :
- Issuer
- Founders
- Seed investors
- Type of security
- Structure of financing
- Closing conditions
- Liquidation preference
- Automatic conversion
- Optional conversion
- Anti-dilution
- Redemption
- Dividends
- Voting
- Series A majority approval
- Pre emptive rights
- Lock up
- Right of first refusal
- Co sale
- Drag along
- Liquidity
- Information and audit rights
- Board of directors
- Management rights
- Leaver
- Employee stock option plan
- Assignment of IP rights
- Non compete/exclusivity
- Documentation
- Exclusivity
- Expenses
- Confidentiality
- Applicable law
- Appendix
Le document est intégralement décrit sur le site Galion Project, nous nous limiterons donc à commenter quelques clauses majeures ou très spécifiques aux jeunes pousses, celles correspondant aux points en rouge plus haut.
Notons tout d’abord que pour intéresser des fonds de capital-risque, il convient de leur donner des droits spécifiques. Pour ce faire, une catégorie spécifique d’actions est créée. Ces actions ont les mêmes droits de vote, sont convertibles en actions ordinaires (et ont vocation à l’être à moyen terme) ; à court terme ces actions offrent des droits plus importants que les actions ordinaires émises à la création de la société et lors de la levée de fonds auprès des friends & family et de business angels.
La disposition la plus caractéristique d’une levée de fonds de start-up est certainement la clause de liquidité préférentielle[1]. Devenue désormais standard dans les levées de fonds, elle dispose que les actionnaires entrants dans la dernière levée de fonds sont remboursés prioritairement de leur investissement en cas de cession ou de liquidation de l’entreprise. Le term sheet Galion propose donc une clause assez simple en cas de cession ou liquidation :
- les premiers 20 % du produit sont répartis proportionnellement à tous les actionnaires en fonction de leur participation (carve-out). Ceci permet de conserver un alignement d’intérêts et une motivation dans tous les scénarios ;
- les actions de la séries A sont ensuite prioritaires jusqu’à remboursement des sommes investies (en tenant compte des sommes reçues au titre des premiers 20 %) ;
- le solde (s’il existe) est enfin alloué proportionnellement à tous les actionnaires en fonction de leur participation.
La liquidité préférentielle permet de réduire le risque pour les fonds entrant en Série A en compensant le prix par action plus élevé que lors de la précédente levée de fonds. La clause peut d’ailleurs être beaucoup plus favorable à l’investisseur en prévoyant, non pas le remboursement de son investissement, mais un multiple de celui-ci ou une rentabilité annuelle.
Il existe des clauses plus complexes. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez les trouver dans le guide des bonnes pratiques du capital risque publié par France Invest (http://www.franceinvest.eu/dl.php?table=etude_publication&chemin=uploads/_afic&nom_file=capital-risque-guide-des-bonnes-pratiques-version-2010_1.pdf)
Généralement, la liquidité préférentielle pour les porteurs d’actions Série A disparaît au tour suivant, une nouvelle liquidité préférentielle étant accordée aux porteurs d’actions Série B.
Les clauses de ratchet (anti-dilution dans le document de Galion) permettent d’ajuster rétrospectivement les prix d’une levée de fonds en cas de levée de fonds ultérieure à un prix inférieur. Assez classiques il y a quelques années, ces clauses se font aujourd’hui plus rares. En effet, elles aboutissent à une dilution importante des actionnaires fondateurs et une démotivation, ce qui n’est jamais bon pour une start-up.
Les clauses touchant à la gouvernance sont assez classiques pour un pacte d’actionnaire. Notons quelques recommandations intéressantes :
- Limiter le conseil à un nombre réduit d’administrateurs. C’est une particularité pour les jeunes pousses : elles se doivent d’être agiles et de pouvoir prendre des décisions rapidement. La convocation et la gestion d’un conseil trop large ne sont donc pas adaptées.
- Offrir un droit de veto aux porteurs de Série A est un impératif. Galion suggère que ce veto soit collectif, et non individuel, ce qui évite d’être dans les mains d’un investisseur particulier. Corrélativement, Galion suggère fortement de cibler au moins deux fonds pour la Série A.
Le document propose une liste de décisions soumises à la majorité qualifiée (en annexe B). Cette liste type a vocation à être adaptée en fonction des particularités de la société.
La clause de fondateur sortant (leaver) proposée est assez complexe avec une proportion d’actions cessibles à prix de marché croissante dans le temps (sur une période de 3 ans). Le rachat des titres non libres est proposé au nominal aux fondateurs, à la société. Les titres libres peuvent être acquis à prix de marché par les fondateurs et les investisseurs Série A. Cette clause montre l’importance clé des fondateurs dans une start-up (souvent plus importants que le concept même sur lequel repose l’entreprise). Tout comme la clause d’exclusivité précisant que les fondateurs doivent consacrer l’essentiel de leur temps à la start-up, l’utilité de la clause de leaver est avant tout de maintenir la motivation des managers. Notons néanmoins, que si le projet bat de l’aile, ces clauses n’auront pas une grande utilité. Elles servent avant tout pour gérer une mésentente entre les fondateurs ou une erreur de casting.
Dernière clause à soigner pour une jeune pousse : celle permettant l’émission d’actions ou d’options pour les employés. D’expérience, cette clause est assez facile à inclure dans un pacte d’actionnaire et paraît légitime et justifiée dès lors que la dynamique de la négociation est bonne. Ça l’est beaucoup moins après l’investissement car toute dilution sera vécue par les investisseurs comme un sacrifice. Une enveloppe de 10 % est généralement suffisante sauf si un poste clé du management reste à pourvoir, il conviendra alors d’imaginer quel pourrait être le package attractif pour la perle manquante !
[1] Voir La Lettre Vernimmen.net n°157 de mars 2018, pages 7 à 9.
Tableau : La valorisation des petites sociétés cotées
Depuis plusieurs mois, la société Infront Analytics, qui fournit les bases de données financières du site vernimmen.net[1], publie un indice de valorisation des petites valeurs cotées de la zone euro.
Il est composé de plus de 1 100 sociétés de la zone euro, dont 67 % valent entre 15 M€ et 150 M€, le solde entre 150 et 500 M€. La médiane des valorisations est à 82 M€, on est donc vraiment dans les petites valeurs, et la marge d’EBE médiane est à 10,8 %.
La France fournit 28 % de l’échantillon, quand on ajoute l’Allemagne, on atteint 50 %. L’ajout de l’Italie, de l’Espagne et du Benelux fait dépasser les trois-quarts.
Les secteurs des produits industriels, des technologies et la santé font la moitié de l’échantillon.
L'indice de valorisation Eurozone Small Cap Infront a fortement rebondi au premier trimestre 2019 avec un niveau médian de valeur de l’actif économique sur EBE (EV/EBITDA) de 8.6x, contre 8.0x en fin d’année 2018, hausse explicable par un meilleur contexte sur les marchés financiers actions, qui a aussi bénéficié au segment des petites valeurs.
Pour obtenir de plus amples informations, https://smallcaps.infrontanalytics.com
[1] Que vous pouvez consulter en cliquant ici
Recherche : RSE et concurrence : les entreprises socialement responsables peuvent-elles survivre ?
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à l’Université
de Cergy-Pontoise
Un problème essentiel de la question éthique en finance est celui de la conciliation entre responsabilité sociale et performance économique. Qui paie les politiques de RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) ? Les actionnaires ? Les salariés ? Dans les deux cas, comment les entreprises dont les dépenses de RSE sont les plus élevées peuvent-elles survivre à leurs concurrents ? C’est la question à laquelle tente de répondre, de manière à la fois théorique et empirique, l’article que nous présentons ce mois[1].
Les auteurs ont focalisé leur étude sur les Employee Grant Schemes (EGS)[2]. Le principe est le suivant : lorsqu’un salarié de l’entreprise décide d’effectuer un don à une association ou un organisme d’utilité publique, l’employeur effectue lui-même un don au même organisme. Le don de l’employeur est le plus souvent égal à celui du salarié, mais d’autres ratios, ainsi que des plafonds, peuvent être spécifiés. Selon l’étude, on trouve des EGS dans un peu plus de la moitié des entreprises du S&P500.
La première partie de l’étude propose un modèle théorique permettant d’étudier les conditions de la survie des entreprises pratiquant les EGS. Le point de départ est que tout écart de salaire ne peut être expliqué que par un écart de productivité. Le versement d’un don dans le cadre d’un EGS constitue une forme de salaire ; à productivité donnée, il ne peut pas être prélevé sur les profits. Pour le dire autrement, ce sont les salariés qui paient. Dans ce cadre, les entreprises qui ne pratiquent pas l’EGS peuvent offrir de meilleurs salaires, et attirer tous les salariés (même ceux qui souhaitent financer les associations). Les économistes parlent d’un problème de coordination, parce que l’EGS serait souhaitable, mais que les entreprises qui mettraient en place ce mécanisme ne pourraient pas faire face à la concurrence.
Il existe une solution. Si les salariés « socialement responsables » sont plus productifs lorsqu’ils travaillent ensemble, alors l’écart de productivité justifiera un écart de salaire (don complémentaire inclus). Les entreprises pratiquant l’EGS et celles ne le pratiquant pas peuvent alors coexister et être également compétitives. Dans leur étude empirique, les auteurs vérifient cet écart de productivité.
Sur l’échantillon étudié (entreprises américaines entre 2010 et 2015), l’écart de productivité des salariés est de l’ordre de 20 000 dollars par an en faveur des entreprises qui pratiquent l’EGS. Le montant est significatif, et même si la mesure des variables et la réalité de la causalité peuvent toujours être discutées, l’étude est techniquement très solide. Un élément particulièrement intéressant est le lien entre EGS et satisfaction des salariés. Les auteurs montrent que, toutes choses égales par ailleurs, la mise en place de ce système augmente les chances d’entrer dans la liste des entreprises préférées des salariés établie annuellement par Fortune[3](ou d’y rester pour celles qui en font partie).
Nous avions présenté il y a quelques mois dans cette chronique, une étude qui montrait que le fait de bien traiter les salariés permettait de créer de la valeur[4]. L’idée selon laquelle la pratique de la RSE rendrait les salariés plus productifs est ici solidement défendue. Par ailleurs, les auteurs posent en introduction la bonne question : qui paie ? Ici, la réponse est sans ambiguïté : ce sont les salariés, et ils en sont conscients. C’est peut-être la limite de l’étude. En pratique, une certaine forme d’ambiguïté nous semble inévitable chaque fois qu’il est question de RSE, ou plus généralement d’objectifs multiples dans l’entreprise. Beau sujet pour de futures recherches…
[1] N.Gong et B.-D.Grundy (2019), « Can socially-responsible firms survive competition ? An analysis of corporate employee matching grant schemes », Review of Finance, vol. 23(1), pages 199 à 243.
[2] On trouve aussi l’expression « corporate matching » gifts. Au Canada, l’expression francophone proposée est « dons jumelés ».
[3] « 100 best companies to work for in America »
Q&R : Comment un emprunteur peut-il gérer de manière flexible la durée d'une obligation ?
L’absence de flexibilité sur la durée et le montant des obligations sont souvent mis en avant comme un inconvénient des émissions obligataires par rapport aux prêts bancaires. C’est fondamentalement vrai sur le marché euro où les obligations « cotées » ne peuvent pas normalement être remboursées avant échéance. Un emprunteur veut vouloir refinancer une obligation avant son échéance pour saisir une fenêtre de marché attractive, pour ne pas courir un risque de liquidité dans le futur, ou encore pour éviter d’afficher une dette à court terme (ce que devient une dette à long terme à moins d’un an de son échéance vis-à-vis des agences de notation). S’il émet une nouvelle obligation avant l’échéance de la précédente, il devra supporter un coût de portage, correspondant au placement des fonds à un taux inférieur au taux de la nouvelle obligation en attendant la date de remboursement de la précédente.
Il existe cependant plusieurs moyens de gérer, de manière flexible, la durée d’une obligation. À commencer par la gestion de son passif en lançant une offre de rachat sur une souche existante. Ce type d’opérations est devenu très commun (Gecina, Vodafone, Adecco etc. y ont eu recours). Leur succès n’est pas garanti puisque les investisseurs sont libres d’apporter ou non leurs titres à l’offre. En moyenne, environ 1/3 des investisseurs participent à l’offre si une (petite) prime est offerte. Le succès de l’offre est plus important si elle est couplée à une nouvelle émission, les investisseurs trouvant ainsi immédiatement une utilisation des sommes reçues.
L’émetteur peut également se laisser de la flexibilité dans la documentation de l’emprunt obligataire. Ainsi, il peut obtenir des souscripteurs le droit de pouvoir rembourser l’obligation avant son échéance (un call). Ce droit peut n’apparaître parfois qu’à partir d’une certaine date, garantissant ainsi à l’investisseur que son investissement durera une période minimum (période de non-call).
· Le call peut être au pair (par call). Si les taux ont baissé depuis l’émission de l’obligation, les investisseurs considéreront alors que la date du call est la nouvelle échéance de l’obligation (ils calculeront en particulier le taux de rendement sur cette date). Lorsqu’une émission prévoit un par call, sa période d’exercice démarre généralement quelques mois avant la date d’échéance effective : classiquement 1 mois pour des maturtiés courtes, 3 mois pour des maturités intermédiaires et 6 mois pour les échéances les plus éloignées Le par call ouvre ainsi une période permettant le refinancement naturel de l’émission obligataire par une nouvelle émission. Cette clause est classique sur le marché américain et est aujourd’hui tout aussi systématique sur le marché Euro.
· Le call peut être à prix fixe (100,5 %, 101 %, 102 % du pair...). Il peut également décroître dans le temps (103 % la première année, 102 % la seconde, …).
· Il peut également être conditionné à la survenance (ou la non-survenance) d’un événement. Typiquement, une entreprise qui est au milieu d’un processus d’acquisition pourra pré-financer cette acquisition avec une émission obligataire, mais rembourser l’obligation si l’opération ne se fait pas pour éviter d’être surfinancée et devoir subir un coût de portage. Cette clause est très fréquente sur les marchés américains, le remboursement se faisant à 101 % du pair. Cette clause est de plus en plus fréquente en Europe où on voit une plus grande latitude en termes de prix de remboursement (100 %, 100,5 % ou 101 %). Le produit de l’émission obligataire est alors conservé sur un compte séquestre.
Le prix du call peut également correspondre à une formule garantissant à l’investisseur une certaine marge par rapport au rendement des obligations d’État. On parlera alors de Make-whole call. Le prix de remboursement est le plus élevé entre le nominal et les flux restants (coupons, call premium et remboursement du nominal), actualisés au taux de l’obligation d’État de maturité la plus proche de l’obligation, incrémenté d’une marge convenue à l’avance. Elle est comprise entre 15 et 20 % de la marge à l’émission pour les obligations investment grade et pour les obligations non notées, et le taux du Bund + 0,5 % dans le cas d’une obligation à haut rendement.
Autre : Formations
Voici les dates des prochaines formations que nous avons conçues pour Francis Lefebvre Formation avec des enseignants que nous avons sélectionnés pour l’excellence de leur pédagogie :
· « Ingénierie financière » le 7 novembre 2019, à Paris
· « Les mécanismes du LBO et l’environnement du Private Equity » le 24 octobre 2019, à Paris
· « Gestion de la trésorerie et des risques financiers : quelles priorités en 2019 » le 2 octobre 2019, à Paris
· « Définir la structure de financement adaptée à votre entreprise » le 19 novembre 2019, à Paris
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière.
Fiat Chrysler Automobiles Renault (29 mai)
Si le rapprochement FCA Renault se concrétise (on parle d’une réalisation à l’automne 2020, dans quasiment 18 mois), le nouveau groupe alignerait, sans tenir compte de Nissan et de Mitsubishi, 8,5 M de véhicules vendus par an avec les marques Fiat, Chrysler, Renault, Alfa Romeo, Jeep, Dacia, Lancia, RAM, Lada, Abarth, Samsung Motors. Sur la base des cours actuels, sa capitalisation boursière serait de 33 Md€, soit seulement 40 % de plus que celle de Ferrari qui vend 10 000 bolides par an (24 Md€), et la moitié de celle d’Hermès. Impressionnant, n’est-ce pas ? Il est vrai que le PER 2019 de FCA et de Renault, qui sont dans des segments cycliques, est de 4, contre 38 pour Ferrari et de 46 pour Hermès.
Car avec des marges opérationnelles de 24 %, Ferrari est perçue comme une marque de luxe en croissance et valorisée comme telle (Renault et FCA sont à 5 % de marge opérationnelle, Hermès à 35 %).
Le chapitre 48 du Vernimmen 2019 contient un graphique de la scission de FCA et de Ferrari en 2016 qui montre toute la pertinence de cette opération financière qui rend possible aujourd’hui un mariage d’égaux, au moins en termes de parité boursière, entre FCA et Renault.