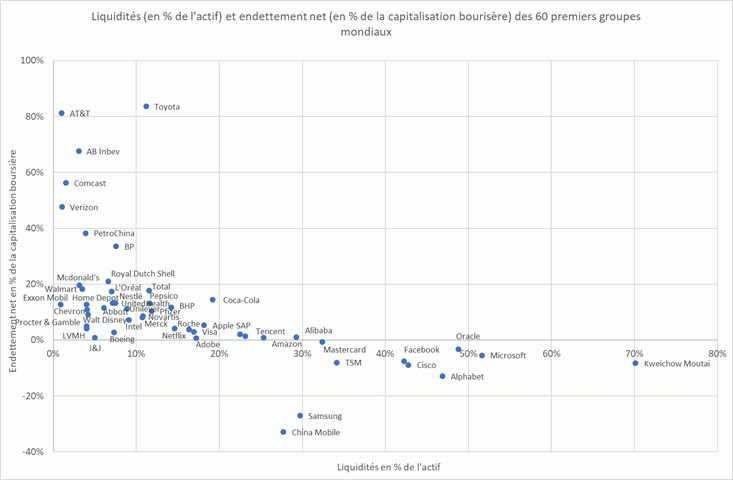La Lettre n°170 de Juillet 2019
Actualités : La couverture du Vernimmen 2020
Le Vernimmen 2020 sortira le 28 août (à l’heure, comme chaque année pour la rentrée universitaire). Pour les impatients qui souhaiteraient découvrir sa couverture, la voici !
Cette année, nous avons infusé dans l’ensemble de l’ouvrage les sujets de durabilité et environnementaux qui deviennent essentiels en finance d’entreprise.
Actualités : La finance : verte, responsable et durable ?
Pour ceux d’entre vous qui auraient manqué l’édition 2019 du Vernimmen, et pour vous faire patienter quelques semaines encore avant de découvrir l’avant-propos du Vernimmen 2020, vous trouverez ci-après l’avant-propos du Vernimmen 2019.
* * *
Cette année, nous aurions pu vous parler de ce qui va bien :
- les marges des entreprises au plus haut depuis bien longtemps, environ 16 % pour les 200 plus grandes entreprises européennes cotées selon Exane BNP Paribas… ;
- …conséquences d'une conjoncture économique qui est bien meilleure en Europe qu'elle ne l'a été depuis 2008… ;
- …elle-même résultante de politiques monétaires non conventionnelles arrêtées aux États-Unis et en voie de l'être en Europe, compte tenu d'une meilleure situation économique ;
- de la réforme fiscale américaine qui libère des sommes considérables pour financer l'innovation et non plus le gouvernement américain et de la baisse e des taux d'impôt sur les sociétés en Europe qui devrait avoir des effets similaires ;
- des progrès dans la coopération internationale pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- etc.
Nous pourrions aussi vous parler de ce qui va moins bien comme :
- certaines poches de survalorisation d'actifs (la valorisation de l'action Hermès à 42 fois son résultat net 2018 attendu nous laisse songeurs, malgré toutes les qualités de cette entreprise ; l'immobilier à Hong Kong, l'immobilier commercial aux États-Unis, etc.) ;
- le fait que le financement des LBO soit redevenu un financement sur actifs comme dans les années avant 2007, et non plus des financements sur cash-flow, avec la disparition des tranches A et des tranches B devenues pour la plupart remboursables in fine ;
- la montée de l'endettement de marché des entreprises chinoises passé de 69 Md$ en 2007, à 2 000 Md$ fin 2017 ;
- etc.
Mais finalement tout ceci n'est que le reflet d'un positionnement dans le cycle économique à un moment donné. Et dans quelques années, ceci aura été oublié.
Par contre, ce qui n'aura pas été oublié à notre avis, c'est que les années 2017 et 2018 marquent l'accélération irréversible des préoccupations écologiques, sociales et durables au sein de la finance, et en particulier de la finance d'entreprise ; au point que l'on peut prédire, paraphrasant avec un peu de grandiloquence André Malraux, que la finance d'entreprise sera à l'avenir verte, responsable et durable ou qu'elle ne sera pas !
* * *
Voici quelques faits de 2018, parmi d'autres, qui illustrent cette accélération dans la prise de conscience écologique, sociale et durable dans le monde financier :
1/ Les analystes financiers du plus grand fonds souverain d'investissement du monde, The Fund de Norvège qui dispose de 870 Md€ d'actifs sous gestion, sont dorénavant accompagnés d'analystes ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) lorsqu'ils rencontrent les dirigeants de l'une des 9 146 entreprises dans lesquelles le fonds est actionnaire, ou envisage de le devenir ;
2/ La Commission européenne a publié en mars 2018 " sa stratégie pour amener le système financier à soutenir les actions de l'Union Européenne en matière de climat et de développement durable " qui passe par :
« – établir un langage commun pour la finance durable, autrement dit un système de classification unifié (taxinomie) de l'UE, afin de définir ce qui est durable et d'identifier les domaines dans lesquels les investissements durables peuvent avoir la plus forte incidence ;
- créer des labels de l'UE pour les produits financiers verts, sur la base de ce système de classification de l'UE : les investisseurs pourront ainsi déterminer facilement les investissements qui respectent des critères de faibles émissions de carbone ou d'autres critères environnementaux ;
- clarifier l'obligation, pour les gestionnaires d'actifs et les investisseurs institutionnels, de tenir compte des aspects de durabilité dans le processus d'investissement et renforcer leurs obligations en matière de publication d'informations ;
- imposer aux entreprises d'assurance et aux entreprises d'investissement d'informer leurs clients sur la base de leurs préférences en matière de durabilité.
- intégrer la durabilité dans les exigences prudentielles : les banques et les entreprises d'assurance sont une source de financement externe importante pour l'économie européenne. La Commission examinera s'il est envisageable de recalibrer les exigences de fonds propres applicables aux banques (le "facteur de soutien vert") pour les investissements durables, lorsque cela se justifie du point de vue du risque, tout en veillant à préserver la stabilité financière ;
- renforcer la transparence en matière de publication d'informations par les entreprises : nous proposons de réviser les lignes directrices relatives à la publication d'informations non financières, afin de les aligner davantage sur les recommandations formulées par le groupe de travail du Conseil de stabilité financière sur la publication d'informations financières relatives au climat. »
3/ Le président de Blackrock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec plus de 5 300 Md€ gérés pour le compte de ses clients, a écrit dans sa lettre de 2018 aux dirigeants des plus grands groupes du monde :
« La société exige que les entreprises, cotées ou non, servent un objectif sociétal. Pour prospérer avec le temps, chaque entreprise doit non seulement délivrer des résultats financiers, mais aussi montrer en quoi elle apporte une contribution positive à la société. Les entreprises doivent bénéficier à toutes leurs parties prenantes, y compris les actionnaires, les employés, les clients et les communautés dans lesquelles ils opèrent. »
Déjà en 2016, Larry Finck avait écrit : « Sur le long terme, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) - allant du changement climatique à la diversité en passant par l'efficacité du conseil - ont des impacts financiers réels et quantifiables. »
4/ La Banque Postale Asset management a annoncé qu'en 2020 la totalité de sa gestion d'actifs, 220 Md€, allait basculer en ISR (investissement socialement responsable).
* * *
On peut se demander pourquoi cette forte accélération a lieu maintenant et non pas il y a trois-quatre ans, ou dans quatre-cinq ans. Difficile à dire. Comme toute lame de fonds, celle-ci naît de plusieurs facteurs, se développe lentement, progressivement puis, à partir d'un moment, jaillit et bouscule tout sur son passage.
Il est indéniable que la crise financière de 2007-2008 a profondément marqué les esprits, probablement beaucoup plus qu'on ne le pensait et sensiblement plus qu'aucune autre crise financière, mis à part celle de 1929. Elle a naturellement marqué les directeurs financiers dans leur pratique de gestion financière (voir le chapitre 41). Elle a aussi profondément marqué le grand public qui a retenu que les subprimes, c'était endetter ses clients au-delà du raisonnable, en faisant supporter le risque pris par les autres, afin de s'enrichir soi-même, et après moi le déluge. Moralement inacceptable. Plus jamais cela.
L'urgence écologique est un autre facteur : l'épuisement des ressources de la Terre probablement surestimée compte tenu de l'ingéniosité humaine, et le réchauffement climatique, dont il est à craindre en revanche qu'il soit sous-estimé.
Enfin, la désaffection pour les idéologies, les difficultés grandissantes des États à tenir leurs rôles traditionnels depuis l'après-guerre de protection et de répartition, font que les individus cherchent désormais du sens là où ils passent l'essentiel de leur vie après le sommeil : dans leur travail. En particulier les plus jeunes dont beaucoup cherchent une mission et non un travail, un mentor plutôt qu'un chef et veulent avoir de l'impact, du sens, dans ce qu'ils font. On attend donc beaucoup plus de l'entreprise aujourd'hui qu'hier. D'où par exemple le rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Senard, Entreprise et intérêt général, qui affirme que l'entreprise a une raison d'être et qu'elle contribue à l'intérêt collectif. Sur ce dernier point, la France était en retard par rapport à certains pays européens (Italie, Grande Bretagne) ou aux États-Unis qui ont créé la possibilité pour les entreprises de devenir des Public Benefit Corporations.
Sans être cyniques ne négligeons pas également les comportements moutonniers que nous connaissons bien en finance. Les annonces se répondent les unes aux autres avec des objectifs toujours plus ambitieux. Ne nous en plaignons pas, mais il va falloir maintenant délivrer.
* * *
Quelles formes concrètes prend tout ceci ?
Au niveau des investisseurs, les préoccupations de l'investissement socialement responsable, ISR, ont commencé à apparaître dès le xviiie siècle au sein de communautés religieuses (quakers, méthodistes) qui interdisaient à leurs membres d'investir dans des entreprises fabriquant des armes, de l'alcool ou du tabac. En France, le plus ancien outil d'investissement ISR est le FCP de partage, Faim et Développement, créé en 1983 par le CCFD.
Aujourd'hui en France, Novethic recense 404 fonds ISR en France regroupant 135 Md€, soit une progression de 14 % par rapport à 2016 et une multiplication par 15 depuis 2005. C'est à la fois beaucoup et peu si on le compare au montant des fonds détenus par les investisseurs institutionnels français (2 200 Md€) qui, par ailleurs, déclarent à plus de 50 % prendre en compte les informations extra-financières dans leurs décisions de placement.
Les investisseurs, l'AFG et le Forum pour l'investissement responsable, ont ainsi défini l'ISR : "L'ISR (Investissement Socialement Responsable) est un placement qui vise un impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable."
Nous écrivons au paragraphe 9.20 que d'un point de vue strictement financier, les hommes et les femmes les plus importants au sein de l'entreprise sont les actionnaires. L'ISR en est une illustration car en surpondérant ou en sous-pondérant, voire en éliminant totalement des entreprises de leurs portefeuilles, les investisseurs, comme d'autres parties prenantes, exercent une pression sur les entreprises. À un investisseur qui lui demandait publiquement s'il était plus intéressé par la durabilité de sa société ou de celle de la planète, le président de Shell a répondu que son groupe ne devait plus se définir comme un groupe pétrolier et gazier, mais comme « an energy transition company », confirmant ainsi une évolution vers un monde à bas carbone qui n'est pas propre à ce groupe pétrolier. De la même façon, les banques européennes et certaines compagnies d'assurances (Allianz, Axa) ont cessé de financer la production d'électricité à partir de charbon.
En parallèle, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) a été définie, par exemple par l'Union européenne, comme : " L'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir "davantage" dans le capital humain, l'environnement et les relations avec les parties prenantes ".
Des critères, dits ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, ont été définis afin de permettre aux investisseurs ISR de sélectionner les entreprises qui leur paraissent les plus vertueuses, et aux entreprises d'agir concrètement dans le sens de leur RSE. Ainsi la stratégie Best in Class préconise d'investir au sein d'un secteur dans les entreprises les plus performantes d'un point de vue ESG. La stratégie Best effort est moins radicale dans sa sélection car elle inclut plus largement les entreprises avec les meilleures progressions en ESG. La stratégie norm-based screening fixe des standards ESG minimums pour qu'une entreprise puisse être incluse dans un portefeuille.
Au niveau du financement de l'entreprise, les volumes de financement verts ou durables sont encore marginaux pour l'instant, mais en très forte croissance. Sont ainsi concernés les obligations vertes (voir paragraphe 22.21), les prêts verts (voir paragraphes 23.9) et les obligations responsables (voir paragraphe 22.21).
Les obligations vertes (green bonds) sont, d'un point de vue de leurs flux financiers, des obligations classiques. L'innovation n'est donc pas financière ! Leur statut vert provient du fait que l'émetteur s'engage à utiliser les fonds pour des investissements ou des dépenses positives pour l'environnement (tels que définis par l'entreprise, généralement assistée d'un cabinet indépendant). Les obligations responsables, quant à elles, financent des projets à connotation sociétale.
Le suivi des dépenses et l'affectation d'une source de financement à un emploi particulier exigent une organisation spécifique inhabituelle pour la direction financière. Cette organisation a un coût. Mais comme les investisseurs ne sont pas prêts à acheter les obligations vertes à un prix supérieur à celui d'une obligation classique, ce surcoût est supporté par l'entreprise.
Les obligations vertes, sociales ou plus généralement responsables sont normées par l'ICMA qui publie des Green Bonds Principles et Social Bonds Principles. Cette normalisation est importante car les investisseurs s'y réfèrent pour démontrer qu'ils investissent bien en ISR et que ces obligations peuvent rentrer dans leurs fonds ou leurs poches d'actifs dédiées à ces investissements.
Les entreprises disposent d'un autre outil financier pour mettre en avant leur politique ESG : les lignes de crédit confirmées (RCF) vertes ou responsables. Contrairement aux obligations, ces financements n'impliquent pas une utilisation des fonds dans des projets ESG (ce serait compliqué car ces lignes sont la plupart du temps pour les grands groupes des lignes de back up non tirées). Leur aspect ESG vient du fait que leur coût (et donc la rémunération des banques) dépend de l'atteinte d'objectifs ESG par l'entreprise. La pertinence de ces objectifs est initialement validée par une agence tierce et sujet d'un contrôle durant la vie du crédit. Notons que ces produits sont un effort ESG tant pour l'entreprise que pour la banque qui la finance ! À ce stade, la variabilité de la marge de crédit due au respect ou non des objectifs ESG est quand même très faible, quelques points de base seulement.
Malgré cela, on notera que les produits de financement de type ESG sont aussi un outil de mobilisation en interne des collaborateurs de l'entreprise : les objectifs ESG deviennent plus concrets car leur non-respect s'accompagne d'une sanction financière (faible) et d'un impact psychologique certainement non négligeable.
* * *
Cette évolution n'est bien sûr pas sans difficulté : comment apprécier, noter et classer les entreprises selon des critères ESG ? Quels critères sont les plus pertinents et pour qui ? Certainement l'appréciation doit se faire par secteur : une entreprise dans l'agroalimentaire n'aura pas les mêmes enjeux ESG qu'une entreprise dans la production d'énergie. Des agences se sont développées pour noter les entreprises sur leur politique ESG (Vigeo Eiris, Cicero et Sustainalytics), les agences de notation classiques et les cabinets d'audit essaient également d'occuper ce terrain tout comme les agences de certification (Bureau Veritas, SGS) alors que des normes (ISO) devraient être lancées.
Une difficulté à laquelle les entreprises doivent se confronter reste l'absence d'une méthode homogène ou évolutive dans le choix de ces critères. Ainsi, de nouveaux critères apparaissent (parfois par effet de mode ou parce que des nouvelles polémiques surgissent) et les entreprises doivent se montrer agiles si elles souhaitent conserver leur notation ou certification.
Un des problèmes soulevés par les obligations vertes ou sociales est que les fonds levés doivent être fléchés vers des investissements ESG. Ils sont donc faciles à émettre pour des entreprises affichant de lourds investissements (énergie, immobilier, …), mais beaucoup plus complexes à mettre en œuvre pour les industries de matière grise (quel investissement d'une agence de publicité pourrait être qualifié de vert ou de social ?). Dans le cadre actuel, ces entreprises se trouvent donc largement privées de cet outil, même si par ailleurs elles peuvent afficher des comportements ESG en pointe.
Ceci souligne la distinction entre l'approche holistique des sujets ESG versus l'approche par projets ciblés. La première est certainement plus ambitieuse mais difficile à mesurer, homogénéiser et à appréhender pour les tiers à l'entreprise. On peut craindre les surenchères de communication, de l'écoblanchissement (greenwashing) sans réelle action pour faire dans le politiquement correct. La seconde approche est plus concrète pour les investisseurs, mais fait courir le risque de financer des entreprises qui globalement n'ont pas des ambitions ESG fortes et qui communiquent uniquement sur quelques projets.
* * *
Mais ne nous y trompons pas. Il ne s'agit certainement pas d'une mode à laquelle il conviendrait de sacrifier, le temps qu'elle passe, avant de retrouver les pratiques du bon vieux temps !
Nous pensons qu'une entreprise qui choisirait d'ignorer ces préoccupations se condamnerait à disparaître sous le double effet d'un renchérissement de son coût du capital, les investisseurs refusant progressivement de la financer ou à des coûts de plus en plus élevés, la pénalisant ainsi par rapport à ses concurrents ; et d'une difficulté croissante à attirer des talents humains sans lesquels tout est beaucoup plus compliqué ; sans compter le risque permanent d'être montré du doigt et de subir l'opprobre de la société.
La bonne nouvelle est que la vision long terme ne semble pas exclusive d'une performance financière. Du côté des entreprises, le BCG montre que, sur un échantillon de 343 groupes dans 5 secteurs, les entreprises à fort score ESG ont des marges plus élevées que les autres. Reste à vérifier le sens de la causalité. L'attractivité pour les employés des entreprises plus éthiques est une des explications. D'autres mettent en avant également une meilleure gestion des risques par la prise en compte des sujets ESG et la création d'opportunités (ArcelorMittal vient d'annoncer qu'une nouvelle technologie de traitement des gaz générés par son usine de Gand allait lui permettre de transformer les gaz en bio-éthanol qu'il commercialiserait).
Du côté des investisseurs, de nombreuses études empiriques montrent que les fonds ISR obtiennent les mêmes ou de meilleures performances que des fonds conventionnels. Ainsi une étude de Russel Investment démontre que les gérants d'actifs créant le plus de valeur possèdent déjà dans leur portefeuille un grand nombre de titres répondant aux critères ESG.
Quant au directeur financier, il ne doit pas se trouver perdu, bien au contraire, puisque l'un de ses rôles est de garantir le financement de l'entreprise pour assurer sa pérennité, et qu'un autre est de gérer les risques financiers, aussi pour garantir la pérennité de l'entreprise. La durabilité, au cœur des préoccupations ESG, est son fil rouge (ou vert ?) depuis longtemps tel Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir . . .
Porte-parole au sein de l'entreprise des investisseurs qui la finance, le rôle du directeur financier est aussi de garantir la sincérité des engagements ESG pris car la sincérité crée la confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de financement possible.
Tableau : Liquidité et endettement des 60 premiers groupes mondiaux
Ce graphe montre le niveau de liquidités et d’endettement net des 60 premiers groupes mondiaux par leur capitalisation boursière.
On note que la plupart des groupes ont un niveau de d’endettement net modéré (entre 0 % et 20 % de leur capitalisation boursière) et des liquidités représentant entre 5 % et 15 % de leur total d’actifs. Certains secteurs se distinguent néanmoins, les télécoms (AT&T, Comcast, Verizon) pour leur endettement élevé, les nouveaux géants (GAFA et autres : Apple, Alibaba, Alphabet, …) par leur faible endettement et leur niveau de liquidité très important.
Recherche : Une première étude sur le risk arbitrage activiste
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à l’Université
de Cergy-Pontoise
Nous présentons ce mois les résultats d’une première étude académique de grande ampleur[1] sur le risk arbitrage activiste, une activité qui s’est développée ces dix dernières années. Dans une opération de fusion-acquisition, le risk arbitrage (on parle aussi de merger arbitrage) consiste à acheter des actions de la cible après l’annonce de l’opération, et à bénéficier de la convergence à la hausse de son cours vers le prix proposé par l’acquéreur. Cette convergence n’est pas immédiate en raison de l’incertitude qui pèse sur la réalisation de l’opération. Un pari est donc possible sur sa réussite[2].
Le risk arbitrage traditionnel est une opération active du point de vue de la sélection des titres, mais passive du point de vue de la gouvernance : l’actionnaire (le plus souvent un fonds spécialisé) se contente de voter favorablement avec les titres qu’il détient, mais n’intervient pas dans l’opération. Le risk arbitrage activiste consiste pour sa part, après l’acquisition des titres, à réclamer un meilleur prix pour la cible. L’activiste tente de coaliser autour de lui les actionnaires passifs et menace de bloquer l’opération si un meilleur prix n’est pas proposé. Quasiment inexistante au début des années 2000, cette pratique est observée dans près de 10 % des opérations de fusion-acquisition aux États-Unis à la fin de la période de l’étude (2014).
Les auteurs ont étudié un échantillon de plus de 4 000 opérations de M&A aux États-Unis entre 2000 et 2014. Leur étude empirique compare les opérations sans risk arbitrage, avec risk arbitrage passif et avec risk arbitrage activiste. Si les deux types de risk arbitrage privilégient les grosses opérations ainsi que les cibles avec un fort actionnariat institutionnel, le risk arbitrage activiste est plus fréquent pour les opérations avec sortie de la cote (notamment les management buyouts ou LBOs), ainsi que pour les opérations amicales. Dans ce genre d’opération, il est possible que le management, favorable à l’acquisition, n’ait pas suffisamment recherché à faire monter les enchères. Sur l’ensemble de l’échantillon, la rentabilité (annualisée) pour le risk arbitrage activiste s’élève à 16,3 %, contre un peu moins de 6 % pour le risk arbitrage passif. En plus de sa sélection de cibles, l’activiste exploite son information privée qui concerne sa propre intention de faire monter les enchères (information inconnue du marché lorsque l’activiste achète sa participation). On peut toutefois imaginer un coût assez élevé de cette pratique, le coût de l’activisme venant s’ajouter aux coûts du risk arbitrage traditionnel. Ce coût n’est pas mesuré par l’étude (la rentabilité est calculée sur le prix des actions).
Un autre résultat intéressant concerne la probabilité de réalisation de l’opération. Les auteurs montrent que la présence d’un arbitrageur activiste renforce cette probabilité lorsque l’opération est favorablement accueillie par le marché (c’est-à-dire que le prix de la cible se rapproche fortement du prix d’achat au moment de l’annonce). Ils en concluent que cette pratique est favorable à l’ensemble des actionnaires de la cible, et pas seulement à l’activiste lui-même. Il est d’ailleurs notable que l’un des co-auteurs de l’étude, Wei Jiang, est l’une des grandes spécialistes de l’activisme actionnarial et a contribué à de nombreux articles sur le sujet, chaque fois favorables à l’activisme sous ses différentes formes.
[1]W. Jiang, T. Li et D. Mei (2018), « Influencing control: jawboning in risk arbitrage », Journal of Finance, vol. 73(6), pages 2635 à 2675.
[2]Notons ici l’utilisation abusive du terme « arbitrage ». Une caractéristique essentielle d’une véritable opération d’arbitrage est l’absence de risque. Toutefois, ce terme est largement utilisé pour désigner les opérations consistant à jouer sur la convergence entre deux prix (ici le prix de la cible après l’annonce et le prix d’achat). Cette utilisation est acceptable à condition de ne pas perdre de vue qu’il s’agit en fait d’opérations spéculatives, c’est-à-dire risquées !
Q&R : Des remue-méninges pour l'été
Voici le premier :
Si la question « un tiens vaut mieux que deux tu l'auras (dans un an) » : quel est le taux d'actualisation utilisé par le bon sens populaire dans ce dicton ?, ne devrait pas vous poser de problème, saurez-vous trouver le taux d’intérêt mensuel à intérêts capitalisés au bout d’un mois équivalant à ce taux actuariel ?
Et voici le second :
Grâce à votre travail, et aussi à la lecture du Vernimmen il faut bien l’avouer, vous avez identifié une action qui vous paraît très prometteuse. Vous achetez 10 actions à 50 €. Trois ans après, le cours est à 600 € et vous considérez que les perspectives que trace la société sont encore mal reflétées dans son cours. Aussi, décidez-vous d’acheter 100 actions supplémentaires à 600 €.
Un an après, le cours atteint 1 000 € et vous décidez de prendre votre plus-value en revendant tous les titres à ce prix-là.
Du premier achat ou du second achat, lequel a été le plus intéressant d’un point de vue financier pour vous ?
Et le dernier :
Quel est le grand pays dont les délais de paiement moyens excèdent ceux de la Grèce (90 jours) et ceux de l’Italie (86 jours) ?
* * *
Et maintenant les réponses :
Pour le premier : La réponse à la première question est de 100 % (= (2-1)/1).
La réponse à la seconde question est 6 %, et non 8,3 % (qui n’est que le taux proportionnel, mais qui n’est pas un taux équivalent), car (1+ 6 %)^12 = 2 qui est le rapport entre la somme future (2) et la somme actuelle (1). En cas de besoin, le chapitre 18 du Vernimmen est là pour vous rafraîchir la mémoire.
Pour le second : Vous avez réalisé un superbe investissement en achetant 10 titres à 50 €, qui 4 ans après, valent 1 000 €. Votre TRI est 111 %. Sur la seconde opération, votre TRI est bien moindre (67 % en un an) tout en étant très correct ! mais c’est pourtant de ces deux opérations la plus intéressante d’un point de vue financier pour vous. C’est celle qui vous a le plus enrichi : 40 000 € contre 9 500 € pour la première.
On retrouve ici l’idée que la valeur actuelle nette est un meilleur indicateur que le TRI pour comparer deux investissements. Avoir un taux de rentabilité très élevé sur une petite somme vous fait une belle jambe. C’est certes une satisfaction intellectuelle, mais elle ne va pas changer votre vie. Mieux vaut un TRI plus modeste sur une somme beaucoup plus importante.
Et pour le dernier :
Eh bien, il s’agit de la Chine avec 92 jours et où une entreprise sur quatre est payée quatre mois après la livraison (source Euler Hermès).
Autre : Nos lecteurs écrivent : Le projet Libra de Facebook est-il viable ?
Par François Meunier, version allégée d’un article publié initialement par Telos[1]
L’idée derrière Libra est simple : combiner un porte-monnaie numérique, tel qu’on en voit de nombreux aujourd'hui, avec la puissance et la commodité des réseaux Facebook et l’expertise des réseaux partenaires (par exemple, Visa et PayPal côté paiements, Coinbase côté cryptomonnaie, Iliad ou Vodaphone côté télécoms). Faire une transaction entre A et B par Whatsapp deviendrait potentiellement aussi simple que l’envoi d’une photo. Techniquement, le projet Libra n’est nullement novateur : d’autres Big Techs, Baidu ou Alibaba avec Alipay, sont déjà très avancés et ont dû d’ailleurs inciter Facebook à forcer le pas. La différence, qui effraie un peu tout le monde, c’est l’immense force de Facebook et ses plus de deux milliards d’utilisateurs.
Un point historique d'abord : c’est une avancée technique qui a permis l’apparition d’acteurs non bancaires dans le domaine des paiements : on sait désormais, en temps réel à la vitesse des électrons, si le compte débiteur est alimenté ou non. Le risque de crédit direct, à savoir un compte débiteur non alimenté, disparaît en pratique. Il n’est donc plus nécessaire d’associer les paiements à du crédit, un métier propre aux banques. Cette avancée est porteuse d’un gain majeur pour le grand public, en termes de coût, de commodité et d’inclusion de personnes privés de services bancaires. C’est dans cette brèche que quantité de nouveaux acteurs se sont engouffrés.
Un peu de technique bancaire aussi : Libra n’est nullement indépendante du système bancaire officiel. Avant d’opérer une quelconque transaction, les échangistes en Libra devront virer de l’argent de leur compte bancaire à vue vers un compte Libra tenu par la société détenue par Facebook et ses partenaires en Suisse. Ce n’est qu’alors qu’ils pourront effectuer des paiements et en recevoir. Et si les échanges en Libra devaient suivre à terme le rythme de l’économie, il y aurait un perpétuel afflux de monnaie bancaire dans le système Libra. Il faut donc insister sur un point mal compris : il n’y a pas création monétaire avec Libra, tant du moins que Libra ne vend des services de crédit. Il est probable toutefois qu’en cas de succès, Libra copiera le modèle économique du pionnier qu’est Alipay et fera du crédit et de la gestion d’épargne. On voit donc potentiellement émerger un acteur financier à part entière, hors les cadres habituels du système bancaire, même si la nécessaire connexion avec les banques obligera toutefois Libra à subir d’emblée certaines des régulations financières en usage : il devra par exemple se voir accorder, du moins en Europe, le statut d’EP, établissement de paiement, avec des obligations en matière de fonds propres et de placement des actifs en représentation.
La vraie différence avec la plupart des autres EP vient du mode opératoire. Paypal ou Visa opèrent par exemple sur l’infrastructure des banques (chambre de compensation, Swift, etc.). Libra, comme l’ont fait d’ailleurs Alipay, M-Pesa et Orange Pay, pour ces deux dernières de dynamiques entreprises de paiement en Afrique de l’est, va construire sa propre infrastructure. Une double conséquence : d’une part, une moindre dépendance vis-à-vis du système bancaire et de la banque centrale et d’autre part, une véritable menace pour les banques s’il s’avère que le Web est un réseau bien plus efficace et moins coûteux à opérer que l’est Swift. Les Big Techs ont sur ce point, la gestion du web, une technicité bien supérieure à celle, dispersée de plus, des banques.
Une autre originalité de Libra réside en ceci qu’il ne s’agit pas, à la différence par exemple du Bitcoin, d’une monnaie pleinement fiduciaire, c'est-à-dire reposant entièrement sur la confiance collective. Il est assorti d’un système de collatéral : les sommes que toute personne fera virer sur son compte Libra, par exemple depuis un compte en euros, seront immobilisées chez Libra en actifs libellés en euros. Pareil pour le dollar et sans doute aussi pour quelques autres grandes monnaies. Il y a donc une contrepartie physique aux dettes qu’accumule le système à recevoir des comptes à vue de la part de ses membres. S’agissant des autres monnaies, y compris les monnaies exotiques, elles seront converties en actifs composées des principales devises. Libra sera de fait calée (« pegged ») sur un mix des grandes monnaies de la planète, avec un avantage que mettent en avant les initiateurs du projet, à savoir une volatilité moindre que chacune des devises prise individuellement.
Une dernière caractéristique du projet demande clarification : les initiateurs de Libra le présentent comme une monnaie dont la surveillance est assurée par un « journal décentralisé », c'est-à-dire une chaîne de blocs (blockchain). Le responsable du projet, David Marcus, recruté par Facebook, est un ancien dirigeant de Paypal et un bon connaisseur des cryptomonnaies. L’Association Libra diffuse (voir ici) un long document sur l’infrastructure blockchain de Libra. Il semble pourtant avéré qu’un système blockchain est mal adapté s’agissant de milliards de petites transactions, ce qui sera le cas pour une monnaie véhiculée par Whatsapp et Instagram. Le coût informatique (et énergétique !) devient prohibitif. Libra compte réduire ce coût en limitant la libre entrée des potentiels « vérificateurs » des transactions ; il reste à voir comment cela va fonctionner.
Mais les obstacles sont nombreux sur la route
Le premier d’entre eux, on pourrait dire le plus simple, consiste à limiter les risques techniques de toute chaîne de paiement : l’identité des parties (on va y revenir), la fraude, de piratage des comptes (quand il y a de l’argent au bout, les chasseurs sont beaucoup plus actifs et intelligents). Les investissements à apporter à l’infrastructure en place sont d’une complexité redoutable.
Le second est commercial et vient de multiples endroits. Le choix de la technologie blockchain en est un. D’une part, l’avantage de la non-falsifiabilité se paie de coûts accrus et d’une moindre commodité pour les clients : à attendre la preuve d’identité, on perd l’avantage de l’immédiateté. D’autre part, le très gros des transactions dans tout pays se fait dans la monnaie du pays. À quoi sert-il de convertir en Libras les apports en euros à un compte Libra pour in fine revenir à l’euro ? Autant en rester à des systèmes de porte-monnaie comme le fait Lydia ou Alipay. Le seul avantage est l’ubiquité internationale de Whatsapp. Mais cet avantage n’apparaît vraiment que pour les pays peu développés où l’infrastructure bancaire est encore primitive et où Libra pourrait représenter une alternative intéressante à une monnaie nationale peu reconnue, soumise au risque d’inflation ou de dévaluation, avec une garantie faible de l’État souverain, et dont le système bancaire exclut encore une bonne part de la population. Un autre marché est celui des transferts internationaux d’épargne, notamment pour les travailleurs migrants. Mais tout cela ne représente pas des marchés extrêmement larges propres à rentabiliser une infrastructure mondiale. Dans les pays développés, les infrastructures bancaires sont solides et déjà en place – qu’on pense aux cartes de crédit si commodes et universelles, et le gros des transactions ne vient pas des particuliers qui jouent avec Instagram, mais les entreprises entre elles, qui ont des besoins financiers bien plus complexes. Si la Chine est très en avance en matière de « fintech », il faut le rappeler, c’est parce que son système bancaire était moins performant qu’il n’est en Europe ou aux États-Unis. Notons déjà que les premières régulations se mettent en place là-bas, en matière de fonds propres, de liquidité des actifs en représentation et de réserves obligatoires sur les dépôts que ces Big Techs reçoivent.
L’inclusion des gens aujourd'hui exclus du système bancaire, 1,7 milliard dit-on de par le monde, voici l’antienne réconfortante, le supplément d’âme qu’annonce candidement Mark Zuckerberg et que répète à foison le document de présentation du projet, le Livre blanc Libra. Mais où est l’infrastructure en Afrique ? Aujourd'hui, le succès de Orange Pay ou M-Pesa, vient de ce qu’ils fonctionnent sur le réseau téléphonique ordinaire et ne nécessitent ni 4G ni des mobiles de dernière génération. L’inclusion financière au sens Ligra exige en premier lieu une inclusion internet au sens plein, et on en est loin.
Si jamais une offre de la part des Big Techs, et de Facebook en particulier, devait voir le jour dans les pays développés, gageons enfin qu’un concurrent redoutable pourrait apparaître, à savoir la banque centrale elle-même, qui dispose de tous les moyens elle aussi de fournir une monnaie numérique, et avec ça une monnaie numérique de meilleure qualité.
Quelle régulation ?
Une autre difficulté ou plutôt questionnement tient à la relation avec les régulateurs dans les domaines financiers, de la concurrence et de la protection de la vie privée. Tant que le « porte-monnaie » Libra est de taille limitée avec un nombre restreint de participants, le régulateur peut s’en moquer. Il en va tout autrement si le projet acquiert une dimension importante.
Sur le plan financier, les banques commerciales perdent leurs liquidités, une masse importante de dépôts leur échappant. Le contrôle de la liquidité par la banque centrale ne sera plus qu’indirect, via le contrôle des crédits faits par les banques pour aller nourrir la liquidité de Libra. À dimension globale, voici que Libra devient « systémique » dans le jargon des banquiers centraux. Une défiance soudaine envers Libra, pour une raison ou une autre, peut provoquer immédiatement des retraits massifs et donc des ventes à la casse des actifs mis en représentation. Vient le paradoxe de la liquidité, cet objet très bipolaire : autant Libra sera attractif si très répandu parce qu’il sera une alternative liquide et moins volatile que les monnaies support ; autant la liquidité peut s’effondrer si les déposants préfèrent se repositionner sur une monnaie garantie par un souverain. Il faut l’appui d’un prêteur en dernier ressort pour éviter les phénomènes de « ruées » propres à tout métier reposant sur la confiance. Pour rappeler ce que disait Bagehot, ce grand théoricien et praticien britannique du métier de banque centrale (et fondateur de la revue The Economist), « quand le crédit d’une monnaie, d’une banque, etc., est mis en doute, il n’y a plus de crédit ». Dans un pays au système bancaire embryonnaire, le choc dépasse la capacité de la banque centrale locale alors qu’il faudra pourtant éviter l’effondrement du système. Ce risque inquiète légitimement. Bien que prudents et politiques, les initiateurs de Libra, à lire le Livre blanc, manifestent un certain dédain pour la capacité du régulateur prudentiel à leur imposer des contraintes.
La question du respect de la vie privée, un point sur lequel Facebook et les big techs ont montré leurs carences, entraîne une seconde suspicion. C’est la question de l’identification, essentielle dans tout projet bancaire, le « KYC », know your customer, essentielle plus encore sachant l’anonymat du Web. On parlait déjà de la volonté de Zuckerberg de faire de l’identifiant Facebook un identifiant universel. Mais voici, comme le signale le site Coindesk, « une possible bombe logée au sein de Libra », et signalée par une phrase anodine au détour du Livre blanc (dans sa page 9) : « Un autre objectif de l'association est de développer et de promouvoir une norme d'identité ouverte. Nous pensons que l'identité numérique décentralisée et portable est une condition préalable à l'inclusion financière et à la concurrence. » Une carte d’identité privée, et voici les États nationaux devenus obsolètes en matière de registre civil si l’usage s’en répand. Probablement pas dans les grands États bien structurés, mais plausible dans des pays aux institutions plus faibles.
Le droit de la concurrence intervient aussi : le régulateur non pas bancaire mais de la concurrence est ici interpelé. Va-t-il laisser se développer une activité de nature bancaire de la part des Big Techs qui pourraient menacer trop violemment et même évincer les banques en place ? Car même soumises à la régulation bancaire, les Big Techs disposent de synergies de réseau considérablement plus fortes que les banques : un nouvel utilisateur de Whatsapp profite pour sa part du service rendu par Whatsapp, mais en fait profiter aussi les autres utilisateurs du réseau qui voient s’étendre les possibilités de mise en contact. Certains voudraient tout simplement que les big techs ne s’occupent pas de monnaie en raison de cet avantage de réseau et d’« envergure » (la capacité à offrir des services liés).
Ce débat est important et on ne peut le trancher d’emblée. On retrouve le conflit classique entre les régulations financière et concurrentielle. Les banques, poussées par leur régulateur, ont profité du souci de sécurité financière pour se carapacer contre l’entrée de nouveaux concurrents. Dans chaque pays, il s’agit d’un oligopole douillet et pas toujours efficace. Quand une fintech pointe le nez et risque d’être trop vivement concurrente, elle est rachetée par les banques traditionnelles. Avec Facebook ou Alibaba, l’histoire est différente. Le numérique est en marche et s’il apporte des gains massifs dans l’industrie des paiements, il sera difficile de l’arrêter. Waze, ce logiciel de cartographie dynamique, a envoyé les cartes routières à la poubelle. Le problème n’est donc pas que le système des paiements passe dans des mains privées : c’est le cas aujourd'hui puisque ce sont des agents privés, les banques, qui en font la gestion. Le problème est que le concurrent qui apparaît, à savoir les Big Techs, peut dominer d’un coup une industrie vénérable, avec des répercussions mal comprises aujourd'hui. Il y aurait d’un coup un excès de concurrence venu d’acteurs aujourd'hui non contrôlés. Pour poursuivre l’analogie, il aurait été préférable que Waze ait été racheté par un consortium de constructeurs automobiles que par Google.
D’autant que le droit de la concurrence intervient dans une autre dimension : les Big Techs ne sont pas simplement les fournisseurs et gestionnaires d’une infrastructure, ils vendent des produits liés à cette infrastructure (information, publicité, services divers…). On interdit qu’une banque, forte de l’information qu’elle a sur le compte bancaire de son client, aille s’engager dans des activités commerciales qui pourraient faire concurrence à ce client. Par exemple, connaître les meilleurs clients d’une entreprise cliente permettrait à peu de frais de la concurrencer efficacement. Les seuls produits liés qu’en principe les banques de dépôts peuvent vendre sont le crédit, les services de banques d'investissement et la gestion de l’épargne, avantage que certains régulateurs continuent à vouloir restreindre. Ce qui vaut pour les banques est un principe général du droit de la concurrence : on interdit – une interdiction plus ou moins respectée – à un opérateur de réseau ferroviaire d’utiliser la rente du réseau pour favoriser une filiale opérationnelle par des coûts de service inférieurs. Même chose pour les opérateurs téléphoniques. Rien de cela n’existe encore pour les Big Techs. Il serait donc étonnant que Facebook, par l’intermédiaire de Libra, connaisse, pour son activité d’agence publicitaire, le détail des achats fait par tout un chacun.
Les initiateurs de Libra jurent leurs grands dieux qu’une muraille sera érigée entre l’opérateur Libra et les partenaires du projet, mais la meilleure muraille est celle de l’indépendance totale. Si elle est strictement mise en place, l’avantage initial se dilue.
Il y a ici une sorte d’imprudence de Facebook. Il fait l’objet aujourd'hui de l’attention de la société civile et des régulateurs appelant pour certains à un démembrement pur et simple. Lancer un projet qui menace frontalement une infrastructure publique aussi importante que celle qu’offrent aujourd'hui les banques privées ressemble à une provocation. Le débat politique va s’amplifier à ce sujet, et tous ne suivront pas Donald Trump qui félicite ouvertement l’initiative Libra et son responsable technique David Marcus.
[1] Et consultable sur https://www.telos-eu.com/fr/le-libra-de-facebook-est-il-viable.html
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière.
Imperial Brands versera moins de dividendes que prévu et investira plus dans les produits d’avenir
Le douzième plus gros payeur de dividendes outre-Manche, le fabricant de cigarettes Imperial Brands (Winston, Gauloises) vient d’annoncer que son dividende ne croîtrait plus 10 % par an comme il le fait depuis 11 ans maintenant, afin de pouvoir financer des investissements supplémentaires dans sa division de vapotage, qui semble avoir plus d’avenir que les cigarettes traditionnelles.
Le cours de Bourse ne s’est pas effondré, il a monté le jour de l’annonce et progresse de plus de 3 % sur la semaine.
Une nouvelle illustration que les investisseurs sont d’abord à la recherche d’investissements créateurs de valeur, plutôt que de dividendes.
[1] Que vous pouvez consulter ici pour Facebook, et là pour LinkedIn.