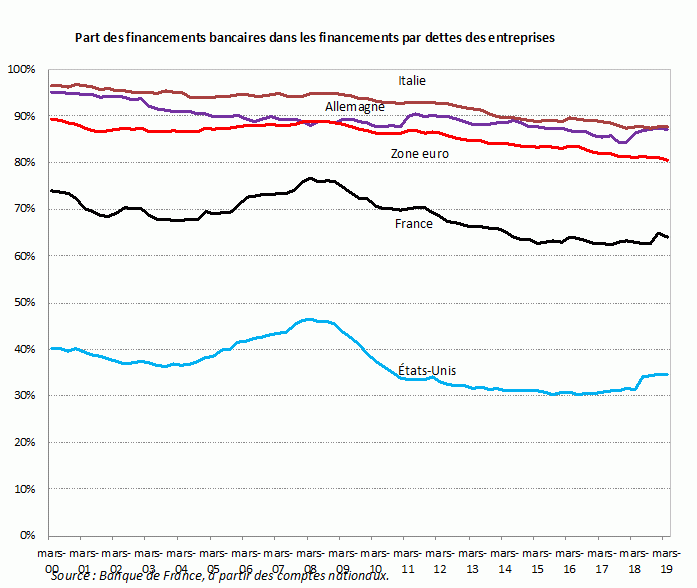La Lettre n°172 de Octobre 2019
Actualités : Compte rendu des tables rondes « Est-il financièrement payant d'être vertueux en matière ESG ?»
A l’occasion de la parution de la nouvelle édition du Vernimmen, dans laquelle nous avons infusé à l’ensemble des chapitres pertinents les préoccupations environnementales et sociales qui changent la finance d’entreprise[1], nous avons organisé une table ronde avec Bertrand Badré, ancien DG et Directeur financier de la Banque Mondiale et fondateur du fonds d’investissement Blue Like an Orange Sustainable Capital, et Cécile Cabanis, DG Finances de Danone. En voici la transcription (les note de bas de page sont de la rédaction).
Vernimmen.net : Danone, dans ses investissements de croissance externe, tient-il compte dans le prix payé de la performance ESG de ses cibles ?
Cécile Cabanis : Je rappelle d’abord que le fondateur de Danone, Antoine Riboud, avait exprimé le fait que la responsabilité des entreprises ne s’arrêtait pas à la porte les usines, et que pour avoir un business en bonne santé, il fallait avoir une société en bonne santé, et une société juste, que l’on avait qu’une seule planète et qu’une seule vie. Cela paraît très naturel maintenant, mais au moment où il l’a dit, c’était devant un establishment[2] pour lequel c’était assez révolutionnaire.
Notre ADN, il est construit comme ça. Et c’est important parce qu’on le met au cœur du business. On n’a pas d’une part une politique économique, une politique de métier, et puis une politique ESG. Tout ce que l’on fait, chaque jour, on essaye de le faire d’une certaine manière qui nous permette de contribuer aux objectifs que l’on s’est fixés pour 2030, dans la perspective d’être certifié B Corp. Etre certifié B Corp, c’est une certification qui demande de répondre à des critères sociétaux et environ-nementaux extrêmement exigeants. C’est donc la façon dont on le met dans le business model. Parce que si l’on veut avoir de l’impact, il faut le mettre au cœur du business. Les entreprises auront l’impact quand ce sera vraiment dans leur process et leur business.
Sur les acquisitions, elles doivent participer à nous conduire vers nos objectifs et nos mandats. Donc quand on annonce une politique sur le climat en disant que l’on va respecter les 1,5 degré, tout ce qu’on va faire dans le business va devoir nous conduire à cela. Et pour les objectifs, c’est la même chose. Quand on regarde le portefeuille de Danone, on est parti d’un conglomérat avec de l’épicerie, il y a bien des années, qui s’est transformé de façon consciente, de sorte qu’aujourd’hui on a presque 90 % des volumes vendus qui sont recommandées pour une consommation journalière.
On fait en sorte que les acquisitions répondre à notre ADN et à notre business model. Les valorisations des acquisitions sont multicritères, elles dépendent de la transformation que vous aurez à faire, des intégrations et de plein de choses. Donc mettre une valeur spécifique en fonction d’un critère, quand vous regardez les reporting ESG aujourd’hui, il y en a des tonnes, on a des équipes entières qui ne font plus que cela et cela en devient ridicule. Donc on n’a donc pas encore décidé ce qui est pertinent de mesurer au titre de la valeur, c’est encore un travail qui doit être fait.
Vernimmen.net : Justement vous Bertrand vous êtes le fondateur de Blue like an orange, un fonds à impact, comment les investisseurs peuvent-ils se repérer dans le fourmillement des critères ESG ?
Bertrand Badré : La question sur les indicateurs est à la fois importante et pas si importante que ça. Elle est évidemment importante parce que dans un monde de mesure, de comparaisons, de benchmarks, les gens veulent se raccrocher à quelque chose. Donc il ne faut pas faire semblant que cela n’existe pas. Ça existe et c’est très bien.
En même temps, ce n’est pas si important. Comme l’a dit Cécile, il y a des tas d’indicateurs. Ce qui est très intéressant, c’est de voir les mouvements capitalistiques autour de ces sujets-là. Et notamment ce que décident les grandes agences de notation et de proxy qui sont en train de marquer leur territoire et qui vont probablement répondre à cette question sans que l’on ait notre mot à dire. Si je suis un peu brutal, nous pourrions revivre ce que nous avions vécu avec les normes IFRS. On est probablement en Europe assez en avance sur ces sujets ; et on risque, ce n’est pas fait, mais on risque de se faire dépasser sur ces questions et imposer un système que l’on n’aura pas nécessairement choisi malgré notre avance, notre sincérité, notre engagement.
Ce point étant posé, oui c’est important mais pas tant que cela. Ce qui est important, c’est l’approche tant des investisseurs que les entreprises. Ces sujets-là paraissent bien connus dans nos économies avancées ; dans des pays émergeants, c’est sensiblement plus compliqué. D’abord car les gens ne savent pas forcément : il y a beaucoup de Monsieur Jourdain qui font de l’ESG sans le savoir. C’est bien de leur dire « ce que vous faites est bien, valorisez-le ». Il faut faire attention à ce que cela n’apparaisse pas comme une nouvelle approche occidentale pour leur dire « voilà le bon capitalisme et voilà le mauvais capitalisme », parce que l’on a déjà fait cela dans le temps. C'est un sujet important. Il faut être inclusif. Les objectifs de développement durable qui sont finalement le fond de tableau de notre discussion sont des objectifs mondiaux, ce ne sont pas les objectifs de la Suède, des États-Unis ou la France, il faut faire très attention à les adapter.
Oui il y a une question de définitions, mais elle va se résoudre. La question des définitions est d’ailleurs posée à plusieurs niveaux. Il y a un certain nombre de normes internationales comme les Principles for responsable investment et d’autres ; celles-là sont moyennement exigeantes, il ne faut pas se raconter d’histoires, mais cela va dans la bonne direction.
Après, on rentre de plus en plus dans les détails, et c’est là qu’il faut à la fois choisir ses indicateurs et surtout, je crois, expliquer ce qu’on fait et respecter deux principes importants : l’intégrité et la transparence. Voilà ce que je fais, et ce n’est pas seulement Emmanuel Faber, le PDG, en haut de la tribune qui dit tout cela, mais c’est l’entreprise tout entière qui doit être mobilisée et agir dans ce sens. Pour Danone, ça fait 50 ans que les messages sont peu ou prou les mêmes, donc c'est plus simple. Pour certains autres, c'est une conversion. Donc ne promettez pas le grand soir du jour au lendemain. Personne ne vous croira. Vous n'allez pas devenir une entreprise exemplaire du jour au lendemain. Indiquez un chemin. Suivez ce chemin, et en transparence dites « J'y arrive », « Je n'y arrive pas », « Voilà comment j'y arrive », etc.
Je ne suis pas effrayé par ce côté un peu bourgeonnant qui révèle deux faiblesses de ce système. La première, est que, quand c'est bourgeonnant, il est plus facile de faire du greenwashing. Attention, ça, c'est important. Il faut être capable de dénicher les menteurs. Le second point, c'est que pour l'instant, tout cela repose quand même assez largement sur la bonne volonté des gens. Il n'y a pas un pistolet sur la tempe de Danone pour leur dire de faire ainsi, c’est dans leur ADN, leur culture, les attentes du consommateur, etc. Mais en gros, vous pourriez ne pas le faire. Je caricature un tout petit peu, le système ne vous récompense pas pour le faire. On pourrait dire si, il y a les consommateurs ou les investisseurs. La vérité c’est que ce n’est pas intégré dans nos normes comptables, c'est très peu intégré dans les modes de rémunération. Donc, on a un système où, pour l'instant, on compte sur la bonne volonté, l'honnêteté et l'intégrité des gens.
Ce qui est formidable, c'est un système de pionniers. Ça bourgeonne. Je pense que maintenant la question est de savoir comment on passe d'un système qui est périphérique et mal défini, à un système qui deviendrait central. Dans les réunions où je vais, on me demande combien il y a de milliards investis en ESG. La réponse, c’est ce que vous voulez ! Vous prenez une définition extrêmement stricte, celle du GIIN, Global Impact Investor Network. Il y a en gros 400 à 500 Md dans le monde qui se qualifient pour des investissements à impact. A l'autre extrémité, certains vous diront qu’il y a plus de 30 000 Md. Entre 500 Md et 30 000 Md, choisissez votre nombre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut se raconter des histoires, qu'on peut afficher de très gros chiffres. Je ne nommerai pas des grands gestionnaires d'actifs qui expliquent qu'ils ont transformé leur modèle, etc. Ça fait très vite des gros chiffres. Je pense qu’il ne faut pas que l'on se raconte des histoires. Nous sommes au tout début de quelque chose. C'est la bonne nouvelle, je pense que c'est en train de vraiment démarrer. Il faut donc rester calme sur le fait que c'est un peu étourdissant.
Vernimmen.net : Cécile, au fond, faut-il payer plus cher une entreprise qui est vertueuse en termes d’ESG ?
Cécile Cabanis : Si je peux rebondir sur les incitations. Nous, il y a 6 ans, on a mis les objectifs de CO2 dans les bonus, dans tous les bonus ; et aujourd'hui beaucoup d’entreprises ont fait de même. La vraie fracture que je vois, c'est chez les investisseurs.
Vous avez un monde de gestionnaires d’actifs dont les bonus sont liés au TRI purement financier calculé par un algorithme. Donc on n’a même pas le droit de discuter. Ce sont les fonds de gestion passive.
Et de l'autre côté, vous avez des équipes qui sont super bien, des équipes gouvernance et durabilité de la gestion active qui ont le dialogue avec vous au moment des assemblées. En revanche, ce n'est pas réconcilié. Ce n'est pas intégré. Ainsi, je me suis retrouvé chez un très grand investisseur, et j'ai rencontré dans la salle leur responsable durabilité. Quand tous les gestionnaires sont arrivés, ils ont demandé qui était la personne de Danone. Ils ne connaissaient pas leur propre responsable durabilité. . .
Tant que l’on n’embarque pas tout le monde, cela ne marchera pas. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, il y a des tas de choses qui bougent, mais on n'est pas encore dans l'action où l’on se met tous ensemble, pour définir le business model qui permettra à tout le monde d'avancer et d’avoir de l'impact. Si on veut de l'impact, ce n'est pas chacun dans son coin, en silo avec ses petites données, ses petites mesures. D’où les coalitions qui ont été lancées dont vous avez entendu parler comme Business For Inclusive Growth (B4IG) et sur la dernière coalition biodiversité (One Planet Business for Biodiversity), où des dizaines d'entreprises se mettent ensemble pour mettre à disposition des projets, des initiatives et des fonds pour s'assurer qu'on peut aller plus vite. Et quand on est dans un collectif, où il y a des initiatives qui sont différentes, on peut aller beaucoup plus vite.
Comment vous assumez que ça réduit le risque, ou que ça augmente la valeur ? Chacun va avoir sa lecture un peu différente. Je ne pense pas qu'on arrivera à définir une norme sur quelle est la valeur, en fonction de quelle mesure, ça va devenir extrêmement compliqué.
En revanche, je pense qu’aujourd'hui, le vrai sujet, ce n'est pas quels sont les critères ESG. Le vrai sujet, c'est dans tout ce que l’on fait. Nous, quand on fait des investissements, dans le processus de validation, on a toute une partie qui est l’impact environnement, électricité, consommation d'eau, etc. que l'on suit, mais c’est dans le cœur de l’activité. Ce n'est pas en plus ou un moins.
Vernimmen.net : Mais si ça se retrouve dans les cashflows, ça se sera forcément dans la valorisation. Tôt ou tard, le problème est celui de l'horizon de temps que les investisseurs sont prêts à prendre en compte. Si c'est dans la réduction du risque, il faut que les investisseurs intègrent cette réduction du risque de l'entreprise plus saine d'un point de vue ESG pour réduire leurs exigences de rentabilité parce qu'il y a moins de risques.
Cécile Cabanis : Oui, c'est bien ce que je dis, les investisseurs n'en sont pas du tout là. Les investisseurs sont encore à regarder votre chiffre d’affaires trimestriel. Et donc vous êtes dans une gestion de tension permanente entre le court terme et s’assurer que vous faites les bonnes choses pour le moyen-long terme.
Mais tant qu'on regardera ça comme un coût ou comme un risque, et pas une opportunité de création, de valeur, de durabilité, ce sera compliqué. Les investisseurs doivent nous rejoindre. Il y a deux ans, on a fait une innovation en renégociant notre crédit syndiqué : 12 banques ont accepté, parce que nous faisons votre chemin pour être certifié B Corp, de nous donner une décote de taux d'intérêt si nous sommes bien sur notre plan, et en revanche, nous aurons un mali si nous ne sommes pas sur notre plan. C'est microscopique, mais ça veut dire qu’effectivement, à un moment donné, il y a une capacité à reconnaître s'il y a moins de bêta ou plus d'alpha.
Et c'est quand on fait des choses comme ça, qu'on commence à bouger. Mais si on veut de l'impact, il faut faire bouger de façon plus fondamentale.
Vernimmen.net : Bertrand, n’y a-t-il pas une contradiction avec le principe de no trade-off que l’investisseur que vous mettez en avant : ne pas vouloir rémunérer, ou en tout cas compenser, pour l'impact de ESG.
Bertrand Badré : Ça pose plein de questions. On est face à un moment important de l'histoire de notre économie de marché. On s'aperçoit que le modèle dans lequel on vit, pour faire extrêmement court posé par Milton Friedman, Jack Welch et quelques autres, que l’on peut simplifier en : Social purpose of business is to make profit, combiné à la shareholder value, touche quelques impasses aujourd'hui. On voit bien qu'il n'est pas tellement équipé pour résoudre la question des défis environnementaux, la question des défis sociaux, etc.
Mais c'est quand même ce modèle qui structure nos normes comptables, les attentes des investisseurs, la manière (avec quelques exceptions) dont on paye largement des gens. Et il ne faut pas oublier qu'on sort de dix ans de crise. J'ai beaucoup passé de temps avec les banquiers centraux quand j'étais à la Banque mondiale, beaucoup sont schizophrènes. Ils disent : On comprend bien qu'il faut qu'on anticipe le long terme, que la réglementation doit prendre en compte le long terme, mais nous sommes payés pour qu’il n’y ait pas une crise demain. Dans ces conditions il est évident que les horizons dans les modèles bâlois, dans les modèles Solvency, conservent une importante dimension intra-annuelle, une espèce d'élastique de rappel en permanence, ce qui fait que malgré toute notre bonne volonté, vous ne pouvez pas pousser trop loin. C'est ça notre système.
Donc, la question d’aujourd'hui, c'est qu'il n’y a pas de maître du monde qui dit oui, OK, le système est déficient, il faut qu'on passe au système B. Il y a 40 ans, quand on a posé les termes de la finance, c'était Reagan, Thatcher voire la Banque mondiale et le FMI. C'était très clair, les modèles financiers et donc ce que j'ai appris, ce qu'on a appris, ça s'est imposé. Il y avait un maître du monde de fait. Aujourd'hui, il y a plus de maître du monde.
Et donc c'est pour ça qu'on choisit de faire un détour le détour avec Emmanuel Faber[3], Paul Polman[4] et quelques autres. Il n'y a pas de maitre du monde, donc on va travailler, secteur par secteur, en regardant comment est-ce qu'on peut créer une masse critique d'acteurs dans un secteur, commencer à changer. Et puis, on espère que cette masse critique va entraîner les autres qui vont se sentir mal de pas faire comme tout le monde et donc basculer. Et puis quand il aura plein de secteurs qui auront basculé, petit à petit on va rétroagir sur le système central et bouger.
Finalement, c'est ce qu'on fait. Je ne sais pas si ça va marcher, parce qu’au début je disais qu’il fallait changer le système, et on me disait : toi tu es bien français, tu penses que la table rase ou la révolution, etc. sont la bonne méthode. Ça, ça ne marche pas, donc on range. On ne va pas changer le système, même si j’aimerais bien. Et donc, voilà le débat. Quand on ne change pas un système, il faut qu'on rentre dans ces questions de : mais qu'est-ce que c'est que le trade-off ? Et comment on fait ça ? Ce sont par exemple les initiatives de Danone.
C'est ce que je fais. Si je veux lever des fonds pour investir dans le développement durable dans les marchés émergents et je commence à avoir une conversation qui est juste, au sens mathématique du terme, indécidable, pour savoir si mon rendement va être impacté positivement ou négativement, car il y a des gens qui vous démontrent le contraire. Il en y a qui disent qu’il y a moins de risque, donc c'est mieux. Et donc, ils vont dire vous prenez un taux mais on ne sait pas très bien. Finalement, ça va peser sur mes cashflows. Donc c'est moins bien. Vous avez des gens qui vous démontrent les deux avec autant d'assurance
Pour l'instant, je ne peux même pas commencer une conversation avec un investisseur institutionnel en disant : écoutez, nos investissements ont de l’impact et donc sous ces conditions, il faut accepter des rendements plus bas. Ce n'est juste pas gérable. Donc vous êtes rémunéré pour le risque que vous prenez, vous êtes dans un marché, le risque vous prenez vaut tant, vous assumez, vous le dites à vos investisseurs, etc. C'est OK. Et en plus. Surprise, surprise, « gratuitement », je vous donne une mesure d'impact. Et c’est comme ça qu'il faut faire ça, sinon on n'y arrive pas ; sinon, c'est un débat sans fin qui va permettre aux « margoulins » de se faufiler et de proposer des « trucs » qui ne sont pas exacts.
Donc il faut jouer avec le système. On ne peut pas, d'un coup de baguette magique, transformer le système. Donc on joue avec le système et on avance sur ses bases, et on attend des pionniers comme Danone et quelques autres qui bougent. J'espère faire partie de ces pionniers et que nous allons petit à petit réformer le système. Mais il ne faut pas se raconter d'histoires. Dans le monde d'aujourd'hui avec les États-Unis qui sont ce qu'ils sont, et la Chine, qui est ce qu'elle est, on ne va pas se mettre autour de la table. J'ai participé à des réunions du Financial Stability Board du G7 ou du G20. Le mode n'est pas à la reconstruction, il est au damage control. Donc on va essayer d'éviter que le système s'effondre avant de penser à le reconstruire. Soyons dans le système les justes qui tiennent la flamme, qui font qu'on va créer quelque chose d'autre après. C'est ça qui est fondamental, vraiment. Il faut être réaliste.
Vernimmen.net : D'ailleurs, on essaye, d'y contribuer dans le Vernimmen en infusant l’ESG de manière un peu volontariste pour que la prochaine génération l’ait comme une donnée de base, et non pas comme un ajout à une finance de base.
Bertrand Badré : Ma conviction, c'est qu'à un moment donné, il n'aura même plus lieu avoir ce débat. Quand vous serez une entreprise, si vous ne vous comportez pas bien, ça vous retombera dessus. Ça va prendre cinq ans, dix ans, ça va dépendre des secteurs, etc. Je travaille avec JAB Holdings, une des grandes holdings de biens de consommation sur la planète. JAB achète 10 % du café mondial, ils ont des chaînes de restaurants : Prêt à manger, Eat et quelques autres. Ils servent 2 milliards de repas par an. Ils m'ont demandé de réfléchir avec eux sur ces questions ESG et durabilité. Ils font partie avec Danone la coalisation Business inclusive for Growth car cela rejoint la conviction profonde des dirigeants. Mais quand vous êtes une entreprise qui sert 2 milliards de repas par an dans le monde d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas mettre sur la table la question du gaspillage alimentaire, vous ne pouvez pas ne pas mettre sur la table la question des emballages. De même, quand vous achetez 10 % du café mondial, il faut vous poser la question de des conditions dans lesquelles vous l’achetez. Donc, un moment donné, ce n'est même plus tellement la question du compte de résultat. C'est une question stratégique. Et donc, la question, c'est bien ce que disait Cécile, c'est comment on transforme le modèle d’entreprise pour que la question ne se pose plus. Qu'un investisseur normal comprenne que l'entreprise qui choisit ça, ne le fait pas parce que c'est bien, c'est sympa, etc. C'est parce que c'est devenu indispensable. On n'y est pas encore, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui vont se passer.
Il a plein de choses qui m'inquiètent dans l'évolution du monde d'aujourd'hui, dans l'hypocrisie d'un certain nombre d'acteurs, etc. Mais fondamentalement, ce qui me rassure, c'est qu'il y a quand même ces fameuses nouvelles générations. Il n’y a pas besoin de leur faire des dessins, ils ont compris. Le système va évoluer sous leur pression, comme consommateur, comme citoyen, comme investisseur, etc. On ne pourra plus raconter des « craques ». Et les gens ironisaient sur Business inclusive for Growth, de même ils ironisaient sur les 200 groupes américains qui ont signé la position de la Business Roundtable. « De qui se moque-t-on ? » entendait-on.
Non, ce n’est pas vrai. Ce n'est pas la bonne manière de regarder. Quand dans le monde d'aujourd'hui, vous mettez votre nom sur un papier et que vous signez en bas ; eh bien, il y a des gens qui vont regarder et dire : tu as raconté que tu allais faire ça, et en fait, tu ne le fais pas. Et alors là, tu commences à te mettre en risque.
Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas parfait. Encore une fois, la baguette magique, on préfère ; mais c'est ça qui est en train de se mettre en place. Et j’ai le sentiment qu’il commence à se passer quelque chose, cela devient sérieux, même si ce n'est pas gagné.
Cécile Cabanis : Je pense qu'il manque toujours les investisseurs. On peut tous faire plein de choses, mais à un moment, il faut les embarquer et je pense que ça démarre effectivement par les bonus. Le patron d’un grand fonds d’investissement nous envoie tous les ans une lettre où il dit se soucier du long terme. Et puis, vous vous retrouverez devant ses gestionnaires d’actifs qui vous disent : Et pourquoi là, il y a 10 M€ en moins de ventes trimestrielles[5] ? Et ils ne vous posent pas une seule question sur le long terme. Donc, la plus grosse problématique, c'est comment adopter du temps long avec des investisseurs qui sont sur un temps court, et comment être capable de faire la bonne transformation au bon rythme, en préservant toujours les trois rythmes de temps qui, sont le court, le moyen et long terme, pour prendre les bonnes décisions. Parce qu'à la fin, le marché financier, le trimestre peut faire prendre de très mauvaises décisions pour le long terme.
Bertrand Badré : Je ne peux pas être plus d'accord. Il y a clairement un sujet d'appréciation du travail financier, de valorisation et de culture. Et c’est pour cela ce que vous faites sur le Vernimmen est essentiel. Je pense qu'il va falloir qu'on change ce que l’on apprend dans les écoles.
De même que le TRI est l’instrument qui résume l'approche rentabilité / risque et qui, au final, conditionne toute une série de choses ; je pense qu'il faut qu'on intègre une troisième dimension : rentabilité / risque/ durabilité, qui montre que nous sommes dans un univers fini, qu’on travaille avec des vrais gens sur une vraie planète, dans des vraies conditions de température, et pas sur un truc qui fonctionne parce que cela marche sur un tableur. Le TRI résulte de plein de chose, c’est un chiffre qui résume, derrière il y a des dizaines d'hypothèses dans la durée. Il ne faut pas se raconter d'histoire, vous savez comme moi que le TRI n'est pas scientifique, je suis désolé. Il faut qu'on arrive à trouver un TRI impact-durabilité, qui intègre cette dimension dans une formule qui simplifiera la vie de tout le monde et qui fait que les gens seront jugés dans 10 ou 20 ans sur ça, et pas seulement sur le TRI tel qu'il est défini aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une bascule qui commence dès l'enseignement.
Je suis d'accord avec Cécile, il y a un sujet de l'appréciation par la sphère financière. Elle est à l’origine de la crise la plus grave que les gens aient jamais connue, et dont nous ne sommes pas vraiment sorti, qui a donné un pouvoir important dans la plupart des institutions financières à la direction de la conformité et à la direction des risques pour d'évidentes raisons. Ce système ne favorise pas naturellement forcément l’innovation.
Le pari que je fais aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans une phase nouvelle, voire même dans un nouveau régime économique, avec des taux d’intérêt négatifs. Ça va contribuer puissamment à agiter la réflexion sur comment on valorise les actifs financiers. Pour l'instant, on déforme les modèles en faisant comme si. A un moment donné, il va falloir se poser la question de savoir si ce n'est pas autre chose. Cela peut être la pire des choses si les gens sont tétanisés. Vous êtes un assureur-vie aujourd'hui. Est-ce que mon modèle économique tient la route dans les 5 prochaines années. Vous êtes un fonds de pension, vous êtes au bord du gouffre si les taux zéro durent dix ans. Cela peut être la paralysie. Dans ces cas-là, les taux zéro sont la pire des choses, et vous continuerez à acheter du Bund allemand en perdant de l’argent, mais vous dites que ce n'est pas grave, car au moins, vous retrouvez quelque chose à la fin. Ou alors, et c'est alors la meilleure des choses, si ça force tout le monde à dire : OK, on est parti pour 10 ou 15 ans de taux très bas. Donc, le modèle actuel ne fonctionne pas. Donc, il faut qu'on réfléchisse différemment, à d'autres options pour revoir la réglementation, qu'on accepte une prise de risque un peu différente, qu’on revoit un certain nombre de critères. Peut-être que les taux zéro vont nous forcer à être un peu plus intelligent que d'habitude.
Vernimmen.net : Très optimiste.
Bertrand Badré : C'est le facteur qui a changé cette année dans l'esprit des gens. On croyait qu'il y aurait une normalisation d'une manière ou d'une autre sur les taux d’intérêt. Aujourd'hui, on voit que les États-Unis les baissent, que la BCE ne va les remonter avant longtemps. Avant, on avait l'espoir que ce n’était qu’une phase. Maintenant on pense que c'est un nouveau régime économique. Alors là, pour le coup, il va falloir réfléchir.
Vernimmen.net : Est-ce qu’être vertueux en termes ESG permet de mieux recruter, de recruter des meilleurs CV ? Est-ce que Danone a l'impression que c'est beaucoup plus facile pour recruter, voire que cela coûte moins cher pour séduire les meilleures compétences ?
Cécile Cabanis : La réponse est oui.
Tous les deux ans, on fait faire un Danone people survey par un organisme externe. Ce que l’on a remarqué, c'est qu’être vertueux en termes ESG comme vous dites, tire très fort le taux d'engagement, on est au top des bests in class depuis des années sur le taux d'engagement. Les collaborateurs de Danone, au-delà de venir faire un travail, se sentent copropriétaires d'un projet.
On a alors décidé de pousser la démarche un peu plus loin, en faisant participer les 100 000 employés de Danone à la définition et l'agenda de nos objectifs stratégiques 2030. Ils sont complètement associés via des consultations deux fois par an. Sur la dernière, plus de 75 000 d’entre eux ont répondu, 300 000 verbatim. Et quand cela vient de 100 pays et de toutes les personnes en entreprise, c'est ultra riche. Parce qu'effectivement, il y a des enjeux globaux, mais il y aura des solutions locales.
Donc c'est extrêmement important d'être connecté en local puisque les enjeux et les priorités ne sont pas les mêmes en fonction de là où vous vous trouvez. Et on a même remonté ce lien jusqu'au conseil d'administration avec un comité du conseil où on a des volontaires qui viennent partager tout ce qui est remonté par les 100 000. Donc, on les a vraiment rendus copropriétaires de la définition des objectifs. Cela a une valeur d’engagement extrêmement forte.
Vernimmen.net : Bertrand, on dynamite le modèle actuel. Quel modèle pour le remplacer ? Vous parlez de Mark-to-planet. Que voulez-vous dire par là ?
Bertrand Badré : Ceux qui en ont fait un peu de comptabilité savent ce que c'est que le mark-to-market. Ça fait partie des piliers des IFRS adoptés collectivement il y a une vingtaine d'années, et qui fait que, même si vous pensez à très long terme, tous les trimestres vous regardez votre bilan en valeur liquidative. Donc c'est compliqué d'être schizophrène. Tous les trimestres, vous arrêtez le bilan comme si l'activité allait s’arrêter demain, et en même temps on prépare les 20 prochaines années.
Qu’est-ce que je veux dire avec le mark-to-planet ? Cela revient à ce que je disais de Friedman : social purpose of business is to make profit, ou dans une variante avec to make profit for shareholders. On oublie une petite note de bas de page d’ailleurs que Friedman avait dit : tout cela nécessite une acceptabilité sociale, on n’est pas quand même pas en apesanteur. Les théoriciens de shareholder value ont un peu oublié cette partie-là en poussant le raisonnement autour de l’actionnaire, ce qui a eu un certain nombre de biais. Le court terme, Cécile en a parlé. Une définition extrêmement financière, et du TRI, on a parlé. Et on s'aperçoit que ça développe un capitalisme que j'appellerais un peu hors-sol, un capitalisme du powerpoint ou excel, ça marche, mais on oublie qu’il y a des vrais gens. Je suis administrateur Getlink (Eurotunnel) et vous avez intégré que la Grande-Bretagne restera dans l'Union européenne pour toujours. C'était très bien pensé d'avoir des usines de part et d'autre, de faire passer les pièces des deux côtés du Channel. Personne n'avait intégré dans le powerpoint qu’il y avait un vrai risque que, dans la vraie vie, de vrais gens décident : on arrête. Même si au cas particulier le monde ne va pas s’arrêter de tourner.
Il faut passer de ce système, The social purpose of business is to make profit, à : The social purpose of business is to find profitable solutions for the planet and its people. Ce n’est pas dire que le profit est mal, je ne fais pas du Picketty, je ne veux pas l’abolition du profit. Je préfère Le profit n'est pas une fin, pas plus que le TRI et les bonus. Le profit est un moyen, ce n'est que comme ça qu'il est durable. Si vous apportez des solutions, vous permettez au modèle de se pérenniser. Si votre devise est take the money and run, ça veut dire que vous n’êtes pas dépositaire de cette planète et des gens qui vivent dessus, etc.
C'est dire le saut quantique qu'il faut qu'on réalise. Je pense que Danone et Antoine Riboud étaient très en anticipation là-dessus. Faire le saut quantique loin du profit comme fin en soi, et regardons-nous dans la glace, c'est quand même comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui, au profit comme moyen en vue d'une fin, qui est bien cette planète. Parce que, comme le disait Antoine Riboud, il n'y en a pas d'autres pour l'instant, à vue humaine il n'y en a pas d'autres. Et avec ses habitants. C'est bien ceux-là, parce que si ces gens-là ne sont pas contents, ça va très mal se passer. C'est bien ça qui est en train de se passer partout sur la planète, on a un capitalisme qui ne répond plus à la commande, et on est un peu comme la poule devant un couteau, il faut changer.
Tableau : Part des financements bancaires dans les financements par dettes des entreprises
C‘est l’un des nouveaux graphiques du Vernimmen 2020 qui montre que, même sur une durée très longue, 19 ans, la structure de l’endettement des entreprises entre endettement par dettes bancaires et endettement de marché (obligations, NEU CP) évolue finalement très lentement, aucune variation supérieure à 10 points n’est enregistrée.
Il montre aussi que la part de l’endettement bancaire a tendance à remonter avant une crise financière, puisque tant pour les entreprises françaises qu’américaines, celle-ci cesse de baisser et remonter dès juin 2004, soit 3 ans avant les premières difficultés. Ce n’est pas pour autant qu’il faut, à notre avis, en faire un indicateur avancé de difficultés à venir. Une seule observation est en effet un peu court pour en tirer une loi !
Recherche : La propagation des faillites : une analyse des réseaux clients-fournisseurs
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à l’Université
de Cergy-Pontoise
Le développement de très larges bases de données permet aujourd’hui d’analyser finement les phénomènes de propagation de chocs dans l’économie. C’est le cas par exemple concernant les faillites d’entreprises. Il est possible d’identifier à grande échelle des connexions de type client-fournisseur entre les entreprises. Intuitivement, l’interdépendance accrue des entreprises peut avoir pour conséquence une plus grande propagation des faillites. Un chercheur a étudié la structure de ces réseaux et la propagation des faillites sur un échantillon large d’entreprises japonaises[1]. Ses résultats indiquent que la structure des réseaux contribuerait en réalité à absorber les chocs liés à la faillite d’une entreprise plutôt qu’à les diffuser à l’ensemble de l’économie.
L’échantillon retenu pour l’étude couvre la période 2013 à 2017 et contient plus d’un million d’entreprises et près de 15 000 faillites. Il s’agit donc ici d’une utilisation du fameux big data en finance d’entreprise. L’étude de la structure du réseau présente en elle-même un intérêt. Par exemple, il est possible d’identifier un réseau d’entreprises connectées, directement ou indirectement, selon une chaîne client-fournisseur, qui regroupe 79,7 % de l’échantillon. Autrement dit, 4 entreprises sur 5 de cet échantillon quasi-exhaustif d’entreprises sont reliées sur un même réseau. Cette première observation peut laisser penser à un potentiel de propagation rapide de la faillite de l’une d’entre elles à l’ensemble de l’économie. En revanche, le réseau apparaît relativement peu dense, au sens où les liens directs ne sont finalement pas si nombreux. Par exemple, 90 % des entreprises ont moins de 10 clients. La structure est bien entendu fortement asymétrique, puisque la moyenne de clients par entreprise est de 3 651, quand la médiane s’élève à… 1 seul client !
Concernant les entreprises en situation de faillite, l’étude montre que 88,7 % d’entre elles ne sont pas directement reliées par une chaîne client-fournisseur. La propagation directe ne semble donc pas si fréquente. Et dans le cas où deux entreprises en faillite sont effectivement connectées, la taille de la chaîne est presque toujours limitée à 2 entreprises. Sur l’ensemble de l’échantillon, il existe tout de même une chaîne de 35 entreprises en faillite directement connectées. Par ailleurs, lorsque 50 % des clients d’une entreprise sont en faillite, la probabilité de faillite de cette dernière est presque doublée. La propagation client-fournisseur est donc un phénomène réel, mais loin d’être systématique.
Finalement, le degré de propagation dépend largement de la structure du réseau. Dans un monde où les entreprises seraient toutes totalement indépen-dantes, point de propagation. Mais dans la situation extrême inverse avec des liens directs entre toutes les entreprises, la faillite de l’une d’entre elles deviendrait négligeable pour les autres (par exemple, il ne s’agirait que d’un client parmi des millions) et les chocs seraient parfaitement amortis. La transmission ne se fait donc que si l’effet de contagion l’emporte sur l’effet de diversification du réseau. A partir de simulations statistiques, l’auteur de l’étude estime que la diversification l’emporte le plus souvent, ce qui est conforme à ses observations de connexions rares entre les entreprises en faillite.
Cette étude comporte quelques faiblesses, comme l’absence d’une analyse longitudinale de la propagation des faillites. Mais son analyse d’un aussi large échantillon fournit des statistiques précieuses sur la structure actuelle de l’économie (dans ce cas précis, du Japon) et ouvre des perspectives pour de futures recherches.
[1] Y.ARATA (2019), Bankruptcy propagation on a customer-supplier network: an empirical analysis in Japan, Rieti discussion paper 18-E-040.
Q&R : Qu'est-ce qu'un term loan B ?
Le Term Loan B (« TLB », ti el bi pour les intimes) est un prêt senior à long terme (généralement entre 5 et 7 ans) souscrit par des investisseurs institutionnels dans le cadre d’opération à fort effet de levier (notamment les LBO, mais pas uniquement). Ces prêts sont très peu ou pas amortissables (avec remboursement in fine donc).
Le terme Term Loan B vient du monde du LBO où historiquement la dette senior était structurée sous forme d’une tranche A (Term Loan A) à 5 ans amortissable, d’une tranche B (Term Loan B) à 6 ou 7 ans in fine voire d’une tranche C à plus long terme[1]. Le Term Loan B a pris son indépendance : il est maintenant mis en place seul, sans tranche A ou C. Par ailleurs, il est aujourd’hui souscrit essentiellement par des hedge funds ou des fonds spécialisés (émetteurs d’une titrisation collaterized loan obligations, CLOs).
Les TLB sont utilisés dans les mêmes circonstances que des émissions obligataires high yield. Ils viennent donc en concurrence (suivant le prix notamment et la flexibilité) ou en complément du high yield (pour maximiser la liquidité, le type d’investisseurs étant différent). Les TLBs s’échangent entre investisseurs, même s’ils ne sont pas cotés sur un marché formalisé.
[1] Pour plus de détails, voir la chapitre 49 du Vernimmen.
Autre : FORMATIONS
Voici les dates des prochaines formations que nous avons conçues pour Francis Lefebvre Formation, avec des enseignants que nous avons sélectionnés pour l’excellence de leur pédagogie :
- « Ingénierie financière » le 7 novembre 2019, à Paris
- « Définir la structure de financement adaptée à votre entreprise » le 19 novembre 2019, à Paris
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière.
Il ne faut jamais désespérer de l’IASB
Dans le cadre de son projet de long terme, Better Communication in Financial Reporting, qui devrait voir la publication d'un document préliminaire avec appel à commentaire du public au dernier trimestre 2019, l'IASB projette de réintroduire en notes aux comptes les éléments exceptionnels de l'exercice qu'il avait supprimés du compte de résultat en 2002. Ce serait mieux de les réintroduire dans le compte de résultat, mais c'est déjà un progrès par rapport à la situation actuelle, où ils sont bannis, ce qui pousse les entreprises à introduire des soldes intermédiaires faisant la part des résultats courants et des éléments non courants, sans que l'on soit assuré que la distinction entre les deux soit d'une rigueur. . . comptable.
Dans le même domaine, serait comblée la lacune actuelle des IFRS qui ne prévoient d'autres éléments obligatoires dans un compte de résultat que les ventes et le résultat net. Ce qui est un peu court quand même.
Si les entreprises gardaient la liberté de présenter leur compte de résultat par fonction ou par nature, celles les présentant par fonction devraient toutefois présenter en annexe une ventilation de leurs dépenses par nature, qui donne normalement plus d'informations sur la structure du compte de résultat.
Succès du placement d’une obligation indexée à des objectifs durables.
A la mi-septembre, l’électricien italien Enel a levé 1,5 Md$ à 5 ans avec un coupon de 2,65 %, soit 5 points de base (0,05 %) en dessous de sa courbe de référence. Dans le cas où Enel ne réussirait pas à porter la part des énergies renouvelables de 45,9 % à 55 % d’ici 2021, le coupon serait rehaussé de 25 points de base de 2022 à 2024, soit un surcoût de 11,25 M$ pour Enel, ce qui commence à être significatif comme pénalité.
L’économie réalisée quant à elle est beaucoup plus modeste, car si on estime que, du fait de la liquidité actuelle du marché de la dette cotée, Enel aurait pu émettre une obligation classique à taux correspondant à celui de sa courbe de référence, soit 2,70 %, le gain sur 5 ans n’est que 3,75 M€.
C’est vraiment timidement que les investisseurs font un effort financier pour favoriser la transition écologique[2].
La composition des indices boursiers depuis 35 ans
En septembre, Marks & Spencer est sorti de l’indice phare de la bourse de Londres, le FT 100. Depuis la création en 1984 de cet indice, seul un peu plus d’un quart des constituants d’origine sont encore membres de ce club. Les deux tiers ont été acquis par d’autres groupes (Cadbury Schweppes, Blue Circle, Scottish & Newcastle, General Accident, Ladbrokes, GEC, etc.), ce qui confirme que sur la Bourse anglaise tout est potentiellement à vendre pour autant que le prix soit là. Un seul groupe a fait faillite.
A cette occasion, un retour en arrière sur le CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, ne montre pas une évolution très différente. Créé en 1988, seuls 15 des 40 constituants d’origine sont encore présents. 2 en sont sortis par marginalisation puis ont fait faillite (Pechelbronn, ancêtre de Sequana, et le Crédit Foncier), 16 ont été acquis (Lafarge, Paribas, Alcatel, Darty, Club Med., etc.), 4 sont devenus trop petits pour y rester (Hachette, Chargeurs, CGIP et Casino) et 3 ont été lourdement restructurés (Compagnie Générale des Eaux, Compagnie Générale d’Électricité et Thomson CSF).
Brexit ou pas Brexit, une leçon commune pour les groupes : s’adapter ou mourir.
Fonds d’investissement et Bourse
Les fonds d’investissement ont la réputation, scientifiquement démontrée par les chercheurs en finance, de ne pas laisser d’argent sur la table, autrement dit de valoriser les actions des entreprises qu’ils introduisent en bourse au plus haut qu’ils le peuvent et que l’acceptent les investisseurs. Ces derniers ne peuvent alors pas se livrer au petit jeu de participer à l’introduction pour revendre quelques heures/quelques jours après en empochant la décote d’introduction, autrefois estimée entre 5 et 10 %.
L’introduction en bourse de Veralia, participation d’Apollo, il y a 10 jours, en est une illustration. Pour un prix d’introduction de 27 €, dans le bas de la fourchette annoncée (26,5 € - 29,5 €), le cours, après avoir un peu et brièvement monté (28,6 € au maximum), s’est stabilisé au bout de 6 jours de négociation vendredi soir à 27,16 €.
En revanche, en Scandinavie, la société de gestion de fonds d’investissement, EQT, semble avoir été beaucoup plus laxiste/généreuse/soucieuse du long terme. Introduite le 23 septembre dans le haut de sa fourchette de 62 à 68 SEK, à 67 SEK, son cours a flambé de 25 % le premier jour et terminait à 90 SEK vendredi soir, soit une performance de 34 %. De quoi laisser de bons souvenirs aux actionnaires de départ, terreau toujours favorable pour de nouvelles augmentations de capital afin de doter cette société de gestion de fonds d’investissement (40 Md€ en LBO, infrastructures, dettes) de capitaux propres nouveaux pour investir comme actionnaire de départ significatif (cornerstone) dans les fonds qu’elle lève régulièrement. Ceci explique peut-être cela.
Mais cette introduction en bourse, longtemps après celles des grands américains (KKR, Apollo, Carlyle, Blackstone) illustre paradoxalement la désaffection pour les marchés boursiers et la montée continue des investissements non cotés, puisqu’elle va donner plus de moyens à EQT pour retirer de la cote plus d’entreprises, même si rien n’est définitif en la matière, comme le montre l’exemple de Veralia. On peut toutefois se dire que Veralia n’est venue en bourse que parce que le marché du private equity la valorisait probablement moins bien. Pour plus de détails sur ce sujet, voyez l’avant-propos du Vernimmen 2020 qui est consacré à cette thématique.
[1] Que vous pouvez consulter ici pour Facebook, et là pour LinkedIn.
[2] Pour plus de détails, voir l’article d’actualité de ce numéro.