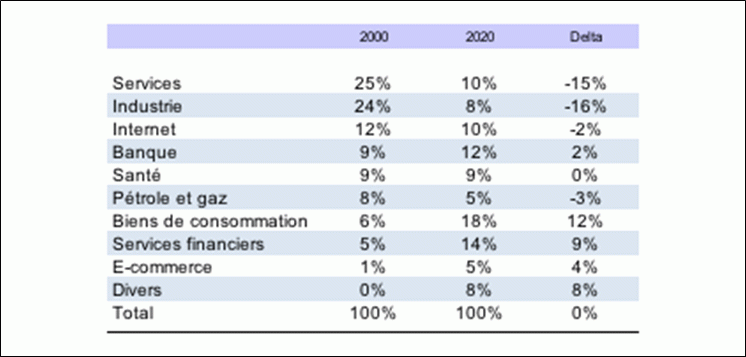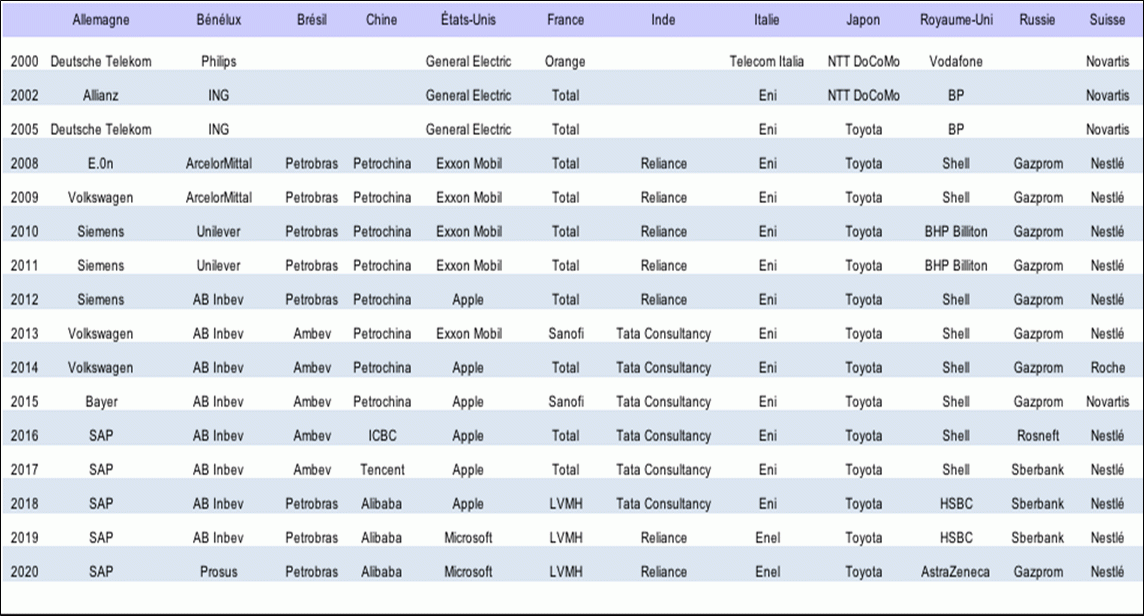La Lettre n°179 de Mai 2020
Actualités : Changements et permanences dans le classement des premières capitalisations boursières mondiales depuis 2000
Chaque année nous mettons à jour dans les annexes du Vernimmen des tableaux de données concernant les 20 premières capitalisations boursières de 14 pays ou zones économiques : capitalisations boursières, bêta, PBR et PER, ventes, résultat net et effectifs.
Cette base de données, établie progressivement, permet de faire des constats de longue période, certes à partir seulement des 20 premières capitalisations boursières d’un pays, mais celles-ci représentent souvent une part significative de la capitalisation boursière de ce pays, 60 % dans le cas français par exemple.
Ici, nous nous sommes limités à 12 pays, laissant de côté le Maghreb et l’UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine). Les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) sont pris en compte à partir de 2008, avant ils ne figuraient pas dans les annexes.
Les chiffres correspondent à ceux d’avril ou mai de chaque année, donc quasiment au plus haut de la bulle TMT (Télécom, Média et Technologie qui comprenaient alors Internet) en 2000 et au sortir du confinement en Europe continentale pour 2020. Les pourcentages ou classements donnés le sont sur la base des valeurs en Md€ et non des nombres d’entreprises.
Sectoriellement, ce qui est frappant est l’effondrement de l’industrie, passée de la première position avec 25 % des capitalisations boursières en 2000 à seulement 10 % en 2020. General Electric en est le symbole avec 521 Md€ de capitalisation boursière en 2000, ce qui en faisait la première capitalisation boursière mondiale[1] et qui n’est plus dans les 20 premières américaines depuis 2018. On peut y voir le besoin moindre d’objets au profit de services dans la part la plus riche de l’humanité, mais aussi les effets de la globalisation (la Chine, atelier du monde) forçant les rentabilités économiques de l’industrie à converger vers les coûts du capital, et donc diminuant les valeurs.
On pourrait croire que c’est la santé et Internet qui ont pris le relais de l’industrie. Pas du tout. Certes en 2000, Facebook, Google ou Tencent n’existaient pas ou étaient loin d’être dans les 20 premières capitalisations de leurs pays respectifs, mais en pleine bulle TMT, Cisco (troisième capitalisation boursière mondiale) valait 465 Md€ (seulement le tiers aujourd’hui), soit un peu plus que Facebook en 2020, America Online valait 131 Md€, T-Online valait 42 Md€, les deux tiers de ce que vaut aujourd’hui sa maison mère Deutsche Telekom, etc.
Quant à la santé, au poids stable sur 20 ans à 9 % des capitalisations boursières, Aventis + Sanofi-Synthélabo constituaient déjà ensemble la 3e capitalisation boursière française, à 93 Md€ (contre 110 aujourd’hui), Pfizer, Merck et Johnson & Johnson étaient déjà les 6e, 13e et 18e capitalisations boursières américaines ; Novartis et Roche la 1re et 3e de Suisse.
Non, le champion de la hausse, ce sont les biens de consommation passés de 6 % à 18 % des capitalisations boursières, principalement grâce à Apple (6 % du total de notre échantillon en 2020, absent en 2000) et au luxe (passé de 0,4 à 2,3 %). Quand on songe que LVMH valait le quart d’Orange en plein bulle TMT, contre 6 fois plus en 2020… Mais aussi Nestlé, Unilever et Danone qui ont crû beaucoup plus vite que notre échantillon : x 2,9 contre x 1,6 ; surtout grâce à Nestlé (x 3,4), leader mondial de l’agro-alimentaire, 11e capitalisation boursière du monde, valant quasiment autant que le premier distributeur mondial classique, Walmart.
Si la part des services a peu augmenté, de 30 à 32 %, quelle mutation à l’intérieur de cette catégorie ! Les services traditionnels ont chuté de 25 % à 10 %, l’e-commerce inexistant a bondi à 8 % avec la troisième capitalisation mondiale (Amazon) et la première chinoise (Alibaba), et les services financiers (assurance, mais surtout moyens de paiement) sont passés de 5 à 14 %. A-t-on conscience que Visa et Mastercard font à eux seuls quasiment 3 % de la capitalisation mondiale de notre échantillon ? En creux, cela démontre la très bonne tenue du secteur bancaire, passé de 9 à 12 % malgré la sortie de son périmètre de Visa et Mastercard, alors filiales des banques.
* * *
Géographiquement, les évolutions en vingt ans sont aussi nettes.
Malgré l’introduction en 2008 dans notre échantillon de la Chine, de la Russie, du Brésil et de l‘Inde qui ont représenté cette année-là 26 % des capitalisations boursières, la part des États-Unis est restée stable à 46 % entre 2000 et 2020, malgré une chute à 25 % en 2008, grâce à une remontée constante depuis, accélérée en 2020 avec un passage en 12 mois de 41 à 46 % du total. Si les États-Unis détenaient six des premières capitalisations boursières en 2000 avec General Electric, Intel, Cisco, Microsoft, Exxon Mobil et Pfizer, ils trustent en 2020 les quatre premières (Microsoft, Apple, Amazon et Alphabet) et 8 du top 10. Mais leurs quatre premières capitalisations, qui représentaient 17 % de l’échantillon mondial en 2000, en font 23 % en 2020.
Alors que pour entrer dans le top 20 américain en 2000, il fallait peser 117 Md€, il faut en 2020 capitaliser 178 Md€. Seuls un groupe Japonais (Toyota), trois suisses (Nestlé, Roche et Novartis) et cinq chinois (Alibaba, Tencent, ICBC, Kweichow Moutai et China Construction Bank) le pourraient aujourd’hui.
Le second pays, qui est passé de 10 % des capitalisations boursières à 16 %, est bien sûr la Chine continentale, officiellement toujours communiste J. Ses vingt premières capitalisations sont assez hétérogènes comme en témoigne un rapport de 1 à 11 entre la première et la dernière (Industrial Bank), contre 1 à 7 aux États-Unis et dans la plupart des autres pays (sauf la Suisse à 14). Le taux de renouvellement annuel[2] du top 20 à 13 % est le plus élevé observé (de 7 à 10 % pour les autres pays), preuve que derrière son peloton d’une dizaine de grands groupes, la situation est mouvante.
Derrière la Chine, on trouve dans un mouchoir de poche le Japon, la Suisse, la France et le Royaume-Uni, dans cet ordre en 2020, et représentant chacun 6 à 7 % du total, avec une vraie performance des groupes suisses passés de 5 % en 2000 à 7 % en 2020, malgré l’introduction des BRIC en 2008 dans notre échantillon qui dilue mécaniquement les positions. Et en dépit de ses seulement 9 millions d’habitants, à comparer aux 67 millions du Royaume-Uni et de la France et aux 126 millions du Japon. Ce dernier est en déclin net (de 14 à 7 %), tout comme le Royaume-Uni (de 15 à 6 %). Pour ces deux derniers pays le déclin est absolu, avec une baisse de la valeur combinée de leurs vingt premières capitalisations boursières de 21 % et 32 % respectivement contre + 60 % pour la Suisse et +13 % pour la France.
L’Allemagne ne représente plus que 5 % contre 8 % des capitalisations boursières en 2000, et un montant absolu de ses capitalisations boursières stable. Même si son industrie a pris des parts de marché significatives, elle est pénalisée par le recul relatif de ce type d’activités et ses multiples de valorisation plus bas : ainsi ses 8 groupes industriels valent moitié moins en 2020 que les 8 groupes français de biens de consommation (378 Md€ contre 689 Md€). On peut aussi penser que l’Allemagne est pénalisée dans ce type de classement par l’importance de son tissu économique d’ETI (entreprises de taille intermédiaire) qui, n’ayant pas été consolidées dans des grands groupes, rendent ceux-ci moins puissants que dans d’autres pays où les ETIs devenues sont devenues plus rares (France, Royaume-Uni) du fait de l’appétit des grands groupes.
Deux pays se détachent par leurs mauvaises performances constantes : l’Italie qui ne fait plus que 2 % du total en 2020 (5 % en 2000), avec un recul de 44 % du montant absolu de ses capitalisations boursières. Alors qu’il fallait en 2000 peser 8 Md€ pour entrer dans le top 20 italien, il n’en faut plus que 6 Md€ en 2020 (contre 20 à 25 Md€ pour les groupes suisses, anglais, allemands et français). Son premier groupe (Enel, 61 Md€) se classe au 72e rang mondial.
La Russie connaît un déclin encore plus rapide en passant de 7 % en 2008 à 2 % en 2020. Son premier groupe, Gazprom (54 Md€) se classe 80e mondial, soit autant qu’Axa, 13e français. 5 Md€ suffisent pour entrer dans le top 20 russe, soit le plus petit chiffre de notre échantillon. Puissance politique et militaire, la Russie est un nain économique.
Son top 20 vaut autant que le tiers de la Suisse, le septième de la Chine et le vingtième des États-Unis. Les trois quarts de ses 20 premiers groupes sont dans les secteurs des matières premières et sur les 13 premiers, un seul est dans un autre secteur (Sberbank, qui doit toutefois avoir de facto beaucoup d’encours sur ce secteur !). La gouvernance souvent critiquée de ses groupes cotés ne les aide évidemment pas à obtenir des valorisations élevées.
L’Inde est stable à 4 %. Le Brésil connaît une évolution similaire à celle de la Russie, avec pourtant une très grande diversification sectorielle, et ne pèse plus que pour 2 % des capitalisations boursières de notre échantillon.
[1] Pour plus de détails, voir La Lettre Vernimmen.net n° 162 d’octobre 2018.
[2] Probabilité qu’un groupe sorte une année donnée des vingt premières capitalisations boursières de son pays.
Recherche : La RSE dans la relation client-fournisseur
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
Les entreprises sont soumises à une demande croissante de respect de bonnes pratiques en matière sociale et environnementale, habituellement regroupées sous le concept de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE). Cette demande de RSE provient des consommateurs, mais aussi des investisseurs et même des salariés, ce qui conduit les auteurs du Vernimmen, paraphrasant A. Malraux, à dire « que la finance d’entreprise sera à l’avenir verte, responsable et durable, ou qu’elle ne sera pas ! »[1]. Mais les entreprises qui se veulent les plus vertueuses en la matière doivent aussi prendre garde aux pratiques de leurs fournisseurs, sous peine de s’exposer à des scandales qui ruineraient leurs propres efforts. Certaines auraient dû avoir en tête ceci il y a quelques semaines avant de ralentir ou arrêter leurs paiements aux fournisseurs en tirant prétexte du Covid-19. Une étude récente[2] montre, sur des données mondiales, que les entreprises soucieuses de RSE ne se contentent pas de choisirent correctement leurs fournisseurs : elles influencent leur comportement.
L’étude se fonde sur une base de données de plus de 30 000 relations client-fournisseur entre 2003 et 2015. Elle retient comme indicateur principal de RSE la notation ASSET4 fournie par Thomson Reuters. Le résultat principal est le suivant : une amélioration de la note de RSE d’une entreprise entraîne l’année suivante une amélioration de la note de RSE de ses fournisseurs (l’impact est de 8 % pour une variation d’un écart-type). En revanche, l’inverse n’est pas vrai, la transmission n’est observée que des clients vers les fournisseurs. Les entreprises semblent faire pression sur leurs fournisseurs pour qu’elles améliorent leur score de RSE, mais pas sur leurs clients.
Techniquement, la difficulté pour ce genre d’étude est d’établir une causalité entre la volonté du client et les pratiques du fournisseur. On pourrait imaginer que le simple choix de fournisseurs soucieux de RSE fasse apparaître le même effet sans que le client influence son fournisseur, une fois son choix effectué. Afin de montrer qu’il s’agit bien d’une pression exercée par les clients, les auteurs ont étudié les conséquences des votes de propositions RSE par les actionnaires des entreprises clientes. Ils montrent que des propositions adoptées de justesse (par une faible marge sur les votes) conduisent à une amélioration de la RSE des fournisseurs bien plus élevée que lorsque les propositions sont rejetées de justesse. Autrement dit, l’adoption (partiellement non anticipée) de bonnes pratiques de RSE par le client se traduit par l’adoption de mesures de même nature par le fournisseur l’année suivante. La causalité semble établie.
Les auteurs discutent ensuite du mécanisme par lequel les clients influencent les fournisseurs. D’une part, la possibilité pour le client de choisir son fournisseur et, surtout, de mettre fin à la relation, est un moyen de pression évident. D’autre part, l’influence peut se transmettre par les canaux de gouvernance habituels : des actionnaires et/ou des administrateurs communs au client et au fournisseur prendront chez le fournisseur des décisions conformes aux volontés du client.
En mettant à jour l’importance de la chaîne client-fournisseur en matière de RSE, cet article contribue à montrer de quelle manière les bonnes pratiques peuvent se propager au niveau mondial. Surtout, le fait que cette transmission ne soit pas réciproque (des clients vers les fournisseurs, mais pas l’inverse) implique que la structure de la chaîne de valeur de chaque industrie joue un rôle crucial dans la diffusion internationale de la RSE.
[2] R. Dai, H. Liang et L. NG, « Socially responsible corporate customers », Journal of Financial Economics, à paraître.
Q&R : Si le dividende ne rémunère pas les capitaux propres, qu'est-ce qui rémunère les capitaux propres ?
Ayant acheté une action 106 le lundi, qui a versé un dividende de 6 le mardi, je me retrouve le mardi soir avec une action qui vaut 100 et des liquidités pour 6, correspondantes au dividende touché, et un gain financier nul (106 - 100 - 6 = 0), même si juridiquement et fiscalement j’ai enregistré un dividende de 6. Ceci montre bien qu’il est abusif de dire que le dividende est la rémunération de l’actionnaire. En effet, quelle rémunération ai-je eue, puisque mon patrimoine est inchangé et que je n’ai fait aucune dépense ? Celui qui détient son action dans un PEA s’en rend aisément compte puisque la valeur de son PEA est naturellement inchangée suite au versement du dividende.
Le caractère fallacieux de cette assimilation du dividende à la rémunération des capitaux propres apparaît clairement d’un point de vue fiscal puisque l’investisseur est taxé sur les 6 de dividende perçus, comme s’il s’agissait d’un enrichissement pour lui alors qu’en fait il ne s’est enrichi de rien du tout.
Qu’est-ce qui constitue alors la rémunération de l’actionnaire ? C’est la plus-value, mais une plus-value calculée non pas selon les critères juridiques et fiscaux habituels qui sont très prégnants, mais selon un critère financier simple, dans lequel tout dividende touché vient en diminution du prix de revient financier de l’action. Pour reprendre l’exemple initial, si le mercredi mon action monte à 102, j’aurais alors gagné 2, écart entre le cours de 102 et mon prix de revient de 100, lui-même résultant d’un prix d’achat initial de 106, minoré par la perception d’un dividende de 6.
On pourrait nous dire : Si j’achète l’action 1 000 le 1er janvier 2019 ; que la société réalise un résultat de 60 en 2019, que ce résultat est valorisé pour 60 par le marché et que donc l’action vaut 1 060 au 31 décembre 2019 ; qu’un dividende de 60 est versé le 1er janvier 2020, alors le dividende correspond bien à la rémunération des capitaux propres. Certes, mais si le dividende n’avait pas été versé, la plus-value pour l’actionnaire aurait été quand même de 1 060 – 1 000 = 60. C’est bien sa rémunération, même si le dividende est nul (comme cela est le cas dans le holding d’investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, qui n’a pas la réputation de mal rémunérer ses actionnaires et qui pourtant n’a jamais versé un dividende). Et si le dividende de 60 avait été versé, nous aurions aussi eu une plus-value financière de 60 (1 000 – 940) puisque notre prix de revient financier serait passé de 1 000 à 940, et que l’action, après versement du dividende de 60, vaudrait 1 000.
Si, maintenant, le marché n’avait traduit dans les cours qu’une partie de la création de valeur en valorisant l’action 1010, le versement d’un dividende de 60, réduisant le cours à 950, vous aurait fait croire à une rémunération de 60, alors que vous ne vous êtes enrichi que de 10 (950 + 60 - 1 000) correspondant à notre plus-value financière (950 – (1 000-60)).
De façon plus générale, la formule de calcul de la rentabilité d’une action sur un an, achetée V0, revendue V1, avec perception d’un dividende D1 dans l’intervalle, qui est de : (V1 - V0 + D1) / V0, est bien sûr juste, mais le dividende D1 ne joue pas le rôle qu’on lui prête le plus souvent, celui d’un revenu touché qui majore la plus-value. Il est vrai d’un point de vue fiscal et juridique, mais pas d’un point de vue financier. En fait pédagogiquement la formule devrait plutôt s’écrire ainsi : (V1 -(V0 - D1)) / V0, car le dividende est un correctif de la valeur initiale, un peu comme si on vous avait remboursé une partie de votre capital, puisqu’à travers le dividende, on vous attribue une partie des actifs (des liquidités) de l’entreprise.
Sur une durée supérieure à l’année, on calcule bien sûr le taux de rentabilité comme étant le TRI de la chronique des flux de l’action achetée et supposée revendue au terme de la période. Ce calcul intègre dividendes ET plus-values. Si nous avons mis en gras la conjonction « ET » dans l’expression « dividendes ET plus-values », c’est bien pour souligner le caractère indissociablement lié de ces deux paramètres dans leur acceptation courante, et de l’impossibilité qu’il y a à ne tenir compte que de l’un, le dividende, pour apprécier la rémunération de l’investisseur, puisque le versement de dividende crée automatiquement de la moins-value. D’où notre conception d’une plus-value financière développée plus haut, qui englobe les deux.
Autre : Formations
Voici les dates des prochaines formations que nous avons conçues pour Francis Lefebvre Formation, avec des enseignants que nous avons sélectionnés pour l’excellence de leur pédagogie :
- « Ingénierie financière » le 16 octobre 2020, à Paris.
- « Définir la structure de financement adaptée à votre entreprise » le 17 novembre 2020, à Paris.
- « Les mécanismes du LBO et l’environnement du Private Equity » le 22 octobre 2020, à Paris.
- « Gestion de la trésorerie et des risques financiers : quelles priorités en 2020 » le 30 septembre 2020, à Paris.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière.
Danone annonce le maintien du dividende qu’il avait indiqué à la publication de ses résultats annuels début février et nous pensons qu’il a raison de le faire.
Du fait de son secteur, son activité est nettement moins atteinte que celle de beaucoup d’autres groupes, sa liquidité est bonne, sa structure de bilan est solide. Il peut donc se permettre de rendre à ses actionnaires une partie des capitaux propres qu’il a générés dans l’année écoulée et dont il n’a pas l’utilité. Des impôts seront ainsi payés par les actionnaires qui recevront le dividende, aidant les États qui en ont bien besoin en ce moment à moins s’endetter. Le solde sera pour l’essentiel réinvesti, en particulier pour souscrire aux augmentations de capital à venir, nécessaires pour rétablir la solvabilité de groupes fortement atteints par la crise sanitaire et économique.
S’il est un vrai esprit de responsabilité et de solidarité, c’est bien celui-ci, plutôt que d’affirmer, comme des groupes qui pouvaient se permettre de maintenir leur dividende, que réduire ou supprimer leurs dividendes était faire preuve de solidarité avec leurs parties prenantes, comme si un tel mouvement avait amené un seul masque ou respirateur de plus dans les hôpitaux.
[1] Que vous pouvez consulter ici pour Facebook, et là pour LinkedIn.