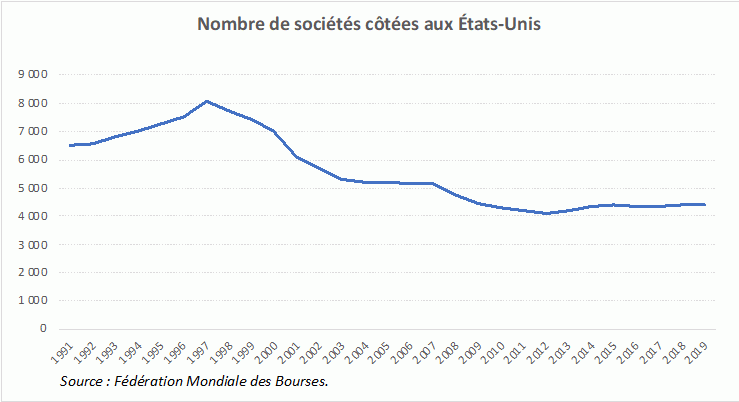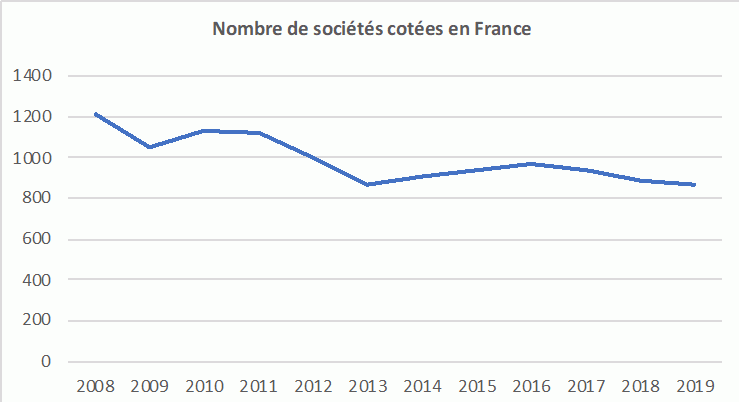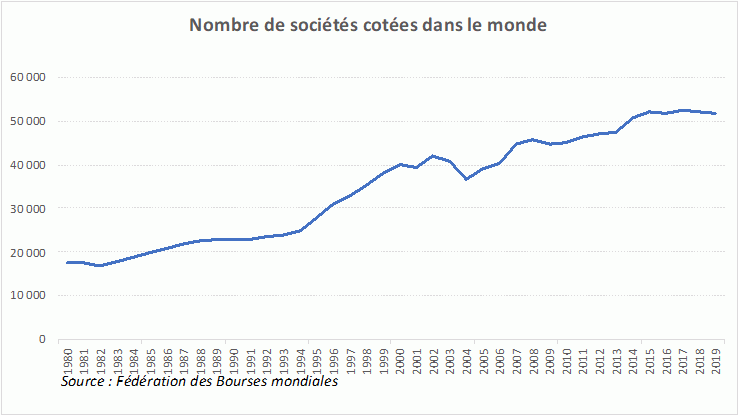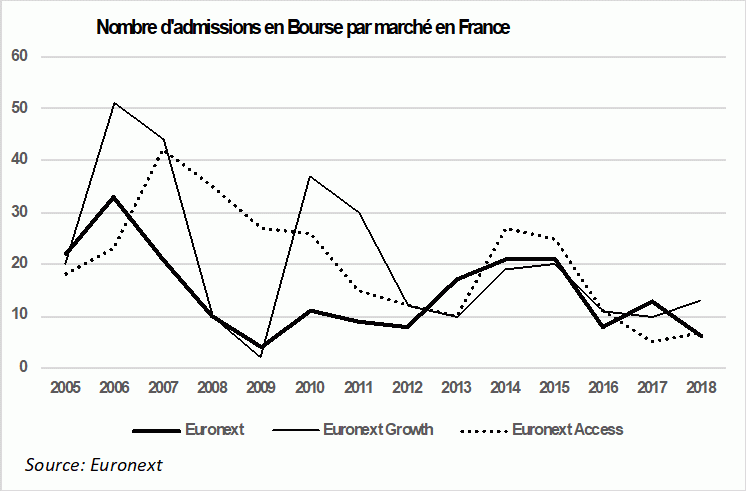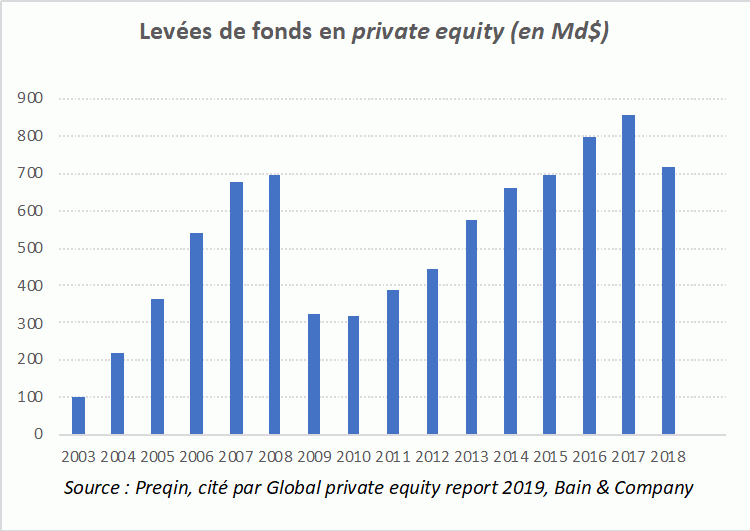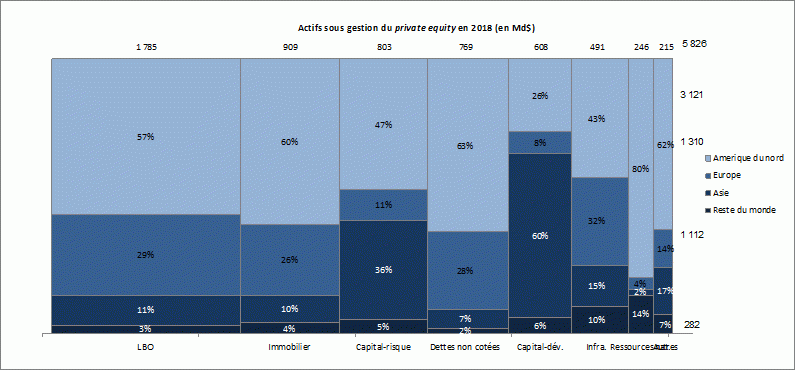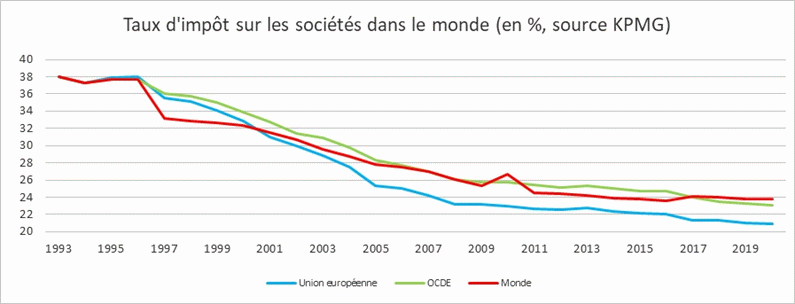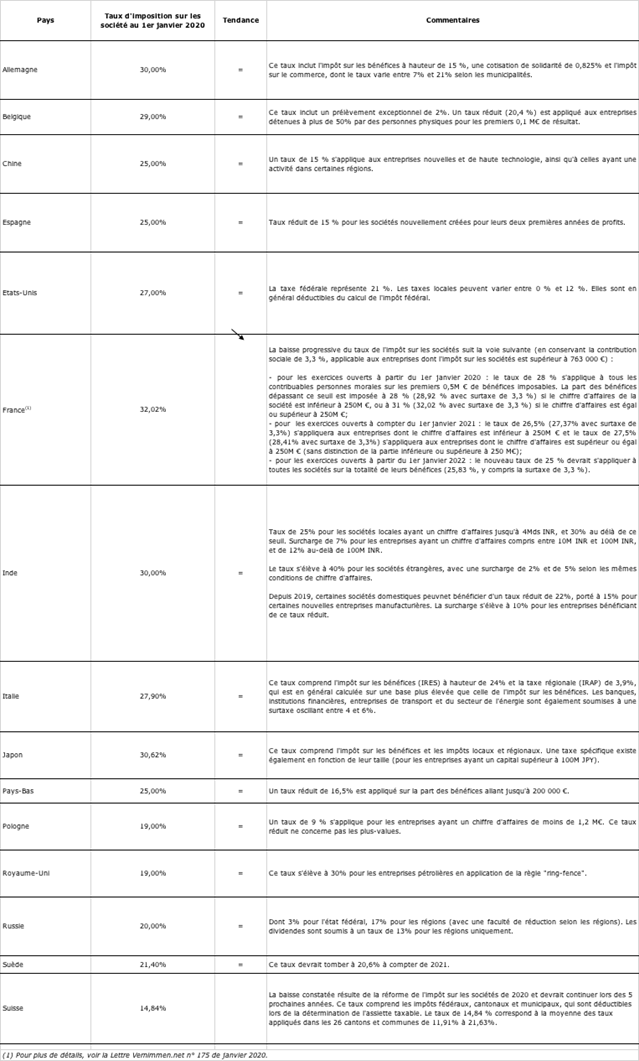La Lettre n°180 de Juin 2020
Actualités : La désaffection pour les marchés boursiers et la montée des investissements non cotés (1/2)
Ce mois-ci et le mois prochain nous reprenons dans La Lettre Vernimmen.net l’introduction du Vernimmen 2020, en espérant que cela vous permettra d’attendre sereinement la sortie du Vernimmen 2021 prévue fin août 2020 !
* * *
2019 a vu l’introduction en Bourse de Uber, Lyft, Pinterest, Slack et devrait voir celle de Palantir, WeWork et Airbnb, toutes anciennes start-up valorisées plus de 10 Md$ (respectivement 82, 24, 13 et 20 Md$), toutes amplement financées pendant des années par des investisseurs du non-coté (private equity).
C’est ainsi que Uber, créée en 2009, a réussi l’exploit de lever près de 21 Md$ (sic), avant sa cotation boursière, auprès de business angels (Babak Nivi, John Thain, etc.), de célébrités (Jay Z), de chefs d’entreprise (Jeff Bezos, Arianna Huffington, etc.), de fonds de capital risque (Benchmark, First Round Capital, Andreessen Horowitz), de riches clients de Goldman Sachs et Morgan Stanley, d’investisseurs institutionnels (Fidelity), de fonds de corporate venture ( Softbank, Tencent, Toyota, Axel Springer, Google), de fonds souverains (Arabie Saoudite), de fonds d’investissement classiques (TPG, General Atlantic), etc. En regard, les actions émises lors de l’introduction en Bourse ne lui ont apporté « que 8 Md$ ».
Mais l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Ces introductions en Bourse d’entreprises emblématiques ne vont pas inverser la baisse du nombre de sociétés cotées aux États-Unis qui a débuté en 1997.
Et cette évolution n’est pas propre aux États-Unis. Au niveau mondial, le nombre de sociétés cotées, après avoir plafonné depuis quelques années, diminue ; en France, c’est depuis une bonne dizaine d’années.
Cette évolution s’explique en France par un nombre décroissant d’introductions en Bourse, tombé à une trentaine par an, tous segments confondus, alors que les sorties de cote sont d’une bonne quarantaine par an.
Ainsi le solde entre les fonds consacrés aux introductions en Bourse et ceux consacrés aux retraits de cote est devenu négatif depuis plusieurs années en Europe et aux États-Unis.
La nature ayant horreur du vide, en même temps que l’attractivité pour les entreprises des marchés boursiers diminue, l’investissement dans le non coté (ou private equity) continue à se développer. Sa définition précise n’est pas claire, et diffère d’une source à une autre. Disons qu’il recoupe tous les investissements faits au travers de fonds d’investissement dans des entreprises non cotées ou qui le redeviennent à cette occasion, ou dans des actifs non cotés (comme l’immobilier ou les ressources naturelles).
Bain & Company[1] estime à 714 Md$ les fonds levés par le private equity en 2018, soit le troisième plus haut historique après ceux de 2017 et 2016, sensiblement supérieur aux records d’avant 2008.
On est bien au-dessus des montants obtenus lors des introductions en Bourse sur les marchés cotés (226 Md$ en 2018[2]). Aux États-Unis, il y a ainsi deux fois plus d’entreprises financées par le private equity (8 000) que d’entreprises cotées. En France, la proportion est de 2,5 (2 200).
Michael Jensen écrivait en 1989 dans un article fameux[3] : « La société cotée a perdu son utilité dans de nombreux secteurs de l’économie. » Arriverions-nous à ce stade d’évolution ? Le non coté va-t-il prendre le pas sur le côté ?
>
* * *
On trace les origines de l’investissement non coté dans sa forme moderne aux États-Unis quand, après la Seconde Guerre mondiale, un professeur de management de Harvard, français d’origine, Georges Doriot, crée dans la région de Boston AR&D, la première société de capital-risque au monde. Avec des fonds apportés en particulier par la compagnie d’assurance John Hancock et le MIT, AR&D finance ainsi DEC[4] dès ses débuts en 1957, qui est un immense succès et devient le second fabricant d’ordinateurs au monde avant son rachat en 1999 par Compaq, lui-même fusionné avec HP en 2002.
Au Royaume-Uni, le non coté prend plutôt la forme d’investissements minoritaires de capital développement afin d’aider des PME ou des ETI à grandir et devenir des groupes. Le non coté, géré par des fonds, se développe plus tardivement en Europe continentale où le capital développement avait été préempté dès le début du xxe siècle par des compagnies financières cotées, dont les plus connues furent Mediobanca, Paribas, Suez, Générale de Belgique, Deutsche Bank, Commerzbank, etc.
Puis dans les années 1980, une mutation génétique se produit au sein de l’investissement non coté avec l’apparition, puis le développement de fonds de LBO majoritaires[5], une première puisque jusqu’ alors le non coté relevait de l’actionnariat minoritaire. Le recentrage des groupes cotés, aiguillonnés par le développement du concept de création de valeur[6], la fin des grands conglomérats (Générale des Eaux, Saint-Gobain, ITT, etc.), les successions d’entreprises familiales créées dans l’immédiat d’après-guerre forment un terreau propice au développement de cette nouvelle forme de private equity.
La longue phase de baisse des taux d’intérêt et d’élévation corrélative des multiples de valorisation (favorisant la performance financière), la remotivation par des plans d’intéressement des managers des divisions acquises (souvent gérées bien lâchement) et l’accent mis sur le cash et la rentabilité expliquent, combinés avec l’effet de levier de la dette, des retours sur investissements très importants qui attirent et fidélisent les investisseurs. Les années passant, le succès des LBO est considérable, au point que pour beaucoup, private equity devient synonyme de fonds de LBO. D’un sas ponctuel entre un actionnariat familial ou une division d’un groupe, et le marché boursier ou un autre groupe, le LBO est devenu un mode de détention à long terme d’entreprises avec le développement des LBO secondaires, tertiaires, etc., comme Picard par exemple.
Le succès aidant, certains des fonds historiques de LBO (KKR, Blackstone, Apollo, Ardian, etc.) élargissent leurs activités aux investissements dans la dette privée, les infrastructures, le capital développement, le capital-risque, à l’immobilier, aux entreprises en difficultés, aux ressources naturelles, aux participations minoritaires dans des entreprises cotées, etc. Si bien que McKinsey estime qu’en 2018[7] le private equity, dans son acception large, gérait 5 800 Md$, en croissance de 12 % sur 2017.
Bien que croissant depuis 2002 deux fois plus vite que la capitalisation boursière mondiale, et ayant multiplié ses encours par plus de 7 depuis, le marché du non coté ne représente encore que 8 % environ de la capitalisation boursière mondiale (74 400 Md$ fin 2018), contre moitié moins en 2000.
Même si cette part peut sembler faible, on ne rencontre plus aujourd’hui un investisseur qui dise se désintéresser du private equity. Au contraire, la plupart veulent accroître la part de leurs actifs consacrée à ce type d’investissement qui est devenu, comme disent les Anglo-Saxons, mainstream.
Au point qu’un certain nombre de grands investisseurs, les fonds souverains[8], les family offices[9] et les fonds de pension, ont développé leurs propres outils et structures d’investissement dans le non coté selon un schéma classique. Ils commencent d’abord par investir dans des fonds de private equity pour en comprendre le fonctionnement. Quelques années après, ils demandent la possibilité de co-investir en parallèle de ces fonds dans certaines de leurs participations, possibilité qui leur est rarement refusée compte tenu des montants qu’ils peuvent apporter. Puis, ils sautent le pas, ayant bien compris le fonctionnement de ce type d’investissement, en débauchant une équipe ou en en constituant une ex-nihilo. C’est ainsi qu’ont procédé les fonds de retraite canadiens (CDPQ, Omers PE, PSP, OntarioTeachers’, etc.).
Autrement dit, les chiffres mentionnés plus haut concernant le non coté sont plutôt conservateurs car ils n’incluent pas nécessairement les investissements de ces intervenants qui ne sont pas astreints à un devoir de transparence.
[1] Global private equity report 2019, 2019.
[2] Voir le paragraphe 46.1 du Vernimmen 2020.
[3] « Eclipse of the public corporation », Harvard Business Review septembre 1989, n° 67, p. 61 à 74.
[4] Digital Equipment Corporation, ou Digital.
[6] Voir le paragraphe 28.2 du Vernimmen 2020.
[7] Private markets come of age, McKinsey Global Private Markets Review, 2019.
[8] Voir le paragraphe 43.13 du Vernimmen 2020.
[9] Voir le paragraphe 43.6 du Vernimmen 2020.
Recherche : Droit des sûretés et accès au crédit
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
En 2006, le Gouvernement français a réformé par ordonnance le droit des sûretés, inscrit depuis 1804 dans le Code civil. Élargissant les possibilités contractuelles en matière de gages et nantissement, la réforme avait pour objectif de faciliter l’accès au crédit et de rapprocher le droit des sûretés français de celui de la plupart des autres pays développés. L’article que nous présentons ce mois[1] propose une analyse empirique détaillée des effets de cette réforme. Selon les résultats présentés, la réforme a permis une démocratisation de l’accès au crédit et une meilleure allocation macro-économique du capital.
Lorsque le Code civil a été établi, le système économique français était centré autour d’activités fondées sur la propriété terrienne. La formulation du droit des sûretés dans le Code civil suivait un double objectif : d’une part, protéger les emprunteurs de prêteurs abusant de leur position, et d’autre part, protéger les prêteurs d’emprunteurs incapables de leur remettre les biens mis en garantie en cas de défaut. Pour parvenir à cet équilibre, le Code précisait que les biens gagés devaient être transférés au prêteur. L’emprunteur ne pouvait donc pas continuer à les contrôler et à les utiliser. L’essentiel de la réforme de 2006 a consisté à supprimer cette limite contractuelle, pour permettre notamment aux entreprises de mettre des actifs physiques en gage sans en perdre le contrôle. Au niveau du financement des entreprises, elle a donné de nouvelles possibilités en élargissant significativement le champ des actifs potentiellement mis en garantie (en particulier les machines et équipements). De plus, la réforme a permis d’utiliser un bien en garantie face à plusieurs emprunteurs (dans le cas des prêts syndiqués).
Pour les chercheurs, cette réforme présente un autre avantage. Si elle élargit les possibilités de mise en garantie pour les immeubles et les biens physiques difficiles à déplacer, elle ne change pas les conditions concernant les actifs liquides, et ne modifie pas non plus l’équilibre des pouvoirs entre débiteur et créancier. Il est donc plus facile d’identifier les effets économiques spécifiques de la mesure introduite.
Le premier résultat porte sur l’évolution de l’endettement des sociétés concernées par la réforme. Après la réforme, le levier financier des entreprises ayant un fort taux d’actifs immobilisés a augmenté de 7 %, et celui des autres entreprises de seulement 1 %. Cette variation est entièrement expliquée par la dette à long terme (celle qui bénéficie des nouvelles possibilités). Aucune variation de dette à court terme n’est observée sur la même période. La réforme semble donc, conformément à ses objectifs, avoir facilité l’accès au crédit des entreprises concernées.
Ce seul résultat ne suffirait cependant pas à démontrer des effets positifs. Il est possible d’imaginer qu’un meilleur accès au crédit puisse créer des effets d’aubaine et encourager un endettement excessif. Les auteurs s’intéressent donc également aux effets sur l’économie réelle. Ils constatent que les entreprises qui ont emprunté davantage ont augmenté les investissements et ont même créé des emplois. Surtout, et contrairement à l’idée d’endettement excessif, la volatilité de leurs résultats a diminué, et même leur taux de faillite ! Il semble donc que les emprunteurs aient réellement bénéficié de ces possibilités accrues.
Par ailleurs, les auteurs montrent que les entreprises qui ont le plus bénéficié de la réforme sont les plus petites et les plus jeunes. À titre d’exemple, les entreprises de moins de 35 salariés (dernier quartile de l’échantillon classé par effectif) ont vu leur levier financier augmenter deux fois plus que celles de plus de 165 salariés (premier quartile), toutes choses égales par ailleurs. Le même effet est visible pour les start-up à fort taux d’actifs immobilisés : leur endettement a augmenté et leur taux de faillite a diminué (alors que l’on n’observe pas de variation pour les autres start-up). Ajoutés au fait que les effets positifs sont particulièrement marqués pour les entreprises situées en-dehors des grandes métropoles, ces résultats font dire aux auteurs que la réforme a permis une démocratisation du crédit. Enfin, au niveau macro-économique, ils mesurent différents indicateurs de qualité de l’allocation du capital à l’intérieur du pays[2], et concluent sur un effet positif pour l’économie française.
La réforme présentée et étudiée dans l’article aurait donc eu de multiples vertus, sans pour autant remettre en cause le principe même du droit civil à la française, décrié dans une partie de la littérature académique sur les liens entre droit et finance. Selon les auteurs, c’est l’exemple même d’une réforme utile, avec un fort impact, et moins difficile à mettre en œuvre qu’une réforme globale du système juridique. Elle avait été portée entre 2005 et 2006 par Pascal Clément, alors ministre de la Justice, disparu tout récemment.
[1] K. Aretz, M. Campello et M. T. Marchica, « Access to collateral and the democratization of credit: France’s reform of the Napoleonic security code », Journal of Finance, vol. 75-1, p. 45 à 90.
[2] Par exemple la sensibilité du taux de croissance des investissements à la croissance de la valeur ajoutée.
Q&R : Comment le droit européen définit-il les entreprises en difficulté ?
La notion d’entreprise en difficulté au regard du droit européen est particulièrement importante car elle limite la capacité des organismes publics à aider financièrement ces entreprises.
Par exemple, pendant la crise du Covid-19, les entreprises en difficulté n’ont pas pu obtenir de prêt garanti par l’État (PGE). Mais c’est aussi le cas en temps normal pour les aides Bpifrance ou ANR.
Une entreprise est considérée en difficulté si elle est en procédure collective (jusqu’ici rien de choquant) et/ou si :
(capital social ou individuel + prime d’émission) / 2 + réserves +/- report à nouveau +/- résultat < 0
C’est-à-dire si le report à nouveau, les réserves et le résultat de l’exercice sont supérieurs à la moitié du capital social et des primes.
Notre lecteur habitué à raisonner en termes de capitaux propres aura constaté que le ratio peut être négatif alors même que les capitaux propres sont positifs.
Ainsi dans l’exemple suivant :
Capital social : 100
Primes d’émission : 300
Réserves : 50
Report à nouveau : - 200
Résultat : - 100
Total des capitaux propres : 150
Ratio : (100 + 300)/2 + 50 - 200 - 100 = - 50
Dans ce cas, l’entreprise pourra, en incorporant les pertes cumulées (report à nouveau et résultat) au capital social ou en les imputant sur les primes, retrouver un ratio positif. Ainsi dans notre exemple :
Capital social : 100
Primes d’émission : 300 – 200 – 100 = 0
Réserves : 50
Report à nouveau : - 200 + 200 = 0
Résultat : - 100 + 100 = 0
Total des capitaux propres : 150
Ratio : (100 + 0)/2 + 50 + 0 + 0 = 100
Nous ne sommes évidemment pas opposés à des règles limitant l’aide des États aux entreprises en difficulté. Mais de grâce, pourquoi chercher midi à quatorze heures en inventant un nouveau ratio pseudo financier, dont la logique ne saute pas aux yeux et nous échappe même pour être honnêtes, et qui dépend largement des choix comptables de l’entreprise ? Ne peut-on pas simplement définir comme en difficulté les entreprises qui ont des capitaux propres négatifs… ?
Autre : Formations
Voici les dates des prochaines formations que nous avons conçues pour Francis Lefebvre Formation, avec des enseignants que nous avons sélectionnés pour l’excellence de leur pédagogie :
- « Ingénierie financière » le 16 octobre 2020, à Paris.
- « Définir la structure de financement adaptée à votre entreprise » le 17 novembre 2020, à Paris.
- « Les mécanismes du LBO et l’environnement du Private Equity » le 22 octobre 2020, à Paris.
- « Gestion de la trésorerie et des risques financiers : quelles priorités en 2020 » le 30 septembre 2020, à Paris.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière.
« Solvabilité, solvabilité (et liquidité), suite et illustration »
L’équipementier automobile Novares, 1,35 Md€ de ventes, 100 M€ d’EBE en 2019, 12 000 salariés dans 23 pays, a annoncé la semaine dernière une opération de recapitalisation à l’issue d’une procédure expresse (un mois !) de redressement judiciaire. Le confinement qui frappait 40 de ses 45 usines lui coûtait 4 M€ par jour, autant dire que sous LBO avec un ratio dette/EBE de 3,3, élevé pour un secteur cyclique comme l’automobile, ses jours étaient comptés, d’autant qu’une reprise par un concurrent ou un fonds était bien compliquée à organiser quand il est impossible de visiter les usines. De facto, aucun n’a déposé d’offre ferme. Les banques ont accepté de convertir 260 des 330 M€ de dettes du holding en capitaux propres leur donnant 25 % du capital, et les actionnaires apportent 30 M€ de nouveaux capitaux propres, résolvant les problèmes de solvabilité du groupe. Les banques, qui avaient refusé d’accorder un PGE en mars dernier (et on peut les comprendre vu l’endettement de Novares), en ont accordé un de 71 M€ et les actionnaires ont consenti un prêt de 45 M€ pour redonner de la liquidité au groupe, au moment où son activité redémarre. On peut se dire qu’obtenir 25 % du capital en contrepartie de l’abandon de 79 % de dettes du holding de LBO, les banques ne semblent pas avoir abusé de la situation, au plus grand profit du fonds Equistone qui garde sa majorité. Comme nous l’expliquions dans le webinar du 19 mai 2020, toujours disponible sur YouTube[2], préparez-vous à en voir beaucoup d’autres, des opérations de sauvetage de groupes à la solvabilité mise en péril.
[1] Que vous pouvez consulter ici pour Facebook, et là pour LinkedIn.