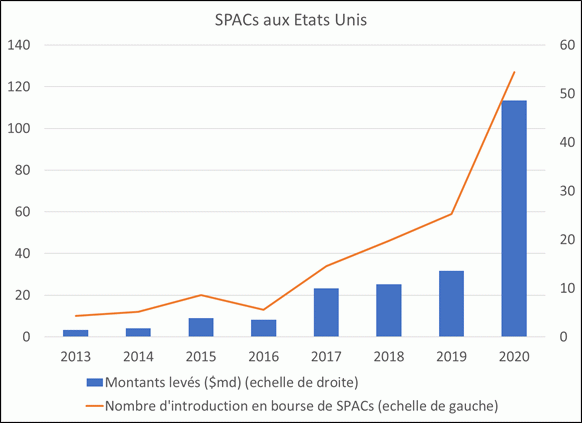La Lettre n°183 de Novembre 2020
Actualités : La percée des obligations durables
L’essor de la finance verte et responsable continue d’être exponentiel. On a pu observer aux mois de septembre et novembre un produit (presque) totalement nouveau se développer : les obligations vertes ou responsables dont la rémunération est indexée sur la performance ESG de leurs émetteurs. On les appelle obligations durables, ou en anglais Sustainability-linked bonds (SLBs).
Nos lecteurs les plus pointus se rappelleront que nous avions déjà vu une opération de ce type dès septembre 2019[1]. L’énergéticien italien Enel avait en effet émis une obligation d’une durée de 5 ans, dont le coupon doit augmenter de 25 points de base (0,25 %) si Enel n’atteint pas, à horizon de 2 ans, une proportion de sa capacité de production à 55 % en électricité renouvelable. Mais cette opération, pourtant saluée par le marché, était restée isolée, laissant penser que le produit n’avait pas trouvé sa place chez les investisseurs, au contraire des émetteurs très demandeurs de pouvoir recourir à ce type d’instrument. Ce type de produit financier, dont la rémunération est (marginalement) indexée sur la performance ESG de l’émetteur, est devenu assez fréquent sur le marché bancaire. Les prêts indexés sur la notation ou des objectifs ESG existent depuis 2016. Pour les grandes entreprises européennes, il est maintenant de bon ton, si ce n’est essentiel, que les renouvellements de RCF (ligne de liquidité) intègrent cette composante (Shell, Pearson, Philips, Danone, Iberdrola, Generali, Gecina, EDF, Edenred, etc.). Cette tendance gagne maintenant l’Asie (Wilmar, Olam), et même les États-Unis (CMS Energy, Avangrid, JetBlue).
Les banques sont-elles plus avancées que les investisseurs obligataires dans leur considérations ESG ? Nous ne le pensons pas. Elles sont en revanche plus proches de leurs clients et sont à même d’accepter plus naturellement les objectifs ESG que l’entreprise s’impose à elle-même.
Le marché obligataire a historiquement choisi une voie différente en demandant une utilisation des fonds levés par l’entreprise (un fléchage) vers des investissements environnementaux (green bonds) ou responsables/durables (sustainable bonds).
Cette pratique a le mérite de la simplicité : les investisseurs sont ainsi sûrs qu’ils finançent des investissements ESG. Mais cette pratique a également ses inconvénients :
- les entreprises dont les investissements sont faibles ne peuvent pas émettre ce type de produit, et ce même si leur politique ESG était volontariste. Le marché était ainsi largement réservé aux services publics, groupes industriels et immobiliers ;
- les investissements verts ou durables de l’émetteur auraient certainement été réalisés qu’ils soient financés par des obligations vertes/durables ou pas. Ainsi, les investisseurs ne contribuent pas nécessairement à une politique plus ESG de l’entreprise ;
- même si la politique générale ESG de l’entreprise était étudiée par les investisseurs dans ces produits (une entreprise peu scrupuleuse en termes d’ESG ne pourrait pas émettre une obligation verte), l’instrument lui-même n’est pas lié à cette politique générale de l’entreprise, mais bien à un (ou plusieurs) projet(s) spécifique(s) ;
- enfin ces obligations demandent un travail supplémentaire aux équipes finance et ESG pour suivre, documenter et reporter les investissements réalisés. Cette surcharge de travail s’ajoute au suivi des objectifs ESG généraux que l’entreprise se fixe et communique au marché. Si l’adhésion à l’origine permet d’embarquer les équipes et d’aligner leurs objectifs, le suivi dans la durée, avec des interlocuteurs qui changent en interne et des nouveaux venus qui ne voient que le surcroît de travail sans avoir eu les honneurs de la communication initiale, est parfois problématique.
Enel, qui avant son obligation de septembre 2019 avait déjà émis trois obligations vertes, avait lancé cette nouvelle obligation avec comme utilisation des fonds le financement des besoins généraux de l’entreprise, comme c’est le cas pour la plupart des emprunts obligataires. Le caractère ESG étant garanti par une sanction financière (un malus sur le taux d’intérêt) à la non-atteinte d’un objectif ESG clair et mesurable.
En septembre et octobre 2020, cinq groupes sont venus sur le marché pour émettre ce même type d’obligations : le groupe de luxe Chanel, le groupe pharmaceutique Novartis, le papetier brésilien Suzano, Enel à nouveau et, tout dernièrement, le producteur et distributeur d’électricité américain NRG Energy. Cela apparaît donc comme une évolution effective du marché (et non une tentative isolée comme avait pu l’être la première émission d’Enel).
Ces émissions ont le mérite d’aligner les produits financiers avec la stratégie globale de l’entreprise en matière ESG. En effet, les critères d’évolution de la marge sont choisis parmi les objectifs plus globaux que l’entreprise se fixe en matière ESG. La communication de l’entreprise dans ce domaine est donc plus lisible pour les investisseurs. Le critère est simple : ne refléter qu’une partie de la politique ESG de l’entreprise (les émissions de CO2 et la part de renouvelable pour Enel, les émissions de CO2 pour Suzano, la proportion de patients à faibles revenus pour certaines thérapies pour Novartis, les émissions de gaz à effet de serre et l’utilisation d’électricité produite à partir de renouvelable pour Chanel, les émissions de gaz à effet de serre pour NRG). Les objectifs qualitatifs ou plus complexes à mesurer ne peuvent pas être capturés, mais qu’importe.
Les objectifs proposés aux investisseurs obligataires peuvent également être alignés avec ceux proposés aux banques pour les prêts verts ou durables que l’entreprise met en place.
La diversité des secteurs est encourageante. Cela démontre en effet que ce type de produit s’adresse à toutes les entreprises et non uniquement à celles qui ont des investissements importants à réaliser. Ainsi, si Enel et Suzano avaient émis des obligations vertes par le passé, ni Chanel, ni Novartis ne l’avaient fait. On peut noter la diversité géographique des émetteurs (Italie, France, Brésil, Suisse et, tout dernièrement, les États-Unis). Enfin, on peut noter également la diversité des notations : AA-/A1 pour Novartis, BBB+/Baa2 pour Enel, BBB-/Ba1 pour Suzano, BB+/Ba1 pour NRG, Chanel étant non coté, toute la palette (hors pur high yield) !
Certains esprits chagrins pourraient regretter que l’ajustement de la marge des obligations ne soit que dans un sens : à la hausse en cas de non-atteinte des objectifs ESG fixés (ce qui est le cas pour les prêts bancaires indexés sur la performance ESG). Facialement, ce serait donc toujours l’entreprise qui perdrait potentiellement. Les investisseurs obligataires seraient-ils demandeurs d’ESG sans vouloir payer ? Ce constat serait une réalité si l’émission était faite au départ à des conditions identiques à une émission classique. Or, on observe qu’à l’émission, l’entreprise bénéficie de conditions avantageuses. En effet, certaines émissions sont réalisées avec une prime d’émission[2] négative, alors que suivant les conditions de marché celles-ci sont généralement comprises entre 5 et 20 points de base.
Remarquons que le marché semble s’éloigner de l’idée d’indexer un produit financier sur une notation ESG (déterminée par une agence spécialisée comme, par exemple, Vigeo Eiris, Sustainalytics). Cette option avait été retenue pour certains prêts bancaires avec label ESG. Il est vrai que ces notations sont souvent des boîtes noires pour les entreprises qui n’ont pas une lecture claire de la méthodologie appliquée par les agences et de son évolution potentielle. Même si ces agences sont respectables et sérieuses, les entreprises préfèrent se lier à des critères qu’elles se sont fixés et sur lesquels elles ont une certaine influence (ce qui ne veut pas dire que les objectifs sont faciles à atteindre bien sûr). On les comprend !
Nous pensons donc qu’il s’agit là d’une évolution majeure du marché, ouvrant les produits ESG à un univers beaucoup plus large qu’il ne l’était jusqu’à présent.
La démarche semble même se diffuser à d’autres produits : Schneider ayant émis cette semaine une obligation convertible durable retenant le même principe d’indexation de la rémunération sur des objectifs ESG.
Longue vie aux obligations durables, alias SLBs !
Tableau : SPAC et search funds
Nous vous parlions déjà en avril 2008[1] des SPAC, ces véhicules cotés en Bourse, sans activité initiale et qui n’ont d’autre raison d’être que de mener à bien une acquisition, permettant ainsi à une entreprise de se faire coter sans passer par la procédure classique et plus lourde aux États-Unis d’introduction en Bourse. Comme nous vous l’indiquions dans la Lettre Vernimmen.net de septembre 2018, cette structure de SPAC a continué de prospérer, principalement aux États-Unis. C’est même une euphorie en 2020 avec plus de 125 nouveaux véhicules disposant d’une puissance de feu de près de 50 Md$, et l’année n’est pas terminée…
Cet engouement reste principalement américain. En France, il n’y a pas eu d’autre exemple à ce jour que Mediawan, même si nous comprenons qu’il y a quelques projets. Le SPAC est donc un véhicule qui s’introduit en Bourse pour y trouver des fonds, sur le fondement de la seule crédibilité de son management susceptible de réaliser une acquisition et de la gérer.
Il existe sensiblement le même concept dans le domaine du private equity, il s’agit du search fund. Une société de gestion identifie un manager de qualité qui cherche à reprendre une entreprise. Le fonds lui donne les moyens et le temps (un à deux ans) de trouver la bonne cible. Le fonds finance alors l’acquisition et le manager investit aux côtés du fonds. Ce type de transaction est mis en œuvre pour les opérations de petite taille (10 à 50 M€) ; elle facilite ainsi la reprise d’entreprise dont l’actionnaire-dirigeant n’a pas de successeur naturel. C’est donc en quelque sorte un SPAC privé… Les search funds existent depuis les années 1980 de l’autre côté de l’Atlantique, et font maintenant leur apparition en France.
Nous avons un ami qui applique ce principe pour faire bourgeonner des start-ups : il identifie des entrepreneurs qu’il estime de talent[2], puis travaille avec eux l’idée du projet dans un deuxième temps. Le concept existe donc bien également dans le capital risque (même s’il est à notre connaissance moins formalisé).
[2] Il prend soin d’avoir une paire d’entrepreneurs, comprenant une femme, pour assurer une diversité des points de vue.
Recherche : L'effet des fonds activistes sur les performances financières et sociales des entreprises
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
L’essor spectaculaire des fonds activistes depuis vingt ans est la source de changements profonds dans la gouvernance des entreprises et les stratégies de création de valeur. Alors qu’ils ne prennent que des participations minoritaires dans le capital de leurs cibles, ces fonds parviennent à imposer des changements de stratégie opérationnelle ou de politique de financement. La recherche académique s’intéresse à l’impact de leurs actions, surtout depuis la publication en 2008 d’un article[1] montrant un effet immédiat très positif de l’entrée au capital d’un activiste sur la valeur de la cible. Plusieurs études ont confirmé cet effet immédiat, mais les fonds activistes ont aussi été accusés d’être court-termistes, ou de créer de la valeur actionnariale au détriment des autres parties prenantes. L’article que nous présentons ce mois[2] propose une analyse empirique incluant performance financière à court et à long termes et performance sociale des entreprises ciblées par les activistes. Les résultats vont dans le sens d’une performance financière à court terme obtenue au détriment du long terme et de la performance sociale.
L’étude empirique se fonde sur un échantillon de plus de 1 000 campagnes activistes sur le marché américain entre 2000 et 2016. Concernant la valeur de marché, les auteurs retiennent comme indicateur le ratio Q de Tobin (rapport de la valeur de marché des actifs sur leur valeur de remplacement, estimée par la valeur nette comptable). Ils constatent une hausse de la valeur de marché de 7,66 % l’année de l’arrivée de l’activiste au capital, ce qui est comparable aux études précédentes sur le sujet. En revanche, ils observent une baisse de 4,92 %, puis 9,71 % les quatrième et cinquième années. Ce résultat s’oppose à celui d’une étude publiée en 2015[3], selon laquelle la hausse de la valeur de marché observée au moment de l’entrée au capital était conservée sur le long terme. L’échantillon de l’étude de 2015 couvrait une autre période (1994 à 2007), et surtout les auteurs utilisaient la performance boursière et non le ratio Q pour mesurer la création de valeur.
Concernant la rentabilité comptable des actifs[4], les auteurs observent une faible hausse les deux premières années, suivie d’une forte baisse entre la deuxième et la cinquième années. Enfin, les flux de trésorerie d’exploitation des entreprises ciblées diminuent dès la première année, et la baisse devient économiquement significative après deux ans. Ces résultats sont spectaculaires car ils ne montrent pas seulement un effet court-termiste de l’intervention des activistes (des gains à court terme corrigés sur le long terme), mais aussi un effet net à long terme négatif. Toutefois, ils ne portent pas directement sur la performance boursière des cibles, et une partie des effets observés peut être liée aux changements de structure (en particulier, les cessions d’actifs) souvent imposés par les activistes.
Sur le même échantillon, les auteurs mesurent une forte réduction des dépenses de la part des entreprises ciblées, confirmant la tendance des fonds activistes à imposer une politique de réduction des coûts. Sur les cinq ans suivant l’arrivée du fonds, le nombre de salariés, les dépenses opérationnelles, les dépenses de recherche et développement et les investissements en immobilisations baissent significative-ment. Globalement, les entreprises ciblées investissent plus que les autres (toutes choses égales par ailleurs) avant l’arrivée du fonds activistes, et moins les années suivantes. La performance sociale et environnementale des cibles[5] est elle aussi en baisse sensible après l’arrivée des fonds.
L’étude empirique est complétée par des discussions qualitatives issues d’interviews de spécialistes, gérants de fonds et dirigeants d’entreprises ciblées. Deux éléments principaux en ressortent. D’abord, la tendance des fonds activistes à actualiser les flux futurs à des taux plus élevés que les autres actionnaires, avec pour conséquence une forte préférence pour les flux rapide. Ensuite, la pression ressentie par les dirigeants des entreprises ciblées peut les inciter à privilégier la performance financière à court terme, au détriment de la performance sociale, voire de la sécurité des salariés.
En proposant, à partir d’un échantillon unique, une analyse complète des effets de l’entrée au capital des fonds activistes sur les cibles, l’article offre une vision critique de l’activisme fondée sur l’existence de contreparties à la performance à court terme obtenue par les fonds. Il nourrit ainsi la littérature académique qui se développe sur ce sujet, avec des résultats parfois contradictoires. Un thème sur lequel nous reviendrons bientôt dans cette chronique.
[1] A. Brav, W. Jiang, F. Partnoy et R. Thomas, « Hedge fund activism, corporate governance, and firm performance », Journal of Finance, vol. 63(4), 2008, p. 1729 à 1775.
[2] M.R. Desjardine et R. Durand, « Disentangling the effects of hedge fund activism on firm financial and social performance », Strategic Management Journal, vol.41(6), 2020, p. 1054 à 1082.
[3] L.A. Bebchuk, A. Brav, W. Jiang, « The long-term effects of hedge fund activism », Columbia Law Review, vol. 115, 2015, p. 1085 à 1155.
[4] Return on assets, ROA.
[5] Mesurée à partir de données de l’institut KLD (Kinder, Lydenberg, Dominici Research &Analytics).
Q&R : Faut-il dans la formule de l'effet de levier, prendre les frais financiers ou les frais financiers nets des produits financiers ?
La formule de l’effet de levier, Rcp =
Re + (Re - i x (1-IS)) x D/CP, repose sur une tautologie comptable, qui est total actif = total passif et qui est assez généralement observée à notre époque, :-)
Dès lors, tous les postes comptables du bilan et du compte de résultat doivent être pris en compte, d’où le raisonnement en dette nette (du disponible et des valeurs mobilières de placement), puisque l’on ne peut pas laisser de côté le disponible et les valeurs mobilières de placement. De la même façon, le coût de l’endettement ne peut pas se limiter aux frais financiers en laissant de côté les produits financiers (même si de nos jours, ils sont le plus souvent nuls voir négatifs du fait du contexte de taux d’intérêt très faibles). Prenons un exemple pour illustrer ceci.
Une entreprise a un actif économique (immobilisations + BFR) de 1 000, financé par des capitaux propres de 500, de l’endettement bancaire et financier brut de 700, et de 500 en net une fois que l’on tient compte de 200 de trésorerie active.
Le résultat d’exploitation est, mettons de 100, et l’impôt sur les sociétés est de 33,3 %. La rentabilité économique de cette entreprise est donc de 6,7 %, i.e. 100 x (1 - 33,3 %) /1 000.
Le taux d'intérêt moyen de la dette est de 5 %, mettons. La trésorerie rapporte avant impôt sur les sociétés du 1 %. Le résultat avant impôt est donc de 100 - 5 % x 700 + 1% x 200 = 67. L’impôt sur les sociétés est donc de 67 x (1- 33, 3 %) = 22,3 et le résultat net est donc de 67 - 22,3 = 44,7. La rentabilité des capitaux propres est donc de 44,7 / 500 = 8,94 %
Quand on injecte la rentabilité des capitaux propres et la rentabilité économique que l’on vient de calculer dans la formule de l’effet de levier rappelée en début de cet article, il convient que le coût de la dette avant impôt sur les sociétés est de 6,6 %.
Ce 6,6 % correspond au résultat financier divisé par l’endettement bancaire et financier net, soit (5 % x 700 - 1 % x 200) / (700 - 200), et pas au taux d’intérêt de la dette brute de 5 %.
C’est donc bien la dette nette et le résultat financier net qui doivent être pris en compte et pas la dette brute et les frais financiers.
Certes, cela fait apparaître un taux d’intérêt plus élevé (ici 6,6 %) que celui que vous facturent vos prêteurs. Mais en cela, ceci ne fait que rendre apparent le coût que vous supportez de maintenir à l’actif, dans une bonne gestion financière qui n’est pas sans coût, des liquidités sans les utiliser à rembourser par anticipation une partie de votre dette, liquidités qui vous rapportent naturellement moins que ne vous coûte la dette brute.
Autre : Formations
Voici les dates des prochaines formations que nous avons conçues pour Francis Lefebvre Formation, avec des enseignants que nous avons sélectionnés pour l’excellence de leur pédagogie :
- « Ingénierie financière » le 8 mars et le 19 octobre 2021, à Paris.
- « Définir la structure de financement adaptée à votre entreprise » le 6 mai et le 19 novembre 2021, à Paris.
- « Les mécanismes du LBO et l’environnement du Private Equity » le 4 mai et le 26 octobre 2021, à Paris.
- « Gestion de la trésorerie et des risques financiers : quelles priorités en 2020 » le 25 mars et le 27 septembre 2021, à Paris.
Autre : Nos lecteurs écrivent : Nouvelles règles de déduction fiscale des charges financières (ATAD 1)
Par Christine Chassaigne Servey
EM Strasbourg, Laboratoire LaRGE
On oppose souvent les deux sources de financement que constituent capitaux propres et endettement. La situation des créanciers apparaît globalement moins risquée et fiscalement plus avantageuse puisque les charges financières réduisent la base imposable. Mais en France, la loi fiscale a considérablement réduit ce « privilège[1] ». À compter de 2019, la transposition de la directive communautaire ATAD 1 bouleverse le régime. Il s’agit d’un texte complexe que l’administration fiscale vient tout juste de commenter[2]. Dans un contexte d'endettement élevé, les responsables financiers doivent en connaître les éléments essentiels. Nous rappellerons donc les objectifs de ce dispositif, clarifierons les étapes de sa mise en œuvre et préciserons les compléments de déduction éventuels attachés aux clauses de sauvegarde.
- LA TRANSPOSITION D’ATAD 1 ENTRAÎNE UNE RÉFORME GLOBALE
- Le nouveau principe directeur : lier le niveau d’endettement net maximum à la capacité bénéficiaire
Le dispositif ATAD 1 prévoit que les charges financières nettes ne sont plus déductibles que dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : 3 M€ et 30 % de l'EBITDA fiscal (plafond général). Les professionnels reconnaîtront ici, des formulations proches de certains « covenants bancaires » imposant que les intérêts financiers nets demeurent en deçà du quart de l’EBITDA[3]. On sait que cet agrégat peut être rapproché du flux de trésorerie dégagé par l'exploitation si l'on exclut l'impôt et les variations du BFR. La logique communautaire est donc de dissuader le recours excessif à la dette, en sanctionnant les entreprises dont les charges financières nettes annuelles dépassent 3 M€ et qui consacrent plus de 30 % du cash dégagé par l'exploitation au règlement desdites charges. On notera toutefois que l’agrégat de référence ne correspond pas strictement à l’EBITDA financier[4] .
- En parallèle, la France sanctionne une répartition déséquilibrée au bilan entre capitaux propres et dette contractée au sein d’un groupe
Lorsque l'endettement BRUT d’une entité française auprès d'entreprises liées excède 1,5 fois les fonds propres[5] le législateur français considère désormais qu’elle est sous capitalisée et le seuil de déduction d’une partie des charges financières nettes est considérablement abaissé (montant le plus élevé entre 1 M€ et 10 % de l’EBITDA fiscal). Ce dispositif sanctionne notamment les schémas d’optimisation au sein des ensembles multinationaux consistant à « surendetter » les entités françaises auprès de filiales étrangères du groupe localisées dans des juridictions moins-disantes fiscalement, pour tirer avantage des différentiels de taux.
- Des mesures tempèrent les effets de la volatilité de l’EBITDA dans le temps
- Report sans limite des charges réintégrées
À défaut de mesures de tempérament, les entreprises seraient sévèrement sanctionnées en cas de mauvaise performance financière : à leurs difficultés de gestion viendrait s’ajouter une base fiscale augmentée (réintégration d’intérêts importante du fait d’un EBITDA faible). C’est pourquoi le dispositif prévoit que les charges financières réintégrées sont reportables en avant, sans limitation dans le temps. Toutefois, les intérêts non déductibles au titre du plafond réduit en situation de sous-capitalisation ne sont reportables que pour un tiers de leur valeur.
- Report sur cinq exercices de la capacité de déduction inutilisée
Les entreprises qui ne sont pas sous-capitalisées et qui dégagent un EBITDA suffisamment élevé au titre d’une année, pour déduire l’ensemble de leurs charges financières nettes, peuvent reporter la quote-part d’EBITDA non utilisée sur leurs cinq exercices suivants et augmenter alors le montant déductible d’intérêts courus au titre desdits exercices. Si lors d’un exercice on dégage un produit financier net, 30 % de l’EBTDA est ainsi reportable sur cinq ans.
- L’entreprise intégrée est un cas particulier
En cas d'appartenance à un groupe d'intégration fiscale (IF), les règles d’ATAD 1 s'appliquent seulement « au niveau d’ensemble ». L’établissement de comptes consolidés aux bornes de l’intégration, c’est-à-dire notamment après annulation des opérations internes au périmètre, mais sans neutralisation des transactions auprès d’entreprises liées hors IF, est alors obligatoire pour mesurer les fonds propres nécessaires au test de sous-capitalisation. Ces comptes n’ont pas à être certifiés. En parallèle, l’entreprise peut devoir déterminer au niveau individuel, l’impact qu’aurait eu ATAD 1 pour estimer sa charge d‘IS théorique et ainsi la participation des salariés.
- Plusieurs dispositifs légaux antérieurs sont abandonnés
La transcription en droit interne d’ATAD 1 entraîne la caducité de plusieurs textes dès le 1er janvier 2019 :
- règles gouvernant l’ancienne sous-capitalisation (réintégration de certains intérêts bruts versés à des entreprises liées ou portant sur des sommes garanties par ces dernières) ;
- dispositif « Carrez » (intérêts bruts liés à l’acquisition de certains titres de participation) ;
- rabot fiscal (au-delà de 3 M€ de charges financières nettes, réintégration de 25 % du total).
« L’Anti-hybride français »[6] est quant à lui supprimé à compter du 1er janvier 2020 (en cas de prêt intragroupe, nécessité pour le débiteur de démontrer une imposition minimale des intérêts chez le créancier).
- UNE MISE EN ŒUVRE RESTANT COMPLEXE POUR LES ENTREPRISES
Les praticiens doivent appliquer les dispositions légales dans l’ordre suivant :
- Dispositifs anti-abus s’appliquant avant ATAD 1
La déduction fiscale des intérêts servis aux associés n'est toujours possible que si le capital social a été entièrement libéré[7].
De plus, la loi limite encore la déductibilité d'intérêts payés aux associés et aux entreprises liées sur la base d’un taux maximal correspondant à la moyenne annuelle des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable[8].
- Application d’ATAD 1
- Test de sous-capitalisation
Lorsque la dette BRUTE à l’égard d’entreprises liées dépasse 1,5 fois les capitaux propres, l’entreprise détermine la proportion que représente ce dépassement considéré « répréhensi-ble » dans la dette brute totale : par exemple 20 %. Elle calcule ensuite les intérêts nets correspondants (20 % des charges financières NETTES), puis leur soustrait un plafond restreint (ici 20 % appliqué au montant le plus élevé entre 1 M€ et 10 % de l’EBITDA fiscal). Si l’écart est positif, il est réintégré à la base IS.
- Limitation générale
On soustrait ensuite du solde des charges nettes (dans notre exemple 80 % d’entre elles) le contre prorata appliqué au plafond général (dans notre exemple 80 % du plus élevé des deux montants suivants : 3 M€ et 30 % de l'EBITDA fiscal). L’écart positif éventuel donne lieu à une seconde réintégration.
En l’absence de sous-capitalisation, c’est l’ensemble des charges financières nettes qui est comparé au plafond général.
- En intégration, maintien de l’amendement Charasse[9]
Ce dispositif remet toujours en cause, au sein d’un groupe d’intégration fiscale, la déductibilité des intérêts correspondant à l’emprunt contracté par une société mère pour acquérir une cible qui devient ensuite membre du périmètre, lorsque les titres correspondants ont été achetés auprès d’une entreprise liée hors intégration (simple reclassement de titres). Il s’applique après ATAD 1.
- DES COMPLÉMENTS DE DÉDUCTION POSSIBLES AU SEIN DES GROUPES
Le texte ATAD 1 prévoit d’atténuer les sanctions lorsque les entités françaises sont moins lourdement grevées en dette que l’ensemble du groupe. Malheureusement la mise en œuvre des clauses de sauvegarde correspondantes est complexe, chronophage et donc coûteuse. Nous invitons le lecteur à se reporter à la version développée de cet article disponible sur le site Vernimmen.net pour plus de précisions (que vous trouverez en cliquant ici).
Conclusion :
Nous saluons, en France, l’abandon de plusieurs dispositions fiscales qui appréciaient l’excès d’endettement à l’aune des seuls emprunts BRUTS ; ATAD 1 introduit un critère qui renvoie désormais à l’endettement NET, ce qui semble beaucoup plus pertinent sur le plan financier. En parallèle, certaines entreprises, autrefois contraintes à des réintégrations sous le régime du rabot fiscal, peuvent désormais déduire l’ensemble de leurs intérêts nets. Reste que la mise en œuvre d’ATAD 1 demeure complexe, notamment dans ses volets « sauvegarde ».
La Commission européenne n’en est pas restée là : par le biais de la directive ATAD 2, elle s’attaque désormais aux produits hybrides et à la double résidence, en tant qu’instruments d’optimisation fiscale au sein des groupes internationaux. La transposition partielle d’ATAD 2[10], dispositif plus technique encore que le premier volet, est intervenue dès 2020, la suite devant être transposée en 2022[11]. Ces nouveaux textes n’ont pas encore été commentés par Bercy.
[1] Cf. les Lettres Vernimmen.net n°116 de juillet 2013 et 133 d’août 2015.
[2] Le 13 mai 2020, BOI-IS-BASE-35-40.
[3] EBE en français.
[4] BOI-IS-BASE-35-40.
[5] Les conventions de cash-pooling et les contrats de location financière intragroupe ne sont pas visés.
[6] CGI, art. 212, I-b.
[7] CGI, art. 39,1-3°.
[8] CGI, art. 39,1-3°, al. 1er et 212, I-a.
[9] CGI, art. 223, B, al. 7.
[10] CGI, art. 205, B, nouveau, visant sept dispositifs hybrides, et 205, D, nouveau, couvrant les asymétries liées à la double résidence.
[11] CGI, art. 205, C, sur les hybrides inversés.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière.
LVMH - Tiffany, tout cela pour cela ?
On se rappelle que LVMH et Tiffany s’étaient mis d’accord en novembre 2019 pour que LVMH acquière Tiffany en payant une prime de 50 % sur le cours de Bourse avant annonce, et que LVMH s’est lancé en septembre dernier dans une bataille juridique aux États-Unis pour obtenir une réduction du prix de 16,2 Md$, en arguant du Covid et en utilisant des mots très durs. Les parties viennent de se mettre d’accord pour que le prix payé soit abaissé de 135 $ à 132,08 $ par action, soit une baisse de 2,2 %. On notera que le prix de 131,50 $, mentionné dans le communiqué de presse, doit être majoré du dividende de 0,58 $ versé par Tiffany à ses actionnaires avant la prise de contrôle, car c’est autant d’argent que LVMH ne trouvera pas dans les caisses de Tiffany.
Deux jours avant, on avait appris que l’américaine Teledyne avait obtenu une réduction de 15 % sur le prix d’acquisition du français Photonis.
Les deux situations sont bien sûr différentes. Ardian, le fonds détenteur de Photonis, avait mis en vente Photonis qu’il détenait depuis 16 ans, alors que les actionnaires de Tiffany n’avaient pas mis en vente leur entreprise quand LVMH est venu spontanément leur proposer une prime finale de 50 %.
On ne pourra cependant pas s’empêcher de penser que le droit américain est beaucoup plus protecteur de l’intérêt des vendeurs que d’autres droits, et que la réputation de LVMH auprès des actionnaires de ses futures cibles est un peu abîmée. Mais c’est le privilège des entités riches que d’avoir du crédit et de pouvoir l’utiliser.
Souhaitons que les actionnaires de Tiffany aient l’élégance de sabrer le champagne (au petit-déjeuner bien sûr) avec du Dom Pérignon ou de la Veuve Clicquot.
Le monde à l’envers ?
Lu dans un quotidien économique : Veolia a placé sur les marchés financiers deux nouvelles obligations perpétuelles hybrides pour un montant de 2 Md€. La première pour 850 M€ a une maturité de 5,5 ans ; la seconde 1,15 Md€ a une maturité de 8 ans ; et le journaliste de poursuivre avec un paragraphe intitulé : « Dette comptabilisée en fonds propres ».
Ainsi, la fin du monde est dans 8 ans puisque ces deux dettes perpétuelles auront alors été remboursées, et ce produit financier, qui est bien une dette comme l’a très bien compris le journaliste, fait partie comptablement des capitaux propres !
Il est donc grand temps que l’IFRS réforme sa norme de comptabilisation des dettes hydrides comme il en a le projet pour faire cesser ces aberrations. Il est quand même triste d’avoir à rappeler qu’une dette perpétuelle n’a pas d'échéance et qu’une dette se comptabilise en dette et non en capitaux propres ! À moins de le prendre avec un sourire, ce que nous vous souhaitons !
P.S. : Pour ceux qui auraient oublié, une obligation hybride est une obligation en théorie perpétuelle, mais avec la faculté pour l’émetteur de rembourser «par anticipation» à une date donnée, ici dans 5,5 ans et 8 ans. À défaut, le coupon payé est fortement augmenté, ce qui constitue une incitation particulièrement forte pour que l'émetteur exerce « volontairement » son option de remboursement anticipé. En normes IFRS, le classement en capitaux propres peut être obtenu si une clause de suspension du paiement des intérêts est prévue. Plus de détails au chapitre 26 du Vernimmen 2021.
Deux réflexions sur la vente par Engie de sa participation dans Suez
Le 5 octobre, le conseil d’administration de l’énergéticien Engie a donné son accord à la cession de 30 % de Suez à Véolia pour 18 €, contre un cours de 10,30 € fin juillet avant que Engie ne se déclare vendeur de sa participation de 32 %. L’État, actionnaire à 24 % d’Engie, a fait savoir par communiqué de presse que ses trois représentants au conseil d’Engie ont voté contre cette cession, en raison de l’absence d’un accord amiable entre Véolia et Suez.
À cette occasion, rappelons deux points :
- que les règles de gouvernance font normalement l’obligation aux administrateurs d’agir au sein du conseil d’administration, et si nécessaire de voter, en fonction de l’intérêt de la société dont ils sont administrateurs, et non en fonction de l’intérêt de l’actionnaire qu’ils peuvent représenter. Et on a un peu de mal à comprendre en quoi une offre en cash avec une prime de 80 % sur un cours pré-annonce n’est pas dans l’intérêt social d’Engie, qui ne détient cette participation sans synergie avec le reste de ses activités que pour des raisons historiques. D’autant qu’il n’y avait pas d’autres offres sur la table. Saluons le courage des autres administrateurs d’Engie qui ne se sont pas laissés impressionner par la position de refus des représentants de l’État ; qu’une opération de rapprochement entre deux sociétés n’est qualifiée d’hostile que par les dirigeants de la cible et/ou ses administrateurs, jamais par ses actionnaires, à qui une prime plus ou moins importante est proposée pour acquérir leurs actions. La volonté du ministre de l'Économie d’aboutir à un accord amiable entre Suez et Veolia part sûrement d’un bon sentiment. Mais malheureusement, il ne résiste pas à l’analyse des faits. Des grandes opérations de rapprochement entre groupes français, celles qui ont réussi, qui ont créé de la valeur et des emplois, étaient des opérations hostiles (au moins au départ) : BNP sur Paribas, Sanofi sur Aventis, Total sur Elf, AXA sur UAP. Les grandes opérations amicales : Carrefour et Promodès, France Télécom et Orange, Capgemini et Ernst & Young Conseil, Crédit Agricole et Crédit Lyonnais ont, au contraire, conduit à des synergies négatives, à des pertes de positions et d’emplois, sans parler de destruction de valeur.
La raison en est assez simple, et appelons un chat un chat. Quand, dans la durée, une entreprise performe moins bien (le cours de Suez fin juillet 2020 était 26 % en-dessous de celui de juillet 2010, contre au même niveau pour Veolia), c’est qu'une partie de ses principaux dirigeants sont moins bons. Quand leur entreprise est rachetée à l’issue d'une opération amicale, ils peuvent souvent rester car le management du nouveau groupe résulte d’un marchandage amical entre les dirigeants des deux groupes. Quand l’entreprise sous-performante est rachetée à l’issue d’une opération inamicale, les dirigeants de l’acheteur ont beaucoup moins de raison de garder les moins bons, et cela fait toute la différence.
Hommage à Samuel Paty
Samuel Paty était un enseignant d’histoire, de géographie et d'éducation morale et civique. C’était donc un de nos collègues.
Il a été assassiné par un terroriste islamiste parce qu’il avait enseigné à ses élèves la liberté d’expression, en utilisant comme un exemple, ô combien pertinent, celui des caricatures de Mahomet.
Toute notre sympathie et nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses élèves.
[1] Que vous pouvez consulter ici pour Facebook, et là pour LinkedIn.