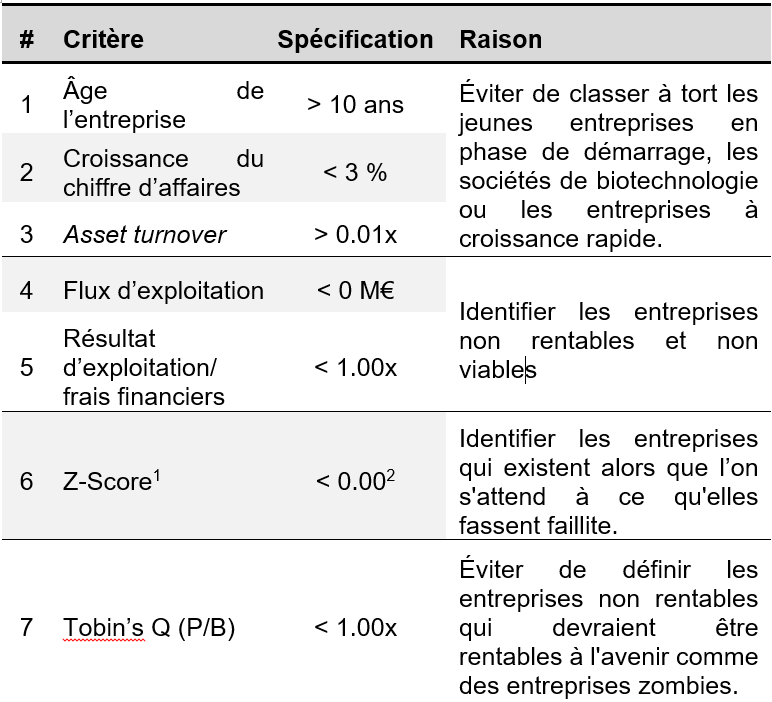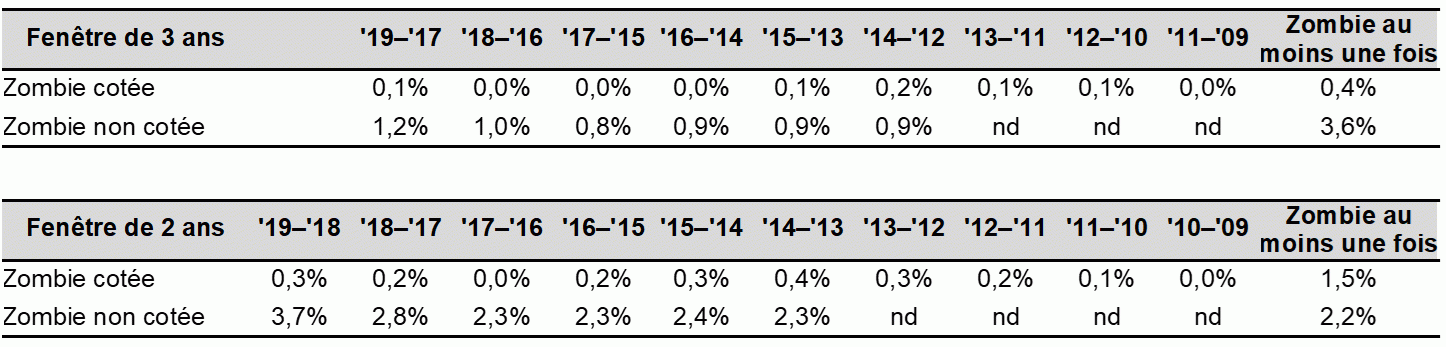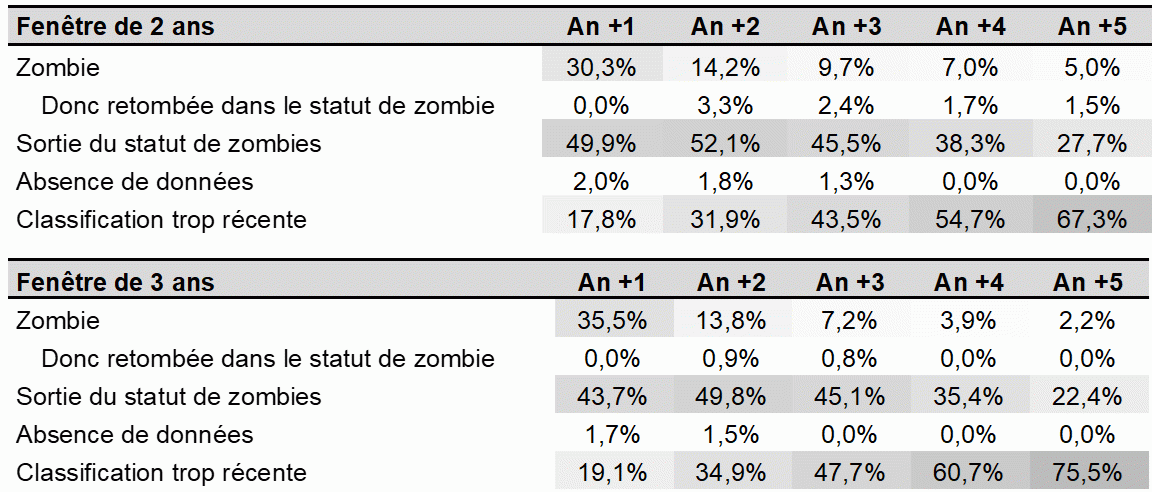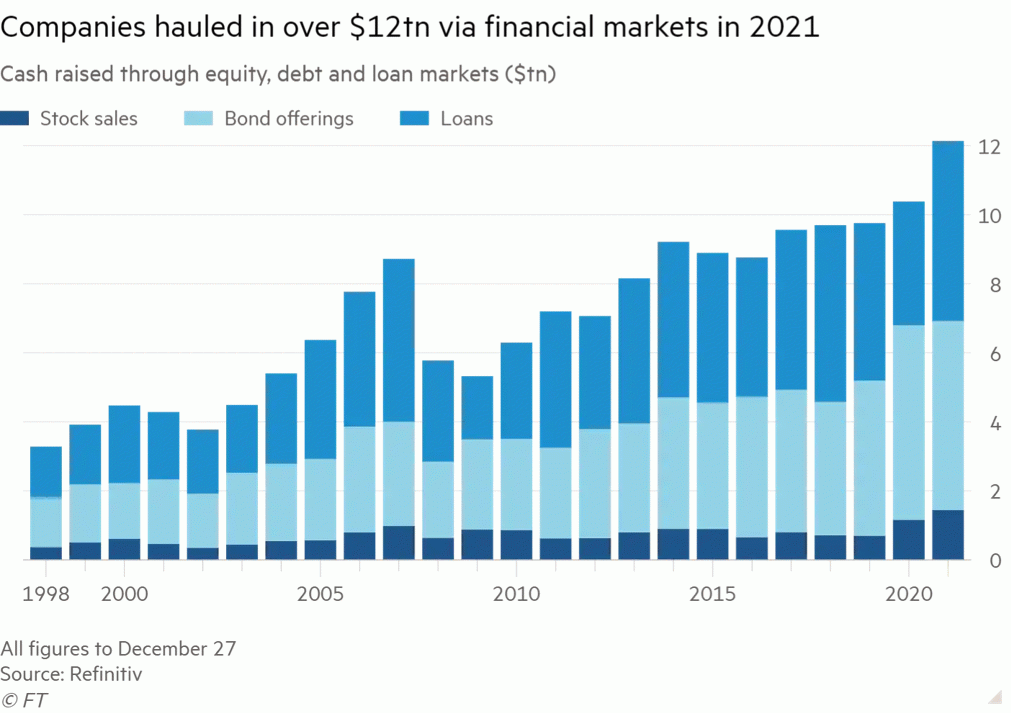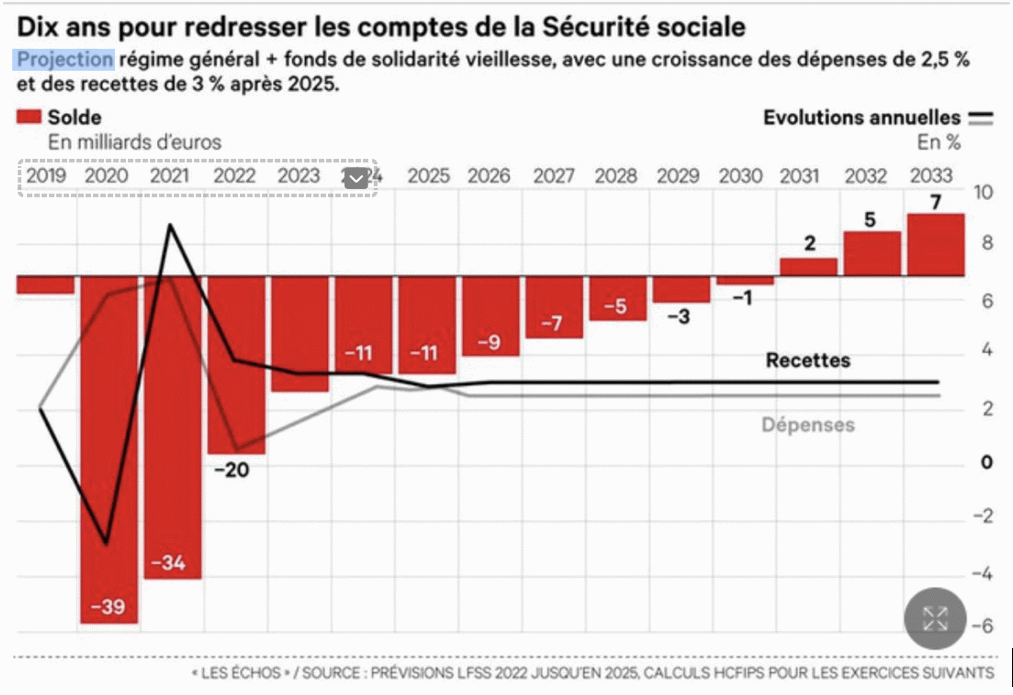La Lettre n°195 de Février 2022
Actualités : Les entreprises zombies existent-elles ?
Par Philippe Oberson et Jonas Pürckhauer
Sur ce sujet, deux de nos étudiants du master de finance à HEC Paris, ont, il y a quelques mois, rédigé leurs mémoires de recherche dont nous présentons une version résumée dans ces colonnes, leur travail complet étant disponible avec d’autres mémoires de qualité sur le site Vernimmen.net, plus précisément au bout de ce lien.
La pandémie de Covid-19 a alimenté le débat sur la zombification des économies de l'OCDE, car la pandémie a poussé les gouvernements à imposer des restrictions sévères à l'activité économique tout en adoptant des mesures de soutien étendues au secteur des entreprises.
Mais le débat sur les entreprises zombies est bien antérieur à l’irruption de la pandémie et trouve ses racines dans la politique de taux d’intérêt très bas des banques centrales européennes pour lutter contre la déflation.
Dans la presse, une entreprise zombie est généralement définie comme une entreprise non rentable qui reste sur le marché au lieu d'en sortir par une faillite ou une prise de contrôle par un tiers. Nous pensons que cette vision n'est pas assez stricte. Une entreprise ne devrait pas être facilement classée comme zombie en raison seulement des inconvénients potentiels qui en découlent, et qu'un grand nombre de caractéristiques différentes définissent une entreprise zombie plutôt qu'une ou deux caractéristiques simples.
Nous définissons les entreprises zombies comme des entreprises matures, présentant un manque de rentabilité persistant et une faible performance future attendue, qui ne se retirent pas du marché alors qu'on s'attend à ce qu'elles le fassent.
De notre définition, nous tirons un ensemble de caractéristiques testables que nous appliquons à notre ensemble de données de 1 162 entreprises cotées et 90 096 entreprises non cotées en France, en Suisse et en Allemagne avec des données financières de 2011 à 2019.
Nous constatons un niveau de zombification presque inexistant dans l'ensemble des entreprises cotées et un niveau de zombification modérément faible dans l'ensemble des entreprises non cotées où nous avons été contraints d’appliquer des critères légèrement moins stricts en raison de l’absence de disponibilité de certaines données. Après avoir recoupé nos résultats avec la littérature dominante en appliquant les définitions de zombie de la littérature et en effectuant une analyse de sensibilité sur nos critères, nous concluons que nos résultats ne sont pas déterminés par la sélection de l'échantillon ou son statut coté/non coté, mais plutôt par les critères de classification des zombies que nous choisissons.
Qu’en pensent les chercheurs ?
La littérature dominante utilise diverses définitions pour identifier les entreprises zombies, allant des conditions de rentabilité (Banerjee & Hofmann) aux crédits subventionnés (Caballero et al.), chaque approche ayant ses avantages et ses inconvénients.
Hoshi décrit les entreprises zombies comme des entreprises insolvables avec peu d'espoir de redressement qui évitent la faillite grâce au soutien de leur banque. Caballero et al. décrivent les entreprises zombies comme des emprunteurs non rentables qui sont maintenus en vie par leurs créanciers. Ces chercheurs analysent si les charges d'intérêts réelles sont inférieures aux charges d'intérêts minimales estimées de l'emprunteur solvable le plus comparable. Ils supposent que les entreprises qui paient moins que leurs charges d'intérêts minimales estimées bénéficient de crédits subventionnés et sont ainsi maintenues en vie artificiellement. Cette approche, qui ignore la productivité et la rentabilité, leur permet d'évaluer l'effet des zombies sur l'économie de manière différenciée. Cependant, elle peut faussement classer les entreprises saines comme des zombies qui méritent des taux d'intérêt inférieurs aux taux préférentiels. En outre, cette mesure peut également ne pas reconnaître que certaines entreprises zombies bénéficient d'un soutien autre qu'une concession d'intérêt ou une remise de dette de la part des prêteurs.
McGowan et al. analysent des données au niveau des entreprises cotées et privées dans 13 pays de l'OCDE entre 2003 et 2013. Ils décrivent les zombies comme des entreprises anciennes qui ont des problèmes persistants pour faire face à leurs paiements d'intérêts. Ils les définissent comme des entreprises qui ont plus de 10 ans et dont le ratio de couverture des intérêts (ICR) est inférieur à 1 pendant 3 années consécutives. L'avantage de la méthode ICR est qu'elle est facilement comparable d'un pays à l'autre et qu'elle est moins endogène à la productivité que les bénéfices négatifs. Toutefois, cette mesure contredit l'idée selon laquelle les entreprises zombies sont maintenues artificiellement en vie par des crédits subventionnés et devraient bénéficier d'une charge d'intérêt plus faible. Le fait de ne prendre en compte que les entreprises plus anciennes (plus de 10 ans) devrait éviter de classer les jeunes start-ups innovantes basées sur des mesures de rentabilité comme des entreprises zombies (McGowan et al.). Cependant, Banerjee & Hofmann critiquent le fait que l'on ne voit pas clairement pourquoi les jeunes entreprises ne pourraient pas être des entreprises zombies également. McGowan et al. expliquent que l'examen de la persistance de la faiblesse financière à travers une fenêtre de 3 ans répond aux préoccupations des effets du cycle économique sur la prévalence des entreprises zombies.
Storz et al. décrivent les entreprises zombies comme des entreprises qui sont maintenues « artificiellement » en vie grâce à des crédits toujours renouvelés. Concrètement, ils définissent une entreprise comme « zombie » si son rendement des actifs (ROA) et ses investissements nets sont négatifs, et si son EBE sur la dette financière totale est inférieur à 5 % pendant au moins deux années consécutives. La combinaison des restrictions sur le ROA et les investissements nets permet de n'identifier comme zombies que les entreprises qui ne sont pas rentables et qui n'investissent pas plus que le montant de leur dotation aux amortissements. En particulier, la contrainte sur les investissements nets permet d'éviter d'identifier les jeunes entreprises en expansion comme des zombies. En utilisant une faible capacité de service de la dette au lieu du ICR comme restriction, ils évitent de classer les entreprises zombies bénéficiant de crédits subventionnés comme des entreprises « saines ».
Banerjee & Hofmann qui ont analysé un ensemble de données de 32 000 entreprises cotées dans 14 pays de l'OCDE entre 1980 et 2017 décrivent les entreprises zombies comme des entreprises non rentables avec une faible valorisation boursière. Ils classent une entreprise zombie comme une entreprise dont le ICR est inférieur à 1 et dont la valeur marchande de l'actif par rapport au coût de remplacement (Q de Tobin) est inférieure à la médiane de son secteur pour une période d'au moins 2 ans. L'ajout du critère du Q de Tobin permet de capturer les attentes des investisseurs quant au potentiel de profit futur de l'entreprise. En d'autres termes, cela évite de classer dans la catégorie des « zombies » les entreprises déficitaires qui devraient être rentables à l'avenir (par exemple, les start-ups).
Acharya et al. décrivent les entreprises zombies comme des entreprises de faible qualité qui bénéficient d'un financement par emprunt à des taux d'intérêt « très bas ». Ils classent une entreprise comme « zombie » si son ICR est inférieur à la médiane, son levier (dette financière totale/actifs totaux) supérieur à la médiane du niveau pays-industrie respectif, et si le coût de la dette est inférieur au coût de la dette payé par les entreprises comparables les plus solvables.
Notre approche
Conscients qu'il n'existe pas de définition parfaite du zombie, nous pensons que la littérature dominante classe les entreprises de manière trop vague en se basant uniquement sur 2 ou 3 paramètres. Une définition trop vague des entreprises zombies dans la littérature a le potentiel de contribuer à un sentiment négatif injustifié sur les prêts aux entreprises, qui pourrait avoir des effets négatifs sur le financement des entreprises.
Dans ce contexte, nous utilisons une définition plus stricte afin de prendre en compte les différentes raisons de la sous-performance des indicateurs individuels. Principalement, nous définissons les entreprises zombies comme des entreprises matures présentant un manque de rentabilité persistant et de faibles bénéfices futurs attendus, qui ne sortent pas de leur marché alors qu'on s'attend à ce qu'elles le fassent.
Le tableau ci-après résume nos critères de classification des entreprises zombies pour les entreprises cotées en bourse. Une entreprise doit remplir tous les critères en même temps pour être classée comme entreprise zombie. Pour éviter de classer à tort des entreprises cycliques ou des entreprises qui n'ont connu qu'une seule mauvaise année comme zombies, ces critères doivent être remplis pendant 2 ou 3 années consécutives.
1 Dans notre analyse, nous avons déterminé le score Z pour chaque entreprise en appliquant le score Z pour les entreprises manufacturières et le score Z-Score pour les entreprises non manufacturières.
2 En 2020, Edward Altman déclare dans une interview pour McKinsey que dans l'environnement actuel de taux d'intérêt bas, un point critique du Z-Score de 0 pour détecter les « entreprises en difficulté » est plus approprié.
Nos critères sont moins stricts pour les entreprises non cotées. En effet, nous n'avons pas eu accès à suffisamment de données pour ces sociétés, nous avons donc réduit ou modifié les critères. Au lieu du critère des flux de trésorerie d'exploitation, nous appliquons un critère de résultat d’exploitation négatif pour identifier les entreprises non rentables et non viables. Comme il n’y a pas de valeur de marché pour ces entreprises, nous renonçons au critère du Q de Tobin. En raison du manque de données suffisantes pour calculer le Z-Score pour les entreprises privées, nous avons également supprimé ce critère.
En appliquant nos critères sur une fenêtre de 3 ans, nous trouvons un niveau de zombification presque inexistant et en appliquant les critères sur une fenêtre de 2 ans, le niveau de zombification augmente
très peu :
En comparant les entreprises zombies aux entreprises non zombies, nous constatons que pour les entreprises cotées, les entreprises zombies sont plus petites, moins rentables et ont un effet de levier plus important. Dans l'échantillon d’entreprises non cotées, nous constatons que les entreprises zombies sont moins rentables (car elles sont contraintes par le critère du résultat d’exploitation). Étonnamment, nous constatons que les entreprises zombies sont en moyenne et en médiane de taille similaire à celle des entreprises non zombies (mesurée par le chiffre d'affaires absolu).
En analysant l'évolution des entreprises zombies dans le temps, nous constatons qu'une entreprise zombie sur cinq (en appliquant une fenêtre de critères de 3 ans) a fait faillite, tandis que les quatre autres entreprises se sont remises de leur statut de zombie ou sont toujours en activité (une entreprise a été classée comme zombie au cours de la période la plus récente et, par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée quant à son état de rétablissement). Pour les 17 entreprises classées comme zombies en appliquant une fenêtre de critères de 2 ans, nous constatons que seule l'entreprise précédemment identifiée a fait faillite, les 16 autres s'étant rétablies ou étant tombées trop récemment dans le statut de zombie.
En raison du plus grand nombre d'entreprises disponibles dans l'ensemble de données des entreprises non cotées, nous pouvons tirer des conclusions plus approfondies sur la sortie du statut de zombie. Nous constatons qu'environ la moitié des entreprises sortent de leur statut de zombie dans les 2 ans qui suivent la fin de leur période initiale de zombie (soit 2 ou 3 ans). Seule une petite partie des entreprises reste entreprise zombie 2 ans après la fin de leur période zombie initiale, avec environ 1 à 3 % de rechutes.
Pour tester ce qui détermine nos résultats, nous supprimons d'abord le critère individuel le plus restrictif et nous constatons que c'est plutôt la combinaison de nos filtres qu'un critère individuel qui détermine nos résultats. Ensuite, nous appliquons les filtres utilisés dans la littérature dominante à notre ensemble d’entreprises cotées pour vérifier si le niveau inexistant de zombification que nous avons trouvé est dû à la sélection de l'échantillon de données. En appliquant ces filtres, nous obtenons des résultats similaires à ceux de la littérature dominante. Nous concluons donc que la sélection de notre filtre détermine nos résultats.
Par conséquent, nous soutenons que les entreprises ne devraient pas être facilement classées comme des entreprises zombies en raison des effets négatifs potentiels que cette publicité négative peut avoir au niveau de l'entreprise individuelle. De plus, l'économie dans son ensemble peut subir les effets négatifs de la propagation d'un sentiment négatif injustifié.
Tableau : Plus de 12 000 Md$ levés par les entreprises en 2021
Ce graphique des émissions de capitaux propres, d’obligations et de crédits bancaires, publié par le Financial Times, met en évidence plusieurs éléments :
D’abord, combien la crise de la pandémie a été différente de celle de 2008, d’origine financière, qui avait disloqué les marchés financiers et entraîné pendant plusieurs semaines (dettes obligataires, voire crédits bancaires) et plusieurs mois (augmentations de capital et introductions en Bourse) l’arrêt des opérations de financement des grandes entreprises. Il n’en a rien été ici avec des volumes d’émission supérieurs de près de 17 % par rapport à 2020 qui lui-même était en progrès de 7 % par rapport à 2019.
Ensuite, la stabilité de la répartition dans les financements par dettes entre ceux assurés par le marché obligataire et ceux accordés par les banques, 51 % - 49 % en 1998 comme en 2021. Cette moyenne mondiale cache d’importantes disparités entre les États-Unis qui sont à seulement 34 % en financements bancaires et la zone euro à 80 %[1].
Enfin à ceux de nos lecteurs qui s’étonneraient du faible poids relatif des levées de capitaux propres par rapport à celles de dettes, nous rappelons que les dettes se remboursent, et ont donc besoin d’être régulièrement renouvelées, ce qui n’est pas le cas des capitaux propres, sauf par rachat et annulation d’actions. Par ailleurs, les entreprises profitables génèrent automatiquement de nouveaux capitaux propres, à hauteur de leurs résultats non versés sous forme de dividendes, alors qu’elles ne génèrent pas automatiquement de nouvelles dettes qu’il faut bien aller chercher auprès des banques ou des marchés obligataires.
[1] Pour plus de détails sur ce point, voir le chapitre 41 du Vernimmen 2022.
Recherche : Dividendes et rachats d'actions aux États-Unis : une forte hausse depuis l'an 2000
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
Le cash distribué aux actionnaires des entreprises cotées a fortement augmenté au tournant des années 2000. Aux États-Unis, en prenant en compte l’inflation, le montant versé annuellement entre 2000 et 2019 (avant la crise sanitaire) est trois fois supérieur au montant observé les 30 années précédentes. Un article récent[1] étudie empiriquement ce phénomène, et montre qu’il provient pour l’essentiel d’une évolution des politiques financières.
À la fin du siècle dernier, l’observation historique des montants distribués montrait une tendance à la baisse, si bien que de célèbres auteurs évoquaient alors la disparition progressive des dividendes[2]. L’an 2000 marque donc un point d’inflexion. Comme le soulignent les auteurs, la distribution de cash aux actionnaires est souvent critiquée dans la classe politique (ils citent des sénateurs américains, mais il en est de même en Europe), qu’il s’agisse de dividendes ou de rachats d’actions. Outre la croyance selon laquelle la distribution serait une rémunération, il est reproché à ces versements de se faire au détriment des investissements. L’étude permet de faire le point sur ces questions et d’explorer les sources de cette nouvelle tendance, même si elle laisse de nombreuses questions ouvertes.
La hausse des montants distribués peut provenir de deux sources : une augmentation des montants distribuables, ou une augmentation des taux de distribution. Le premier résultat de l’étude est que près des deux tiers de la hausse (63 %) proviennent des taux de distribution. Le ratio des versements (dividendes et rachats d’actions inclus) rapporté au résultat d’exploitation est passé de 19,2 % entre 1971 et 1999 à 33,7 % entre 2000 et 2019. Il est à noter que la hausse provient entièrement des rachats d’actions ; si l’on ne prend en compte que les dividendes, le ratio est stable à 14,4 %. Bien entendu, il ne faut pas en conclure que les montants distribués n’auraient pas augmenté en l’absence de rachats d’actions, ces derniers étant largement substituables aux dividendes. En réalité, ces observations recouvrent deux phénomènes : d’une part la hausse des taux de distribution, d’autre part le succès croissant des rachats d’action comme mode de distribution.
Les auteurs s’intéressent ensuite à l’évolution des caractéristiques des entreprises cotées entre les deux périodes. Ils remarquent que, après l’an 2000, les entreprises cotées sont en moyenne plus grosses, plus âgées et plus matures que dans la période précédente. Autrement dit, l’évolution des caractéristiques pourrait expliquer l’augmentation des taux de distribution. Toutefois, en calculant les sensibilités du taux de distribution aux différents facteurs avant l’an 2000 et en les appliquant sur la période suivante, on explique qu’une petite partie de la hausse observée. L’évolution des caractéristiques des entreprises cotées n’explique que 56 % de la hausse des taux de distribution.
Concernant les investissements, les auteurs remarquent une baisse des acquisitions d’immobilisations corporelles après l’an 2000. C’est d’ailleurs cette baisse qui explique en grande partie la hausse des flux de trésorerie disponibles. Toutefois, cette baisse concerne dans la même proportion les entreprises qui distribuent du cash et celles qui n’en distribuent pas. Il est donc vrai que la hausse des montants distribués provient en partie de la baisse des investissements, mais rien ne soutient la causalité inverse (les investissements seraient réduits pour favoriser la distribution). En pratique, après l’an 2000, les entreprises qui ne distribuent pas utilisent le cash notamment dans des dépenses de recherche et développement.
Finalement, cet article est très complet sur le plan descriptif mais laisse de nombreuses questions ouvertes. Il montre que la hausse des taux de distribution ne peut pas s’expliquer seulement par l’évolution des caractéristiques des entreprises cotées. De manière générale, les entreprises versent une part plus importante de leurs flux de trésorerie disponibles. Dans le choix de la méthode de distribution, les rachats d’action rencontrent un succès croissant, si bien que les taux de distribution calculés sur les seuls dividendes sont à peu près stables. Il reste du travail pour expliquer la hausse des taux de distribution (pression croissante des fonds d’investissement ?) et le choix du rachat d’actions (volonté de garder de la souplesse dans la politique de distribution ?).
[1] K. Kahle et R. Stulz (2021), « Why are corporate payouts so high in the 2000s? », Journal of Financial Economics, vol.142-3, pages 1359 à 1380.
[2] E. Fama et K. French (2001), « Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay? », Journal of Financial Economics, vol. 60-1, pages 3 à 43.
Q&R : Dans l'appréciation de la solvabilité d'une entreprise cotée, mieux vaut-il raisonner avec le ratio Dettes bancaires et financières nettes / Capitaux propres avec les capitaux propres pris en montants comptables ou en valeur de marché ?
Disons déjà que dans le sens galvaudé de solvabilité – capacité à rembourser ses dettes dans le cours ordinaire de l’activité – le ratio Dettes nettes/EBE est devenue la norme.
Dans le sens classique du terme solvabilité – capacité à rembourser ses dettes en cas de liquidation – la valeur de marché paraît beaucoup plus pertinente que le montant comptable des capitaux propres, car elle reflète la vision actuelle du marché sur la valeur des actifs et des dettes (dont la différence fait la valeur des capitaux propres) alors que le montant comptable des capitaux propres est établi suivant des règles formelles (pas de prise en compte des plus-values latentes, reconnaissance des moins-values latentes avec retard) et reflète plus un passé qui peut être lointain qu’un présent qui nous préoccupe.
Que la valeur de marché introduise de la volatilité n'est pas en soi un défaut, car une entreprise dont la solvabilité est en doute aura une valeur de ses capitaux propres qui fluctuera structurellement beaucoup, puisque résultant d’une petite différence entre deux grosses masses dont l’une est à peu près fixe (la valeur de la dette). Voir à ce propos notre billet du 30 janvier sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen, reproduit juste après.
Autre : Formations
Voici les dates des prochaines formations que nous avons conçues pour Francis Lefebvre Formation, avec des enseignants que nous avons sélectionnés pour l’excellence de leur pédagogie :
- « Définir la structure de financement adaptée à votre entreprise » le 18 mai et le 18 novembre 2022, à Paris.
- « Les mécanismes du LBO et l’environnement du private equity » le 5 avril et le 5 octobre 2022, à Paris.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière, des réponses à des questions qui nous sont posées ou des citations.
En voici quelques-uns :
Méfiez-vous des petites différences entre des gros montants
C’est la réflexion que nous nous sommes faite en voyant ce graphique des Echos du 20 janvier 2022 :
qui montre que si les recettes dont bénéficie la Sécurité sociale croissent de 3 % l’an, contre seulement 2,5 % par an pour les dépenses, eh bien le déficit de l’an passé de 34 Md€ disparaît en 2031 et permet d’enregistrer un excédent de 7 Md€ en 2033. Comment un si petit écart de 0,5 % peut-il réduire un si grand déficit ?
Cela n’est possible que parce que les recettes 2021 de la Sécurité sociale ont été de 529 Md€ (correspondant au cumul des chiffres d’affaires d'Apple + Microsoft + Google) et des dépenses de 564 Md€, soit des sommes sans commune mesure avec le montant du déficit. Il faut en effet des masses considérables pour que dans la durée, de petits écarts entre deux taux produisent des effets significatifs, dans un sens comme dans l’autre.
En effet, si les dépenses croissaient, contrairement aux prévisions, de 3,5 %, soit un petit 0,5 % de plus que les recettes, et non pas d’un petit moins 0,5 %, le déficit en 2033 serait multiplié par 3, à 98 Md€.
Comme quoi des petites différences sur des très grandes masses peuvent avoir des effets considérables.
Le projet d’introduction de Porsche, ou la schizophrénie des investisseurs
C’est un grand classique quand un groupe se sent durablement sous-évalué de réfléchir à l’introduction en Bourse de sa filiale la plus brillante, qui n’est pas nécessairement la plus importante en volume d’activité. Ainsi Fiat Chrysler Automobiles et Ferrari, ou Vivendi et UMG.
Le 22 février, le groupe Volkswagen a confirmé réfléchir à faire coter 25 % du capital de Porsche AG, qu’il détient actuellement à 100 %, et qui représente 3 % de ses véhicules vendus (0,3 M), 10 à 12 % de son chiffre d’affaires (32 Md€), 33 % de son résultat d’exploitation (5,5 Md€) et 45 % (102 Md€ selon BNP Paribas Exane) environ de la valeur de ses actifs.
À cette annonce, le cours de Volkswagen a grimpé de 4,1 %. Celui de son principal actionnaire (31 % des actions et 53 % de ses droits de vote), qui s’appelle Porsche SE, de 11,3 %. Et le lendemain, le cours de Porsche SE a progressé de 4,6 %, probablement car le schéma prévoit qu’il acquière lors de l’introduction en Bourse de Porsche AG une participation directe de 5 % dans le constructeur automobile, quitte à vendre des actions Volkswagen pour financer cet investissement.
Que les investisseurs, tels de modernes Saint Thomas, aient besoin de voir la cotation en Bourse de Porsche AG pour confirmer sa valeur, est déjà un premier objet de surprise ; surtout que l’on parle de Volkswagen, la seconde capitalisation boursière allemande (110 Md€), qui n’est a priori pas une entreprise en dessous du radar des analystes et des grands investisseurs.
Par ailleurs, en quoi créera-t-on de la valeur pour les actionnaires de Volkswagen, quand on vendra à des tiers des actions de la pépite du groupe, sauf à les vendre à un prix significativement surévalué, ce qui est peu probable dans ce qui sera l’un des plus grands processus d’introduction en Bourse en Europe ?
Imagine-t-on LVMH introduire en Bourse Louis Vuitton ? Et le cours de LVMH bondir de 4 % à cette annonce ?
Enfin une fois Porsche AG coté, la décote du cours de Volkswagen par rapport à la somme de ses actifs sous déduction de ses dettes nettes n’en sera encore que plus flagrante, appelant soit à une scission pure et simple (à l’instar de AXA et Equitable, Atos et Worldline), soit à un rachat des minoritaires de Porsche AG (à l’instar de Orange et Wanadoo par exemple).
La pression en sera d’autant plus forte que l’on aura trois niveaux de cotation pour des actifs peu dissemblables : Porsche SE, Volkswagen, Porsche AG. Ce n’est alors pas une surprise si la recherche académique a montré que la création de valeur dans une scission était réelle quand on allait au bout du processus sans s’arrêter, comme dans ce projet, à une introduction en Bourse partielle. Si la scission de Ferrari a été un tel succès, c’est que justement la scission a été totale et que Ferrari a réussi à se positionner comme une valeur de l'ultra luxe (prix de vente moyen de 0,4 M€ contre 0,1 M€ pour Porsche, volume de production 30 fois inférieur) avec un PER du luxe (40 fois actuellement).
Au cas particulier, la gouvernance peu satisfaisante du groupe Volkswagen – la famille fondatrice détient 15 % des actions, mais 53 % des droits de vote, le conseil de surveillance est de facto contrôlé par une alliance entre les salariés, la famille, l’État de Basse-Saxe – rend cette évolution peu probable.
Bref, trop ou trop peu.