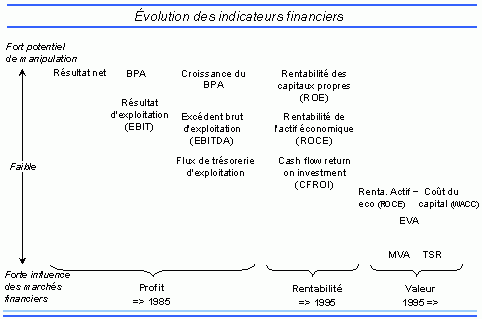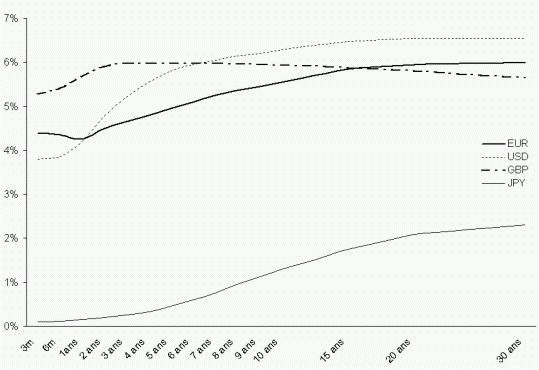La Lettre n°2 de Juillet 2001
Actualités : Communiquer sur la création de valeur
Le foisonnement actuel n'est pas sans avantage : la concurrence est saine et doit normalement permettre au meilleur indicateur d'émerger. Plus prosaïquement, certaines entreprises profitent du flou actuel et de l'absence de normalisation des calculs pour choisir l'indicateur qui sert le mieux leurs intérêts du moment, quitte à en changer l'année suivante...
Le tableau suivant positionne l'apparition chronologique des indicateurs de création de valeur selon un double critère : leur caractère manipulable et l'influence des marchés financiers qu'ils subissent.
Sans surprise, les indicateurs sont regroupés sur une diagonale nord-ouest / sud-est, la capacité de l'entreprise à manipuler ses indicateurs diminuant avec l'expérience des investisseurs et l'influence des marchés financiers étant croissante. La Banque de France estime ainsi qu'environ 55% des financements sont en France d'origine de marché contre moins de 30% en 1978 (*1).
- Les indicateurs de profit : jusqu'au milieu des années 1980, l'entreprise communiquait essentiellement sur le résultat net ou le bénéfice par action (BPA), paramètre éminent de la comptabilité mais aussi éminemment sujet à window dressing : éléments exceptionnels, provisions, ... L'accent progressivement mis sur le résultat d'exploitation ou l'excédent brut d'exploitation représente un progrès en réduisant très fortement l'impact de l'exceptionnel ou des charges calculées.
- Les indicateurs de rentabilité : la seconde étape est le raisonnement en terme de rentabilité, c'est-à-dire d'efficacité, qui rapporte les résultats dégagés aux capitaux mobilisés pour les atteindre. On parle alors de rentabilité des capitaux propres, critère soumis néanmoins à l'effet de levier : une hausse judicieuse de l'endettement accroît le plus souvent cet indicateur sans que la valeur n'en soit pour autant augmentée, l'accroissement du risque annihilant celle de la rentabilité.
- Les indicateurs de création de valeur : cependant la rentabilité dégagée est, en tant que telle, un critère insuffisant en matière de valeur puisqu'elle ne prend pas en compte la notion de risque. Elle reste à comparer au coût des capitaux employés, c’est-à-dire au coût moyen pondéré du capital (ou coût du capital, le WACC des anglo-saxons) pour mesurer si de la valeur a été créée (rentabilité de l'actif économique supérieure au coût des capitaux employés) ou détruite (l'inverse).
La Market Value Added (MVA pour les intimes) et le Total Shareholder Return (TSR) sont eux fortement influencés par la conjoncture boursière. La MVA correspond à l'écart entre la valeur des capitaux propres et de l'endettement net, et leur montant comptable ; elle s'exprime en unités monétaires. Le TSR s'exprime en pourcentage et correspond à l'addition du taux de rendement de l'action (dividende / valeur de l'action) et du taux de plus-value (plus-value sur la période / valeur initiale de l'action). C'est le taux de rentabilité pour l'actionnaire qui achète son action en début de période et la revend en fin de période.
Dès lors, et c'est là leur principale faiblesse, ces deux indicateurs peuvent faire apparaître une destruction de valeur (qui résulte de la baisse des anticipations de profits futurs) alors même que l'entreprise a dégagé sur son actif économique une rentabilité supérieure au coût du capital. Ainsi Carrefour dont le cours de bourse a baissé de 25% sur les douze derniers mois alors que la rentabilité de son actif économique a été de 9% en 2000 pour un coût du capital de l'ordre de 7%. A l'inverse, en cas d'euphorie boursière, une société aux performances économiques médiocres peut afficher des TSR et une MVA flatteurs. Certes, sur longue période, les hauts et les bas sont lissés et une société aux performances modestes aura un TSR et une MVA en rapport ; mais dans l'intervalle il peut y avoir des écarts considérables.
C'est d'ailleurs cette considération qui a conduit la COB à préconiser l'établissement d'une distinction claire entre indicateurs de performance économique (*2) et indicateurs de création de valeur boursière (TSR et MVA). En effet, les premiers mesurent une performance passée sur un exercice alors que les seconds reflètent beaucoup plus une anticipation de création de valeur dans l'avenir à travers la prise en compte du cours de l'action qui reflète ces anticipations. Ils sont donc plus complémentaires qu'antinomiques.
Pour plus de détails, voir le chapitre 32 de Finance d'entreprise de Pierre Vernimmen - Dalloz 2000 et l'excellent rapport de la COB "Création de valeur actionnariale et communication financière" disponible sur son site www.cob.fr.
2 Recommandation relative à la communication sur la création de valeur actionnariale du 2 avril 2001.
Tableau : Principales courbes de taux dans le monde
Les courbes de taux d'intérêt actuelles sont de forme "normales" (taux long terme supérieurs aux taux court terme), ce qui signifie que les marchés s'attendent à une progression des taux à court terme par rapport à leurs niveaux actuels une fois que la croissance économique aura retrouvé son dynamisme d'il y a peu (*1).
On ne manquera pas de remarquer la faiblesse des taux d'intérêt japonais : l'argent au jour le jour coûte 0,07% (sic !) et l'Etat japonais s'endette à 30 ans à 2,3%. C'est le fruit d'efforts jusqu'à présent vains pour relancer l'activité économique qui reste obérée par le poids de l'endettement.
Recherche : Confrontation de la théorie et de la pratique de la finance d'entreprise
2 Ibidem pages 641 et 642
3 Ibidem page 588
Q&R : Quelles sont les raisons des rachats d'actions
La principale motivation des rachats d’actions est de réallouer des liquidités de secteurs et de groupes à maturité vers de nouveaux secteurs ou vers des entreprises en plein développement. De moins en moins exceptionnels, ils ont un caractère sain : en absence d’opportunités d’investissement à un taux de rentabilité correspondant au taux exigé, les dirigeants restituent les fonds aux actionnaires à charge pour eux de trouver ailleurs des investissements qui satisfassent leurs exigences. On retrouve ainsi la théorie du free cash-flow de M. Jensen : au moins pendant qu’un groupe rachète ses actions, il ne procède pas à une diversification hasardeuse ou à des surinvestissements massifs !
D’autres motivations propres aux actionnaires ou aux dirigeants peuvent exister ou coexister :- la modification des poids relatifs des actionnaires entre ceux qui refusent l’offre de rachat pour des raisons de pouvoir (afin d’augmenter leur part relative dans la société) et ceux qui acceptent que soient rachetées leurs actions à un prix qui peut être supérieur à la valeur. C’est l’exemple récent de Peugeot ;
- l’incitation fiscale, car il est souvent fiscalement moins coûteux pour l'actionnaire de toucher des liquidités sous forme de rachat d'actions que sous forme de dividendes ;
- la signalisation d’une bonne nouvelle : les dirigeants considèrent que le cours de leur société est sous-évalué. Le rachat d'actions pour les annuler contribue à accroître la valeur des actions restantes. Vu l’évolution récente de certains cours de bourse, cette motivation pourrait devenir très forte… ;
- l’effet de levier lié à l’endettement, afin de jouer des avantages fiscaux correspondants. Ceci est peu convaincant car c’est oublier que la dette et les capitaux propres deviennent plus risqués après un rachat d'actions et donc plus coûteux. L’avantage fiscal est souvent illusoire d’autant que l’entreprise perd en flexibilité financière. Si les rachats d’actions permettaient de réduire le coût moyen pondéré du capital, il y aurait belle lurette qu’ils auraient été pratiqués sur une échelle massive !
- la constitution d’une réserve d’actions propres destinées à être ultérieurement remise dans le cadre de plans de stock-options ou pour financer une acquisition payée en actions ;
- la régularisation des cours de bourse pour les sociétés cotées afin d’atténuer des fluctuations erratiques. Mais ce qui est acheté peut être revendu et ces opérations, souvent à doses homéopathiques sont fortement encadrées par les autorités boursières ;
- la lésion des créanciers : le rachat d’actions, réduisant la solvabilité de l’entreprise, augmente donc son risque et diminue la valeur des créances ; mais comme les créanciers peuvent s’opposer à la réduction de capital, cette raison est bien théorique.
Dalloz 2000 et la page 590 pour la théorie du free cash flow de M. Jensen.