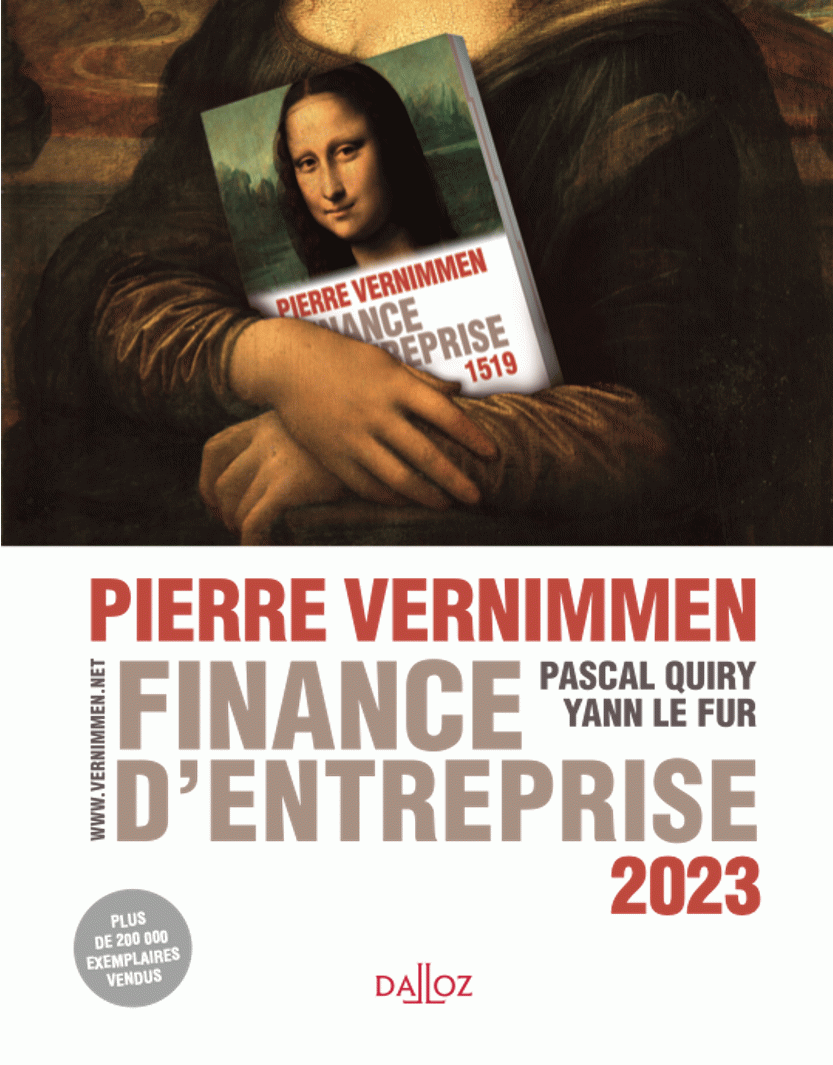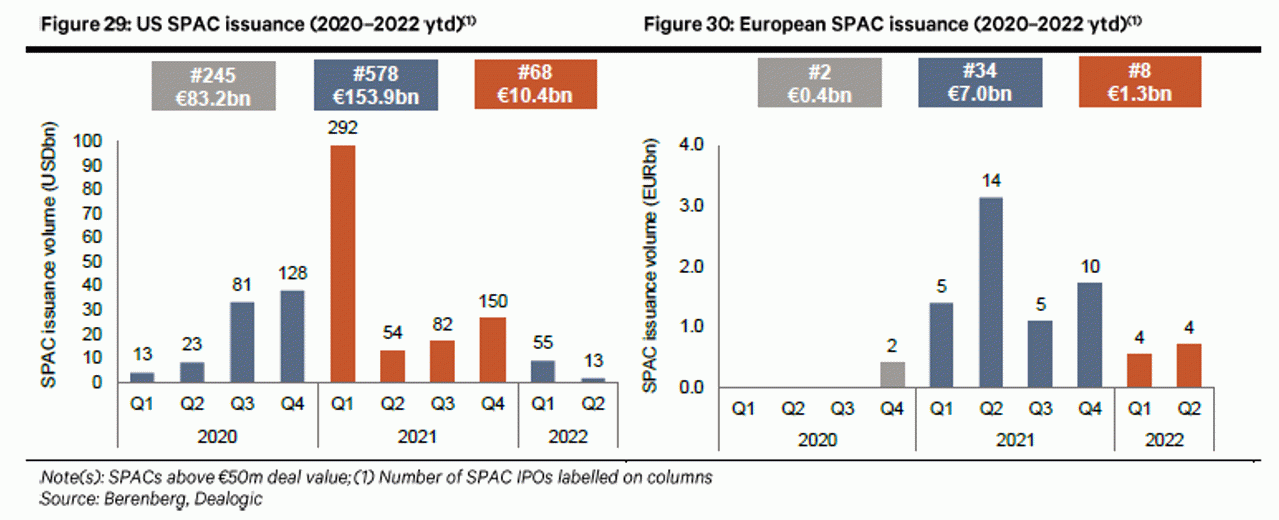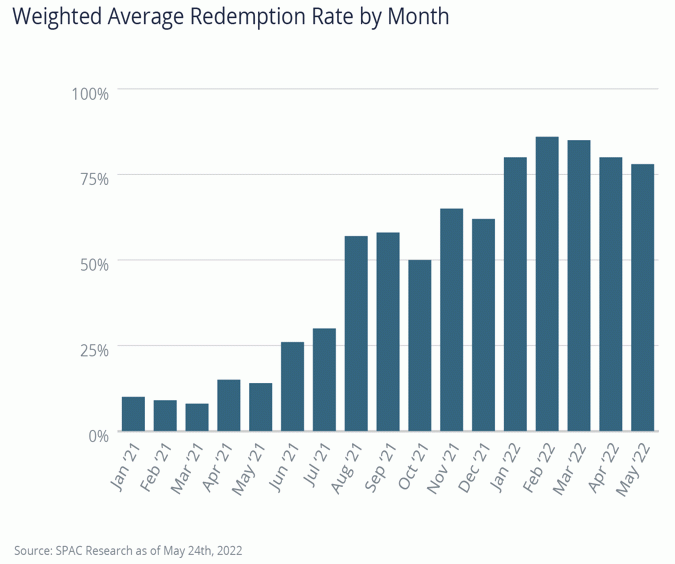La Lettre n°200 de Juillet 2022
Actualités : Des nouvelles de nos amis les SPACs
Alors que la dynamique des SPACs est en perte de vitesse très rapide aux États-Unis :
deux opérations de despacking viennent d’être menées en Europe sur des actifs importants dans le domaine des médias : Banijay/Betclic (sous le nom de FL Entertainment) capitalisant 4,5 Md€ d’une part, et Deezer, capitalisant 550 M€ d’autre part, ont été introduits en Bourse ces dernières semaines par fusion avec un SPAC.
À l’inverse, aux États-Unis, le SPAC le plus important jamais levé (« Tontine » mis en place par Pershing Square qui avait levé 4 Md$) a annoncé rendre les fonds levés aux investisseurs faute d’avoir pu trouver une cible.
Les raisons de l’essoufflement aux États-Unis sont multiples :
- Un marché largement saturé par un nombre incroyable d’opérations en 2020/2021 : plus de 850 SPACs ont été introduits en Bourse mobilisant 240 Md€. La majorité de ces véhicules (plus de 550) sont encore à la recherche de leur cible !
- Des contraintes réglementaires plus fortes et une attention particulière de la SEC sur ce type d’opérations. Les nouvelles règles adoptées en mars par les autorités boursières américaines font porter une responsabilité juridique plus importante aux banques réalisant l’introduction en Bourse du SPAC et alignent les règles d’information des despackings sur les normes jusqu’ici réservées aux « vraies » introductions en Bourse.
- Des banques d’investissement qui se retirent du marché devenu sensiblement plus volatil et avec un risque réputationnel plus fort. Ainsi en mai dernier, Goldman Sachs et Bank of America ont annoncé qu’ils allaient arrêter (sauf exception) de conseiller les SPACs pour leur despacking mais également ne plus participer à l’introduction en Bourse de nouveaux SPACs. C’est un sacrifice limité alors que le marché des fusions-acquisitions s’est grandement calmé et alors que les introductions en Bourse de SPACs ont été divisées par 4 au deuxième trimestre. Après avoir très largement profité des commissions versées par les SPACs, mieux vaut se retirer sur la pointe des pieds alors qu’il va nécessairement y avoir beaucoup de casse dans le marché (notamment un nombre important de SPACs ne trouvant pas à se marier).
Un marché boursier chahuté qui rend les opérations de despacking beaucoup plus aléatoires même quand la cible a été identifiée. Sur le seul mois de juin, une dizaine d’opérations pourtant annoncées au marché ont été annulées à cause des conditions de marché.
La dynamique semble bien plus saine en Europe :
- Beaucoup moins de véhicules sur le marché (moins d’une cinquantaine en tout) ce qui rend les opérations de despacking plus crédibles.
- Des sponsors plus homogènes (pas de stars ou autres sponsors farfelus).
Bien que la structure soit intéressante à bien des égards et a certainement sa place dans la boîte à outils du financier (nous renvoyons notre lecteur à l’échange captivant que nous avons eu avec Emmanuel Hasbanian sur le sujet[1]), les SPACs nous semblent être quelque peu un marché de dupes :
- Les investisseurs qui participent à l’introduction en Bourse du SPAC ne prennent en réalité aucun risque car ils peuvent demander le remboursement de leur action au moment du despacking. Les fonds confiés sont placés sous séquestre pour éviter qu’ils ne soient dépensés par le SPAC dans sa phase de recherche d’une cible. Les investisseurs bénéficient même d’une option gratuite (un warrant généralement exerçable à 11,5 $ ou 11,5 € quand le prix initial de l’action est classiquement de 10 $ ou 10 €). Cette option est conservée par l’investisseur même s’il demande le remboursement de son action. Le marché des introductions en Bourse de SPACs s’est très rapidement orienté vers des hedge funds intéressés uniquement par l’option et n’ayant aucune intention de laisser les fonds lors du despacking. Ainsi les demandes de remboursement atteignent plus de 80 % des fonds levés initialement… Tout ça pour ça !
- Les groupes despackés ne prennent pas le risque d’introduction en Bourse mais ont généralement un flottant faible et donc une liquidité tronquée. En effet, le risque de marché est éliminé et remplacé par une négociation de gré à gré avec le management du SPAC. Une fois l’accord trouvé, il peut être annoncé sans risque (théoriquement) sur la capacité de mener à bien l’opération. Deux bémols à cela : nous avons vu récemment des opérations annoncées ne pas aller jusqu’à leur terme à cause des conditions de marché. Nous comprenons les sociétés industrielles qui rechignent à commencer leur vie boursière dans une conjoncture de marché si chahutée. Par ailleurs, certaines opérations nécessitent de lever des fonds au travers d’un PIPE (Private Investment in Public Entity, c’est-à-dire un placement auprès d’investisseurs institutionnels), ce qui est quasi-impossible pour des montants significatifs lorsque les marchés sont si volatils.
- Les sponsors semblent les grands gagnants des SPACs car ils bénéficient d’actions gratuites représentant généralement 20 % du capital avant despacking. C’est oublier qu’ils ont investi quelques millions au départ pour couvrir les frais du SPAC avant despacking (frais d’introduction en Bourse et de fonctionnement du SPAC dans sa phase de recherche). Ces sommes sont perdues si le SPAC ne trouve pas à se marier. Ce scenario est loin d’être improbable. Par ailleurs, ils doivent parfois faire des concessions (abandonner une partie de leurs actions gratuites) dans la négociation du despacking.
- Le nom SPAC est devenu une duperie. Le A de SPAC tient pour Acquisition, mais c’est une illusion perdue depuis longtemps. Les SPACs n’achètent pas (plus) leur cible (ou en tout cas c’est extrêmement rare), elles fusionnent avec elle. Il est vrai que SPMC (avec un M pour merger) est moins vendeur…
Mais le marché n’est pas moribond : sur 124 introductions en Bourse au premier semestre aux États-Unis, plus de la moitié (73) étaient encore des SPACs. Il est vrai qu’il est plus facile aujourd’hui de vendre un papier sans risque grâce à l’option de revente au nominal au moment du despacking qu’une action d’une valeur technologique ! Et pour des investisseurs qui sont obligés de détenir tout ou partie de leur portefeuille en actions, la poche SPACs de leur portefeuille est un pôle de stabilité dans un contexte boursier baissier et les warrants constituent une option gratuite sur un retournement.
Le marché va indubitablement se normaliser, les volumes délirants de 2020/2021 ne se reverront très certainement jamais. Ce n’est pas pour cela que le produit est mort, car il permet de s’introduire malgré tout en Bourse, même quand le temps boursier n’est pas propice. Si Deezer a chuté de 44 % depuis son introduction en Bourse via un SPAC début juillet, FL Entertainment n’a reculé, quant à lui, que de 5 %.
Tableau : Les PER dans le monde
A défaut de publier tous les PER du monde, voici ceux des principaux marchés, en prospectifs, c’est-à-dire comme le rapport des cours de début juillet 2022 sur l’estimation de BPA courant 2022.
Ce qui donne :
| Nasdaq | 23,5 | États-Unis |
| S&P 500 | 16,3 | États-Unis |
| Nikkei 225 | 11,6 | Japon |
| FTSE China | 11,0 | Chine |
| CAC 40 | 10,9 | France |
| Dax | 9,2 | Allemagne |
| MIB | 7,1 | Italie |
Dans une perspective historique, on note :
- La forte correction depuis les plus hauts de l’été 2020 (certainement une combinaison de résultats faibles anticipés, mais de manière non récurrente, et de marchés redevenus optimistes).
- Les PER américains sont toujours les plus élevés depuis 2012.
-
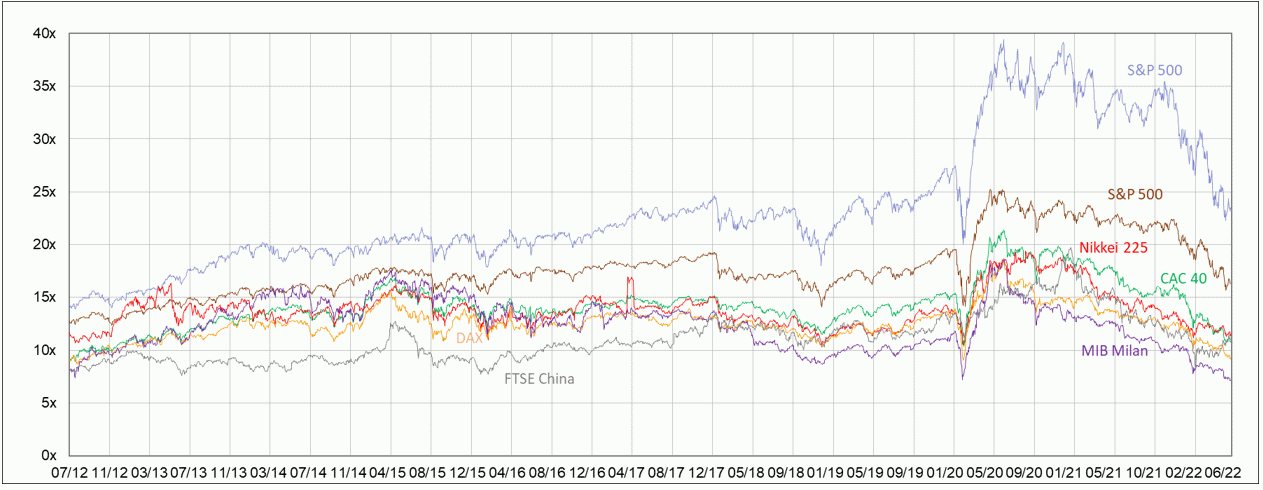
Les autres marchés (même s’ils ont moins corrigé en valeur) sont revenus à des niveaux plus en ligne avec leurs historiques, et en valeur absolue beaucoup plus bas que les US. - La hausse des PER chinois sur le dernier trimestre, décorrélée probablement en raison de la baisse anticipée et temporaire des résultats avec les nouveaux confinements.
- Le déclassement des PER italiens, reflet de celui de son économie, et d’un coût du capital plus élevé dans un monde concurrentiel.
Recherche : Les réévaluations sectorielles lors des acquisitions
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
Les annonces d‘acquisitions dites « horizontales » (dans le même secteur et au même niveau de la chaîne de valeur) constituent des événements porteurs d’information sur la valorisation des entreprises cotées du secteur. Les dirigeants de l’acquéreur ont accès à des informations sur la valeur fondamentale de leur entreprise et donc sur les potentielles surévaluations ou sous-évaluations de marché. Ce contenu informationnel est bien connu théoriquement, mais difficile à mesurer empiriquement. Le problème vient du fait que la réévaluation de la cible (et même de l’acquéreur) au moment de l’annonce a des sources multiples. En plus de la correction de la valeur de marché, les mouvements sont liés notamment aux synergies anticipées et au prix spécifiquement proposé pour l’opération. L’article que nous proposons ce mois[1] échappe à ce problème en étudiant les réévaluations sectorielles lors des acquisitions. Si les dirigeants sont bien informés, alors le choix de privilégier l’acquisition d’entreprises cotées ou non cotées doit entraîner une réévaluation, à la hausse ou à la baisse, des entreprises cotées du même secteur.
L’intuition de l’article est la suivante : considérons le cas d’un acquéreur ayant le choix entre deux cibles équivalentes du point de vue de leur valeur fondamentale et des synergies anticipées, et qui ne diffèrent que par le fait que l’une est cotée et l’autre non. Dans ce cas, le prix de la première est un prix de marché sensible à des fluctuations de diverses origines. Lorsque la cible cotée est sous-évaluée, l’acquéreur la choisit. Si elle est surévaluée, il préfère acquérir la cible non cotée. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, l’acquisition d’une cible cotée envoie au marché un signal de sous-évaluation, qui doit entraîner une réévaluation à la hausse des entreprises du même secteur. À l’inverse, l’acquisition d’une cible non cotée doit plutôt entraîner une baisse des cours des entreprises du secteur. En s’intéressant aux réactions boursières sur les entreprises qui ne sont pas directement impliquées dans l’opération, on mesure une réévaluation liée aux informations des dirigeants sur la valeur fondamentale dans le secteur indépendamment de l’opération elle-même.
Les auteurs appuient leur étude empirique sur un échantillon de près de 8 000 acquisitions horizontales sur le marché américain entre 1990 et 2015. L’échantillon comprend 88 % d’acquisitions non cotées, qui représentent 50 % de l’échantillon en valeur.
Les résultats confirment l’intuition théorique. Après une acquisition d’entreprise cotée, la réévaluation (mesurée par la rentabilité anormale observée lors de l’annonce) est positive, entre 0,02 % et 0,34 % selon les spécifications du test économétrique. Lorsque la cible est non cotée, la réévaluation est négative, d’environ – 0,2 % quelles que soient les spécifications.
Ces montants peuvent sembler faibles au regard de l’effet boursier d’autres annonces sur les marchés, et les études d’événements mettent souvent à jour des mouvements plus spectaculaires. Toutefois, la grande taille de l’échantillon rend ces résultats statistiquement significatifs. Surtout, l’idée de l’article n’est pas tant d’expliquer des mouvements de marché que de prouver l’existence d’un contenu informationnel sur la valeur fondamentale des cibles dans un secteur lors des acquisitions. En ce sens, l’exercice est réussi grâce à une idée originale.
Dans la suite de l’article, les auteurs procèdent à divers tests qui confirment que les résultats obtenus sont attribuables à l’effet testé. Par exemple, ils montrent que les réévaluations sont plus importantes lorsque les analystes ont des prédictions divergentes sur l’évolution future du titre. Surtout, les réévaluations positives sont suivies de hausses des rentabilités sectorielles (et inversement pour les baisses). Cela est cohérent avec l’idée d’une correction progressive des écarts d’évaluation, et surtout avec le fait que ces réévaluations sont financièrement justifiées.
Finalement, l’article confirme empiriquement qu’un marché des acquisitions actif contribue à l’efficience (au sens informationnel du terme) des marchés financiers, comme le fait par exemple un marché secondaire liquide.
[1] F. Derrien, L. Frésard, V. Slabik et P. Valta (2022), « Industry asset revaluations around public and private acquisitions », Journal of Financial Economics, à paraître.
Q&R : « J'achète ce qui existe et ce qui va venir » est-il un bon raisonnement en matière d'évaluation ?
« Un confrère qui intervient auprès de TPE/PME (je travaille dans une petite boutique M&A) applique des multiples d’EBE issus de données de marchés pour obtenir une valeur qu’il appelle de “rentabilité” à laquelle il ajoute le montant comptable des capitaux propres.
Son raisonnement consiste à dire que la valeur de la société se répartit entre ce qui est existant, et qui doit être payé par un acquéreur (représenté par les capitaux propres), et les cashflows futurs que va pouvoir générer l’activité (représentés par les multiples d’EBE). Pour rappel, il intervient auprès de TPE/PME. Je comprends son approche qui est de dire : “J’achète ce qui existe et ce qui va venir” mais en termes de valorisation cela me semble survaloriser les sociétés qu’il accompagne. Auriez-vous des pistes pour clarifier ma pensée ? »
Nous ne sommes pas surpris que vous trouviez que cela donne des valeurs élevées, car on compte deux fois la même chose ! En effet, une entreprise ne produit pas de l'EBE à partir de rien. Elle le fait à partir d'actifs et de passifs exigibles qui sont repris dans les capitaux propres comptables (différence entre les actifs et les passifs exigibles). Donc ajouter les capitaux propres (différence entre les actifs et les passifs exigibles) à une valeur issue d’un multiple de l'EBE qui, pour être dégagé, suppose de bénéficier de ces actifs et de ses passifs est dans le double comptage.
Il oublie donc dans son approche "j'achète ce qui existe et ce qui est a à venir" que la valeur des actifs et des passifs exigibles actuels ne vaut que pour leur capacité à générer de l'EBE dans le futur, valeur qui est déjà prise en compte dans la valeur issue d’un multiple de l’EBE.
Autre : Nos lecteurs écrivent : Pour une comptabilité carbone universelle
Par François Meunier
Face au défi climatique, beaucoup d’entreprises se mobilisent pour mettre en place la comptabilité carbone de leur activité, entendue comme le décompte physique du carbone que leur production occasionne (leur trace carbone). Des normes ou taxonomies se mettent progressivement en place. La réglementation évolue. La France, par un décret paru le 1er juillet 2022, recommande désormais l’établissement et la publication d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre, associé à un plan de transition, ceci à un niveau consolidé.
Or, s’il est à peu près facile pour une entreprise d’estimer ses émissions directes de carbone, par exemple à partir des énergies fossiles utilisées pour le chauffage de ses locaux, il est plus complexe de le faire pour les émissions indirectes, à savoir l’énergie utilisée dans la production ou plus encore le carbone qui a été consommé pour la production des biens et services qu’elle utilise comme intrants. Il faut recourir à des cabinets experts qui ont des méthodologies différentes, avec des normes complexes et non harmonisées. Il y a duplication du travail entre différentes entreprises, quand bien même elles utiliseraient les mêmes produits ou seraient en relation de fournisseur à client. L’auteur a pu observer que les responsables ESG au sein des entreprises, tout à fait à l’aise sur les sujets sociaux ou de gouvernance, considèrent la question carbone comme complexe, coûteuse et requérant une compétence technique dont ils se sentent dépourvus.
Dans cette note, on soumet à discussion une méthode générale, homogène et peu coûteuse à terme, pour mettre en place une telle comptabilité carbone. Son principe est très simple : chaque entreprise inscrit dans ses factures client le contenu carbone du bien ou du service vendu. En pratique, la facture inscrit, à côté de la colonne où figurent les euros, une seconde colonne où l’on reporte les kilos ou tonnes d’équivalent CO2 contenus dans le bien ou le service vendu. Ainsi, par simple cumul de ses factures fournisseurs, l’immense majorité des entreprises, à savoir toutes les entreprises qui ne sont pas productrices primaires d’énergie fossile ou de gaz à effet de serre, est en mesure d’établir son bilan carbone et de le faire connaître à ses clients. Les directions financières sont en charge de ce calcul et ne se reposent sur des audits techniques que pour le calcul des émissions primaires de carbone.
Après un exposé de la logique d’une comptabilité carbone, on décrit de façon plus technique la comptabilité carbone universelle (CCU) en abordant les problèmes comptables et méthodologiques soulevés. Quelques perspectives dans l’utilisation de la méthode sont présentées en conclusion.
Pourquoi une comptabilité carbone ?
Aujourd’hui, deux grands instruments aident à réduire les émissions de CO2 par action sur les comportements des acteurs économiques. Le premier procède par réglementation et quotas, par exemple au travers des normes d’émission de CO2 imposées aux constructeurs automobiles. La seconde utilise le signal des prix en donnant un prix forfaitaire au carbone émis, soit par un mécanisme de taxe ou par fixation d’un quota et sa négociation sur un marché de permis d’émission. Ces deux instruments sont efficaces s’agissant de la sobriété carbone des entreprises.
La comptabilité carbone est le troisième instrument, indispensable, à mettre en place. Il repose non plus sur la motivation économique (la taxe carbone) ou sur l’obéissance à la réglementation, mais sur une motivation non pécuniaire et citoyenne des agents, à savoir la sobriété carbone. Disposant du contenu carbone des biens et services qu’elle achète, l’entreprise pourra, par choix personnel ou par pression de ses investisseurs, salariés ou clients, retenir les méthodes de production économes en carbone. Elle soumettra aux tiers un bilan carbone suivi sur la durée ou comparé à celui d’entreprises du même secteur d’activité. De même, le particulier pourra orienter de façon sobre ses achats de consommation.
Pour ce faire, l’idéal serait que la totalité des biens de l’économie, qu’ils soient biens finals, biens intermédiaires ou biens d’investissement, fassent figurer la quantité physique totale de CO2 émis avant qu’ils arrivent entre les mains des ménages et des entreprises qui les achètent. En clair, le contenu carbone de leur activité.
Par contenu carbone, on entend les émissions directes occasionnées par la production d’un bien ou d’un service (par exemple, pour le service de transport, le carburant consommé par l’entreprise de transport), ce que la norme internationale GHG Protocol appelle le scope 1. On inclut aussi les émissions indirectes (l’énergie fossile qui a été consommée dans les pneus, les pièces de rechange, l’huile ou les camions afin de produire le service de transport), qu’on désigne par scopes 2 et 3. Le contenu direct est relativement facile à apprécier, puisque l’entreprise connaît ses achats de carburants et fait aisément la conversion en carbone. Cependant, le contenu indirect, par exemple celui des pneus achetés, suppose une information externe dont ne dispose pas aujourd’hui l’entreprise. Il en va de même pour le ménage dans ses décisions de consommation : il connaît son budget essence, mais non le contenu CO2 des yaourts ou des biscuits consommés, alors qu’il connaît, il faut le noter, leur contenu en sucre ou en matières grasses.
Disposer des bonnes données
Tout l’enjeu est l’extraction et la diffusion de l’information pertinente sur les contenus carbone. Le carbone qui sera émis par le système productif trouve son origine chez certains « producteurs primaires », essentiellement les compagnies pétrolières (et par importation dans le cas de la France) auxquelles on ajoute des secteurs tels la cimenterie (en raison de la carbonisation du calcaire) ou le secteur de l’élevage, et retrancher les industries qui retirent le carbone d’un cycle de production ou de l’atmosphère.
Carbone contenu dans les factures-fournisseur
+ production nette primaire de carbone
= carbone figurant dans les factures-client.
Pour les consommations indirectes de carbone, les entreprises recourent à des cabinets d’experts qui font une analyse monographique des processus de production et des intrants achetés par l’entreprise. Ils procèdent de façon ascendante.
Facile pour le carburant consommé, le calcul est plus délicat pour des intrants comme les cuves de stockage, les emballages, les ordinateurs, etc. Et si l’expert veut une estimation complète, il doit faire un pas de plus vers les fournisseurs de rang 2 (les tôles qui rentrent dans la fabrication des cuves, etc.), puis les fournisseurs de rang 3, etc. De pas en pas, il remonte les filières de production jusqu’aux fournisseurs primaires de carbone. Sachant l’infinie complexité des flux interentreprises, un calcul précis est impossible par une méthode monographique ascendante. L’expert pallie cette complexité en usant de coefficients techniques forfaitaires, qu’il peut connaître de par ses enquêtes chez d’autres clients, ou par usage de mercuriales qui commencent à circuler (par exemple faites par l’ADEME) mais qui restent encore imprécises et incomplètes. À cette imprécision, s’ajoutent le manque d’harmonisation, la duplication des études, la non-exhaustivité et le coût qu’engendre tout ce processus.
C’est ici qu’intervient la CCU : le fournisseur communique directement à son acheteur la quantité de CO2 contenu dans les biens et services qu’il lui vend. D’où lui-même tire-t-il une telle information ? De ses propres fournisseurs, et ainsi de suite en amont dans les filières de production. Mais ici, la démarche est descendante puisque l’information passe toujours du fournisseur à son client, via le système sécurisé de la facturation.
Le mécanisme de la CCU
Pour tout fournisseur, il a deux cas de figure : soit il ne produit pas lui-même de produits carbonés primaires, et il se contente alors de répercuter dans les factures clients – et ventilées selon la façon dont les biens facturés ont utilisé les intrants – le total des contenus carbone figurant sur les factures qu’il a reçues. Soit il est lui-même pour une part producteur primaire – éventuellement une production négative s’il retire du carbone – et il ajoute (ou retranche) dans ses factures clients le contenu carbone qu’il aura lui-même généré ex nihilo et qu’il lui faudra estimer. Dans tous les cas :
Le fait comptable générateur, pour les flux en euros ou en carbone, c’est la facture, carbone « acheté » ou carbone « vendu ». Pour obtenir le contenu carbone associé à l’activité d’une entreprise, on fait la somme des contenus carbone figurant dans les factures clients, un montant homogène aux ventes ou chiffre d'affaires de l’entreprise[1]. On ne s’écarte donc pas de la comptabilité classique en unités monétaires, ce qui reste un principe général de la CCU ; on ne fait que lui accoler les contenus carbone. Dans le cas d’un intrant incorporé dans deux biens, le contrôleur de gestion aide à faire le partage, selon les principes habituels de la comptabilité analytique. Pour les biens de consommation ne faisant pas l’objet de facture, l’information figure, quand c’est possible, sur l’étiquette ou le dépliant technique associé.
La détermination des contenus carbone
On a vu le principe comptable au niveau d’une entreprise, il faut voir à présent comment s’obtient l’information sur l’ensemble des firmes. Car si l’entreprise connaît ses achats directs en énergie, elle ne connaît pas le contenu carbone de ses autres intrants si le fournisseur lui-même ne les connaît pas.
Dans la version longue de cette note, disponible sur le site Vernimmen[2], on montre d'abord comment, en théorie, on peut pourtant connaître dans l’immédiat le contenu carbone total de chacun des biens et services.
Dans la pratique, on procède par voie itérative. En effet, le carbone ne fait que se diffuser dans l’économie à partir de ses sources primaires, le secteur de l’énergie, du ciment, de l’élevage, etc. Si donc, tout en amont en général, le fournisseur primaire communique à ses clients le contenu en carbone du bien livré, de proche en proche, par des échanges interentreprises répétés, l’information se diffusera. La version longue de cette note montre qu’on aboutit exactement à la solution théorique. Usant d’une image comparant les flux interentreprises à des tuyaux, ces tuyaux s’emplissent progressivement de carbone.
Sachant que l’économie a des flux internes très complexes et souvent circulaires (un bien en bout de chaîne de production peut être l’intrant d’un producteur primaire), la convergence vers les contenus complets en carbone sera, pour beaucoup d’entreprises, assez longue. On préconise d’accélérer la production de la bonne information en incitant les entreprises qui en ont les moyens de compléter provisoirement dans leurs factures client les estimations à dires d’expert du contenu carbone qu’elles ne connaissent pas directement. Par le jeu itératif, les entreprises retiendront progressivement, plutôt que leurs estimations, les contenus déclarés par leurs fournisseurs. Il faut souligner le rôle important des cabinets experts et des bases de données que construisent par exemple l’ADEME ou la Commission européenne dans l’acclimatation rapide de la CCU.
Cette nécessaire montée en régime avant que les contenus carbone soient raisonnablement fiables suppose vraisemblablement une initiative publique pour pousser les entreprises à ce type de comptabilité. Mais toute entreprise peut décider, dès à présent, sans attendre une régulation à venir, de communiquer les contenus carbone qu’elle connaît dans ses factures. Déjà des banques, à des fins marketing, communiquent à leurs clients le coût carbone de l’utilisation de leur carte de crédit, avec des chiffres probablement assez fantaisistes. Mais la voie est donnée.
En résumé, le principe est d’une simplicité extrême : les entreprises qui ne sont pas productrices primaires de carbone, c’est-à-dire l’immense majorité, ne font que passer en aval une information reçue en amont. Une analogie avec la TVA est utile. La CCU diffère de la TVA puisque cette dernière passe d’une entreprise à l’autre par ajout successif non cumulable, sachant que l’entreprise se fait rembourser la TVA sur ses achats ; mais elle est proche aussi puisque, dans les deux cas, la collecte de l’information – et de l’argent dans le cas de la TVA – se fait de façon décentralisée sans qu’aucun organisme central n’intervienne.
Les problématiques soulevées
Les produits importés posent problème s’ils proviennent de pays n’adoptant pas la CCU. Ici on gardera des coefficients à dire d’expert, mais qui seront progressivement affinés par l’information autogénérée par la CCU. Il en va de même pour les produits non marchands du secteur public.
L’achat de biens d’équipement occasionne d’un coup un fort contenu de carbone des achats et donc des ventes, si on retient la convention que c’est la facture qui détermine le contenu carbone. Pour étaler la « charge », il est commode de procéder par amortissement selon un profit d’amortissement qui calque exactement l’amortissement en euros du bien. À nouveau, la CCU n’est que la duplication de la comptabilité en euros. Le contenu carbone sera en quelque sorte « capitalisé » au bilan comme une dette latente ; son flux d’amortissement passe quant à lui directement en compte de résultat carbone.
Une convention devra être retenue pour les produits de recyclage. Pour les biens de consommation, l’achat neuf éteint le contenu carbone ; pour les biens d’équipement, à hauteur du carbone non encore amorti.
Comme toute comptabilité, la CCU ne regarde que le passé, à savoir le contenu carbone déjà intégré au produit. Elle repousse à plus tard la mesure du carbone qu’entraîne l’usage futur du bien. Dans la terminologie acceptée, elle couvre le scope 3 « amont », mais pas le scope 3 « aval ». En tout état de cause, la CCU génère des informations physiques de qualité pour des analyses de projet d’investissement.
En regard des avantages évidents de la CCU, il faut évoquer le coût logistique de sa mise en place. Elle implique un changement des systèmes d’information qui demandera un certain temps d’implémentation. Il y a ici l’habituel problème de la décision collective : le mécanisme bénéficie à la collectivité confrontée à l’enjeu climat ; il bénéficie aussi à toutes les entreprises en leur épargnant les coûts répétés d’une analyse ponctuelle de leur bilan carbone. Mais, à court terme, le mécanisme impose à l’entreprise des investissements dans ses process avant qu’elle puisse en mesurer l’avantage. La puissance publique doit alors encourager, puis sans doute imposer, cette mise en place via l’obligation d’une facturation à deux colonnes.
Conclusion
Les utilisations aval du système sont nombreuses. Il y a des réflexions intenses chez les analystes financiers et ESG sur la construction de métriques pour mesurer la performance carbone. L’évolution dans le temps du contenu carbone de l’entreprise est l’indicateur de base. Il existe aussi des réflexions intéressantes sur une comptabilité climat de l’entreprise, telle que le propose par exemple le système Care[3]. L’entreprise Danone, qui a été pionnière en ce domaine, va plus loin et impute un prix à l’unité de carbone, de sorte qu’en mesurant un coût financier du carbone, elle est en mesure d’exhiber un résultat opérationnel net de ce coût, c’est-à-dire de ce qu’elle a pris à la nature dans son activité de production. Cela agit comme une sorte de taxe carbone virtuelle. Mais toutes ces initiatives reposent avant tout sur des données de qualité. C’est ce à quoi répond la CCU.
La comptabilité carbone universelle offre un moyen simple d’informer l’ensemble des agents économiques sur les coûts liés à la pollution carbone. La décentralisation du système est un atout important, car les entreprises disposent déjà de toute une infrastructure de comptables et de contrôleurs de gestion, d’auditeurs internes et externes qui aident à répliquer dans de bonnes conditions le travail qu’ils font déjà sur les comptes en euros. L’importance de l’enjeu et la simplicité de la solution méritent un examen attentif de la communauté financière.
[1] Si les contenus carbone s’additionnent entre les différents produits de l’entreprise, donnant le bilan carbone de la période, ils ne s’additionnent pas forcément entre diverses entreprises en raison du risque de générer des doubles comptes. On ne s’écarte pas de la comptabilité en euros qui élimine également les flux internes quand elle procède à des « consolidations ».
[3] Rambaud A., Richard, J., Révolution comptable. Pour une entreprise écologique et sociale, Éditions de l’Atelier, 2020.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière, des réponses à des questions qui nous sont posées ou des citations.
En voici quelques-uns :
EDF, une évolution inéluctable
L’État va donc racheter la part des actionnaires minoritaires au capital d’EDF pour retirer l’énergéticien de la Bourse s’il réussit à atteindre le seuil de 90 % en droit de vote et en actions, partant de 83,8 % aujourd’hui.
Cette évolution paraît inéluctable et souhaitable, tant le grand écart entre l’État actionnaire majoritaire d’EDF et l’État qui veut protéger les citoyens contre une trop forte hausse des prix de l’énergie est devenu insoutenable. Ainsi, celui-ci a ordonné en janvier dernier à EDF de céder 20 TWh provenant de ses centrales nucléaires de plus à ses concurrents à un prix de 46,2 €/MWh, bien en dessous du prix du marché, afin de permettre au consommateur final de ne supporter qu’une hausse de 4 % de sa facture. C’est une baisse de 8 Md€ environ de son EBE qui était ainsi enclenchée (à comparer à 18 Md€ en 2021). Et le cours d’EDF avait chuté de 20 %.
Il nous semble que la logique voudrait que l’offre de rachat des actionnaires minoritaires soit calculée avec un plan d’affaires qui neutralise ce fait du prince contre lequel le management d’EDF a intenté un recours gracieux. Ce sera probablement le cas, puisque le Gouvernement a choisi la voie de l’OPAS suivie d’un retrait obligatoire, et non celle d’une nationalisation, plus protectrice de l’intérêt des actionnaires minoritaires car son succès est conditionné à l’accord de 38 % d’entre eux (6,2/16,2, pour atteindre 90 %). Voici un avis d’équité qui sera observé de près.
Les plus financiers d’entre vous n’auront pas manqué de noter que pour l’État, la cotation boursière n’aura pas été une mauvaise affaire financière, avec une introduction en Bourse à 32 €, puis une cession à 82 € et un rachat probablement aux environs de 10 €.
En attendant, être actionnaire aux côtés d’un État est rarement une situation enviable à cause de sa double casquette de puissance politique et d’actionnaire, conduisant logiquement à des choix qui ne sont pas toujours dans l’intérêt de l’entreprise. D’où des décotes de valeur pour les entreprises cotées à actionnariat étatique dont peuvent témoigner Renault ou Eramet, et que ne semble pas compenser l'élimination du risque de faillite induit par un actionnariat étatique.
Turbulences sur le marché du crédit
La remontée plus forte que prévue des taux d’intérêt, couplée à des craintes de fort ralentissement économique pouvant virer en récession dans les prochains trimestres, a mis à l’arrêt le marché du high yield et est en train de bloquer celui des emprunts crossover (notation comprise entre BBB et BB). En témoigne un coût de la protection contre le risque de défaut de ces emprunts qui atteint, sur l’index iTraxx crossover, 600 bps, soit quasiment autant qu’en avril 2020, mais loin du record de l’hiver 2009 (1123 bps).
Résultat, le marché des LBO de taille significative est au point mort, et certains emprunteurs pour qui le marché obligataire est de facto fermé se retournent vers les banques, pour autant que celles-ci aient de l’appétence à leur prêter et de la place dans leur bilan. Dans ce cas, les marges ne sont pas minces. Sale temps pour les emprunteurs les plus endettés.
Les banques font leurs premières pertes importantes sur des LBO engagés en février et qui ne sortent que maintenant, car les processus M&A sont de plus en plus longs. Les banques préfèrent subir leur perte maintenant pour ne pas se traîner un bilan vérolé dans le futur. C'est plutôt sain.