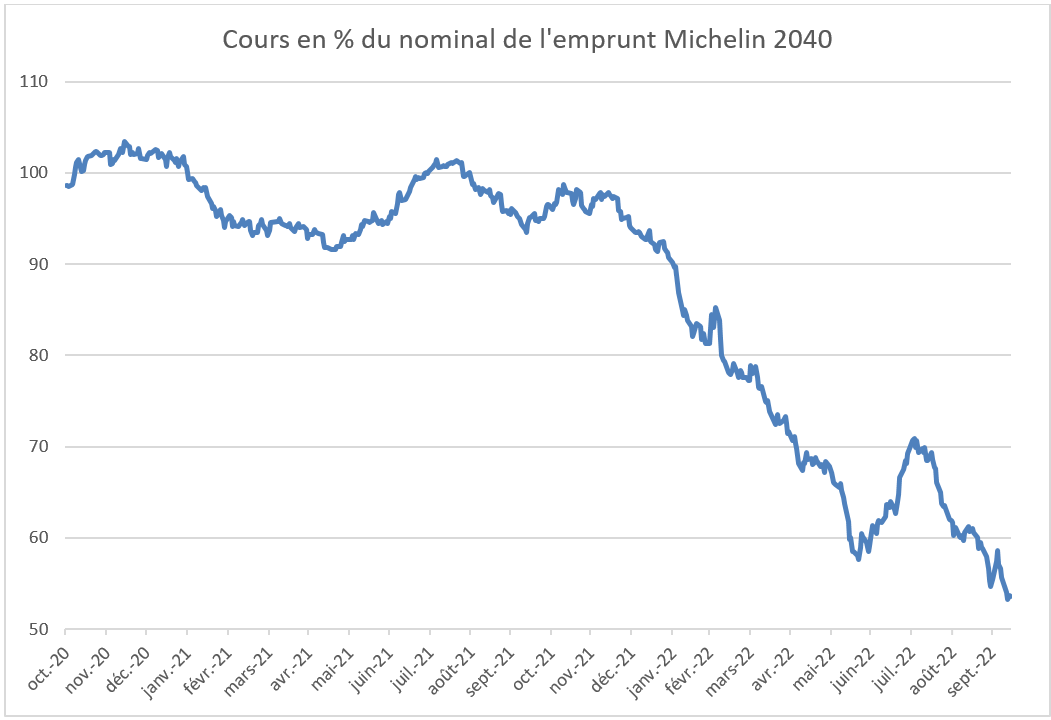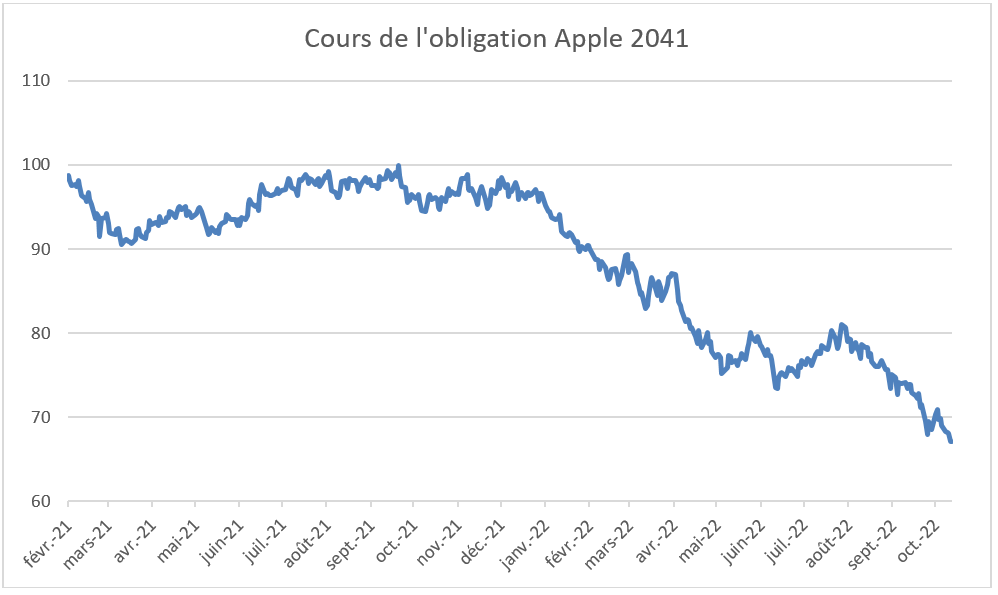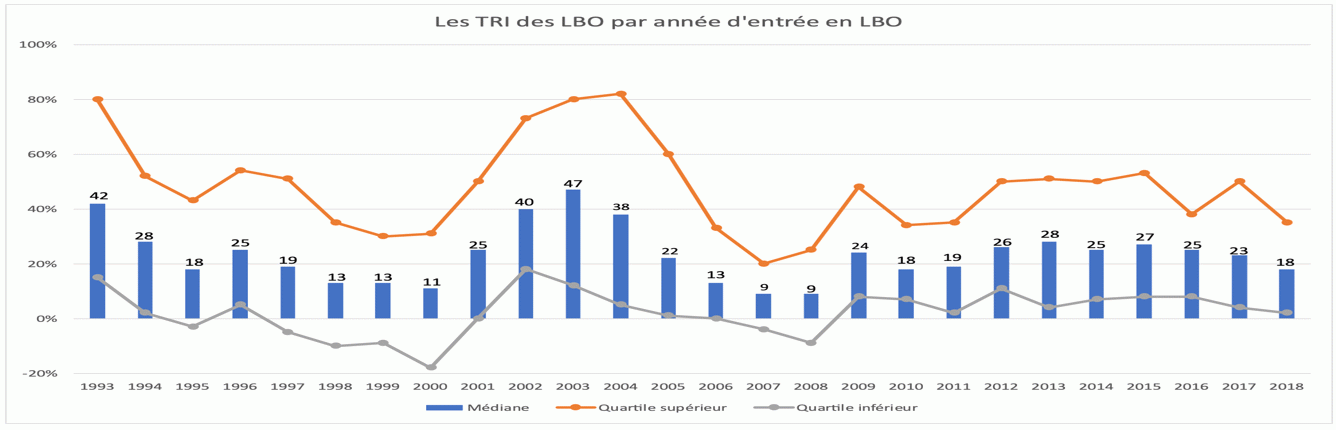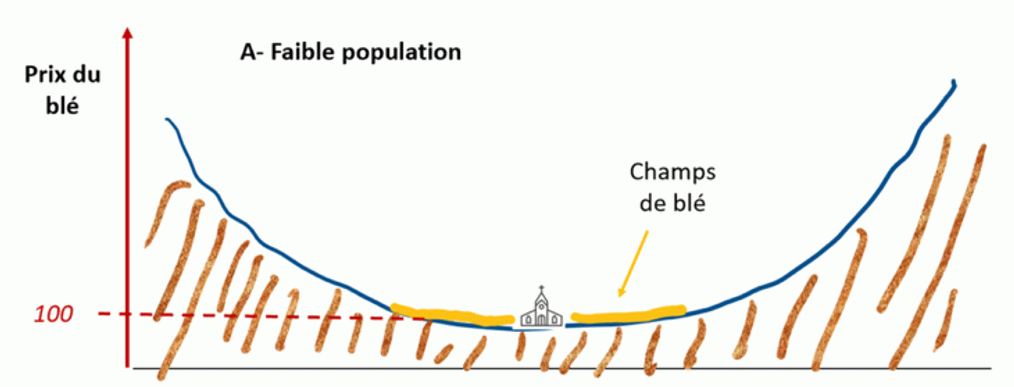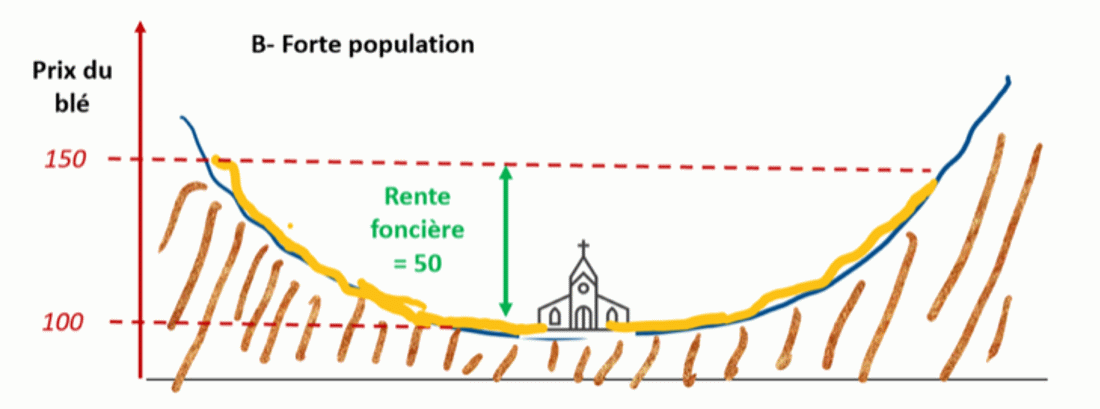La Lettre n°202 de Octobre 2022
Actualités : Deux tables rondes de finance d'entreprise
Pour ceux d’entre vous qui seront disponibles physiquement à Paris ou via Internet, le 30 novembre, nous animerons deux tables rondes, à partir de 18 h 45, dans les locaux de Bpifrance, boulevard Haussmann.
La première consacrée à Comment les entreprises réagissent-elles face à l’inflation ? avec la participation de Stéphanie Besse, managing director chez Natixis et Mathieu Malige directeur financier de Carrefour.
La seconde, consacrée à Faire faillite en 2023 dans le nouveau cadre réglementaire, avec Hélène Bourbouloux, administrateur judiciaire et Pierre-Olivier Chotard, secrétaire général du CIRI.
Nous aurons ainsi le plaisir de vous rencontrer et de dédicacer votre exemplaire du Vernimmen, qui sera aussi en vente sur place.
Pour vous inscrire gratuitement, cliquez ici.
Actualités : Les entreprises doivent-elles racheter leur dette obligataire ?
En octobre 2020, Michelin émet un emprunt obligataire de 500 M€, d’une durée de 20 ans, rapportant un taux d’intérêt facial de 0,625 %. Heureuse époque !
Aujourd’hui, cet emprunt obligataire coté en Bourse 53,6 % de son montant nominal présente un taux de rentabilité actuariel de 4,4 %.
Ce n’est bien sûr pas que la capacité perçue de Michelin de rembourser en temps et heure sa dette se soit dégradée. Simplement, les taux d’intérêt ont bondi depuis comme chacun a pu le remarquer. Et avec une sensibilité[1] de 16,1, l’impact sur la valeur de l’obligation Michelin de la hausse des taux d’intérêt est massif.
Ainsi le pneumaticien a pu émettre cet emprunt obligataire en octobre 2020 à mid-swap[2] + 63 points de base. Aujourd’hui, son cours faut apparaître une rentabilité actuarielle à mid-swap + 125 points de base. Autrement dit, si le spread, dû à la qualité de la signature de Michelin, s’est un peu détendu avec la moindre intervention de la banque centrale sur les taux d’intérêt, l’essentiel de la baisse du cours de l’obligation Michelin 2040 est dû à l’évolution du taux d’intérêt mid-swap passé de - 0,03 % à 3,15 %.
D’ailleurs, on observe une évolution similaire sur l’obligation Apple 2,375 % 2041 qui cote actuellement 67 % de son nominal de 1,5 Md$ :
avec un spread passé de 84 points de base à l’émission en février 2021 à 130 points de base actuellement, et un taux actuariel passé de 2,45 % à l’émission à 5,17 % actuellement. Si l’on peut se dire que dans un secteur concurrentiel comme celui de l’automobile, Michelin n’est en rien assuré de sa survie dans 20 ans, cela est nettement moins certain concernant la plus grosse capitalisation boursière au monde, assise sur un matelas de trésorerie de 189 Md$ et un endettement bancaire et financier net de - 16 Md$.
D’un point de vue financier, la décote de 46 % du cours de l’obligation Michelin sur le nominal correspond à la valeur actuelle sur la durée de vie résiduelle de cette obligation, 18 ans, de l’écart entre le taux du marché actuel pour une obligation Michelin de cette échéance, 4,4 % et le taux coupon de 0,625 %.
Si Michelin voulait racheter cette dette sur le marché, et sauf à utiliser des actifs de trésorerie, ce qui réduirait sa liquidité, il devrait émettre un nouvel emprunt obligataire pour financer le rachat, au taux du marché actuel, c’est-à-dire pour une même maturité, de l’ordre de 4,4 %.
D’un point de vue financier, il n’y aurait ni gain, ni perte, puisqu’il rachèterait sa dette à sa valeur, à la prime près payée pour racheter les obligations 2020, mais sur les marchés obligataires, elles sont très faibles (1 ou 2 %), et bien loin de celles du marché actions. Il n’y a donc pas d’intérêt financier significatif dans ces conditions.
D’un point de vue comptable, Michelin enregistrerait une plus-value non récurrente de 500 M€ x 45 %, en supposant un rachat à 55 % du nominal, soit 225 M€ ; payerait un impôt sur les sociétés à 25 %, soit 56 M€, et gonflerait ses capitaux propres du montant net, soit 169 M€ ; substituerait au sein de son compte de résultat, à une charge annuelle de 0,625 % x 500 M€ = 3,1 M€, une autre de 500 M€ x 55 % x 4,4 % = 12,1 M€. On pourrait bien sûr réduire l’impact négatif sur le résultat, en refinançant la dette rachetée par l’émission d’une dette d’une durée plus courte, et donc avec un taux d’intérêt plus faible, maintenant que les courbes des taux ont repris leur forme normale. Mais ce serait au prix d’une prise de risque complémentaire Au bilan, la dette de 500 M€ serait remplacée par une dette de 225 M€. Donc un résultat réduit pour plus de capitaux propres comptables et moins de dettes financières, en tout cas pour ceux qui ne voient pas plus loin que leur bout du nez et prennent la dette en montant comptable et non en valeur.
Donc l’intérêt pour les entreprises de racheter leur dette cotée ne saute pas aux yeux. À quelle condition une telle opération pourrait-elle néanmoins faire sens ?
On pourrait penser au cas de l’entreprise à la trésorerie pléthorique et qui voudrait réduire le coût de portage, écart entre le coût de sa dette et la rentabilité de sa trésorerie. Mais l’évidence de ce cas de figure ne s’impose pas. En effet, du fait de la hausse des taux, les entreprises plaçant à court terme bénéficient d’un taux d’intérêt ou ne vont pas tarder à bénéficier d’un taux d’intérêt supérieur au taux nominal de leurs vieilles obligations. En effet, €STER est actuellement à 0,66 %, et l’Euribor 3 mois est à 1,4 %. Donc même dans ce cas de figure, réduire sa liquidité pour réduire son résultat net ne semble pas une bonne idée.
Du fait du traitement comptable et fiscal de l’opération, l’entreprise qui sort de difficultés significatives, qui aurait émis des dettes à des taux bas avant d’entrer en difficultés, et à qui des prêteurs sont disposés à lui prêter, pourrait être concernée. Elle pourrait ainsi reconstituer plus rapidement ses capitaux propres qui, quoi qu’on en dise, font toujours mauvais genre quand ils sont négatifs ou bien réduits, et diminuer le montant facial de sa dette ; sans coût fiscal pour elle compte tenu des pertes accumulées. Mais le cas n’est pas si fréquent que cela.
On peut aussi penser au cas de l’entreprise qui voudrait envoyer un signal sur sa liquidité à l’instar de Credit Suisse qui, en proposant de racheter début octobre 3 Md€ de sa dette senior, a déclenché un bond de 7 % de son cours de Bourse (après une chute de plus de 50 % en 2022). Il est vrai que lorsque votre CDS passe en une semaine de 130 bp à 590 bp (sic), il y a péril en la demeure, surtout quand vous devez, comme une banque, vous réendetter beaucoup plus régulièrement qu’une entreprise.
En fait, il nous semble que le vrai sujet de cette thématique va être celui de la prise en compte de la valeur de la dette à la place du montant comptable dans l’évaluation des entreprises par les méthodes indirectes (multiples d’excédent brut d’exploitation, résultat d’exploitation ou actualisation des flux de trésorerie disponible).
Certes, il ne fait aucun doute[3] qu’en matière d’évaluation la valeur de la dette nette prime sur son montant comptable, mais le sujet concernait jusqu’à présent essentiellement des entreprises dont la solvabilité perçue s’était beaucoup dégradée, c’est-à-dire des cas assez marginaux. Maintenant, c’est potentiellement l’ensemble des groupes, car quel directeur financier a été assez inconscient ou incompétent pour ne pas émettre de la dette à long terme dans ces conditions de taux que l’on ne voit qu’une fois dans sa vie ?
La publication des comptes 2022 dans quelques mois donnera en annexe le montant estimé de la valeur la dette financière, permettant plus aisément aux analystes de mener à bien leur travail correctement.
La décote sur cette seule obligation de Michelin représente 1,4 % de la valeur des capitaux propres du groupe. C’est dire si c’est un sujet qui nous paraît mériter beaucoup d’attention de la part du directeur financier que celui de savoir s’il faut ou non la racheter. À lui le soin de veiller au grain !
[1] Pour plus détails sur la sensibilité des obligations, voir le chapitre 22 du Vernimmen 2023.
[2] Si vous avez oublié ce que mid-swap veut dire, la rubrique « Question & réponse » de ce mois-ci est faite pour vous.
Tableau : Les investissements qui sont faits en période de récession génèrent généralement de meilleures rentabilités
Cette règle générale est clairement identifiée dans le graphique suivant qui montre comment l'année d’entrée sous LBO a un impact considérable sur le taux de rentabilité qui sera obtenu.
Ainsi, un investissement réalisé au plus fort de la bulle TMT et de leurs valorisations en 2000 donne un TRI de 11 % contre 25 % en 2001, 40 % l'année suivante et 47 % au plus bas de la Bourse en 2003.
Cette règle correspond au bon sens puisque plus le prix d’achat est faible, meilleur sera le taux de rentabilité !
Ce graphique a été produit par Bain dans son rapport semestriel sur le capital-investissement pour 2022.
Recherche : La rétention des talents comme déterminant de la structure financière
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
Identifier les critères de choix de structure financière des entreprises, et en particulier le bon dosage entre financement par dette et capitaux propres, constitue le Graal de la finance d’entreprise.
Plusieurs théories concurrentes ont vu le jour depuis le principe de neutralité établi par Modigliani et Miller en 1958[1]. L’une des plus utilisées est celle du trade-off, autrement dit du compromis entre les avantages fiscaux de la dette et les coûts liés au risque de faillite si l’entreprise se retrouve en stress financier. Utile sur le plan conceptuel, cette approche se heurte à des difficultés pratiques. D’une part, l’avantage fiscal de la dette est en réalité assez faible. D’autre part, les problèmes liés au stress financier sont difficiles à mesurer empiriquement. Sur ce dernier point, un article récent[2] utilise une base de données exceptionnellement précise issue de Suède pour montrer que le stress financier peut entraîner une fuite rapide des talents, et que ce risque constitue un argument en défaveur de la dette dans la structure financière.
L’intuition de l’article se fonde sur l’idée qu’il est plus facile pour un salarié de trouver un emploi lorsqu’il en occupe déjà un. Dans le cas d’une entreprise en difficulté, les salariés dotés de compétences particulières, et qui sont a priori ceux les plus à même de retrouver un emploi rapidement, seraient les premiers à quitter le navire. Si tel est le cas, alors leur départ constitue un élément du coût du stress financier énoncé dans la théorie du trade-off.
Empiriquement, mesurer cet effet requiert une base de données détaillée, contenant non seulement des informations sur la santé financière et la structure du passif des entreprises, mais aussi et surtout des données détaillées sur les salariés (âge, diplômes, ancienneté, salaire, « compétences »…). Pour y parvenir, les auteurs ont croisé plusieurs sources sur le marché suédois. Ils se sont servis de données longitudinales sur les individus récoltées entre 1990 et 2011 permettant de suivre les carrières sur le long terme. Ils ont pu les croiser avec des données issues de l’armée : jusqu’en 2009, les jeunes hommes suédois devaient subir des tests non seulement physiques, mais aussi cognitifs (logique et compréhension) et psychologiques (intelligence émotionnelle, capacité à assumer des responsabilités…). Bien entendu, le résultat de ce genre de tests est à prendre avec prudence. Mais ces données ont permis aux auteurs de mener l’étude et d’obtenir des résultats très significatifs.
Le principal d’entre eux porte sur le départ des salariés identifiés comme « talentueux » (ayant des capacités cognitives et non cognitives élevées selon les tests militaires) dans les entreprises en stress financier. La probabilité de départ est 65 % plus élevée que celle des autres salariés. Une explication pourrait être que ces salariés coûtent cher et que l’entreprise prend l’initiative de s’en séparer pour réduire ses coûts. Afin de l’écarter, les auteurs vérifient qu’il s’agit bien de départs volontaires. D’une part, dans la plupart des cas, les salariés concernés ne connaissent aucune période de chômage avant de retrouver un emploi. D’autre part, selon la législation suédoise, les entreprises qui souhaitent licencier pour motif économique doivent suivre une règle de type LIFO (last in first out). Les salariés talentueux partent avant leur tour dans cette file d’attente, ce qui présume là encore d’un départ volontaire.
Il s’agit ensuite d’établir le lien entre cet effet et le choix de structure financière. Pour cela, on observe les départs lors de variations non anticipées de taux de change qui provoquent des baisses brutales de ventes à l’international. Dans cette situation, les salariés talentueux sont beaucoup plus nombreux à partir dans les entreprises avec un levier financier élevé. Ainsi, le fait de privilégier la dette comme mode de financement entraîne un risque accru de départ des talents, toutes choses égales par ailleurs. Ce n’est pas la difficulté économique fondamentale qui provoque le départ, mais bien la difficulté financière accrue par l’effet de levier.
Enfin, le dernier résultat important concerne la prise en compte effective de ce risque dans les choix de structure financière. Les auteurs identifient les entreprises les plus fortement dépendantes des talents comme étant celles dans lesquels ces derniers sont les plus nombreux, mais aussi les plus concentrés dans quelques unités. Pour ces entreprises, le départ volontaire des talents entraîne des conséquences très négatives et constitue un coût important en cas de stress financier. Sur l’échantillon étudié, une augmentation d’un écart-type de la dépendance aux talents se traduit par une baisse de 1,1 point de pourcentage du taux d’endettement (pourcentage de dette dans le passif), un montant significatif à comparer à un taux moyen de 13,3%.
Cet article constitue une contribution importante à la compréhension des structures financières. Parmi les critères de choix du mode de financement, la rétention des talents a probablement été sous-estimée. En plus de proposer une évaluation de cet effet grâce à une base de données exceptionnelle par sa richesse, l’article identifie une raison possible du sous-endettement des entreprises par rapport aux prédictions théoriques : la volonté de rétention des talents en période de crise.
[2] R. P. Baghai, R. C. Silva, V. Thell et V. Vig, « Talent in distressed firms: Investigating the labor costs of financial distress », Journal of Finance, 2021, vol. 76(6), pages 2907 à 2961.
Q&R : Qu'est-ce que les taux de swap et de mid-swap ?
Le marché obligataire a la particularité d’être assez peu liquide. La plupart des investisseurs achètent les titres à leur émission et les conservent jusqu’à leur terme. Ainsi, l’observation des prix sur le marché obligataire secondaire ne reflète qu’approximativement le niveau des taux d’intérêt exigés par les investisseurs.
Le marché des swaps de taux d’intérêt (qui permettent de passer d’un taux fixe à un taux variable ou l’inverse) est en revanche beaucoup plus liquide, notamment du fait que de nombreuses entreprises qui s’endettent auprès de banques à taux variable utilisent cet instrument pour passer à taux fixe tout ou partie de leur dette. Ainsi, à un instant donné, le taux fixe des swaps de taux reflète de manière juste le niveau des taux d’intérêt du moment. Ces taux de swap[1] sont donc généralement retenus comme référence de marché pour les taux longs. La plupart des prospectus obligataires comparent les taux d’intérêt de l’émission au taux de swap pour calculer le spread de l’émission.
Le terme mid-swap est parfois utilisé de manière plus précise afin de préciser que le taux de swap retenu est celui à mi-chemin entre le taux fixe d’un swap où l’investisseur reçoit le taux fixe et celui d’un swap où il paye le taux fixe (excluant ainsi la marge que conserve la banque).
[1] Les swaps sont cotés en annonçant le taux fixe contre lequel la banque est prête à échanger le taux variable (généralement Euribor 3 mois pour la zone euro).
Autre : Nos lecteurs écrivent : Tempête sur le marché électrique : prix, rente et taxation
Par François Meunier
La règle la plus naturelle pour tarifer l’électricité, celle qui est en vigueur sur le marché de l’UE, est celle du coût marginal. Le prix de l’électricité qui prévaut sur le marché est le coût de la dernière unité de production mise en œuvre. Aujourd’hui, et de loin en raison de la crise ukrainienne, le coût qui prévaut est celui de la mise en œuvre des centrales au gaz, les autres modes de production, hydro, renouvelables et nucléaire étant moins coûteux.
La règle la plus naturelle en effet : un prix plus bas, sur un marché arbitré par les prix, signifierait une offre insuffisante puisque les acteurs privés ne mettraient pas les centrales à gaz en service ; un prix plus haut, et la concurrence entre producteurs se chargerait de ramener le niveau du prix à ce coût.
En conséquence, les producteurs inframarginaux, ceux qui ont des coûts de production plus bas, bénéficient d’une rente, écart entre le prix de marché et leur propre coût de production. Comme il s’agit d’un gain fortuit, dû à des circonstances exceptionnelles, certains pays ont mis en place des taxations spécifiques de cette rente, sujet désormais discuté au niveau de la Commission européenne. Mais quel est l’effet de cette taxation ?
Il faut rendre hommage ici à l’économiste David Ricardo qui, au début du xixe siècle, a théorisé ce phénomène de la rente. Il traitait du cas de la rente issue de la propriété de la terre, mais cela vaut aussi pour tout type de capital fixe ou incorporel non aisément renouvelable (mines, immobilier des grandes villes, brevet, etc.). Les deux graphiques ci-après illustrent le point.
Nous voici dans un village faiblement peuplé au creux d’une belle vallée, avec quelques champs de blé autour. Il y a concurrence entre les cultivateurs de sorte que le prix du blé s’établit au niveau de son coût (un coût qui peut prendre en compte le coût du capital, ce qui signifie qu’il n’y a pas de profit pur au-delà de la rémunération du capital). Ce sont les terres les plus fertiles, celles du fond de vallée, qui sont exploitées en premier, avec disons, un prix de 100.
Mais la population croît, de sorte qu’il faut mettre en culture les terres moins riches et plus dures à cultiver dans les hauteurs (graphique B). Le coût marginal de la dernière terre à être mise en semis s’établit à 150, ce qui fixe le nouveau prix ; mais rapporte aussi 50 de rente sans aucun risque ni aucun travail spécifique pour l’heureux propriétaire des terres fastes près de l’église.
Que nous dit Ricardo si jamais quelque malin souverain se mettait en tête de taxer cette rente ? Réponse : rien ! Du moins rien dans l’économie réelle. La demande de blé ne changerait pas, la dernière terre cultivée non plus. Il n’y aurait qu’un transfert de revenu de chacun des producteurs inframarginaux vers le souverain. On appelle cela en anglais une windfall tax, une taxe apportée par le vent, à la vérité une taxe idéale puisqu’à la différence de la plupart des autres impôts, elle n’affecte nullement les comportements des agents économiques.
Ce simple modèle éclaire pleinement ce qui se passe tous les jours sur le marché électrique : on met en œuvre des capacités moins productives, plutôt que des terres moins fertiles, ce qui enrichit les détenteurs d’actifs énergétiques moins coûteux, plutôt que des terres plus fertiles.
Il éclaire aussi un point très simple et pourtant assez subtil en finance d’entreprise. Supposons qu’entre la situation A et la situation B, le profit des terres les plus proches de l’église ait doublé grâce à la rente, et ceci de façon permanente. Clairement, la valeur de ces terres aura doublé également. Supposons aussi un marché libre des terres, tel un marché d’actions pour entreprises cotées. Si un nouvel arrivant veut acheter une terre près du village, il paiera le double de ce que le propriétaire historique avait payé à l’époque. Par conséquent, le rendement de son actif sera exactement le même que celui de la terre marginale, la moins fertile (à risque d’exploitation identique, mais ceci est un détail). Voici pourquoi une des sociétés les plus rentables d’Europe, LVMH, peut avoir, grâce à l’extrême solidité de ses marques, un rendement sur ses fonds propres « historiques » de près de 20 %, alors que le rendement de celui qui achète aujourd’hui l’action est de l’ordre de 4 à 5%, c’est-à-dire, sans surprise, le coût que supporte LVMH pour lever du capital. La rente s’est diluée dans le marché.
Qu’en est-il aujourd’hui sur le marché électrique ?
- En raison de la crise ukrainienne, le prix du gaz a été multiplié par un facteur 4, voire 10 au pic du marché. La rente des producteurs inframarginaux s’est fortement accrue. Ce choc purement fortuit ne tient ni à l’effort des « capitalistes » ni à celui des « travailleurs ». Si les travailleurs voient que cette rente risque d’être distribuée en dividendes face à la pression des capitalistes, ils peuvent exiger leur part en salaires, si illégitimes que soient l’une et l’autre des demandes. Une taxation forfaitaire et temporaire de cette rente est alors une sorte de jugement de Salomon, propre à éviter ce risque de conflit. Dans le cas de la France, le gouvernement est probablement resté trop longtemps indécis, d’où le conflit récent.
- On lit qu’à taxer la rente électrique, on gêne la capacité d’investissement des grands opérateurs électriques ou des grands pétroliers. Cela doit être fortement nuancé. En première approche et comme toujours en finance, le mode de financement (sur épargne propre ou par recours externe à l’emprunt ou augmentation de capital) a peu à voir avec la rentabilité opérationnelle du projet. Ce n’est que si une protestation écologiste arrivait à persuader les investisseurs de ne plus financer les Shell et autres ExxonMobil, qu’il ne serait pas indifférent que la rente reste dans la poche de l’entreprise ou parte vers l’État. Cette menace de rationnement pousse probablement les grands groupes pétroliers à retenir au maximum la rente.
- Par un accord entre la France et la Commission dont on voit à présent les défauts, EDF est dans une singulière position. Afin d’encourager la concurrence sur le marché électrique national, on lui demande de vendre un quota de sa production d’origine nucléaire à des tiers à un prix pré-convenu, et bas. En clair, on la prive de sa rente nucléaire à un moment où elle en aurait bien besoin. En retour, certains des opérateurs bénéficiaires ont été en mesure de la capter, revendant l’électricité au prix du marché.
- Suite à la flambée du prix du gaz, les gouvernements européens mettent en place des mécanismes d’aide aux ménages et aux entreprises : chèque aux ménages à faible revenu, bouclier mettant un plafond au prix de vente ou, comme en Espagne, remise en cause de la règle du coût marginal. On a vu que cette règle assurait le fonctionnement optimal du marché du côté de l’offre. C’est le cas aussi du côté de la demande : celle-ci baisse si le prix monte, donnant priorité aux clients qui font l’usage économique le plus efficace de l’électricité achetée. Mais quand la hausse de prix est violente, la règle devient socialement très brutale car elle évince ou impose de fortes privations aux clients qui n’ont pas les moyens économiques de suivre, ceci pour un bien, l’énergie, dont il est impossible de se passer.
- Le mécanisme du bouclier semble avoir la préférence aujourd’hui en France : bien que moins ciblé sur ceux qui en ont besoin, il permet de minorer l’indice des prix, un fort avantage dans le contexte inflationniste du moment. Des formules plus astucieuses auraient pu être retenues : par exemple, un prix maintenu bas jusqu’à un seuil de consommation, ce qui encouragerait des économies de la part des ménages, tout en préservant ceux d’entre eux qui ont des bas revenus. Dans une situation extrême où le prix de l’énergie atteindrait des sommets, il faudrait, comme dans une économie de guerre, quitter la logique d’un équilibre par les prix et accepter une gestion de la demande électrique par rationnement.
- Green marketing. On voit des producteurs ou distributeurs électriques user de l’argument commercial suivant : « Achetez mon électricité, elle est plus “verte” que celle du voisin : j’utilise un barrage et non une ignoble centrale thermique au gaz. » Ce n’est pas recevable. L’offre électrique forme un tout et les électrons n’ont pas de couleur verte ou brune. Le barrage ne peut couvrir toute l’offre électrique, il dépend du débit des fleuves, de la distance au lieu de consommation, etc. Il n’est qu’une brique dans un ensemble compact, mêlant différentes sources d’énergie pour pallier tous les facteurs de risque, de volatilité de la demande, de climat, de prix des intrants, etc. Le contenu en carbone de l’offre électrique est son contenu moyen, quelle que soit la source d’énergie utilisée.
Reproduit avec l’autorisation du site Vox-Fi où cet article est initialement paru.
Autre : Formations
Voici la date de la prochaine formation que nous avons conçue pour Francis Lefebvre Formation, avec des enseignants que nous avons sélectionnés pour l’excellence de leur pédagogie :
-
« Définir la structure de financement adaptée à votre entreprise »
le 10 novembre 2022, à Paris.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière, des réponses à des questions qui nous sont posées ou des citations.
En voici quelques-uns :
Prendre ses pertes pour mieux rebondir
Dans les opérations de M&A, les banques qui arrangent le financement s’engagent très en amont de la réalisation de l’opération. Elles ne peuvent syndiquer aux investisseurs institutionnels ou refinancer sur les marchés obligataires que lorsque l’opération devient certaine, en moyenne 6 mois pour les opérations les plus importantes, un peu moins pour les plus petites, mais parfois plus d’unan après l’annonce de l’opération. En effet, il faut obtenir le feu vert des autorités de la concurrence, et il peut y avoir des contre-offres ou des contestations.
Pendant cette période, les marchés financiers peuvent se dégrader. C’est ce qui s’est passé depuis le début de l’année 2022. Les conditions (et notamment le prix) du financement ne correspondent plus à celle du marché ; syndiquer le financement s’avère alors compliqué.
Des opérations importantes avaient été annoncées début 2022 (Citrix : 8,5 Md$ de financement, Brightspeed : 3,9 Md$, Nielsen : 8,3 Md$, etc.). La syndication de ces financements ne peut être envisagée qu’avec une décote par rapport au nominal du crédit pour refléter les nouvelles conditions de marché, puisque le taux du crédit correspond à celui de l’engagement initial de la banque, même si une petite partie peut être supportée par l’acquéreur quand le contrat de dette le prévoyait (clause de flex). Les décotes sur le prix de cession du crédit, c’est-à-dire les pertes potentielles pour les banques, peuvent aller jusqu’à 10 % du nominal du crédit (OID - original issue discount). Que faire pour les banques arrangeuses ? Attendre des jours meilleurs et « garder le papier » ou syndiquer avec une décote ?
En 2022, aux États-Unis, les banques ont quasiment toutes choisi de syndiquer quitte à ce que ce soit avec une forte décote ; elles ont donc accepté de réaliser une perte sur ces opérations. Plusieurs raisons justifient de choix :
- La crise de 2008-2009 a démontré que conserver des opérations non performantes au bilan rendait la sortie de crise plus longue et douloureuse ;
- Les banques doivent faire de la place pour de nouvelles opérations plus profitables ;
- Les banques arrangeuses ont bénéficié de commissions importantes à la mise en place du financement. Ces commissions réduisent pour elles fortement les pertes ;
- Difficile pour les banques arrangeuses de second rang de faire un choix différent. Qui prendrait la responsabilité de conserver au risque de pertes qui s’aggravent, alors que matérialiser des pertes en même temps que les banques arrangeuses est aisément justifiable ?
Sur le marché américain, les banques arrangeuses ne sont pas mécontentes que les banques de second rang subissent des pertes importantes (les commissions touchées étant plus faibles pour ces dernières car elles ne structurent pas le financement et ne sont pas conseil dans l’opération d’acquisition). Cela permet de conforter leur position et de décourager des acteurs potentiellement menaçants.
Pourriez-vous être directeur financier de Softbank ?
L'interview du directeur financier de Softbank, Yoshimitsu Goto[2], diffusée il y a quelques jours par le Financial Times illustre bien, nous semble-t-il, les qualités d’un directeur financier d'un grand groupe. Il est vrai que diriger depuis 2000 les finances du conglomérat financier fondé par le charismatique, dynamique mais chaotique Masayoshi Son n’est pas à la portée du premier venu. Car à côté de brillantes intuitions comme les investissements dans Alibaba et Yahoo! avant même que nous ayons entendu parler de ces firmes, se trouvent des investissements nettement moins brillants comme dans WeWork et Greensill Capital.
En tout cas, voici quelques traits saillants :
- Créatif, il ne dit pas non à un dossier qu’il n’aime spontanément pas, mais réfléchit d’abord à quelles conditions ce dossier pourrait quand même être réalisé par Softbank.
- Cela dit, il lui arrive de dire « non », tout en sachant bien que dans un groupe comme le sien, son refus équivaut pour les opérationnels à la fin d’un dossier.
- Il a la confiance absolue de son patron ; sans elle, le point précédent ne tiendrait pas longtemps.
- Il a aussi et surtout la confiance du principal banquier du groupe, Mizuho, dont il est issu il y a plus de 20 ans, ce qui aide, mais qu’il cultive avec assiduité car il sait que le jour où la confiance de son premier banquier est en doute, la situation de Softbank, dont la structure financière n’est pas la plus claire malgré ses efforts de simplification, change du tout au tout.
- Enfin, il dit toujours à son patron que s’il trouve meilleur que lui, il doit alors le remplacer. Ce qui vous offre peut-être des perspectives !
Gribouille au pays des dividendes
Un amendement parlementaire a été adopté à l’Assemblée nationale qui prévoit de hausser de 30 à 35 % l’impôt payé par les actionnaires personnes physiques recevant des dividendes, ou bénéficiant de rachats d’actions, de la part d’entreprises les ayant augmentés au titre de 2022 et 2023 de plus de 20 % par rapport à la moyenne de 2017-2021.
Si la mesure a peu de chance de survivre à la probable procédure du 49-3, elle dénote un total manque de réalisme.
Un groupe qui voudrait augmenter ses dividendes va-t-il changer d’avis parce qu’une infime fraction de ses actionnaires va voir l’imposition de ses dividendes se tendre ? Les sociétés cotées ont en moyenne 10 % de leur actionnariat composé de personnes physiques, les seules visées par cette mesure, et la plupart de celles-ci ont compris depuis belle lurette qu’il valait mieux détenir ses actions via un PEA, une société holding ou un contrat d’assurance-vie, qu’en direct, rendant ainsi ineffectif cette fiscalité accrue affectant au mieux 1 à 2 % des actionnaires.
La mesure en visant aussi les gains tirés des rachats d’actions est inapplicable. En effet, comment identifier qu’un actionnaire, qui a cédé ses titres en Bourse, se les est fait racheter par la société elle-même et non pas par un autre investisseur, comme c’est statistiquement le plus probable (les rachats d’actions oscillent entre 10 et 20 Md€ par an contre 2 096 Md€ de transactions en 2021 à Paris) ? Quiconque n’a jamais vendu des titres en Bourse sait qu’il ne connaît pas l’identité de son acquéreur, dont il se soucie comme d’une guigne !
La motivation de cet amendement, dixit ses auteurs, est de soustraire les entreprises faisant des super-profits à l’irrésistible pression de leurs actionnaires pour plus de dividendes et les inciter au contraire à accroître leurs investissements. Factuellement, nous ne connaissons pas une entreprise qui ait dû réduire ses investissements pour verser des dividendes, car tout chef d’entreprise qui se respecte et tout actionnaire préférera moins de dividendes pour réaliser en contrepartie des investissements créateurs de valeur. Et quand l’entreprise verse des dividendes, c’est qu’elle ne trouve plus suffisamment d’investissements assez intéressants. Ah si, nous connaissons un exemple d’un groupe qui a dû réduire ses investissements pour faire face à la pression au versement de dividendes d'un actionnaire majoritaire : EDF, détenu à 84 % par l’État français qui, il y a encore peu, a exigé des dividendes affaiblissant EDF afin de limiter son propre déficit budgétaire…