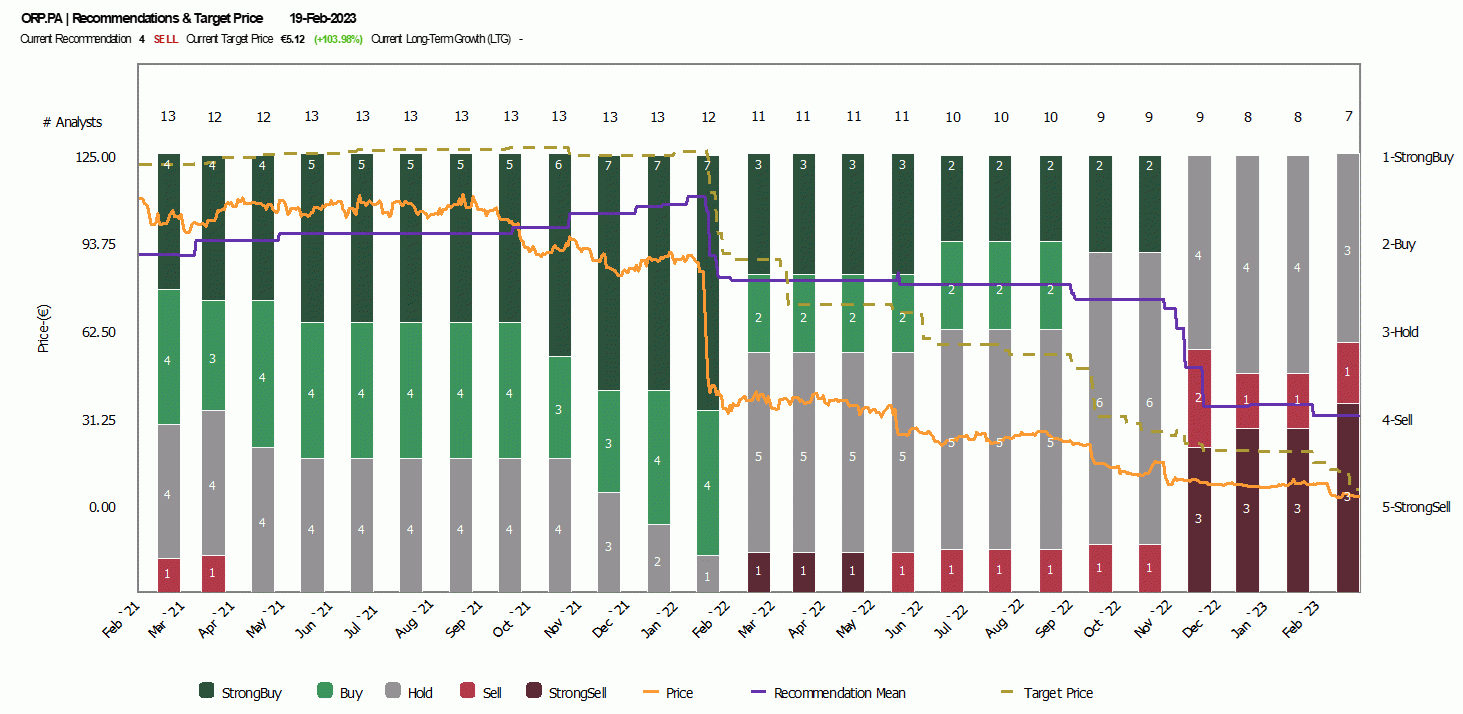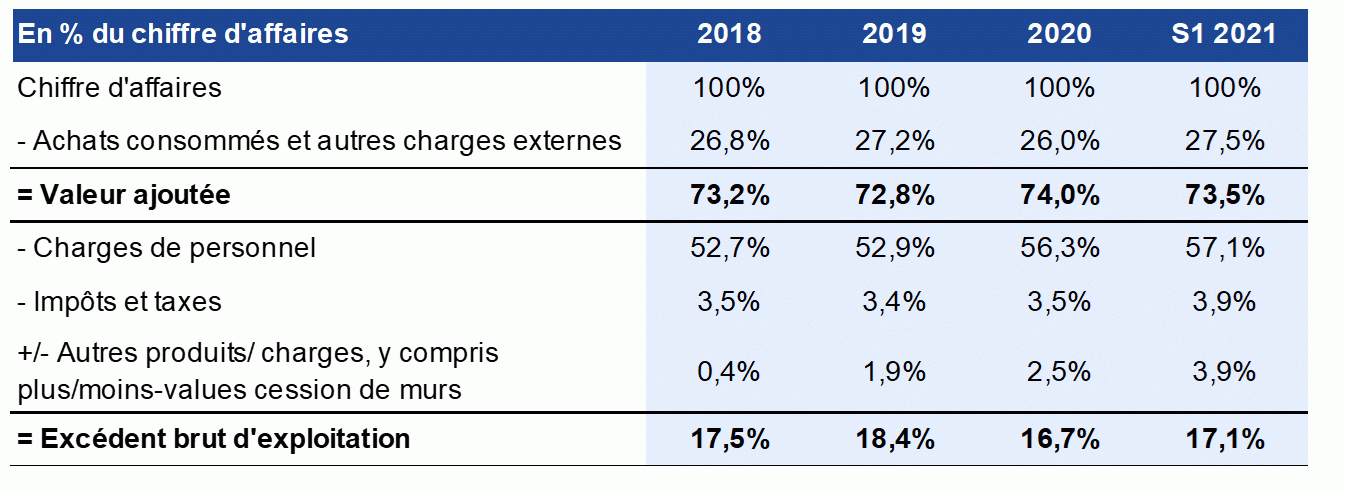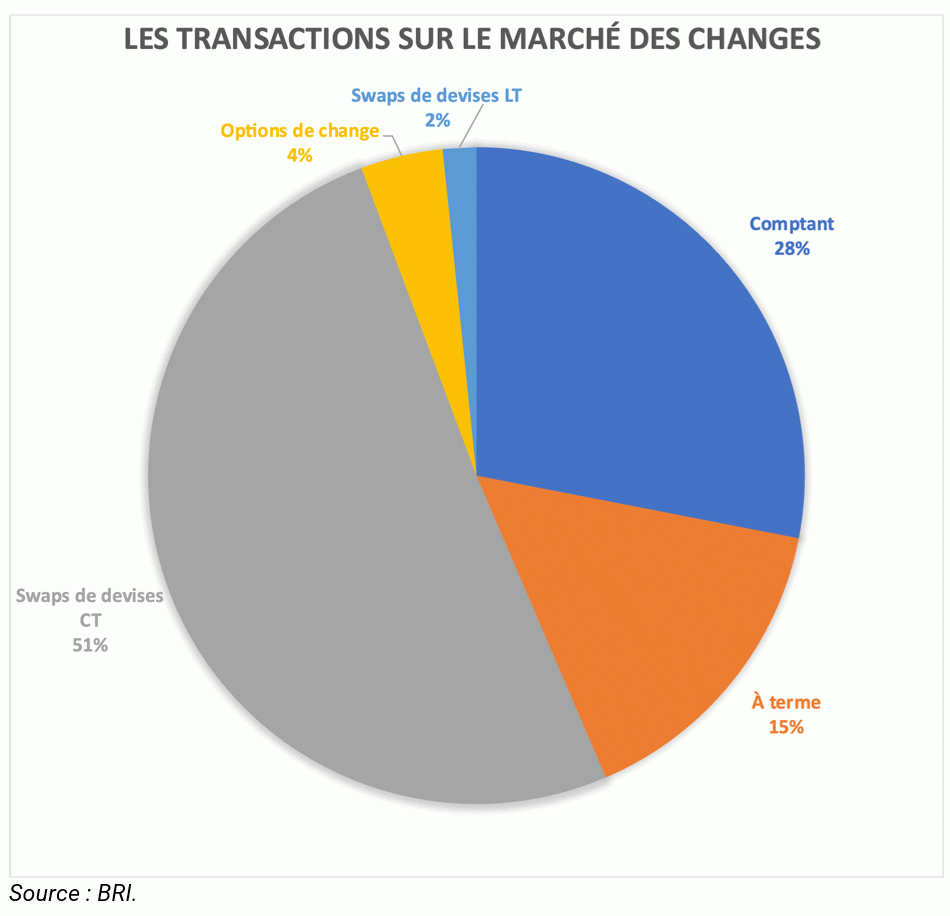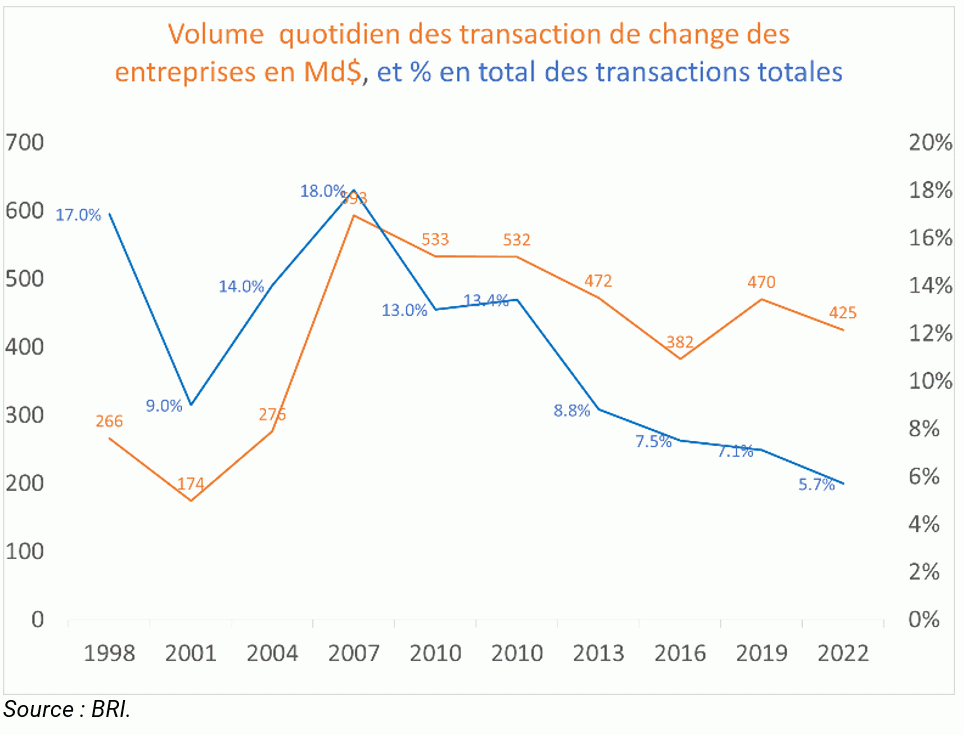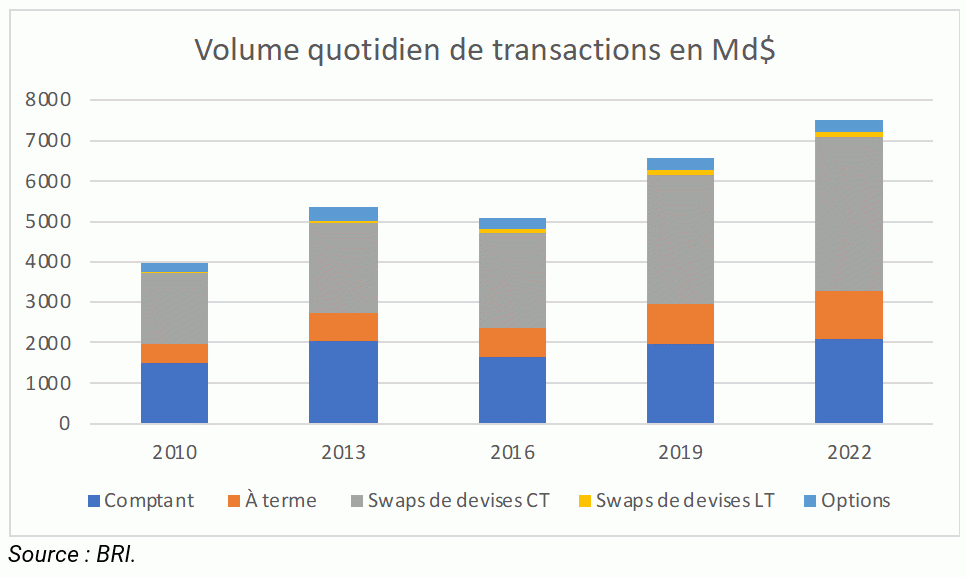La Lettre n°205 de Février 2023
Actualités : Orpéa : Ils avaient des yeux et ils ne voyaient pas (1/2)
Il est bien sûr plus facile de prédire l’avenir quand celui-ci est derrière nous que lorsqu’il est encore devant et partiellement inconnu.
Il nous semble toutefois qu’un investisseur qui aurait fait son travail de documentation et de réflexion à l’automne 2021 avait toutes les raisons de vendre au plus vite ses actions et ses dettes Orpéa, s’il en détenait, voire de les vendre à découvert.
En effet, nous pensons et allons démontrer dans cet article en deux parties qu’une analyse financière correctement menée démontrait immanquablement qu’Orpéa allait de plus en plus vite droit dans un mur qui se rapprochait tout aussi vite. Même sans la publication le 26 janvier 2022 de l’ouvrage Les fossoyeurs du journaliste d’investigation Victor Castanet, qui allait mettre à jour des maltraitances, des détournements de fonds et des modes de gestion choquants, Orpéa était confronté à une rentabilité bien trop faible pour faire face au poids de sa dette et à un cours de Bourse très surévalué. Tôt ou tard, cette situation aurait entraîné une crise financière majeure chez Orpéa.
Du côté des capitaux propres
Regardons d’abord du côté des analystes financiers se penchant sur la valeur des capitaux propres.
Comme l’illustre le graphique suivant, sur les 13 analystes[1] suivant Orpéa fin 2021, deux seulement n’étaient pas à l’achat (Exane BNP Paribas et Oddo BHF). Ils étaient simplement à conserver. Tous les autres sont à l’achat, certains avec des recommandations pressantes : « A rare entry point » pour Berenberg avec un objectif de cours le 13 décembre 2021 à 110 € (cours de 83 €). Kepler vise le 7 janvier 2022 155 € alors que l’action cote 86 € et titre sa note : « A wake up call », et pas dans le sens où on l’entendrait aujourd’hui alors que l’action cote 2,5 €, ce qui nous paraît d’ailleurs encore largement surévalué.
Comment expliquer un tel enthousiasme ? Il y a bien sûr un effet grégaire qui rend très coûteux pour un analyste d’être à contre-courant net du consensus de place, surtout s’il se trompe. On s’en rappellera des années, alors que s’il a raison contre le consensus, on ne s’en rappellera pas au-delà de 3 jours. Par ailleurs, afficher une recommandation « Vendre » est pour un analyste la garantie de se couper d’une proximité avec les dirigeants d’Orpéa pourtant bien utile pour produire des notes d’analyse et rassurer les investisseurs quant à la pertinence de ses travaux.
À une époque où les principaux investisseurs et gérants d’actifs se sont dotés de leurs propres capacités d’analyse financière (le buy-side), où la recherche est essentiellement destinée à des hedge funds qui, la plupart, ne trouvent de valeur dans les notes des analystes financiers que pour autant qu’elles leur permettent de se positionner juste avant la publication d’un résultat, on aurait pu penser que les notes d’analyse sur Orpéa seraient assez creuses et orientées sur le très court terme. Eh bien, non. Certaines des notes que nous avons passées en revue témoignaient d’un vrai travail d’analyse, bien loin de la superficialité de savoir si l’entreprise allait battre ou pas le consensus de BPA ou d’EBE lors de la publication de ses résultats 2 jours après.
Néanmoins, la totalité des analystes financiers sont tombés dans le piège d’IFRS 16, la norme sur la comptabilisation des locations financières et opérationnelles de l’entreprise, dont nous vous avons à plusieurs reprises dit tout le mal que nous en pensons[2].
On sait que cette norme conduit à traiter de la même façon les locations simples et les locations financières, ce qui nous a toujours paru un contresens majeur[3].
La norme IFRS 16 fait que depuis les comptes 2019, le loyer payé est éclaté au compte de résultat entre des frais financiers et une dotation aux amortissements. Il sort donc intégralement du calcul de l’excédent brut d’exploitation puisque ce dernier est avant dotation aux amortissements et avant frais financiers.
Par ailleurs, l’entreprise inscrit à l’actif de son bilan en droits d’usage la valeur actuelle des loyers de location opérationnelle et des loyers de location financière, et au passif de son bilan un montant similaire. Mais le point crucial est que ces montants sont calculés sur la durée résiduelle des contrats de location opérationnelle ou financière.
Quand on calcule le ratio dettes financières et bancaires nettes/EBE, on a au dénominateur un EBE dont on pense qu’il est à peu près récurrent, modulo la conjoncture et la rentabilité des investissements en cours. Ce qui donne sa pertinence à ce ratio en permettant d’estimer au bout de combien d’années la dette est éteinte si la totalité de l’EBE est consacrée à cet objectif.
Avec IFRS 16, Orpéa ajoute à ses dettes bancaires et financières nettes classiques ses dettes de location sur une durée de 9,3 ans au 30 juin 2021, pour un montant de 3 020 M€. Pourquoi 9,3 ans ? Parce qu’au 30 juin 2021, dernière publication financière d’Orpéa avant l’irruption du scandale, l’échéance moyenne des contrats de location simple et financière était de 9,3 ans.
Le plus probable est bien sûr qu’au bout de 9,3 ans, ces contrats soient renouvelés, car sinon l’activité d’Orpéa, et son EBE, chuteraient significativement. Mais de cela IFRS 16 ne tient nul compte. En effet, sa lecture est juridique (quelle est l’échéance du contrat de location ? 9 ans en France par exemple avec des contrats 3-6-9), et non économique : pour que l’activité se maintienne, il faudra bien que ces contrats soient renouvelés ou que Orpéa signe de nouvelles locations pour des volumes immobiliers similaires afin de continuer d’héberger ses clients et employer son personnel. À activité constante, le volume de locations est constant et non limité à la durée des contrats en cours.
Autrement dit, dans le calcul du ratio dettes nettes/EBE, on ne prend au numérateur, post IFRS 16, que la dette de location sur 9,3 ans alors que l’on estime implicitement que l’EBE du dénominateur se poursuit à l’infini dans une logique de continuité de l’exploitation. Ce qui constitue une grave erreur de raisonnement contre laquelle nous avions mis en garde nos lecteurs[4]. Le seul raisonnement correct à ce niveau, à défaut de détricoter complètement les effets de IFRS 16 sur les comptes, serait de prendre la dette de location non pas sur 9,3 ans, mais sur l’infini, pour être homogène avec le raisonnement fait sur l’EBE. Une estimation rapide montre qu’il faut alors ajouter environ 12 600 M€ (sic) et non les 3 020 M€ effectivement ajoutés au 30 juin 2021 par les normes IFRS.
Comme tous les analystes financiers actions dont nous avons pu consulter les travaux raisonnent post IFRS 16 dans leurs calculs du niveau d’endettement, ils n’ont pas trouvé celui-ci insupportable pour une société avec une très forte composante immobilière (47 % des actifs sont en pleine propriété). Le ratio qu’ils calculent, en reprenant tel quel les données comptables, est en effet au 30 juin 2021 de 10,0[5] (sur la base de l’EBE des 12 derniers mois de 986 M€). Avec cette logique de considérer les contrats de location comme des dettes, la réalité économique et financière est que ce ratio est de 19,7[6], soit le double de celui trouvé par les analystes actions, correspondant à un niveau écrasant !
Par ailleurs, continuant de raisonner post IFRS 16, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la plupart des analystes financiers actions ont retenu dans leur calcul du passage de la valeur de l’actif économique à la valeur des capitaux propres un montant d’endettement IFRS 16 largement sous-évalué (3 020 M€, contre 12 600 M€), conduisant à une surévaluation de leur estimation de la valeur de l’action. En effet, les EBE actualisés à l’infini dans leurs calculs de DCF reposaient sur des EBE post IFRS 16, c’est-à-dire sans loyers, alors que la dette retirée ne prenait en compte la dette des loyers que sur 9,3 ans, et non pas sur l’infini.
Il en était de même dans la méthode des multiples, avec un actif économique évalué sur la base d’un EBE avant loyer, multiplié par un multiple de l’EBE, sous déduction d’un endettement net incluant une dette IFRS 16 limitée à 9,3 ans.
On remarquera que la perte de valeur que supportent les investisseurs dans le plan de sauvetage annoncé est de l’ordre de 8,8 Md€[7], sans compter la baisse de la valeur de la dette sécurisée qui sera moins rémunérée, ce qui n’est pas très différent du supplément de dettes IFRS 16 non vu par les analystes actions (9,5 Md€).
* * *
Si les analystes financiers actions avaient détricoté IFRS 16, en revenant à la situation où l’on considère un loyer sur une location opérationnelle comme une dépense d’exploitation, et non un élément gonflant l’EBE, auraient-ils été plus efficaces ?
Nous avons des raisons de le penser, car ce travail les aurait conduit à retraiter les comptes au lieu de les prendre pour argent comptant, et à s’apercevoir, ce faisant, que l’EBE d’Orpéa était maintenu par un changement significatif de la politique immobilière du groupe qui conduisait à le doper à court terme, mais à le réduire dans le futur. Malheureusement, aucun des analystes actions ne semble avoir pris conscience de ce fait.
Orpéa avait annoncé un objectif de porter la proportion de ses établissements dont il était propriétaire à 50 %, le solde étant loué. C’est ainsi que cette proportion était passée de 47 % en 2018 à 49 % en 2019. Mais au 30 juin 2021, le ratio est retombé à 47 %. Pourquoi ?
Parce qu’Orpéa a souhaité dégager des plus-values pour maintenir sa marge d’EBE mise à mal par la hausse des frais de personnel post-covid :
On voit très bien dans le compte de résultat, dépollué des effets d’IFRS 16, que si la valeur ajoutée (après le versement des loyers) se maintient à environ 73 % des ventes, et que l’EBE est stable à environ 17-18 % des ventes, malgré des frais de personnel qui bondissent de 53 à 57 % entre 2018 et le premier semestre 2021, c’est bien parce que le poste « Autres » bondit de 0,4 % à 3,9 %. Or ce poste inclut les plus-values sur cessions de murs, Orpéa devenant locataire de murs que le groupe possédait.
Deux remarques à ce niveau, dont les effets se cumulent. Primo, vendre des murs pour dégager des plus-values, tout en devenant locataire, revient à accroître la part des loyers ce qui conduit à réduire l’EBE futur, en montant absolu et en pourcentage des ventes. Secundo, si nous n’avons pas de problèmes à considérer, par exemple, que les plus-values que font les loueurs de voitures lorsqu’ils les revendent au bout de 6 mois font partie de leur exploitation, le cas est bien différent avec les murs d’EPHAD et de cliniques d’Orpéa. En effet, les cessions des murs ne peuvent pas être récurrentes car, à en céder régulièrement pour maintenir le niveau d’EBE, il viendra un moment où il ne restera plus de murs à céder.
Tout ceci nous fait penser que la qualité de l’EBE d’Orpéa se dégradait nettement, ce qui doit conduire l’analyste qui réfléchit à abandonner ce critère qui n’est qu’une approximation pratique du flux de trésorerie d’exploitation, pour se concentrer alors sur l’original, le flux de trésorerie d’exploitation.
Sur les 12 derniers mois[8], celui-ci était de 294 M€. Face à un endettement bancaire et financier net de 7 435 M€. Soit 25 fois plus. Comment peut-on imaginer qu’un flux de trésorerie d’exploitation de 294 M€, qui est avant tout investissement d’entretien ou de modernisation[9], puisse faire diminuer la dette nette ? Le niveau d’endettement était clairement insoutenable, et Orpéa était dans une fuite en avant avec des investissements importants de croissance interne et externe (2 950 M€ entre 2018 et 2020), avec seulement 650 M€ de flux d’exploitation sur le même période, nécessitant un recours croissant à l’endettement. Ceci alors même que sa rentabilité économique déclinait de 4 % à 2 %, bien loin d’un coût du capital à 6-7 %, et au niveau du coût de son endettement. L’inversion de l’effet de levier était très proche.
* * *
Dans la seconde partie de cet article à paraître dans La Lettre Vernimmen de mars, nous analyserons d’autres erreurs mineures commises par les analystes actions – pour que vous évitiez de les faire à votre tour – et regarderons comment les analystes dettes ont pu se fourvoyer eux aussi, alors même qu’ils avaient évité le piège IFRS 16 en en excluant les effets sur les comptes comme nous le préconisons.
[1] Bank of America, Berenberg, Bryan Garnier, CIC, Exane BNP Paribas, Gilbert Dupont, HSBC, Jefferies, Kepler, Oddo BHF, Portzamparc, Société Générale, et Stifel. Nous n’avons pas eu accès aux notes publiées par HSBC et Stifel.
[2] Voir en particulier La Lettre Vernimmen.net no 166 de mars 2019, ou le Vernimmen 2023, p. 152 et suivantes.
[3] En effet, une entreprise entre dans une location simple quand elle veut simplement disposer d’un bien, sans vouloir l’acquérir. Elle entre dans une location financière quand elle souhaite, au terme du contrat, acquérir le bien en question pour un prix modique compte tenu des loyers déjà payés qui reviennent à étaler le paiement de l’acquisition dans le temps, comme dans un crédit-bail. Il s’agit donc d’une modalité de financement de l’actif. Comptabiliser de la même façon, en ajoutant à l’actif la valeur du bien en location et au passif la valeur actuelle des engagements de loyers, nous parait contraire au bon sens puisque l’intention de l’entreprise est radicalement différente dans les deux cas : avoir la flexibilité de la location sans vouloir acquérir le bien, versus acquérir le bien en crédit-bail.
[5] (6.841 + 3.020) / 986.
[6] (6.841 + 12.600) / 986.
[7] 99,6 % de la capitalisation boursière, soit environ 5,8 Md€ sur la base d’un cours de 90 € et 70 % de la dette non sécurisée de 3,8 Md€.
[8] Second semestre 2020 et premier semestre 2021.
[9] Les dotations aux amortissements sont de l’ordre de 300 M€, ce qui donne une idée du montant des investissements de maintien.
Actualités : Une nouvelle formation en ligne pour aller au-delà de l'ICCF@HEC Paris
Il y a 8 ans, nous lancions avec HEC Paris et First Education Online une formation totalement digitale à la finance d’entreprise reprenant nos cours fondamentaux de finance à HEC. Le succès fut au-delà de nos espoirs avec, à ce jour, plus de 8 500 personnes formées.
Le 24 avril prochain, un nouveau programme de certification en ligne, développé par HEC Paris et Education Online, « M&A, Ingénierie et Financements » - ICCCF2@HEC Paris, sera lancé.
Dans la continuité des méthodes et des pratiques pédagogiques qui ont fait le succès de l’ICCF, ce nouveau programme met l’accent, de façon très concrète et opérationnelle, sur :
- Les fusions-acquisitions : pourquoi et comment réaliser une opération de cession ou de rapprochement d’entreprise ? Quel process utiliser ? Comment structurer la transaction, sur quoi et comment négocier ? Comprendre les OPA, savoir financer et intégrer une acquisition.
- Les opérations en capital et les levées de fonds : connaître et fédérer ses actionnaires notamment dans un pacte d‘actionnaires, faire appel au private equity, savoir mener une IPO, une scission, un retrait de cote…
- Les financements, en particulier de dette : choisir le bon financement parmi les dettes bancaires, les dettes obligataires, les financements hybrides, les obligations convertibles ou les financements verts et durables et comprendre les enjeux et la pratique du « restructuring ».
Le programme est animé par Marc Vermeulen, professeur associé de finance à HEC Paris et ancien banquier d’investissement et de financement, assisté de Juliette Laquerrière, directrice financière adjointe du Groupe Bolloré, et Michael Loy, professeur de droit à HEC Paris et juriste d’entreprise spécialisé en fusions-acquisitions.
Répartie sur 18 semaines, la formation alterne cours en ligne, accompagnement en continu, et cas pratiques.
Pour en savoir plus/pour s’inscrire cliquez ici.
Tableau : Le marché des changes
Le marché des changes (FX) représente des volumes moyens quotidiens de 7 506 Md$ répartis entre les produits suivants :
Source : BRI.
Les swaps de change représentent la majorité des volumes, les transactions au comptant n’en représentant que 28 %.
La part des entreprises a diminué dans le temps depuis 2007 et ne représente plus que 5,7 % des volumes quotidiens mondiaux :
Source : BRI.
Les volumes de transactions ont presque doublé depuis 2010 (et ont été multipliés par près de 10 depuis 1992). La croissance a été largement alimentée par l'augmentation des swaps contractés par les institutions financières :
Source : BRI.
New York et Londres représentent plus de 50 % des transactions.
Les devises les plus actives sont le dollar américain (88 % des transactions de change ont une composante en dollars), l'euro, le yen, la livre sterling et le renminbi.
Recherche : Les clients des fonds mutuels (SICAV, FCP) sont-ils vraiment « smart » ?
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
Il est usuel de considérer que les clients des fonds mutuels sont des investisseurs plus sophistiqués (smart investors) que ceux qui se contentent de déposer leur épargne sur des livrets bancaires, des comptes à vue ou des comptes en euros. L’écrasante majorité de ces clients est formée de ménages (plus de 90 % depuis l’an 2000 sur le marché américain). Leur comportement d’investissement répond-il vraiment au principe financier de rationalité davantage que celui observé dans la moyenne de la population ? Les modèles théoriques considèrent presque toujours que la concurrence entre les fonds se joue sur leur performance financière effective compte tenu du risque, autrement dit sur l’alpha généré sur le long terme par les fonds. Tel devrait être le cas si les clients étaient rationnels. L’article que nous présentons ce mois[1] apporte des éléments empiriques forts en défaveur de cette hypothèse : les clients des fonds mutuels semblent peu rationnels. Ils investissent naïvement selon la performance absolue des fonds sans tenir compte des effets liés aux mouvements de marché, et en ignorant les modèles d’évaluation.
La première partie de l’article porte sur les critères utilisés par les clients dans leur choix d’investissement. Il apparaît que les deux critères les plus suivis sont la note attribuée par Morningstar et la performance passée. L’effet de performance est observé tant en coupe transversale (les clients se dirigent vers les fonds ayant été performants) qu’en série temporelle (les montants investis augmentent après une période de hausse des marchés). En série temporelle, la performance passée explique 15,9 % des montants versés et constitue le seul critère statistiquement significatif. En particulier, l’alpha généré par les fonds n’a pas de conséquence sur les investissements.
Un élément particulièrement convaincant identifié par les auteurs concerne le comportement des clients des fonds passifs. Ils retrouvent les mêmes mouvements liés à la performance passée, alors que les fonds se contentent de répliquer un indice. Par ailleurs, les flux vers les fonds actifs et passifs augmentent conjointement suivant les périodes de hausse des indices. Les clients se comportent comme s’ils supposaient que la performance passée présumait de la performance future, quels que soient les conditions de marché ou le risque pris, et même lorsque le fonds est géré passivement.
Concernant le choix entre fonds actifs, la note Morningstar exerce aussi une influence significative. Le fait d’avoir la note maximale (5 étoiles) compte bien davantage que l’alpha obtenu, quel que soit le modèle d’évaluation retenu. En 2002, le système de notation Morningstar a connu une révision importante. Après la réforme, les fonds ont été notés selon le style d’investissement (value ou growth, large ou small caps), alors que cet élément était précédemment ignoré. Cette catégorisation permet de retirer de la note les effets liés à la surperformance d’un style pendant une période donnée. Les auteurs montrent que la réforme n’a pas eu de conséquence sur la manière dont les clients intègrent la note Morningstar dans leur choix d’investissement. Lorsque la note augmente, les flux vers le fonds concerné augmentent autant que précédemment (d’environ 0,5 % par mois), alors même que la méthode de calcul a changé. Si le suivi de Morningstar n’était que la conséquence de sa corrélation avec la compétence effective des gestionnaires, la réforme aurait dû modifier l’effet de la notation sur les comportements d’investissement.
L’intérêt de cet article réside en une prise de position très nette, et empiriquement fondée, sur une question non tranchée de la littérature financière : les clients des fonds mutuels fondent-ils leurs choix d’investissements sur des critères de performance financièrement reconnus ? Pour les auteurs, la réponse est clairement négative. Les flux vers les fonds mutuels sont expliqués par les signaux les moins sophistiqués : performance passée et note Morningstar considérée indépendamment de la méthodologie. Les théoriciens qui fondent leurs modèles sur des hypothèses de forte rationalité des investisseurs devront peut-être revoir leur copie…
[1] I. Ben-David, J. Li, A. Rossi et Y. Song, « What do mutual fund investors really care about? », Review of Financial Studies, 2021, vol. 35-4, pages 1723 à 1774.
Q&R : Qu'est-ce qu'un ARR financing, Annual Recurring Revenue Based Financing ou financement sur revenus récurrents ?
Dans le chapitre 42 du Vernimmen sur les start-ups, nous insistons sur le fait que, sauf exception (principalement financement de l’immobilier et des créances clients), les start-ups ont vocation à être financées par des capitaux propres et non par de la dette. En période faste (comme l’a été l’année 2021 pour le capital-risque), les financiers redoublent d’inventivité pour pousser les limites de cette assertion. Ainsi, certains prêteurs se sont aventurés sur le terrain des jeunes pousses pas encore rentables, mais prometteuses, et dont le modèle économique donnait une forme de visibilité. Ainsi se sont développés des prêts à des sociétés affichant un niveau de revenus récurrents (sécurisés par des abonnements ou des contrats long terme) et proche de l’équilibre financier.
Initialement (dans les années 1990-2010), il s’agissait aux États-Unis de prêts de quelques centaines de milliers ou quelques millions de dollars à de petites start-ups, amortissables et offrant des rentabilités de 30 à 40 %. Maintenant, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe, les ARR financings désignent des prêts plus importants, in fine, d’une durée de 5 à 7 ans, assez proches des prêts unitranches[1] mis en place dans le cadre de LBO. Leur coût est aussi plus raisonnable, mais néanmoins tout de même compris entre 5 et 10 % au-dessus du taux sans risque !
Ils sont assis sur un covenant rapportant l’endettement aux revenus annuels récurrents (sécurisés contractuellement), ratio qui a vocation à moyen terme (2 à 3 ans) à se transformer en un classique ratio endettement / EBE quand l’entreprise devient rentable, l’endettement prenant alors la forme d’un endettement unitranche classique.
Durant la première phase, le covenant de ratio est accompagné d’une clause de liquidité minimum pour s’assurer que l’entreprise a assez de cash pour continuer ses opérations. Toujours durant cette première phase, l’entreprise bénéficie d’un différé pour le paiement des intérêts (PIK). Le financement est sécurisé par un engagement des actionnaires (généralement un fonds de venture capital) de réinjecter du capital en cas de bris des covenants – l’equity cure. Sans cette clause, très peu de prêteurs s’aventureraient dans un tel financement. Ces opérations restent néanmoins très risquées et sont réservées à des fonds de crédit (direct lenders) et non à des banques.
Au début des années 2020, les montants prêtés étaient compris entre 1 et 3 fois le montant des revenus annuels récurrents (1-2x en Europe et 2-3x aux États-Unis). Le retour à la raison pour les valeurs technologiques de mi-2022 a mis un coup d’arrêt à ces opérations… pour l’instant (tout comme l’essentiel des opérations avec un fort effet de levier).
[1] Pour plus détails sur les prêts unitranches, voir le chapitre 49 du Vernimmen 2023.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière, des réponses à des questions qui nous sont posées ou des citations.
En voici quelques-uns :
L'étrange communication de la Société Générale sur sa politique de retour aux actionnaires
À l’occasion de la publication de ses résultats 2022, SG annonce une politique de distribution aux actionnaires avec un dividende de 1,7 € par action et un programme de rachat d’actions de 440 M€, « équivalent à environ 0,55 € par action ». Curieux pour le moins, et à notre avis pas honnête intellectuellement, de mettre sur le même pied, en € par action au titre d’une « politique de distribution aux actionnaires », un dividende de 1,7 € reçu par tous les actionnaires et 0,55 € par action de rachat d’actions que ne toucheront pas les actionnaires. En effet, même les actionnaires qui vendront leurs actions, et qui seront acquises par SG, sans qu’ils ne le sachent et par hasard (vu les volumes d’échanges enregistrés quotidiennement sur cette action), ne toucheront pas 0,55 €, qui est un chiffre qui n’a pas de signification financière car c’est diviser des choux par des carottes !
Il est bien sûr plus sympathique d’annoncer 1,7 € + 0,55 € = 2,25 €, calcul que ne donne pas SG qui se contente de pousser implicitement le lecteur de son communiqué à le faire, que simplement 1,7 €. Mais il y a des limites au pouvoir des communicants, au risque d’entamer sa crédibilité. Le seul chiffre qui compte dans ce domaine est la somme totale en M€ des dividendes et des rachats d’actions, soit 1,8 Md€. Et là, les investisseurs ont été pris à contre-pied car SG laissait anticiper un taux de retour aux actionnaires d’au moins 50 % comme l’année précédente. Et comme les résultats 2022 étaient meilleurs qu’en 2021... Rapporté à un résultat net récurrent 2022 part du groupe de 5,6 Md€, le compte n’y est pas d’un milliard.
Non pas que les actionnaires soient assoiffés de dividendes ou de rachats d'actions, tels des sangsues, mais ils savent que la rentabilité marginale des capitaux propres réinvestis, au-delà des niveaux requis par les normes prudentielles, est actuellement de 2 %, soit le taux du marché monétaire, et largement inférieure au coût du capital de SG. Or, SG dispose d’un ratio CET 1 de 13,5 %, au-dessus de ces minimums, BNP Paribas est à 12,3 %. SG cotant le tiers de ses capitaux propres comptables (22 Md€ contre 66 Md€), le milliard non distribué par SG ne se traduira pas par une progression de sa valeur de 1 Md€, mais de simplement 333 M€, soit une destruction de valeur de 666 M€. On comprend alors mieux pourquoi, malgré de bons résultats, le cours de SG a reculé le jour de la publication de ses résultats de 5 %, le plus fort recul du CAC 40, dans un marché stable.
Une bonne leçon pour ceux qui ont oublié qu’une politique de retour aux actionnaires se juge naturellement à l’aune de la rentabilité des investissements marginaux que peut faire l’entreprise.
Très intéressants résultats trimestriels de Procter & Gamble
Procter & Gamble vient de publier les résultats de son trimestre clos le 31 décembre qui montrent un recul du chiffre d’affaires trimestriel de 1 %. Mais on aurait bien tort de s’arrêter à ce chiffre, car sa décomposition est très illustratrice de la conjoncture économique actuelle. Le -1 % résulte de trois effets principaux :
- Un effet prix de prix de + 10 %, car P&G a augmenté ses prix peu ou prou de l’inflation compte tenu de la force de ses marques.
- Un effet volume de -6 %, car les consommateurs ont réduit leur consommation de produits P&G, probablement pour acheter des produits moins chers comme ceux des marques de distributeurs. D’ailleurs, la baisse en volume est la plus forte dans les divisions Fabric & Home Care (Ariel, Cash, Lenor), et Grooming (Braun et Gillette), -7 et -8 %, là où les hausses de prix ont été les plus fortes : 13 et 11 % respectivement.
- Un effet devise de -6 %, compte tenu de la force du dollar depuis un an.
On notera un taux effectif d’impôt sur les sociétés de 18 %, venant de 19 %, qui laisse songeur, quand on sait que les principaux pays où P&G exerce son activité ont tous des taux d’impôt sur les sociétés à des taux supérieurs, et que son principal concurrent, L’Oréal, était à 22,5 % au premier semestre 2022. À cette aune et sur un an, c’est environ 1 Md$ qui est perdu par les administrations fiscales du monde, au titre du seul P&G.
Renault-Nissan : divorce au fond de la classe
Présenté comme un nouveau départ de l’alliance entre Renault et Nissan, les termes du nouveau partenariat s'apparentent, nous semble-t-il, à un divorce entre deux acteurs qui, d’un point de vue financier, se sont marginalisés au cours du temps, avec des capitalisations boursières respectives de 11 et 13 Md€, à comparer à 4 fois plus pour Stellantis (Peugeot, Fiat, Chrysler), 46 Md€, et 14 fois plus pour Toyota (180 Md€).
Au classement 2021 des ventes de voitures, l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi apparaît 3e mondiale avec 7,7 M de véhicules vendus, versus 10,5 M pour le 1er (Toyota) et 8,9 M pour Volkswagen. Sur cette base, Renault, seul, va pointer à la 10e place, et Nissan à la 8e, plus en rapport avec leur capitalisation boursière.
Certes, en vendant progressivement 28 % de Nissan, Renault peut récupérer au cours actuel un peu moins de 4 Md€, mais ce n’est que le sixième du flux de trésorerie d’exploitation de Stellantis en 2022… et, bien sûr, un montant non récurrent.
La triste morale de cette histoire est double. Des schémas alambiqués et des gouvernances bancales conduisent rarement à des réussites industrielles, et encore moins financières. Trop compliqués, synergies non dégagées, prés carrés protégés, susceptibilités nationales entretenues par la coexistence de deux entités. Par ailleurs, il fait rarement bon d’être actionnaire aux côtés de l’État quand celui-ci est en direct, comme les Agnelli ont eu l’intelligence de le comprendre en cassant une négociation avancée de fusion avec Renault pour se marier avec Peugeot et créer Stellantis, face aux atermoiements de l’État, premier actionnaire de Renault.
Quant à ceux qui s’inquiètent pour comprendre comment Renault va remplacer la fraction des dividendes de Nissan qui vont disparaître de son résultat, qu’ils se rassurent. Ce n’est pas le sujet. Le sujet est industriel avant tout. Le produit de la vente des 28 % sera réinvesti dans les activités de Renault et générera des résultats supérieurs à la quote-part des dividendes perdus, si les investissements entrepris rapportent leur coût du capital.