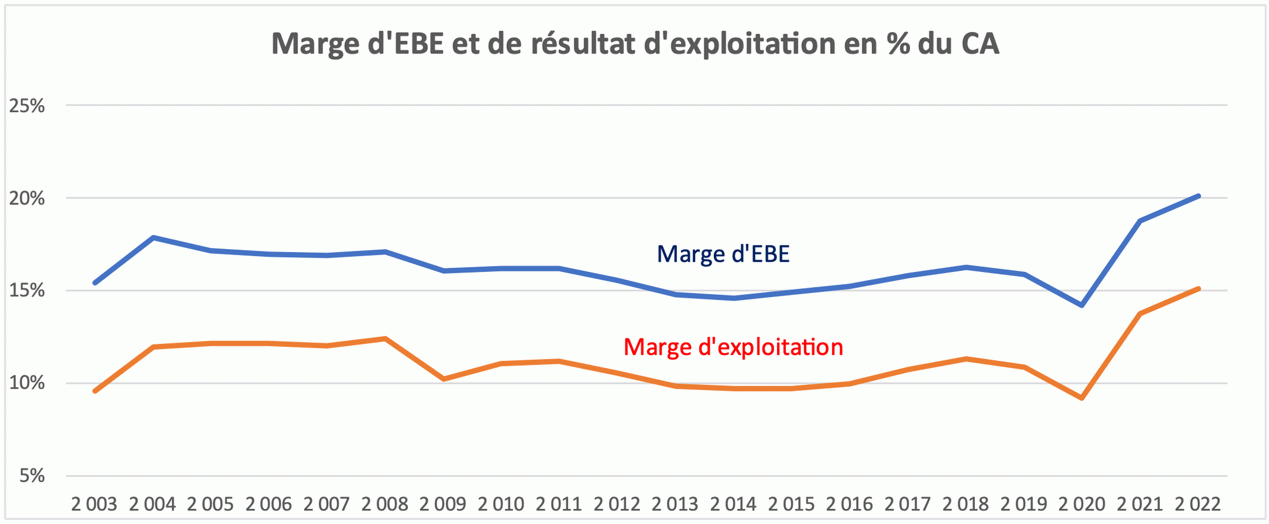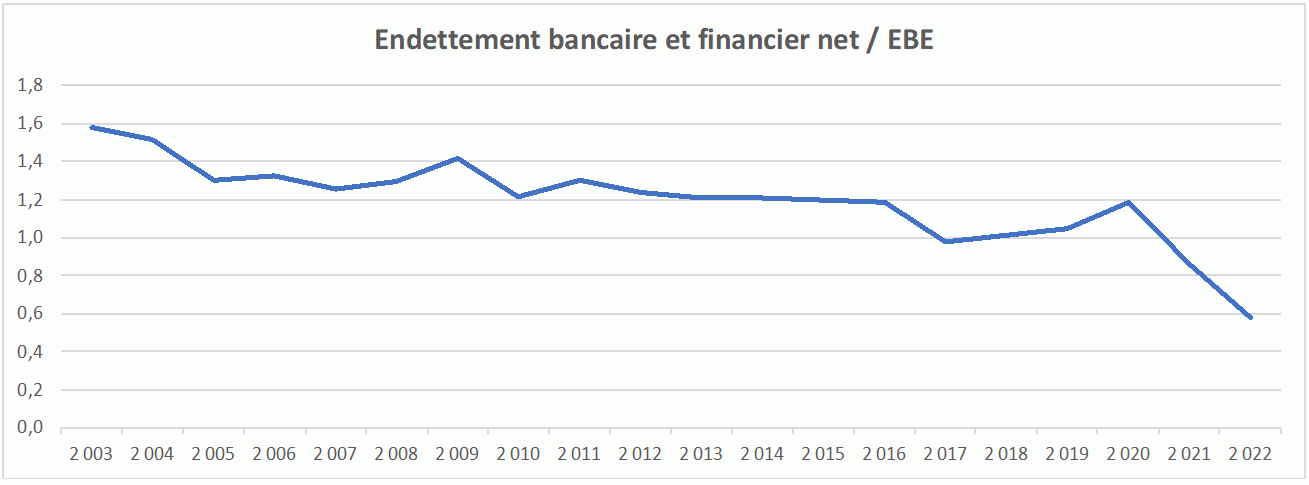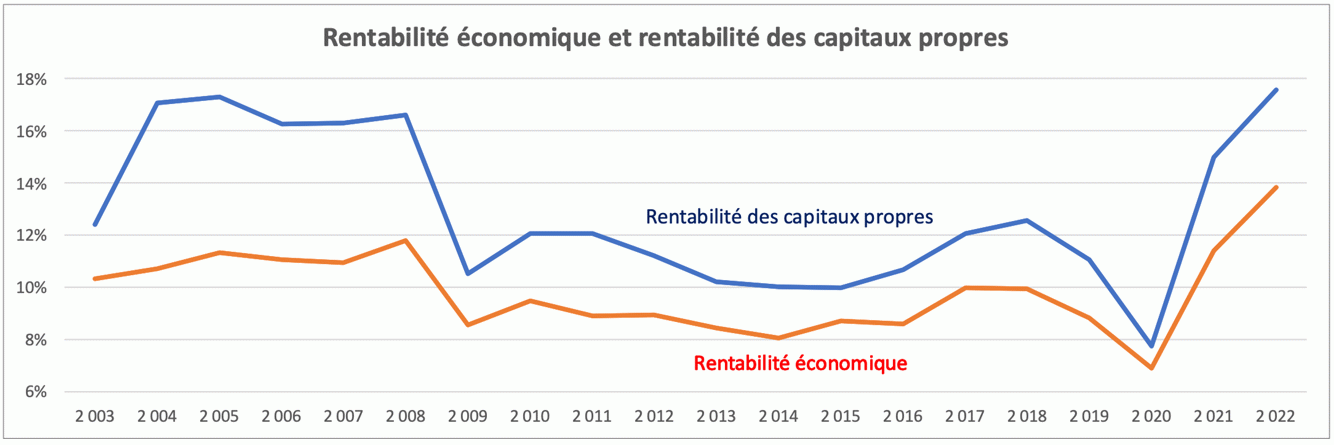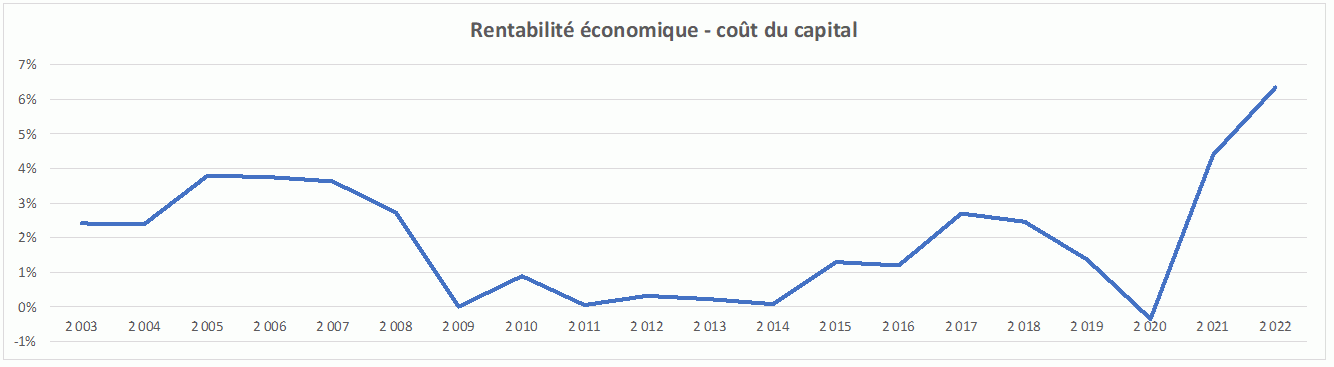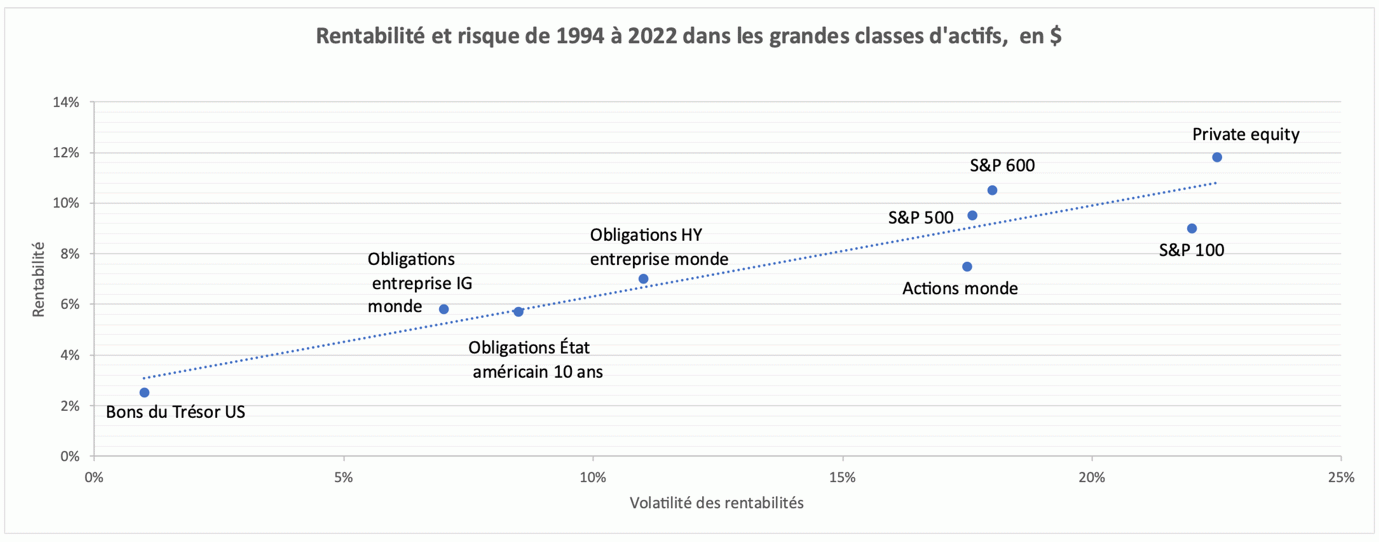La Lettre n°208 de Mai 2023
Actualités : L'analyse financière du CAC 40 depuis 2003
Grâce aux données que nous a fournies BNP Paribas Exane, nous nous sommes penchés sur les évolutions sur 20 ans des membres du CAC 40 actuel, comme s’ils avaient été membres du CAC 40 dès 2003, ce qui n’est pas le cas de tous. Cette composition stable de l’échantillon permet d’éviter les effets de changement de la composition de l’index qui, sur la période, aurait surtout concrétisé la montée des services et de l’industrie légère au détriment de l’industrie lourde avec les départs de Holcim-Lafarge, Solvay, Vallourec, Alcatel, et les arrivées de Publicis, Essilor, Legrand, Hermès, Dassault Systèmes, Teleperformance, Worldline et Eurofins[1]. Ce choix induit un biais positif sur les résultats que nous allons présenter puisque les groupes du CAC 40 qui avaient de moins bons résultats à un moment donné sont sortis de l’indice et ne figurent pas dans notre étude.
Bien sûr, les groupes financiers et immobiliers sont hors champ de l’analyse tant leurs comptes diffèrent. L’étude est donc concentrée sur les 34 groupes non financiers et non immobiliers de l’indice.
On gardera en tête que 2003 est un point bas du cycle alors que 2022 a toutes les chances d’être un point haut ; et on ne sera pas surpris que nous retenions comme plan de notre analyse celui que nous préconisons au chapitre 9 du Vernimmen.
L’analyse des marges
Le taux de croissance du chiffre d’affaires du CAC 40 depuis 2003 est de 4,1 %, ce qui finalement est peu avec une croissance mondiale de l’ordre de 3 % en volume sur la période et une inflation moyenne d’au moins ce taux dans le monde, ou de 1 à 2 % dans la zone euro. Ceci alors que les opérations de croissance externe ont été nombreuses. Depuis 2019 toutefois, la croissance annuelle s’est accélérée à 6,8 % (aidée par une inflation plus soutenue).
Il est vrai que la performance du trio de tête, qui faisait 37 % des ventes de 2003 (TotalEnergies à 105 Md€, Carrefour à 70 Md€ et Orange à 46 Md€) est très médiocre : + 4,6 % par an pour TotalEnergies, + 0,8 % pour Carrefour et – 0,4 % pour Orange qui n’a réalisé l’an passé que 43 Md€ de ventes, soit 3 Md€ de moins qu’en 2003. 8 groupes ont dépassé Orange en ventes en 2022[2] et le trio de tête de 2003 ne représente plus aujourd’hui que 29 % du chiffre d’affaires cumulé 2022. Quant au nouveau trio des ventes de 2022, avec LVMH à la place d’Orange, il représente 32 % des ventes.
Concernant les marges proprement dites, ce qui est frappant est qu’il a fallu aux 34 meilleurs groupes français, ou peu s’en faut, 11 ans pour retrouver le niveau de marge d’EBE de 2008 (17,1 %) et 13 ans pour retrouver le niveau de marge d’exploitation de 2008 (12,1 %). C’est dire la violence indirecte de ce choc financier, que la politique budgétaire européenne plutôt restrictive dans les années suivantes n’a pas contribué à atténuer.
Quant aux marges de 2022, elles ont toutes les chances d’être des marges de haut de cycle, comme l’indiquent les anticipations pour 2023 en recul de 1,3 point de marge pour les 2 marges, d’autant que, même au sein du CAC 40, les arbres ne montent pas au ciel.
Mais les marges requièrent des investissements.
Les investissements
Ils sont d’abord en immobilisations puisque celles-ci représentaient en 2022 99 % de l’actif économique qui totalise 1 020 Md€ (laissant au BFR 1 %), contre 92 % en 2003.
Hors les impacts de la norme IFRS 16 sur les locations qui pollueraient intempestivement une nouvelle fois les raisonnements si on ne les éliminait pas [3], les investissements organiques sont de 27 % supérieurs aux dotations aux amortissements, ce qui est cohérent avec le profil de croissance et explique que les immobilisations aient été multipliées par 2,6 sur la période contre 2,2 pour le chiffre d’affaires.
Le BFR, qui ne représente que 1 % de l’actif économique moyen, passe de – 6 jours de ventes en 2003 à 4 jours en 2022, chiffres collectivement assez peu significatifs. Plus intéressant : la proportion de groupes avec un BFR négatif qui passe de 10 à 17, soit la moitié de l’échantillon. Orange, qui faisait à lui tout seul 100 % du BFR négatif de 2003 (– 12 Md€), a divisé par plus de trois cette ressource de trésorerie.
Et les investissements doivent être financés.
Le financement
Les flux d’exploitation, au sens de l’excédent de trésorerie d’exploitation dégagé par l’activité, se sont élevés depuis 2003 à 2 872 Md€. Les groupes du CAC 40 ne peuvent affecter librement cette somme qu’après versement de leurs impôts sur les sociétés (513 Md€), soit 18 % du flux d’exploitation et des versements des frais financiers aux prêteurs pour 234 Md€, soit 8 %. Restent donc 74 % du flux d’exploitation dont 51 % sont consacrés à l’investissement : 41 % à l’investissement organique (1 172 Md€) et 11 % (306 Md€) à la croissance externe payée en cash nette des cessions (la croissance externe payée en actions n’apparaissant pas dans les flux). Le solde de 647 Md€, une fois déduit un désendettement net pour 59 Md€, correspond pour l’essentiel au versement de dividendes et aux rachats d’actions nets des augmentations de capital pour un montant de 616 Md€, soit 21 % du flux d’exploitation dégagé par les entreprises.
On notera que si les augmentations de capital sont moindres de 25 Md€ que les rachats d’actions depuis 2003, à chaque fois que la conjoncture économique ou financière requérait un surcroît de capitaux propres, les actionnaires ont répondu présent : en 2003 pour Alstom (0,6 Md€) et Orange (28,5 Md€ afin de refinancer des acquisitions payées par dettes quelques années auparavant) ; en 2008-2009 pour Pernod Ricard (1 Md€), Danone (3,1 Md€), ArcelorMittal (2,1 Md€), Saint-Gobain (1,9 Md€) ; 3,3 Md€ pour Air Liquide en 2016 ; en 2020 pour Alstom (2 Md€), ArcelorMittal (1,3 Md€) ou Eurofins Scientific (0,5 Md€) ; et encore récemment pour Veolia (2,5 Md€) en 2022.
On est donc loin de la caricature qui voudrait que les actionnaires des groupes du CAC 40 les pressurent pour obtenir des dividendes ou des rachats d’actions trop copieux au détriment des investissements. Cette position idéologique ne correspond pas à la réalité des faits et des chiffres, ni à la réalité tout court.
Au demeurant si elle était juste, on aurait du mal à expliquer comment les groupes du CAC 40 peuvent avoir une capitalisation boursière cumulée (2 469 Md€) qui dépasse celle de leurs homologues du CAC 40 allemand (1 612 Md€) ou anglais (2 129 Md€), ce qui n’était pas le cas en 2003, sauf à supposer que les actionnaires anglais et allemands sont encore plus assoiffés de dividendes et de rachats d’actions.
Sur toute la période sous revue, les groupes non financiers du CAC 40 ont consacré 49 % de leur génération organique de nouveaux capitaux propres (les résultats nets !) aux dividendes et aux rachats d’actions, le solde a été réinvesti pour financer le développement et le désendettement.
Il est vrai qu’au début de 2003, au moins trois groupes du CAC 40 présentaient un niveau d’endettement quasi mortel (Orange, Vivendi et Alstom). Aujourd’hui, tous ont une forte solvabilité comme en témoigne la décrue du ratio dettes nettes/EBE passé en 2020 de 1,6 à 0,6 qui les place en position de pouvoir saisir des opportunités futures.
Mais les rentabilités – fruits de l’interaction des marges, des investissements et des financements – doivent être correctes sur moyenne période pour assurer la survie et l’indépendance des groupes, comme l’ont illustré a contrario Lafarge, Casino, Lagardère, ou Alcatel qui ont tous quitté le CAC 40 depuis 2003[4].
Les rentabilités
Elles se décomposent en rentabilité économique et rentabilité des capitaux propres, l’écart correspondant à l’effet de levier de l’endettement qui a toujours été positif depuis 2003, de 2 à 4 points de pourcentage, compte tenu d’une rentabilité de l’actif économique toujours supérieure au coût de la dette. La rentabilité économique est calculée après un impôt sur les sociétés dont le taux moyen observé depuis 2003 est de 28 %.
De 2009 à 2014, la rentabilité économique est peu différente du coût du capital, c’est-à-dire au taux de rentabilité requis par les investisseurs pour financer l’entreprise. Peu de valeur a été créée. Même pour des leaders mondiaux, en moyenne, et la moyenne connaît une certaine dispersion en son sein, le surcroît de rentabilité en bonne conjoncture n’est que 2 à 3 points de pourcentage :
La théorie économique, qui veut que les forces de la concurrence poussent à la baisse les rentabilités excédentaires par rapport au niveau justifié par le risque, nous amène à penser que les excellents résultats de 2022 ont toute chance d’être transitoires, car une rentabilité économique de 6,7 % de plus que le coût du capital n’est pas durable. Une croissance moindre de l’activité, une baisse des prix de l’énergie (le flux d’exploitation de TotalEnergies est en baisse de 33 % au premier trimestre 2023 en comparaison du même trimestre de 2022) et un gonflement des BFR dû à l’inflation vont y contribuer, sans parler de hausses de salaires qui ont pu prendre du retard.
[1] Si nous listons plus d’arrivées que de départs, c’est que certains membres du CAC 40 ont acquis /fusionné avec d’autres comme Crédit Agricole et Crédit Lyonnais, Aventis et Sanofi, Gaz de France et Suez et qu’il y a eu aussi des sorties d’entreprises de services comme AGF ou TF1.
[2] ArcelorMittal, Airbus, Engie, LVMH, Renault, Saint-Gobain, Sanofi et Vinci.
[4] Et dont les comptes ne figurent pas, de ce fait, dans le périmètre de notre étude.
Tableau : Risque et rentabilité
Sur ce graphique construit par Les Cahiers Verts de l’Économie, la relation entre risque et rentabilité des principales classes d’actifs est éclatante avec un coefficient détermination de 87 % entre 1994-2022.
Il est intéressant de remarquer la performance comparée des actions monde et celle des grandes capitalisations boursières américaines. Les premières ont un niveau de risque marginalement plus faible compte tenu de leur diversification géographique, mais vraiment marginalement compte tenu du niveau planétaire atteint par la plupart des grandes capitalisations boursières américaines. Mais côté rentabilité, l’écart annuel de performance est de 2 à 3 points, ce qui sur 28 ans fait une différence considérable. 100 investis en actions monde donne 758 de valeur finale, contre 1 637 pour le S&P 600.
En revanche, il valait mieux détenir des obligations d’entreprise investment grade (notation supérieure ou égale à BBB-) que des obligations de l’État américain, car pour une même rentabilité, elles ont présenté un risque inférieur, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes. Quand on pense que certains évaluateurs ont fait des obligations d’État américaines l’actif sans risque du MEDAF !
La détention des seules 100 premières capitalisations boursières américaines a été sous-optimale par rapport à celles des 500 ou 600 premières, puisque la rentabilité supplémentaire de 0,5 à 1,5 % par an ainsi obtenue avec des indices plus larges l’a été avec une réduction significative de la volatilité de la performance. Enfin, tant qu’à prendre le niveau de risque du S&P 100, autant investir dans le private equity qui a rapporté depuis 1994 presque 3 points de rentabilité annuelle supplémentaire pour un risque marginalement plus élevé.
Recherche : Le retour des entreprises payant des dividendes
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
La politique de distribution de dividendes fait partie des sujets les plus mal compris en finance, qu’il s’agisse du grand public qui prend le plus souvent les dividendes pour une rémunération, des professionnels qui gèrent de façon sous-optimale les dividendes reçus[1], ou même des chercheurs qui éprouvent des difficultés à expliquer les changements de comportement des entreprises en la matière. L’article que nous présentons ce mois[2] expose de façon factuelle des changements assez spectaculaires dans cette politique depuis la fin des années 1970, sans que l’essentiel de ces changements ne puisse être expliqué par les caractéristiques des entreprises.
La principale observation de l’article porte sur un inversement de tendance en l’an 2000. Entre 1978 et 2000, les dividendes versés par les entreprises cotées américaines ont connu une baisse régulière, si bien que certains prévoyaient leur future disparition. La tendance portait tant sur la fraction d’entreprises versant des dividendes (qui est passée de 73 % à 23 %) que sur les montants versés. Par la suite, entre 2000 et 2018 (date de fin des observations, donc avant la crise Covid), la tendance s’est inversée. Sans retrouver les montants de 1978, les dividendes ont augmenté et la fraction d’entreprises en versant est passée à 36 %.
Si le versement des dividendes est l’une des politiques d’entreprise les plus facilement observables (c’est un versement de numéraire, les données sont fiables), la source des variations est difficile à identifier. Les auteurs de l’article se sont évertués à distinguer d’une part, les variations liées à des changements de caractéristiques des entreprises, et d’autre part, les variations dans les taux de versement à caractéristiques équivalentes. Entre 1978 et 2000, la disparition des dividendes est due à parts égales aux deux phénomènes. Mais depuis l’an 2000, le changement de caractéristiques n’explique que 18 % de la remontée des dividendes. Et parmi les caractéristiques testées, une seule induit une hausse des dividendes et explique ces 18 % : la réduction de volatilité des bénéfices. Ainsi, la quasi-totalité du phénomène de retour aux dividendes (82 %) est observée « toutes choses égales par ailleurs », à caractéristiques équivalentes des entreprises.
Les auteurs montrent aussi que la date d’introduction en Bourse joue un rôle important dans la tendance à verser des dividendes. Entre 1978 et 2000, le phénomène de disparition est principalement expliqué par les entreprises nouvellement introduites en Bourse (donc après 1978), ces dernières versant moins de dividendes que les entreprises déjà cotées. De même, après l’an 2000, le retour aux dividendes s’explique en grande partie par la sortie de la cote des entreprises ne versant pas de dividendes. Il y a donc un phénomène de cohorte (pour parler comme les économistes) ou générationnel dans la politique de dividendes. Précisons également que les auteurs vérifient que toutes ces observations ne sont pas la conséquence d’une simple substitution entre dividendes et rachats d’actions. En incluant les rachats d’actions, les tendances sont un peu atténuées mais les observations demeurent statistiquement et économiquement significatives.
En conclusion de cette synthèse, le lecteur fidèle remarquera que l’an 2000 fut une année d’inflexion de pas mal de tendances en finance d’entreprise. C’est en l’an 2000 que l’on a connu le plus d’entreprises cotées dans le monde, et que le private equity a commencé à connaître le succès qu’on lui connaît aujourd’hui. C’est aussi cette époque qui a vu l’explosion du succès de la gestion passive avec notamment les ETFs (Exchange Traded Funds). Au même moment, en lien avec la montée de la gestion passive, les fonds activistes se sont développés et sont devenus des acteurs majeurs de la gouvernance des entreprises cotées, même pour celles qui n’ont pas été ciblées[3]. Enfin, et l’article le montre, l’an 2000 constitue un point bas dans le versement de dividendes, et la disparition des dividendes imaginée par certains auteurs à l’époque n’a pas eu lieu car la tendance s’est inversée. Sans se lancer dans la numérologie ou croire en la magie des chiffres ronds, il est possible que la concomitance de ces phénomènes ne soit pas le fruit du hasard. Dès lors, une question resterait sans réponse : que s’est-il passé en l’an 2000 en finance pour que l’on observe autant de changements de tendances ?
[1] Voir à ce sujet « Erreur sur les dividendes : les professionnels aussi ! » dans La Lettre Vernimmen.net no 176 de février 2020.
[2] R. Michaely et A. Moin, « Disappearing and reappearing dividends », Journal of Financial Economics, vol.143-1, pages 207 à 226.
[3] Pour comprendre ce phénomène, voir l’ouvrage coécrit par l’auteur de cette chronique « Les fonds activistes : modes d’action, stratégies et résultats » par S. Gueguen et L. Melka, 2021, Dunod.
Q&R : Comment calculer le coût du capital d'une entreprise très sous-évaluée ou surévaluée ?
C’est une banalité de dire que les marchés financiers ne sont pas toujours à l’équilibre, même si les déséquilibres durent rarement longtemps. L’entreprise peut être très surévaluée comme Esker, Nio ou Rivian mi-2021, ou très sous-évaluée comme ArcelorMittal début 2020.
Un calcul du coût du capital par la méthode indirecte, comme la moyenne pondérée du coût des capitaux propres et du coût de l’endettement net, c’est-à-dire par le passif, donne alors un chiffre artificiellement bas pour l’entreprise fortement surévaluée à cause d’un coût des capitaux propres trop faible. On a alors un coût du financement bien plus faible que le taux de rentabilité à exiger sur l’actif économique compte tenu de son risque de marché que matérialise son coefficient bêta. Et inversement pour l’entreprise fortement sous-évaluée.
La seule façon d’éviter ce biais est de calculer le coût du capital selon la méthode directe, c’est-à-dire du côté de l’actif, qui doit devenir votre méthode préférée comme elle est la nôtre !
Avec ße, le bêta de l’actif économique ou bêta deleveraged en franglais.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière. En voici quelques-uns :
SMTPC, un an après
On se rappelle qu’il y a un an étaient publiés les résultats de la tentative d’expropriation de Vinci et Eiffage des actionnaires minoritaires de leur filiale cotée en Bourse SMTPC, et que c’était un échec retentissant avec 94 % des actionnaires concernés ayant refusé d’apporter leurs titres à l’OPA.
La publication des comptes 2022 de SMTPC confirme toute la fausseté du plan d’affaires bâti par les majoritaires pour exproprier à vil prix : la marge d’EBE atteint son plus haut historique à 78 % contre 73,3 % planifié ; le BFR annoncé à – 7 % des ventes est à – 20 % ; les investissements hors finalisation de la construction de la bretelle Schlœsing achevée dans quelques mois sont à 1,1 M€ contre 1,75 M€ prédits.
Alertée par des actionnaires vigilants, l’AMF n’avait pas été dupe et a imposé à Vinci et Eiffage l’interdiction de faire une nouvelle offre avant avril 2025 à un prix supérieur à celui de l’OPA ratée, minoré des dividendes versés, soit actuellement 25,1 €. Comme le cours d’hier est de 28 €, les actionnaires minoritaires n’ont pas à regretter leur choix, d’autant que dans l’intervalle, l’indice boursier a progressé deux fois moins vite.
Plus généralement, cette position novatrice et ad hoc de l’AMF pour lutter contre les offres à 2 tours (prix bas au premier tour pour ramasser les actions des naïfs ou étourdis, suivis dans les 12 mois d’une offre à un vrai prix équitable) semble produire ses effets dissuasifs, tant les émetteurs préfèrent pour l'instant proposer le bon prix du premier coup, plutôt que de prendre le risque de différer de 3 ans un retrait de cote. En effet, tous les retraits de cote annoncés depuis un an ont franchi le seuil des 90 % les permettant, montrant que le prix n’était pas mauvais. Et c’est tant mieux ainsi.
L’un des co-auteurs du Vernimmen est détenteur d’actions SMTPC.