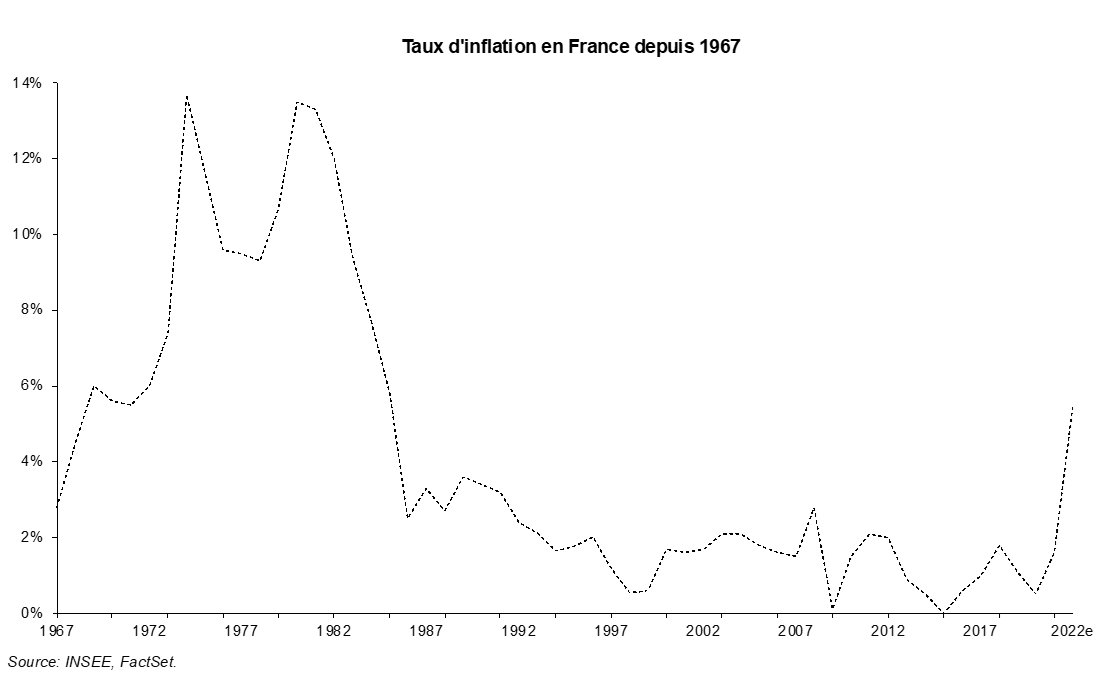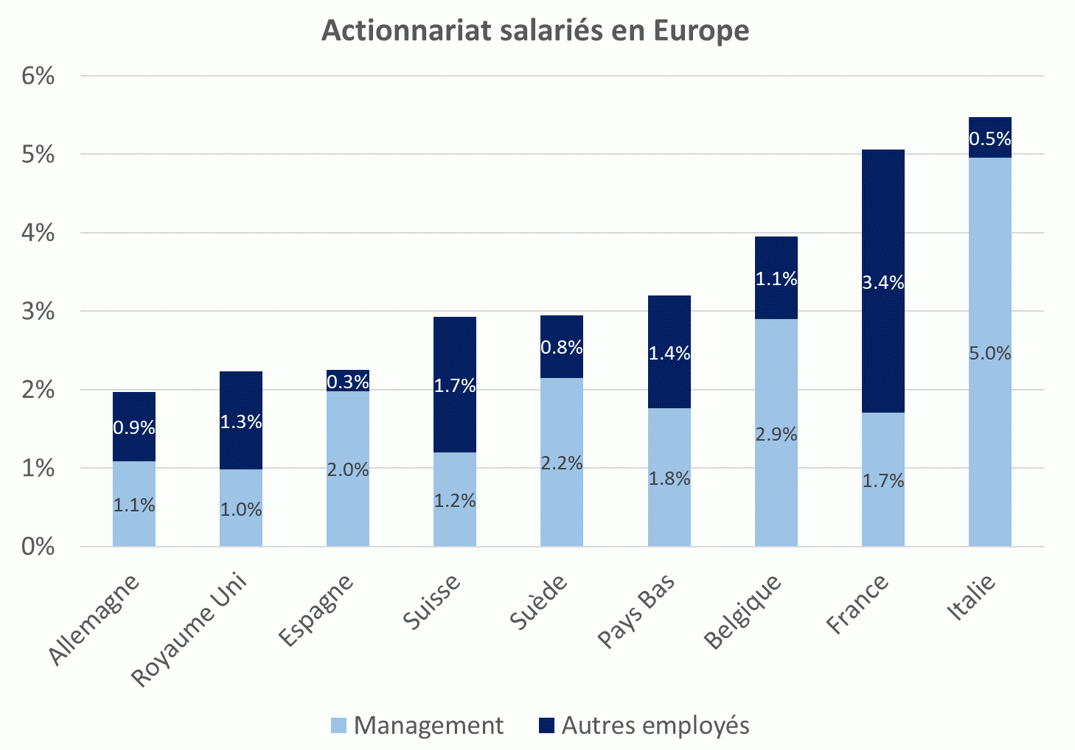La Lettre n°209 de Juin 2023
Actualités : La gestion financière en temps d'inflation (1/2)
Chaque édition du Vernimmen s’ouvre par un avant-propos consacré au traitement d’un thème d’actualité. Dans l’édition 2024, à laquelle nous mettons actuellement la dernière main, ce sera l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les entreprises. Dans l’édition en cours publiée fin août 2022, c’est la gestion financière en temps d’inflation que nous reproduisons en 2 parties dans cette Lettre Vernimmen.net et la suivante de juillet.
A l’été 2021, le consensus de marché était que l’inflation en Europe allait piquer vers 4 % en 2022, puis revenir vers sa moyenne des 30 dernières années à 2 % l’an, la désorganisation générée par la pandémie se résorbant et cessant de créer des tensions sur les prix des biens et des services.
Un an après, l’inflation en Europe atteint 8,1 % contre 7,4 % en avril, et les États-Unis sont à 8,6 %.
La normalisation attendue en 2023 est repoussée à 2024 au mieux. Beaucoup se demandent si l’inflation ne va pas se maintenir durablement à des niveaux beaucoup plus hauts que les 2 % qui ont prévalu sur les trente dernières années. Il est vrai que lorsque l’on regarde l’évolution du prix des matières premières en 2022 versus 2021, sur les 41 denrées que suit CyclOpe, seules 4 connaissent une progression de leurs prix inférieure à 10 %, et 20 sont au-delà de 49 % de hausse, 49 % étant le taux moyen de progression ! Six mois auparavant, c’était une hausse moyenne de 4 % qui était attendue pour 2022. Bref, il n’est pas infondé de se demander si nous n’allons pas entrer dans une spirale inflationniste nourrie par une ré-indexation des salaires sur le niveau des prix. Déjà le syndicat IG Metall exige en juin 2022 des hausses de salaires de 7 à 8 % pour les 3,8 M de salariés de l’électrométallurgie allemande.
Soyons francs : nous n’avons pas la compétence nécessaire pour prédire si l’inflation va revenir dans son lit pluri-décennal des 2 % en Europe ; ou si des années de hausses des prix bien supérieurs à ces 2 % auxquels nous nous étions habitués sont devant nous. Comme nos lecteurs âgés de moins de 50 ans n’ont pas connu dans leur vie professionnelle des taux d’inflation dépassant certaines années les 5 % (entre 1969 et 1985), voire les 10 % (1974 - 1983), nous nous contenterons de leur présenter ici les conséquences pour les entreprises d’une inflation forte et volatile. Ainsi, ils seront préparés en tant que de besoin.
Auparavant mentionnons deux points.
1 / La situation n’est pas identique des deux côtés de l’Atlantique. Avec un taux de chômage à 3 %, les États-Unis sont en situation de plein emploi, voire de pénurie de main-d’œuvre dans certains postes comme l’illustrent par exemple les 110 000 $ (sic) de salaire annuel versés par Walmart à ses conducteurs de camion débutants. L’inflation, de 8,6 % en mai 2022, y est nourrie par une pression salariale forte faute de suffisamment de bras disponibles, et un plan de relance en 2021 (trop) largement dimensionné (15 points de PIB).
En Europe, la situation est moins tendue sur le front du travail avec un taux de chômage de 6,8 %, et une inflation (8,1 % en mai 2022) qui s’explique principalement par la hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation, suite à la guerre déclenchée en Ukraine par l’hubris du dictateur russe.
2/ On trouve sous la plume des économistes autant d’arguments en faveur d’une flambée soutenue de l’inflation que d’un retour sous peu à la normale.
Mentionnons parmi les premiers :
• la transition énergétique qui se traduira par des coûts de l’énergie élevés pendant les prochaines années et par l’imposition de taxes carbone ou mécanismes similaires afin de financer les investissements nécessaires à cette transition énergétique et de décourager la consommation de biens ou services dont la fabrication n’est plus compatible avec l’objectif zéro émission en 2050. Sans parler des événements extrêmes causés par les déséquilibres climatiques qui ont un impact direct sur les coûts, comme la sécheresse qui augmente le prix des denrées alimentaires, moins nombreuses à être produites de ce fait ;
• le vieillissement de la population qui fait sortir du marché du travail des compétences qui sont partiellement remplacées pour les nouvelles générations aux effectifs plus réduits, et pousse à la hausse leurs salaires. D’ores et déjà 65 % des entreprises industrielles françaises disent avoir du mal à embaucher ;
• une volonté politique certaine de relocaliser près des lieux de consommation un certain nombre d’industries perçues comme stratégiques (semi-conducteurs, ingrédients pharmaceutiques, etc.) qui s’étaient délocalisées en Asie pour bénéficier, en particulier, des coûts de la main-d’œuvre moins élevés que dans le monde occidental. Au demeurant, au fur et à mesure que le temps passe l’avantage salarial de la Chine, ajusté de la productivité, se réduit sous l’effet de hausses de salaires annuels plus ou moins égales au taux de croissance du PIB chinois ;
• une volonté politique de revaloriser dans certains pays les salaires les plus bas pour lutter contre des inégalités de revenus devenues criantes et menaçant un certain niveau de cohésion sociale. Ainsi Amazon a augmenté le salaire de départ moyen à 18 $ l’heure (contre 15 $ depuis 2018) et a également déclaré qu’il paierait une prime à l’embauche de 3 000 $ dans certains endroits et que le salaire horaire pourrait atteindre 22,50 $. Il est vrai qu’ayant annoncé son intention d’embaucher plus de 125 000 employés dans ses entrepôts et pour le transport aux États-Unis, il faut bien appâter les candidats et lutter contre la grande démission. En France, le Smic augmente en 2022 de près de 6 % contre 2 % pour les autres salaires.
Tandis que pour la thèse d’une bouffée d’inflation temporaire, on trouve :
• le vieillissement de la population, eh oui ici aussi, car la consommation des seniors décline, ce qui a un effet dépressif, et car ils sont rarement favorables à des mesures politiques induisant de l’inflation qui rongent leurs retraites, et comme ils votent plus que les autres citoyens… ;
• le très faible taux de syndicalisation des salariés qui réduit leur pouvoir de négociation et leur capacité à obtenir des hausses de salaires nourrissant par ce biais l’inflation. Seuls 3 % d’entre eux dans le secteur privé européen ont des salaires directement indexés sur l’inflation ;
• la hausse des prix de l’énergie n’aura qu’un temps, et quand les prix de l’énergie baisseront, le mécanisme actuellement observé se renversera entraînant une baisse du taux d’inflation. Dans l’intervalle, on peut ne pas nourrir l’inflation en accordant des hausses de salaires, mais des primes (par définition non récurrentes contrairement à des salaires) ou des réductions de la fiscalité pesant sur l’énergie pour en contenir la hausse ;
• la capacité des banques centrales, qui montent toutes leurs taux d’intérêt à la vitesse grand V, à éviter tout dérapage dans ce domaine, quitte à casser le rebond post-covid déjà mis à mal par la guerre en Ukraine ;
• les nouvelles capacités de production en construction dans les domaines du transport maritime, des semi-conducteurs, induites par la volonté de faire sauter ces goulots d’étranglement et financées grâce aux cash-flows exceptionnels des années 2021-2022, vont arriver en production en 2023 et 2024, ce qui aura alors un effet déflationniste ;
• les profits des entreprises sont au plus haut, et pas seulement au sein du CAC 40, puisque l’EBE représente en France 35 % de la valeur ajoutée, soit son plus haut niveau depuis 70 ans. Autrement dit, les entreprises peuvent supporter un pincement de leurs marges et n’ont pas besoin d’augmenter leur prix pour reconstituer leur capacité bénéficiaire.
* * *
Au niveau de la gestion financière d’une entreprise, une inflation significative joue sur 4 niveaux :
- elle gonfle les BFR et réduit les flux de trésorerie disponible ;
- elle biaise les résultats publiés en sous-évaluant la dotation aux amortissements qui reste calculée sur une base historique, alors que le renouvellement des immobilisations nécessite un montant croissant du fait de l’inflation ;
- elle crée des incertitudes et des frictions dans les prises de décisions et dans les relations de l’entreprise avec ses parties prenantes ;
- en fonction du caractère positif ou négatif du taux d’intérêt réel, l’entreprise peut être perdante ou gagnante sur son endettement. En 2022, elles sont plutôt gagnantes alors que les taux d’intérêt apparents restent inférieurs à 3-4 % en Europe…
1/ On pourrait croire qu’il suffit pour une entreprise de pouvoir répercuter intégralement sur ses prix de vente toute hausse de ses prix de revient pour être protégée de l’inflation, par exemple parce que son chiffre d’affaires est indexé contractuellement sur l’inflation comme les concessions autoroutières ou Batisanté qui est notre exemple de LBO de cette année. Ou que ses produits ou services sont suffisamment innovants et différenciants comme ceux de Cogélec, notre cas d’analyse financière, pour que ses clients acceptent des hausses de prix. Erreur ! Il n’y a rien de plus faux que cela !
L’inflation va se traduire par un gonflement du BFR qui, dans la plupart des cas, sera supérieur à l’accroissement de l’excédent brut d’exploitation ou du résultat d’exploitation induit par l’inflation, même si l’entreprise est capable d’augmenter des prix de vente à hauteur de la hausse subie sur ses prix de revient.
Prenons ainsi une entreprise avec un chiffre d’affaires de 100, un résultat d’exploitation de 12, une dotation aux amortissements de 5, un BFR de 20 stable hors inflation et un impôt sur les sociétés de 25 %. Pour simplifier, cette entreprise n’est ni endettée, ni en croissance. Dans un contexte d’inflation faible, son flux de trésorerie d’exploitation est de :
Résultat d’exploitation : 12
Dotation aux amortissements : 5
- Impôts sur les sociétés à 25 % : 3
- Variation du BFR : 0
= Flux de trésorerie d’exploitation : 14
Maintenant, supposons que l’inflation passe brutalement à 10 % comme on le voit en Europe en ce moment et que notre entreprise soit capable de la répercuter à ses clients. Dans ce cas, on a alors :
Résultat d’exploitation : 12 x 1,1 = 13,2
Dotation aux amortissements : 5
- Impôts sur les sociétés à 25 % : 3,3
- Variation du BFR : 20 x 1,1 – 20 = 2
= Flux de trésorerie d’exploitation : 12,9
Si le résultat d’exploitation croît bien de 12 à 13,2 dans le cas favorable où l’entreprise est capable de répercuter la hausse de ses coûts de production sur ses prix de vente, son flux de trésorerie généré par l’exploitation est en baisse de 1,1, soit 8 %.
C’est donc un besoin potentiel de financement supplémentaire de 1,1 sans aucune contrepartie pour l’entreprise. Cette réduction du flux d’exploitation ne sera naturellement pas sans conséquence sur la valeur de l’entreprise comme on l’établira plus loin.
Mais on pourrait penser que, si pour une entreprise avec un BFR positif, l’inflation a un effet négatif, alors pour un groupe avec un BFR négatif, l’inflation devrait avoir un impact positif. L’observation des faits montre que malheureusement, au moins dans un premier temps, il n’en est rien comme l’illustre l’exemple des résultats trimestriels publiés par Walmart en mai 2022.
Au premier trimestre 2022, le grand distributeur américain enregistre un flux de trésorerie d’exploitation de - 3,8 Md$, contre + 2,9 Md$ au trimestre équivalent de 2021. La principale raison est le bond des stocks de 8,4 %, soit 4,7 Md$, alors que les ventes ont baissé par rapport au trimestre précédent (qui inclut Noël) de 7,4 %. Ce bond des stocks s’explique par des changements dans la consommation des Américains confrontés à l’inflation, qui achètent des produits moins chers au détriment des produits plus coûteux (postes de télévision, ameublement, etc.), ces derniers restant ainsi plus longtemps que prévu sur les gondoles. Et cette nouvelle inattendue a fait baisser le cours de Walmart de 20 % en une semaine, baisse qui n’a pas été récupérée depuis. Dans un contexte inflationniste, le « toutes choses égales par ailleurs » est rarement un bon raisonnement car les acheteurs adaptent leur comportement à cette nouvelle donne pour eux.
La seconde partie de cet article sera publiée dans le numéro de juillet de La Lettre Verninimmen.net.
Tableau : L'actionnariat salarié en Europe
L’actionnariat salarié représente en moyenne 3,26 %[1] du capital des sociétés européennes (contre 2,37 % en 2006). Derrière cette moyenne se cachent des situations très disparates selon les pays :
Ainsi, la France apparaît comme un champion européen en termes d’actionnariat salarial démocratique avec plus de 5 % du capital détenu par les salariés (et majoritairement hors du management). À l’opposé, l’Allemagne ne voit que moins de 2 % du capital détenu par les salariés (ce qui est certainement compensé par une participation active des salariés à la gouvernance). En France, 75 % des entreprises cotées ont plus de 1 % de leur capital détenu par les salariés, contre seulement un tiers en Allemagne, mais 49 % en Italie et 62 % au Royaume-Uni.
[1] « Recensement économique annuel de l’actionnariat salarié dans les pays européens » - Fédération européenne de l’actionnariat salarié – Étude réalisée sur 3149 entreprises dans 32 pays représentant 34,5 millions d’emplois.
Recherche : Recrutement des administrateurs : le rôle des réseaux personnels
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
Comment les administrateurs d’entreprise sont-ils recrutés ? Selon un vieil adage, pour être désigné, le chemin le plus rapide consiste à connaître déjà un membre du conseil d’administration[1]. Le principe dans une entreprise de format classique (en l’occurrence, nous nous intéressons ici aux sociétés cotées) est que les administrateurs, pour la majorité d’entre eux, défendent les intérêts des actionnaires. Pourtant, ils ne sont pas directement choisis par les actionnaires. Ces derniers votent sur des propositions qui émanent du conseil. Or, il est souvent observé dans les nominations, sinon du copinage, du moins l’existence de relations préalables entre le nouvel administrateur et un membre du conseil. Cette pratique est controversée. Un article[2] s’est intéressé à mesurer le phénomène, avec deux objectifs. D’une part, vérifier que les réseaux personnels jouent effectivement un rôle significatif dans les nominations, au-delà de quelques cas médiatisés. D’autre part, d’en étudier les conséquences sur la valorisation des entreprises.
L’étude empirique porte sur la nomination d’administrateurs entre 2003 et 2014 dans les sociétés cotées américaines (près de 10 000 nominations). Sur l’ensemble de l’échantillon, 29 % des nouveaux administrateurs ont une connexion professionnelle directe avec au moins l’un des autres administrateurs de l’entreprise. Ce résultat est marquant pour une raison simple : parmi tous les administrateurs référencés aux États-Unis, seuls 0,4 % (selon la base Boardex, référence en la matière) disposait d’une telle connexion avec le conseil en question. Si l’on considère les connexions de second degré (l’administrateur a travaillé avec quelqu’un qui a travaillé avec un membre du conseil), on monte à 69 %. Le chiffre est plus élevé encore pour les entreprises du SP500 : plus de 90 % des nominations ont une connexion de premier ou second degré contre 21 % dans la base. En revanche, les réseaux non professionnels (liés aux études ou aux autres connexions sociales) semblent jouer un rôle marginal. Il ne s’agit donc pas forcément de copinage et les auteurs s’intéressent à la rationalité du phénomène.
D’un côté, choisir un nouvel administrateur parmi les réseaux personnels peut avoir ses avantages. La recherche a montré que le fait d’avoir déjà interagi professionnellement avec cette personne favorisait la coordination. Cela peut faciliter la prise de décision au conseil qui la plupart du temps recherche le consensus. Il s’agit de l’hypothèse de coordination (coordination hypothesis) : le rôle des réseaux personnels est positif car il réduit les coûts de coordination au conseil. Un autre argument favorable porte sur le processus de recrutement en lui-même. Il est plus facile d’obtenir des informations fiables sur la qualité d’un candidat que l’on connaît déjà, au moins par personne interposée. Trouver la perle rare au-dehors des réseaux personnels prend plus de temps et nécessite une recherche plus approfondie pour s’assurer des compétences, sans que cette dépense additionnelle ne se traduise forcément par un meilleur recrutement. On appelle ça l’hypothèse de réduction des coûts de recherche (search cost hypothesis). Ces deux hypothèses impliqueraient une hausse de la valeur de l’entreprise lorsque le réseau est utilisé.
D’un autre côté, choisir parmi les réseaux présente le risque d’ajouter à l’homogénéité des compétences au conseil. Le nouvel administrateur ainsi sélectionné a plus de risque de partager l’approche et les idées des membres actuels. Cela favorise la coordination, mais cela réduit d’autant la capacité à élargir les perspectives, apporter de nouvelles idées ou identifier des problèmes. Il s’agit de l’hypothèse d’homophilie (homophily hypothesis). Plus grave encore, le copinage, qui est principalement associé au réseau du directeur général, qui choisirait dans son réseau pour avoir les mains libres d’agir dans son intérêt propre et impliquerait un problème d’agence (agency hypothesis).
Parmi les quatre hypothèses, une seule n’apparaît pas clairement dans les données, celle d’homophilie. Dans beaucoup de cas, les réseaux professionnels sont même utilisés pour recruter des administrateurs ayant une spécialité différente des autres membres du conseil. La procédure n’est donc pas défavorable à la diversité des compétences. D’une manière générale, le marché réagit positivement à la nomination d’administrateurs choisis parmi les réseaux personnels, et c’est particulièrement le cas dans les entreprises soumises à des problématiques complexes liées au secteur et à la concurrence. Le seul effet négatif (et qui ne fait qu’atténuer cette tendance) apparaît lorsque le réseau utilisé est celui du directeur général. À tort ou à raison, car l’étude s’intéresse à la réaction de marché instantanée, les investisseurs considèrent que le choix d’un administrateur dans les réseaux professionnels est judicieux et plutôt gage de qualité, d’autant plus que le nouvel administrateur apporte ses propres compétences. Seul le copinage avec le directeur général est perçu négativement.
Cette étude est importante car c’est probablement la plus complète et documentée sur le rôle des réseaux dans les processus de recrutement des administrateurs. Elle montre que l’utilisation de ces réseaux n’est pas destructrice de valeur et que les problèmes de copinage, s’ils existent et sont fortement médiatisés, ne doivent pas conduire à rejeter systématiquement l’utilisation des réseaux personnels.
Q&R : Qu'est-ce que le modèle APT ?
D’une certaine façon, le modèle APT (Arbitrage Pricing Theory) est une généralisation du MEDAF. Le MEDAF suppose que le taux de rentabilité d’un titre est fonction du risque de marché de ce titre et qu’il dépend donc d’un seul facteur : l’évolution du marché en général. L’APT, tel que le propose S. Ross, fait l’hypothèse que la prime de risque est fonction de plusieurs variables (et non plus d’une seule). Le titre est alors plus ou moins sensible à ces variables macroéconomiques (V1,
V2, …,Vn), et il subsiste un « bruit » propre à l’entreprise.
On a donc pour un titre J :
rJ = a + b1 × rV1 + b2 × rV2 +… + bn × rVn + bruit
Le modèle ne définit pas une liste précise des facteurs S. Ross retient, sur la base d’analyses quantitatives, les critères suivants : l’inflation, la production industrielle, la prime de risque et l’évolution de la courbe des taux.
Si l’on souhaite faire le lien avec le portefeuille de marché, on constate que le modèle APT a remplacé la notion (délicate à mesurer dans la pratique) de rentabilité exigée par le marché en faveur d’une série de variables qui restent malheureusement à déterminer… C’est ce qui explique que l’APT soit un outil de gestion de portefeuille et non d’évaluation des actions.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière. En voici quelques-uns :
La longue et coûteuse sortie d'HSBC du marché français de la banque de détail
Petit acteur du marché français avec 244 agences (moins de 0,7 % du total national) et 0,8 M clients, en perte de 500 M$ les deux dernières années, HSBC avait signé un accord en 2021 avec le fonds d’investissement Cerberus pour lui céder à 1 € ses actifs de banque de détail en France, moyennant un renflouement préalable de l’ordre de 1,9 Md€, soit une valeur négative pour le groupe bancaire de ce montant.
À quasiment 4 fois les pertes, la sortie pour HSBC du marché de détail français n’était pas particulièrement donnée puisque la plupart des actifs en perte sont cédés entre 1 et 3 fois leurs pertes annuelles.
La hausse des taux et la faillite de la Silicon Valley Bank ont accru le montant du chèque à verser sur lequel les parties viennent de se mettre d’accord.
Cerberus, qui sait compter, a renégocié l’accord et obtenu qu’HSBC garde pour lui environ le tiers du portefeuille de crédits de HSBC France banque de détail. Il n’aura pas ainsi à porter ces actifs à un taux d’intérêt supérieur à celui des intérêts reçus sur ce portefeuille de crédits du fait de la hausse des taux d’intérêt. Par ailleurs, HSBC va investir 407 M€ dans la holding de reprise de ces actifs sur lesquels sa plus-value potentielle est plafonnée, alors que Cerberus ne réinvestit que 225 M€ de plus. Au total, HSBC perd dans cette transaction 2,7 Md$, c’est-à-dire plus de 5 fois la perte annuelle, soit à notre connaissance un nouveau record dans les cessions d’actifs en perte. Et comme le PER 2023 d’HSBC est de 6 fois, l’opération est marginalement créatrice de valeur pour le groupe bancaire anglais.
Mais comme HSBC a acheté la filiale anglaise de la Silicon Valley Bank pour 1 £ en un week-end pour lui éviter une faillite (avait perdu un tiers de ses dépôts en un vendredi) parallèle à celle de sa maison mère californienne, et a dégagé à cette occasion 1,5 Md£ de profit avant impôt, HSBC pouvait se permettre d’être généreux. On peut faire confiance à Cerberus pour l’avoir compris, lui qui faisait courir après cette emplette d’HSBC la rumeur de son retrait du deal français où il était le seul acheteur, comme HSBC l’était sur SVB UK.
Faire moins de bêtises que ses voisins
C’était le sage conseil de Wilfrid Baumgartner, gouverneur de la Banque de France dans les années 1950, puis ministre des Finances et enfin patron de Rhône-Poulenc, première capitalisation boursière française dans les années 1960.
Nos voisins anglais n'ont pas suivi ce conseil, et à côté du Brexit, popularisé par des menteurs et des incompétents, ils ont commis une autre erreur majeure gaspillant l’un de leurs avantages les plus considérables, la Bourse de Londres, que fuient aujourd’hui certaines entreprises anglaises qui trouvent des valorisations plus élevées aux États-Unis (CRH, ARM, Ferguson, etc.). Si la capitalisation boursière de la Bourse de Londres était le double de celle de Paris en 2000 (environ 3 000 Md€ contre 1 600 Md€), elles sont aujourd’hui équivalentes (à 3 600 Md€, incluant les cotations secondaires). Si la capitalisation boursière de Londres faisait 159 % du PNB britannique en 2000, elle n’en fait plus que 95 % aujourd’hui.
La raison est à chercher dans la part que les fonds de pension britanniques consacraient à l’investissement actions dans leurs portefeuilles, passée de 50 % en 2000 à... 4 % en 2022, alors que celle des produits de taux est passée dans le même intervalle de 15 % à 60 %. L’État britannique a ainsi pu financer à bon compte son déficit budgétaire. Les entreprises britanniques cotées, quant à elles, ont vu fondre leur valeur relative. Ainsi les 20 premières capitalisations boursières britanniques sont passées d’un cumul de 1 529 Md€ en 2000 à 1 657 Md€ en 2023, soit + 8 % en 23 ans, avec un PER moyen de 15, contre 20 pour leurs homologues cotées à Paris qui, elles, sont passées de 1 031 Md€ en 2000 à 2 148 Md€ en 2023, soit + 108 %.
Cette évolution est d’autant plus incompréhensible que s’il est un investisseur qui peut viser le long terme, ce sont bien les fonds de pension, qui en capitalisant sur le long terme, battent systématiquement les produits de taux. On conclura en rappelant qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de la sottise dans l’histoire. En voici un exemple moins connu que le Brexit, mais aussi nocif.