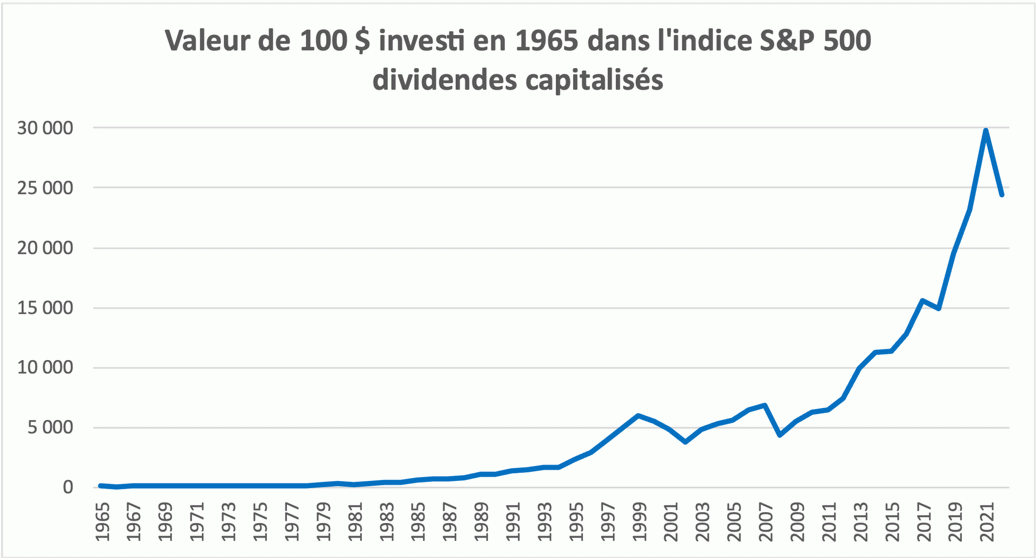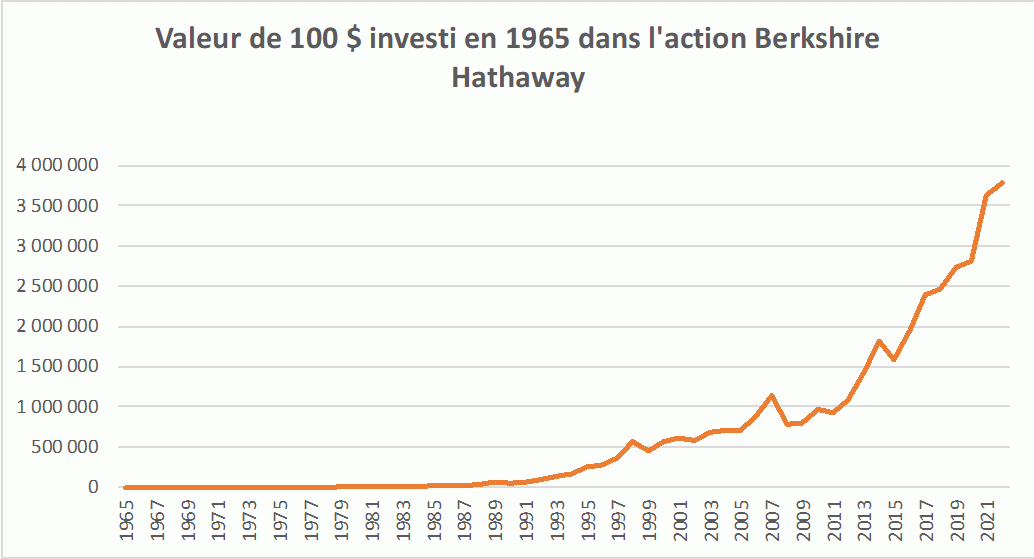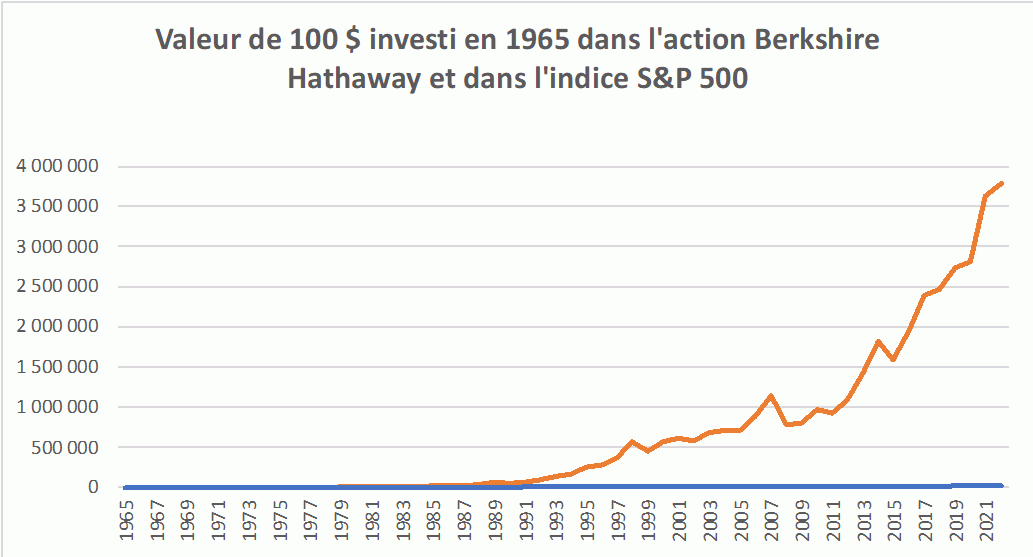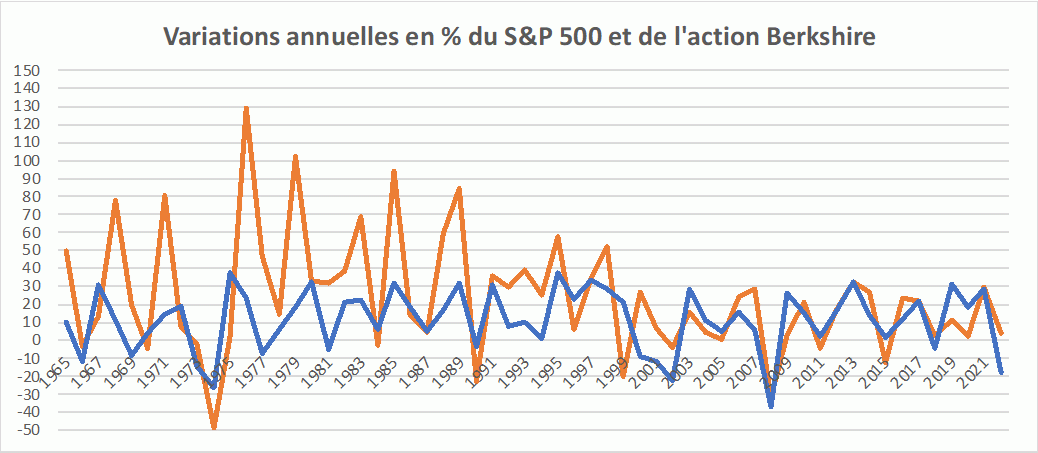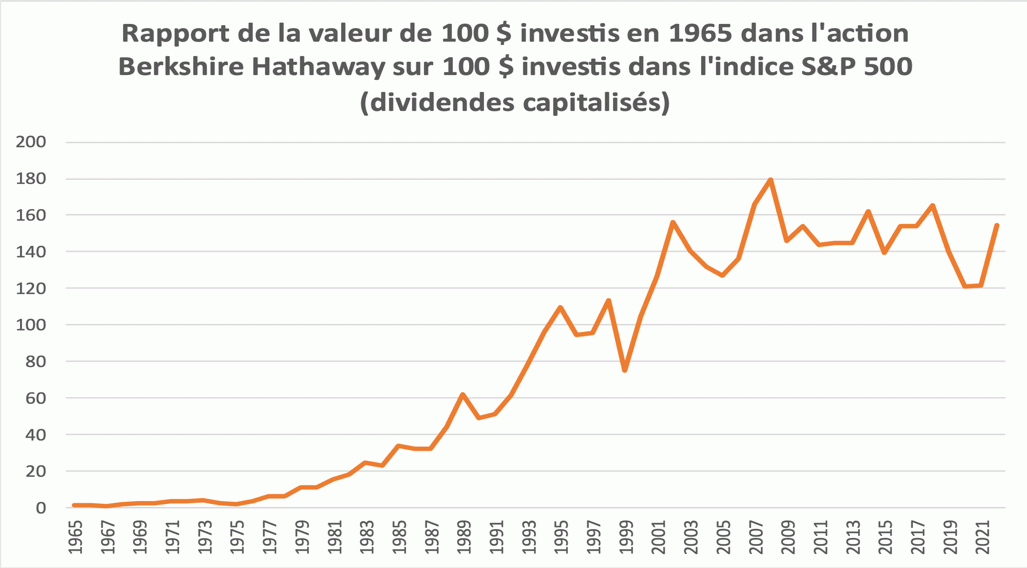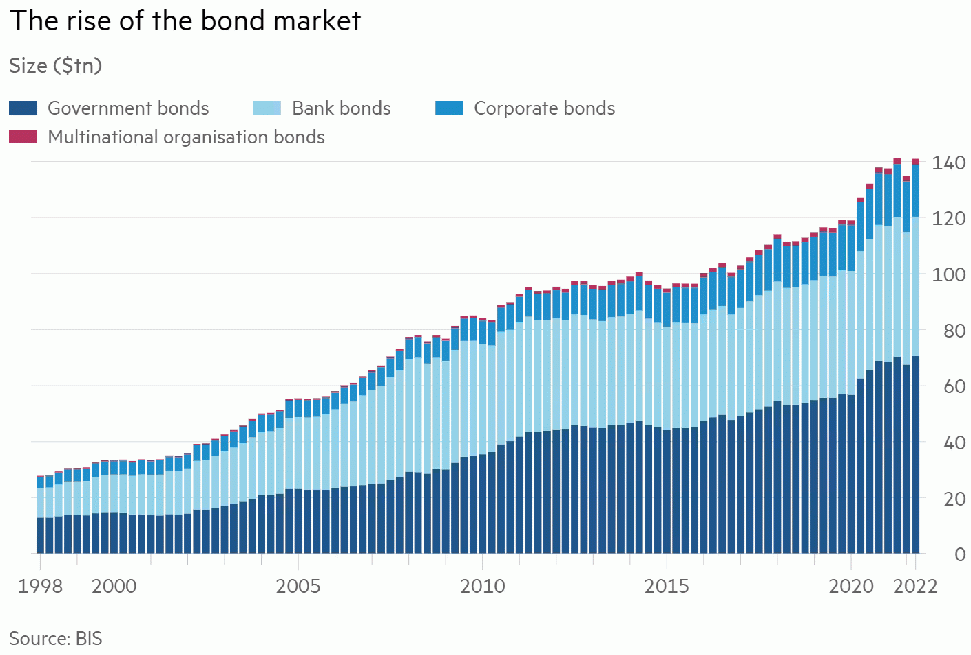La Lettre n°212 de Octobre 2024
Actualités : Le mode de gestion du groupe Berkshire Hathaway explique-t-il son exceptionnelle performance ?
L‘exceptionnelle performance du véhicule d’investissement de Warren Buffett peut s’illustrer par 5 graphiques.
Voici ce que seraient devenus 100 $ que vous auriez investis en 1965 dans l’indice S&P 500, dividendes réinvestis au fur et à mesure où vous les auriez perçus :
Voici maintenant ce que seraient devenus 100 $ que vous auriez investis en 1965 dans l’action Berkshire Hathaway, sans que vous n’ayez réinvesti les dividendes puisqu’il n’y en a pas eu :
Si vous ne faites pas attention à l’échelle verticale, vous pourriez penser qu’il n’y a pas grande différence. Grande erreur ! En 58 ans, la rentabilité de l’action Berkshire Hathaway a été de 20 % l’an contre 10 % pour celle de l’indice S&P 500. Dans le premier cas, vous avez multiplié votre investissement par 37 779 (sic) et dans le second par 244. Cela montre à la fois la force des intérêts composés dans la longue durée (57 ans ici), surtout quand l’investissement se fait dans une économie américaine qui n’a pas connu de crises menaçant son existence comme la Russie (en 1917), la Chine (en 1949), l’Allemagne (en 1923), Cuba (en 1959), le Liban en ont connu.
Cela montre aussi l’exceptionnel talent de Warren Buffett pour le plus grand bien des investisseurs qui lui ont fait confiance il y a des années, et aussi pour le plus grand bien de la Société à double titre.
D’abord, grâce à son activité, le capital confié a été bien investi et non gaspillé dans des investissements qu’il aurait mieux valu ne pas faire. Sur une aussi longue période, une telle performance boursière ne peut pas être atteinte sans que les entreprises dans lesquelles Berkshire Hathaway a investi évitent de gaspiller leurs capitaux dans des investissements peu judicieux. N’oublions pas le capital n’existe pas dans la pratique en montant infini, et que de piètres investissements mobilisent des fonds qui auraient pu le plus souvent être investis plus judicieusement par d’autres équipes de dirigeants dans d’autres entreprises L’allocation judicieuse du capital est la clé dans la création de valeur dans la durée et l’évitement de l’appauvrissement relatif ou absolu.
Ensuite, car Warren Buffet redistribue une partie très substantielle de la richesse qu’il a créée au profit d’œuvres philanthropiques, bénéficiant aussi à l’ensemble de la Société. Son objectif est en effet de redistribuer toutes ses actions de Berkshire Hathaway ; à ce jour il a donné de l’ordre de 50 Md$.
Et l’on voit mieux sa surperformance dans la durée en superposant les deux courbes précédentes dans celle-ci :
Eh oui, le S&P 500 qui progressait sur 58 ans de 10 % l’an est, en relatif, devenu quasiment tout plat.
En fait, si dans la durée Berkshire Hathaway a délivré à ses actionnaires une rentabilité deux fois supérieure à celle de l’indice boursier, il a aussi délivré une volatilité deux fois plus forte, ce qui se comprend puisque Berkshire Hathaway est naturellement moins diversifié que le S&P 500. C’est le résultat d’une stratégie de choix d’actions consciente et réfléchie qui produit ses résultats dans la durée, et non instantanément. Berkshire Hathaway n’est pas un ETF !
Si sur 58 ans Berkshire Hathaway a produit une performance annuelle positive autant de fois que l’indice S&P 500 (47 fois contre 45 fois, ce qui n’est pas une différence significative), le groupe de Warren Buffett a battu 39 années sur 58 années l’indice. Et quand il le bat, c’est d’un montant bien plus élevé que les 19 années où il fait moins bien que l’indice : + 26 % contre - 15 % dans les années de sous-performance.
On remarque que l’écart de performance annuelle s’affaiblit au cours du temps au fur et à mesure où Berkshire Hathaway grossit (il représente aujourd’hui 2 % de la capitalisation boursière du S&P 500). Joue dans le même sens le fait d’ajouter des actifs aux actifs, du fait d’une politique de réinvestissement total des résultats excluant le versement de dividendes ; la diversité des actifs de Berkshire Hathaway s’accroit et se rapproche ainsi de la composition de l’indice boursier.
Ce qui fait que depuis la crise financière de 2008, Berkshire Hathaway a cessé de surperformer l’indice S&P 500.
* * *
Dans cette seconde partie nous allons regarder, non comment Berkshire Hathaway sélectionne ses investissements, sujet sur lequel Warren Buffett a beaucoup écrit, produisant ce faisant des aphorismes fameux, mais les principes de gestion de ce groupe.
Vu de l’extérieur, le groupe s’organise autour de trois pôles :
1/ L’activité d’assurance qui du fait de son cycle inversé (les clients assurés payant les primes avant de recevoir des éventuelles indemnités) génère un encours de cash (166 Md$ au 30 juin 2023) qui va être investi :
2/ Dans des participations financières minoritaires (Apple, Bank of America, Amex, Coca-Cola, Occidental Petroleum, etc.) ;
3/ Ou dans des entreprises industrielles ou commerciales totalement contrôlées, comme BNSF dans les chemins de fer, PacificCorp et Nevada Power Company dans l’énergie, mais aussi HomeServices of America dans le courtage immobilier, Precision Castparts dans les équipements aéronautiques, Lubrizol dans la chimie de spécialité, Clayton dans la construction de maisons, Shaw Industries dans le revêtement des sols, John Manville dans l’isolation thermique, Acme dans les matériaux de construction, Fruit of the Loom dans le textile, Duracell dans les piles, NetJets dans l’aviation d’affaires, International Dairy Queen dans la restauration rapide, Candy Shops dans la confiserie, etc.
C’est l’associé de Warren Buffett qui, au printemps dernier, a donné sa vue des principes de gestion du groupe[1] qui font de lui, non une holding financière familiale à la GBL ou Exor, non un fonds de capital-investissement comme Carlyle ou CVC, non un conglomérat comme Bouygues ou Reliance, non un groupe financier comme l’ont été il y a 40 ans Paribas ou Mediobanca, mais un animal assez unique dans son organisation comme dans sa performance.
Berkshire Hathaway n’est pas un conglomérat, car il s’interdit de faire circuler les dirigeants de ses diverses participations entre elles, à la différence d’un conglomérat qui pense apporter à ses divisions un savoir-faire de management par ce biais. Quand on est le patron d’une division chez Berkshire Hathaway, c’est pour la vie, sauf accident de parcours. La faiblesse de ses équipes en central est la meilleure façon de lutter contre le risque de bureaucratie à laquelle toute organisation qui s’accroit en taille est exposée, et qui a tué les grands conglomérats des années 1960-1970 (Schneider, ITT, Gulf and Western, GEC plc, Philips, etc.). Chez Berkshire Hathaway, l’équipe centrale c’est un président (Warren Buffet), un vice-président (Charlie Munger), un directeur financier qui produit les comptes consolidés, fait du contrôle interne, du contrôle de gestion, des relations avec les investisseurs, et... et c’est tout.
Toutes les autres fonctions sont dans les filiales industrielles et commerciales, qui sont donc totalement autonomes d’un point de vue managérial. En particulier, les départements fusions-acquisitions sont dans les filiales, pas au siège qui en est dépourvu, car l’idée est bien que ces entités étudient par elles-mêmes les acquisitions complémentaires dans chacun de leurs métiers qui font sens, pas au centre. Ce dernier se contente de prélever les flux de trésorerie disponible des entités ne trouvant plus suffisamment d’opportunités de croissance interne ou externe rationnelles, pour affecter le capital excédentaire au profit d’autres entités du groupe en déficit de capital mais pas de projets, ou à de nouvelles acquisitions ou investissements.
Dans la même veine, il n’y a pas de système d’intéressement du personnel du groupe, chaque entité gère le sien propre, sans aucune mutualisation intragroupe.
Warren Buffett, outre le choix des prises de contrôle et des principaux investissements boursiers, se focalise sur le choix des dirigeants avec quelques principes de bon sens : choisir les élus en fonction de la confiance que l’on peut leur accorder et de leur honnêteté, de leur énergie, de leur connaissance et amour (oui amour) de leur secteur.
L’accent mis sur le long terme, la responsabilisation des dirigeants des principales filiales choisis avec soin par Warren Buffett, fait qu’un dirigeant de talent dans le groupe ne sera jamais poussé à la retraite sous le prétexte de son âge, ni un autre promu à l’ancienneté. Or avoir des dirigeants talentueux dans la durée fait toute la différence. Ainsi l’illustre par exemple en France Nicolas de Tavernost, DG puis PDG de M6 depuis 1990, une chaîne de télévision considérée alors comme la chaîne de trop, et qui, 35 ans après, a dépassé l’archi-leader TF1, au point de pouvoir le racheter si l’antitrust ne s’était pas mis en travers. Ou L’Oréal depuis 1948 avec François Dalle, Lindsay Owen-Jones et Jean-Paul Agon, chacun en poste de DG, PDG ou président pendant une durée moyenne de 27 ans.
Berkshire Hathaway n’est pas une holding financière car il détient 100 % de ses filiales industrielles et commerciales, et non une minorité, partant du principe que si l’on croit à la valeur d’un actif et de son équipe dirigeante, autant en avoir 100 % que 15 ou 25 % comme Exor ou Wendel. De la même façon, Berkshire Hathaway procède rarement à des cessions de filiales. Tout comme dans la partie gestion de participations cotées minoritaires, il est dans une logique d’acheter et de garder, confiant dans la profondeur de son analyse préalable à l’investissement et du choix des femmes et des hommes pour les diriger.
Du fait de sa réticence à céder ses actifs industriels et commerciaux, et de sa détention à 100 % de ses actifs, le résultat net de Berkshire Hathaway est moins volatile et beaucoup plus pertinent. En effet, les résultats des filiales sont appréhendés à 100 % et non via des dividendes qui sont, soit confiscatoires pour les entités et conduisant à des sous-investissements, soit ne reflétant qu’une partie de leurs résultats, conduisant tôt ou tard à vendre ces filiales pour extérioriser la valeur créée. Ainsi, les investisseurs peuvent-ils évaluer Berkshire Hathaway sur la base d’un multiple du résultat courant après impôt. Est donc évitée la plaie mortelle d’une holding financière, l’évaluation par les investisseurs sur la base d’un actif net réévalué, inexorablement affecté tôt ou tard d’une inévitable décote.
Ainsi actuellement, la capitalisation boursière de Berkshire Hathaway dépasse de 55 % ses capitaux propres comptables consolidés (733 Md$ contre 472 Md$), contre des décotes pour les holdings comprises généralement entre 20 et 60 % (Wendel et GBL sont à un tiers de décote sur les capitaux propres comptables, et plus encore sur l’actif net réévalué). Le PER sur les résultats des 12 derniers mois est de 22,7.
Berkshire Hathaway n’est pas non plus un groupe de capital-investissement car il est allergique à la dette, considérant que la disponibilité de cash est un actif stratégique majeur[2] lui permettant de saisir dans les inévitables phases de crises du cycle économique des opportunités que peu peuvent saisir, à des prix qui construisent la surperformance dans le temps. Il a la chance de bénéficier de capitaux propres pérennes, dont l’essentiel provient du réinvestissement de ses profits depuis 58 ans, puisqu’aucun dividende n’a été versé. Et quand il fait du rachat d’actions, il n’a pas besoin de céder des actifs pour les financer, alors que les fonds de capital-investissement doivent céder leurs participations, le plus souvent au bout de 10 ou 12 ans.
Nous terminons en citant ce qu’est la « première priorité » du dirigeant de Berkshire Hathaway selon Charlie Munger : « His first priority would be reservation of much time for quiet reading and thinking. » À une époque où beaucoup sont connectés en permanence à leurs mails, SMS, à leurs comptes LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, sans oublier leur tableur, c’est un rappel bienvenu. À bon entendeur, salut !
Muni de ses éléments, nous vous laissons répondre par vous-mêmes à la question qui est le titre de cet article.
Actualités : Sujet et corrigé de l'examen de mi-parcours à HEC Paris en M1
C’est l’examen de mi-parcours que nous venons de donner à nos étudiants d’HEC Paris en Master 1. Il couvre l’analyse financière, l’évaluation et les fondements conceptuels de la finance d’entreprise. Vous le trouverez sur le site vernimmen.net en rubrique S’entraîner.
Le corrigé est donné sur la même page. Et si vraiment vous vous ennuyez trop en ce moment, il y a aussi les énoncés et les corrigés des 12 examens précédents. Que du bonheur !
Et nous venons d’ajouter 3 nouveaux cas et leurs corrigés consacrés à l’augmentation de capital de Voltalia, les problèmes de gouvernance de Mr.Bricolage, et la fusion ICE-Euronext qui s’ajoutent aux 24 déjà disponibles que vous trouverez ici.
Recherche : Trop de rétention de cash : une solution fiscale ? L'exemple coréen
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
La rétention de cash de la part des entreprises a considérablement augmenté en tendance longue depuis les années 2000[1], en particulier hors d’Europe et des États-Unis. Les investisseurs parlent péjorativement de cash hoarding et voient cette tendance d’un mauvais œil. Pourtant, il peut exister de bonnes raisons à la rétention de cash : elle peut favoriser la réactivité pour entreprendre des projets créateurs de valeur, ou protéger l’entreprise en cas de chocs non anticipés. L’article que nous présentons ce mois[2] donne toutefois raison à l’intuition des financiers. En étudiant une réforme fiscale en Corée, l’article montre que le fait de décourager la rétention de cash a des effets globalement vertueux sur la valorisation des entreprises.
La méthode empirique utilisée est appelée par les chercheurs une « expérience naturelle ». Il est difficile en finance de mener des expériences en laboratoire destinées à mesurer un phénomène. Il existe toutefois des réformes réglementaires ou fiscales qui offrent aux chercheurs un terrain d’étude semblable à une expérience. Les auteurs de l’article ont utilisé ici une réforme fiscale mise en place en Corée du Sud en 2014. La réforme consistait à taxer à hauteur de 10 % le cash retenu par les entreprises après augmentations de salaires, investissements et distribution (dividendes ou rachats d’actions). L’objectif affiché de la réforme était de réduire cette rétention de cash, supposée nuisible sur le plan macroéconomique.
La première partie de l’étude s’attache à mesurer l’efficacité de la réforme sur son objectif. L’expérience naturelle permet de recourir à une analyse difference-in-differences qui consiste à comparer l’évolution de la rétention de cash des entreprises soumises à la réforme (celles dont les capitaux propres comptables dépassent les 50 M$) avec celle des entreprises non soumises. Le résultat est sans appel : la réforme produit l’effet escompté. L’accumulation de cash est réduite de moitié (pour les entreprises concernées) après la réforme. Le cash est dépensé principalement en distribution aux actionnaires (+30 %) et en investissements (+20 % à 30 %), mais aussi en augmentations de salaires. Notons au passage, même si ce n’est pas l’objet de l’article, que ces résultats montrent une nouvelle fois que les dividendes ne sont l’ennemi ni des salaires ni des investissements et que l’arbitrage se fait entre distribution et rétention de cash. En taxant la rétention de cash, la réforme réduit le désavantage fiscal associé à la distribution, et l’objectif est atteint.
Tout cela ne signifie pas pour autant automatiquement que cette réforme est positive. Si le cash est dépensé inutilement pour éviter la taxe, en particulier dans des investissements destructeurs de valeur, il est possible que la valorisation des entreprises s’en trouve négativement affectée. Ce n’est pas ce que trouve l’étude ; elle confirme au contraire que le fait d’inciter à l’utilisation ou la distribution du cash est favorable à la valorisation. Après prise en compte de l’effet mécanique des dividendes, la diminution de la rétention de cash des entreprises concernées se traduit par une rentabilité anormale de 2 %. Plus parlant encore, un dollar de cash dans les caisses de l’entreprise était valorisé 62 cents avant la réforme, et 92 cents après. La destruction de valeur liée à l’excès de cash est donc considérablement réduite, et la rétention après la réforme devient presque optimale du point de vue de la valeur.
Dans la seconde partie, les auteurs analysent la source de la sous-optimalité antérieure. Deux effets prévus par la théorie expliquent le phénomène. D’abord, le biais comportemental lié à une crainte excessive des crises. Les entreprises ayant subi un manque de cash au moment de la crise asiatique avaient tendance à thésauriser à l’excès par motif de prudence ; en valeur, ces entreprises bénéficient davantage de la réforme que les autres.
Ensuite, les conflits d’agence liés à une mauvaise gouvernance peuvent inciter les dirigeants à conserver trop de cash. L’étude montre que les entreprises soumises à ce genre de problème conservent moins de cash après la réforme, mais que c’est aussi le cas des entreprises sans problème de gouvernance. Toutefois, l’effet positif sur la valeur n’est observé que pour les entreprises sans problème de gouvernance. Les auteurs supposent que le cash y est mieux utilisé, et que là où les conflits d’agence subsistent, la réforme peut inciter à mettre en œuvre certains projets à valeur actuelle nette négative.
Finalement, l’article montre qu’une réforme consistant à introduire une taxe supplémentaire sur les entreprises peut se traduire paradoxalement par une hausse de leur valeur. L’idée est que, dans le cas étudié, cette taxe est destinée à atténuer une distorsion favorable à la rétention de cash, dans un monde où les entreprises ont déjà tendance à thésauriser de manière excessive. Prudents, les auteurs rappellent tout de même qu’au niveau de l’entreprise l’effet d’une réduction de la rétention de cash dépend évidemment de l’usage qui est fait de ce cash. Il ne s’agit surtout pas d’inciter les entreprises à dépenser pour dépenser ni investir pour investir !
Q&R : Recalcul de la VAN et du TRI en cours d'investissement
« Je travaille sur le plan financier d’un projet de construction d’une usine dont la construction a démarré en 2017 et qui devrait se terminer fin 2023. Je souhaiterais recalculer le TRI/VAN du projet maintenant que j’ai les coûts réels de construction du projet. Cependant, je ne sais pas comment intégrer les investissements de 2017 à aujourd’hui dans mon calcul. Dois-je me repositionner en 2017 et calculer mon TRI/VAN à cette date, ou dois-je calculer mon TRI/VAN au 1.12.2024 en cumulant les investissements réalisés sans les capitaliser ou dois-je les capitaliser au taux hors risque ou au coût du capital jusqu’au 31.12.2023. »
Vous avez deux optiques possibles.
1/ Vous voulez simplement mettre à jour vos prévisions en fonction du temps qui est passé. Vous êtes dans le domaine du contrôle de gestion. Dans ce cas, le plus simple est de reprendre vos calculs de 2017 en remplaçant vos estimations de chaque année par le réel que vous avez pu constater depuis cette date. Vous pourriez capitaliser vos flux passés au coût du capital pour les ramener en valeur de 2023. Cela modifiera votre TRI, sauf si par extraordinaire il était égal à votre coût du capital. Mais ne capitalisez pas au taux sans risque ni à un taux nul, ce serait donner, artificiellement et faussement, un sacré coup de fouet à votre TRI et à votre VAN, puisque vous oublieriez ou sous-estimeriez le prix du temps écoulé depuis 2017.
2/ Vous vous interrogez pour savoir s’il est toujours opportun de faire cet investissement. Vous êtes plus dans le domaine financier. Dans ce cas, vous faites un calcul à aujourd’hui en prenant les flux futurs que vous actualisez au coût du capital pertinent et vous comparez le chiffre obtenu, qui est la VAN des flux futurs de votre investissement, à la valeur que vous pourriez tirer en l’état de la vente de votre investissement. S’il lui est supérieur, c’est que d’un point de vue financier, votre investissement vaut la peine d’être conduit à bien.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière. En voici quelques-uns :
Vedanta, une scission en pays émergent
Vedanta, conglomérat indien, actif dans le pétrole et le gaz, l’aluminium, les mines (zinc, argent, cuivre, fer, plomb) et la sidérurgie principalement, qui capitalise en Bourse 10 Md$, vient d’annoncer une scission qui donnera naissance dans quelques trimestres à 6 nouveaux groupes, chacun centré sur son métier.
Dans les pays où les marchés financiers sont peu développés, avec un accès aux financements difficiles, les conglomérats cotés en Bourse (Argos en Colombie, Reliance en Inde, etc.) sont un mode d’organisation plus efficace car ils constituent leur propre marché financier interne, les divisions vaches à lait alimentant en trésorerie les divisions ayant des besoins de fonds. Du fait de leur grande taille et d’un risque plus faible induit par leur diversification sectorielle, ils captent plus aisément l’épargne locale ou internationale qui complémente leur autofinancement.
Quand les marchés financiers se développent, leur avantage financier concurrentiel s’estompe, et l’on voit surtout leurs défauts : complexes à analyser, voire opaques, diversification imposée à l’investisseur, crainte de mauvaise allocation interne de fonds, les divisions stars pouvant être freinées dans leur développement si les fonds du conglomérat soutiennent trop les divisions en difficultés qui devraient être fermées.
C’est ainsi qu’en Europe, depuis une quarantaine d’années, Philips, Siemens, Schneider, Fiat, Générale des eaux, CGE, GEC plc, etc. se sont recentrés sur un de leurs métiers de base avec succès (Schneider Electric, Veolia) ou moins (Philips, Alcatel-Lucent). Aux États-Unis, qui concentrent 69 % des scissions comme nous le signalions dans La Lettre Vernimmen.net de septembre, la même évolution a aussi eu lieu : ITT, General Electric, Gulf and Western, etc. qui ne disent peut-être pas grand-chose à nos lecteurs les plus jeunes. Il en est de même au Japon.
Une des justifications mises en avant par Vedanta pour sa scission est un accès plus aisé au crédit de ses différentes divisions, dont les performances individuelles sont difficiles à analyser par les prêteurs au sein de ce conglomérat. On pourrait être surpris de cet argument, puisqu'en général on estime que le conglomérat, par la diversification de ses métiers, réduit le risque des prêteurs. Mais il est vrai que lorsque les niveaux d’endettement deviennent élevés, comme c’est le cas pour Vedanta, les prêteurs préfèrent identifier clairement les flux de trésorerie, dans une logique qui s’apparente presque à un financement de projet, logique que l’éclatement du conglomérat rendra possible.
Même si une hirondelle ne fait pas le printemps, on ne pourra pas s’empêcher de penser que si l’Inde se met aux scissions, c’est qu’elle change !
Euronext, mission : impossible
Le retrait de l’introduction de Planisware, pour des raisons de prix, la veille du jour J (12 octobre) est un coup dur pour Euronext qui accueille de moins en moins d’entreprises cotées (1 212 en 2008, 857 en 2023 à Paris).
Planisware, dans le domaine des logiciels en SaaS pour les entreprises, avait pourtant tout pour plaire : en forte croissance (+ 20 % l’an), 25 % de marge nette, sans dette et avec des liquidités nettes compte tenu d’un modèle d’abonnement, et des dividendes de 40 % du résultat net. Son évaluation dans le bas de sa fourchette d’introduction donnait un multiple du résultat d’exploitation de 2022 de 30 fois. Ce n’est pas donné, mais avec un taux de croissance de 20 % par an, cela ne fait plus que 21 fois pour 2024.
L’introduction en Bourse devait permettre au fonds de private equity Ardian de céder ses 20 %, les dirigeants gardant leurs 80 % d’une entreprise dont la capitalisation boursière devait être de 1 100 M€.
Et c’est probablement là où le bât a blessé. D’un coté, pourquoi un groupe de private equity qui sort totalement du capital accepterait-il de ne pas maximiser son prix de vente pour permettre à la nouvelle recrue boursière d’avoir un bon début de carrière boursière ? Un entrepreneur qui joue le long terme peut ainsi raisonner (à l’instar de Jacques Veyrat et de Neoen par exemple). Mais peu probablement un fonds de private equity qui sait qu’il pourra, à défaut d’une cession en Bourse, céder sa participation à un autre fonds de private equity ou à un family office, sans réduire pour autant le carried interest de ses associés.
D’un autre côté, les investisseurs en Bourse ont souvent en tête que si un fonds de private equity introduit en Bourse une de ses participations, c’est qu’il n’a pas trouvé mieux du côté de ses confrères et des industriels. Et il est vrai que lorsque l’on regarde depuis 2018 les introductions en Bourse d’entreprises ayant levé au moins 200 M€, toutes les anciennes participations de fonds de private equity ont fait moins bien que le marché qui, lui, a progressé de 40 % : Verallia + 30 % ; OVH, Antin Infrastructure et Believe ont vu leurs cours divisés par 2 ou 3... De quoi refroidir les ardeurs des investisseurs pour les opérations des fonds de private equity, comme Planisware en a fait les frais dans un contexte géopolitique terrible, mais correct boursièrement (recul de moins de 1 % sur la semaine).
Depuis 2018, à ce niveau de taille, les fonds de private equity ont fait la moitié des introductions en Bourse. Euronext doit réussir à les convaincre de laisser de l’argent sur la table au profit des premiers investisseurs boursiers pour ne pas tuer le marché des introductions valant quelques milliards. Sinon ce segment continuera de dépérir, alors qu’il peut attirer des candidats sur le long terme pour le SBF 120, voire le CAC 40.
Toute notre sympathie pour l’équipe de la direction financière de Planisware qui a travaillé d’arrache-pied depuis des mois pour que tout soit annulé au dernier moment.
Nommer et couvrir de honte au Japon
Le Japon ne cessera de nous étonner. Il y a 8 mois nous avions fait un commentaire sur les relations entre Kyocera et KDDI, qui sont loin d’être marquées du sceau d’une bonne gouvernance.
Cette semaine, on a appris que la Bourse de Tokyo allait sous peu publier officiellement la liste des entreprises cotées dont la valeur des capitaux propres est supérieure à leur montant comptable, c’est-à-dire dont le PBR est supérieur à 1. Moins de la moitié des groupes japonais cotés ont un PBR supérieur à 1, contre 60 % à Paris. Toutefois, si un plan sérieux pour remédier à cette situation a été annoncé, un groupe japonais qui vaut moins que ses capitaux propres comptables pourrait rejoindre le tableau d’honneur. Ouf !
La honte évidemment pour ceux qui resteront à l’écart de cette liste ! Ils signaleront qu’ils se complaisent dans une situation où les 100 investis par les actionnaires sous forme d’augmentation de capital ou de bénéfices réinvestis et non versés en dividendes valent moins que 100. C'est la caractéristique d’une mauvaise allocation du capital, qui pénalise l’économie dans sa globalité car ce capital, qui n’existe pas en quantités illimitées, aurait pu être consacré à des équipes dirigeantes plus efficaces pour réaliser d’autres projets. Un PBR durablement inférieur à 1 peut provenir d’une rentabilité des actifs durablement inférieure au coût du capital, d’une structure de groupe particulièrement opaque, d’une gouvernance déficiente, d’une structure financière avec beaucoup trop de dettes, etc.
Aux États-Unis et en Europe, sans qu’il soit nécessaire de publier une liste, c’est le rôle des actionnaires activistes que d'essayer de faire évoluer les choses. Au Japon, où les actionnaires activistes ne sont pas les bienvenus, c’est la Bourse de Tokyo qui veut inciter ses clients, les sociétés cotées, à s’améliorer pour le plus grand bien des utilisateurs de sa plateforme, les investisseurs, et de la Société en général, en publiant en creux la liste des prochaines cibles des activistes.