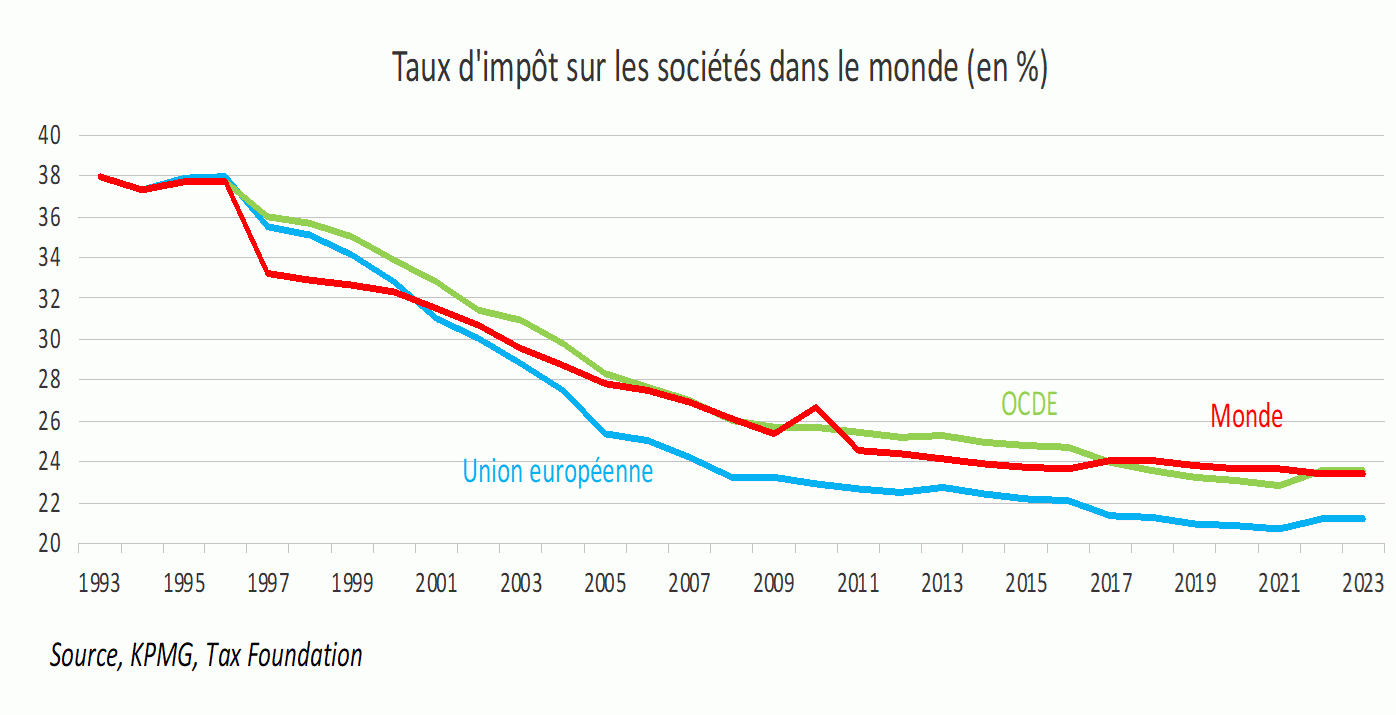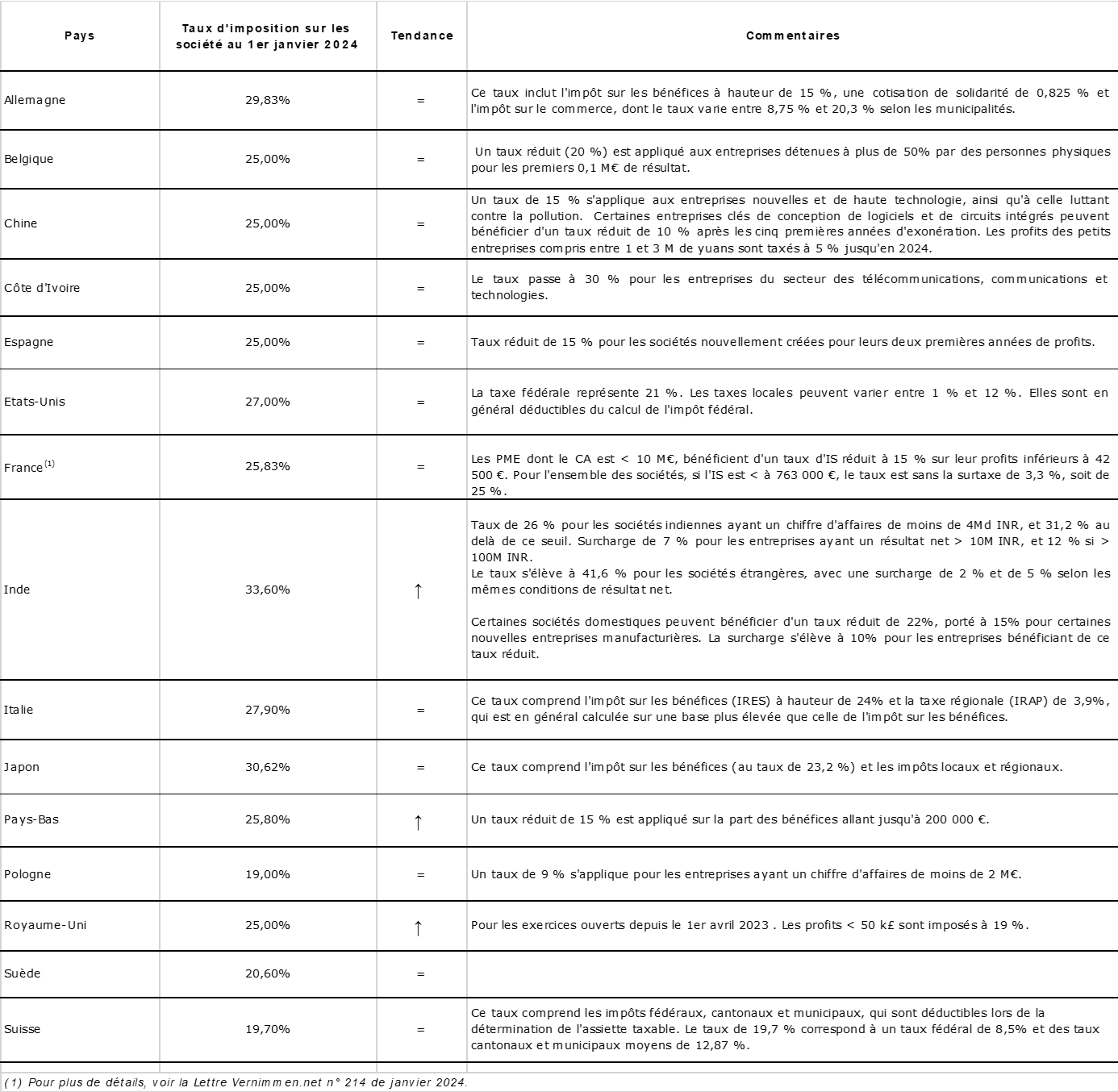La Lettre n°215 de Février 2024
Actualités : Diriger une entreprise sous LBO
A l’occasion de la remise des certificats de la 15e promotion de la formation totalement digitale à la finance d’entreprise que nous avions créée, ICCF@HEC Paris, Nicolas Milesi, PDG de Batisanté, société sous LBO, a traité des particularités de la gestion d’une entreprise sous LBO, en comparaison avec la gestion d’une affaire familiale ou de la filiale d’un grand groupe.
Il y a un peu plus de vingt ans, j'étais comme vous. J’avais passé trois ans sur ce campus et j’assistais à la cérémonie de remise de diplôme. Et parmi mes camarades, à mes côtés, il y avait présents dans la cérémonie, Rémi et Fabrice. Je dirige aujourd'hui une société sous LBO, Batisanté ; Rémi est devenu directeur associé au sein du fonds de private equity qui est l'investisseur majoritaire dans Batisanté ; et Fabrice est le responsable du fonds de dettes qui prête de l'argent à Batisanté.
Donc, je vous conseille de faire bien attention à côté de qui vous êtes aujourd’hui ! Il y a peut-être parmi vous des gens qui vont former ce trio infernal du fonds de private equity, de la société opérationnelle et du fonds de dette. Et en tout cas, j'espère que je vous donnerais quelques « trucs » pour vous permettre de savoir si ça vous intéresse ou pas d’aller dans ce monde-là.
Pardonnez-moi, je vais vous parler de mon expérience pendant quelques minutes pour que vous compreniez, pour que ça illustre de manière très concrète ce que veut dire d'être président de société en fonction de la nature des actionnaires.
J'ai dirigé pendant huit ans une société, qui était une filiale d'un groupe industriel ; puis j'ai dirigé pendant cinq ans une société qui était possédée par un entrepreneur qui l'avait fondée et développée ; et je travaille depuis cinq ans dans une société qui est sous LBO.
J'ai dirigé pendant huit ans une société qui s'appelle Châteaud’eau, qui est le numéro 1 de la fontaine à eau et qui était filiale de Danone à l'époque. Pour Danone, Châteaud’eau, c'était le bras armé de sa stratégie en mode 360° pour offrir une occasion de boire de l'eau de source à chaque moment de la journée : Volvic à la maison, Evian et Badoit au restaurant, Châteaud’eau en entreprise. Quand vous dirigez ce genre d'entreprise, vous êtes sur le front, vous vous occupez des hommes, donc des opérations, des clients, du commerce. Et vous êtes comme dans une course de relais, vous bénéficiez de services partagés, les services du Groupe qui vous permettent de ne pas penser aux financements, à la comptabilité et aux systèmes d'information. Cela vous est fourni de manière à ce que vous soyez très focalisé sur l'exécution de la stratégie de la société. Tant que ça va bien, c'est confortable.
Quand ça ne va pas, c'est moins bien. Et pourquoi c'est moins bien, c'est parce que vous vous retrouvez dans un monde où vous êtes au service de la stratégie d’une entreprise, d’un groupe industriel, Danone, et vous ne pouvez pas optimiser tout ce qui se passe dans le monde de la fontaine à eau.
Donc en 2005, quand arrive sur le marché de la fontaine à eau une formidable innovation pour le client, qui est une fontaine qui est filtrante, rafraîchissante et qui est connectée directement sur le réseau d'eau, c'est une hérésie pour Danone, qui ne veut vendre que de l'eau de source et de l'eau minérale. Donc qui ne veut pas vendre de l'eau du robinet, même filtrée.
Or pour les clients, c'est formidable parce que vous voyez, une bonbonne pèse 20 kilos, qu’il faut la porter pour la positionner sur la fontaine, et que parfois le distributeur ne vous en livre pas quand il fait 33 degrés depuis quinze jours parce qu’ils sont en rupture de stock. Donc vous n’êtes pas en mesure dans ce cadre-là d'optimiser complètement le marché sur lequel vous êtes en vous saisissant de ce nouveau relais de croissance.
Pendant cinq ans, j'ai dirigé une société qui était possédée par son fondateur. Cette société s'appelle MaxiCoffee, c'est le numéro 1 de la distribution de café en entreprise, en distributeurs automatiques, et peut-être que quelques-uns d'entre vous ont acheté des machines à café sur le site MaxiCoffee.com qui est le numéro 1 de la distribution de ce type de machine à grain en ligne. Donc là, dans ce type d'entreprise, c'est formidable, vous avez la main sur l'informatique, vous récupérez la main sur la comptabilité, vous avez aussi la main sur le financement.
Vous n’avez pas en revanche la main, parce que c'est le domaine réservé du fondateur, sur la vision stratégique. Et là, commence peut-être un début d'introspection. Il faut bien s'assurer que vous êtes très en ligne avec le fondateur, qu'il n'y a pas l’épaisseur d’un trait entre la vision stratégique du fondateur et la manière dont vous l'exécutez. Parce que ce que vous pensiez être de la stratégie venant d'un groupe industriel, la stratégie qui est vue dans la rationalité du marketing, du commerce, de la RH, de l'informatique ; dans une boîte qui est possédée par son fondateur visionnaire, on est dans une rationalité partielle de l'intuition. Et donc, il faut s'assurer que dans cette entreprise-là, le visionnaire est visionnaire ici, maintenant et pour plus tard. C'est extrêmement important d'être très en harmonie avec cette personne.
Enfin, j'ai rejoint il y a cinq ans, une société qui était sous LBO, qui s'appelle Batisanté, qui est le numéro 1 de la protection des bâtiments contre l'incendie, contre les nuisibles, et qui permet aux bâtiments de garantir leur conformité réglementaire.
Cette société avait été fondée dans les années 80 par un entrepreneur fondateur visionnaire, comme celui de MaxiCoffee, et qui l'a développée jusqu'en 2008, de 0 à 30 M€ de chiffre d'affaires et qui a décidé de la vendre à un premier fonds de private equity, qui l'a payé à un bon prix, douze fois l’EBE et qui l'a endetté à sept fois l’EBE, c'était la norme à l'époque, et ça redevient la norme un peu aujourd'hui également.
L'année suivante, en 2008-2009, le marché se retourne sur les diagnostics amiantes. Le chiffre d'affaires baisse un petit peu, 5 %, les coûts dans ce type de société sont fixes comme du roc. La société faisait 10 % de résultat net à l'époque. Qu'est-ce que ça fait, messieurs les financiers ? 5 % en moins de ventes, 50 % de la marge qui disparaît.
Donc ça fait des covenants de dette qui sont violés. Ça fait que le fonds de dettes qui prête de l'argent demande le remboursement immédiat. Ça ne marche pas. Le fonds de dettes devient l'actionnaire. Très naturellement, il dit au revoir au dirigeant. Nomme un nouveau dirigeant. Il lui donne une nouvelle feuille de route qui est de relancer la croissance et d'améliorer la marge. C'est classique. Malheureusement, ça ne marche pas. Donc il remercie ce dirigeant.
Il nomme votre serviteur il y a cinq ans. Ça marche un peu mieux. On remet la société en croissance et avec une belle marge avec 20 % d’EBE. Et on est en mesure avec cette situation-là de mettre la main sur notre plus gros concurrent, et on double de taille. Et à ce moment-là, l'année dernière, on se dit : « Mettons un vrai nouveau fonds de private equity qui ne vienne pas de la dette, qui a cette culture du private equity ». Et l'année dernière, j’ai eu la chance d'avoir Rémi comme actionnaire et Fabrice pour me prêter de l'argent.
Gardez en tête que quelle que soit l'expérience dans une entreprise, qu'elle soit possédée par un industriel, qu'elle soit possédée par un fondateur visionnaire, ou qu'elle soit possédée par un fonds, le job est le même. Vous faites trois choses : vous garantissez la satisfaction client, vous accélérez la croissance, vous renforcez la rentabilité. Quelle que soit la nature de l’actionnaire.
C'est facile de comprendre. Une société, c’est une organisation qui n'existe que pour satisfaire le besoin d'un client. Votre job, c'est de faire en sorte que cette organisation soit souple, soit fluide, pour que l'expérience client avec le produit, avec le service, soit le plus compatible avec la satisfaction client. Le client vous le rendra bien par de la croissance, en vous donnant plus de business, et vous gagnerez plus de clients.
Je ne vais pas vous expliquer pourquoi la croissance c’est bien. Moi, j'ai vécu la décroissance. Donc, essayez la décroissance ; vous verrez, c'est très sympathique. Moi, je ne connais pas de boîtes où les coûts sont variables. Les coûts, c'est fixe comme du roc. Vous avez les salaires qui augmentent, les loyers qui augmentent, toutes vos équipes travaillent trop et vous demandent plus de moyens, plus de gens, plus d’investissements.
Donc il suffit que le chiffre d’affaires baisse un tout petit peu et vous tombez dans l’effet ciseaux, le chiffre d'affaires baisse, les charges montent, vous avez la tête au milieu, et ça coupe, et ça fait mal. Ce qui est bien, c'est que l'inverse fonctionne aussi. Comme les coûts sont à peu près fixes, si vous augmentez un peu le chiffre d’affaires, ça vous redonne de la marge pour l'investir en satisfaction client et en marge. Et vous avez ce cercle vertueux formidable sur cette stratégie à trois piliers, et faites-le bien dans ce sens : 1) satisfaction client, 2) croissance, 3) rentabilité.
Comment vous le faites ? On fait toujours de la même façon. Vous avez votre équipe, les gens qui sont autour de vous. Faites attention à l'équilibre qu'il y a dans vos équipes. Il y a des gens qui viennent du terrain, qui ont gravi les échelons en interne.
Il faut qu'il y ait des experts, des gens qui ont fait des études pour tenir les fonctions d'experts, en finance, en RH, en informatique, ça ne s’invente pas. Ce n’est pas parce que l’on vient du terrain que ces fonctions-là sont faciles à tenir.
Et aussi veillez à faire rentrer des nouveaux talents pour ouvrir les fenêtres, pour que ces gens-là requestionnent les habitudes de votre organisation.
La deuxième façon de mener votre stratégie, votre développement, il faut développer un plan stratégique. Et que vous vous assuriez qu'il soit à la mesure des trois défis, de la satisfaction client, de la croissance et de la rentabilité.
Faire un plan stratégique vous donne le cap. Car dans une entreprise, le cap, on n'y arrive jamais comme ça. On tire des bords. Et si on n'a pas dit que c'était par-là, parfois on dit, oh c'est beau par ici. Parce que le vent pousse. Souvenez-vous que c'est par-là. Et ça, c'est le plan stratégique qui vous le dit. Et vous serez amené à développer plein de plans. Alors ça s'appelle des plans d'excellence commerciale pour la satisfaction client et pour la croissance. Ça s'appelle des plans d'excellence opérationnelle pour la rentabilité. Ce sont des plans qui vous aident au quotidien à tirer des bords vers la bonne direction, celle que vous vous êtes fixée en amont.
On en vient au cœur du sujet, mais gardez en tête que c'est le même job. Gérer une boîte, c'est gérer ces trois piliers-là.
Maintenant, le LBO. Il faut se souvenir qu'il y a deux leviers dans le LBO. Le premier, on pense toujours à la dette, c'est facile. Évidemment, le fonds de private equity achète la société en levant de la dette.
Mais il y a le deuxième levier, qui est sans doute le plus important, c'est qu’un fonds de private equity, c'est des professionnels de la finance, des professionnels de la stratégie. Ils n'ont pas investi leur argent, ce n’est pas leur argent. Ils sont allés le chercher auprès d'investisseurs, des banques, auprès d'institutionnels, de « family offices », ils sont allés lever quelques centaines de millions d'euros. Ça, c'était il y a quelques années ; maintenant, ils y vont par milliards. Et ils leur promettent en retour d'investissement un TRI, un TRI supérieur à 20 %. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans cinq ans, ils doivent rendre plus du double de ce que les investisseurs ont investi dans le fond. L'investisseur met 100 ; dans cinq ans il faut qu'il touche 250.
L'équation est super simple. Si vous avez compris ces deux choses, ces deux leviers, vous comprenez la spécificité du management sous LBO. Et d’après mon expérience, il y a cinq grandes spécificités du management sous LBO.
La première spécificité, c'est qu’il y a beaucoup d'indicateurs importants, beaucoup. Ça peut surprendre, mais c'est absolument nécessaire. Parce que votre actionnaire, ce n’est pas un gars qui connaît votre métier. Il ne connaît rien à la protection contre l'incendie. Il ne connaît rien au diagnostic amiante, à la performance énergétique. La seule chose qu’il connaît, ce sont des indicateurs. Il faut donc créer ce langage commun qui permet d'échanger sur comment va la satisfaction client, comment va la croissance, comment va la rentabilité. C'est très important de créer ce langage, mais ça veut dire que c'est très exigeant, en termes de temps, de précision, en termes de rigueur pour votre équipe finance. C'est passionnant de travailler dans un LBO, dans l'équipe finance, parce que vous êtes au cœur de la performance. Vous êtes au cœur de l'exécution des plans. Parce qu'il n'y a pas un plan qui ne se traite pas par des indicateurs.
La deuxième spécificité, c'est que vous utilisez beaucoup de conseils extérieurs. Je n’ai jamais utilisé autant de conseils extérieurs de ma vie. Je n'en utilisais presque pas avant. Pourquoi ? J'étais dans une société possédée par un industriel, par Danone. J'avais une question. J'appelais le patron d'Espagne, le patron du Canada. Il n'y avait pas un gars dans la confrérie des DG de Danone qui n'avait pas vécu mon problème, qui n'avait pas une solution à mon problème. Donc, je n’avais pas besoin de quelqu'un d'extérieur. Le Groupe y pourvoyait. Je caricature bien sûr...
Quand vous êtes dans une société qui est possédée par son fondateur, le fondateur est génial, il a l'intuition, c'est incroyable. La science sort. Donc, il n'y a pas besoin de conseils extérieurs. Enfin, c'est ce qu'il pense.
Quand vous êtes sous LBO, vous avez des problèmes. Votre équipe ne sait pas y répondre et vous non plus. Allez voir des sociétés de conseil en stratégie, en organisation, allez voir des spécialistes de cyber-sécurité, allez voir des spécialistes de chemin directeur pour transformer votre business. C'est très utile.
La troisième spécificité tient au mode de financement. J'ai déjà essayé de vous faire toucher du doigt l'équilibre financier. Quand vous faites 10 % de marge nette, si vous perdez 5 % de chiffre d'affaires, 50 % de votre marge disparaît, vous perdez votre job. Vous êtes assez motivé à faire en sorte que vous ne dériviez pas de votre plan stratégique. Sous LBO, d'après mon expérience, il ne vaut mieux pas reculer en EBE.
Et dans des boîtes de business service, dans les boîtes assez intensives en ressources humaines, il vaut mieux ne pas reculer en chiffre d'affaires non plus. C'est la troisième chose très spécifique. Vous avez des boîtes qui peuvent bouger, ça peut monter, descendre, l'entreprise flotte. Sous LBO, il ne faut pas que ça se passe ainsi. Il y a trop de gens qui seront beaucoup trop stressés à cause du niveau d’endettement et de l’exigence de retour sur investissement à moyen terme.
La quatrième spécificité : c'est qu'on fait beaucoup d'acquisitions. Vous vous souvenez que l'expert financier qui est votre actionnaire, qui est allé promettre du 20 % à ses actionnaires. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple pour doubler la valeur ? Faut faire doubler la taille d'entreprise. C'est bête. C'est comme ça. C'est parce que c'est beaucoup plus difficile de rembourser la dette. C'est plus facile d'aller faire des acquisitions. Souvent, un fonds de private equity, et c'est notamment le cas chez Batisanté, choisit des sociétés qui peuvent être des plateformes d'acquisitions. Ils ont déjà un moteur organique de croissance organique forte. Pour Batisanté, on fait entre 7 et 10 % de croissance embarquée par an. Ça veut dire que si je fais 100 M€ de chiffres d'affaires, dans cinq ans, j'en ferai 150. Je n’ai pas doublé de taille. Il reste 50 M€. Donc il faut que j'aille les chercher par des acquisitions ciblées. Et depuis un an, j'ai réalisé quatre acquisitions. Soit l’équivalent sur les trois années précédentes avant l’entrée du fond au capital.
Donc il y a vraiment une grande intensité sur les acquisitions. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que votre temps est très pris sur l’identification des cibles. Il ne faut pas acheter n'importe quoi. Il faut les négocier, les acheter et les intégrer. L'intégration, c'est ce qui prend le plus de temps à vos équipes RH, finance et informatique. Donc il faut être prêt en amont à avoir créé cette équipe qui va s'occuper de toutes ces intégrations. Si vous ne le faites pas, cela ne va pas bien se passer.
La cinquième spécificité, c'est que le fonds de private equity aura à cœur d'aligner les intérêts des gens clés dans l'entreprise. Et donc ils vont vous demander d'investir à leur côté, dans ce qu'on appelle un management package. Ça peut être 50 000 €, ça peut être 200 000 €, ça peut être 1 M€, n'importe, c’est ce que vous êtes capable de faire. Ce qui est significatif pour vous, ce qui vous permet d'être motivés sans vous empêcher de dormir la nuit si vous le perdez. Et en principe, si ça se passe bien, si le fonds fait fois trois, vous pouvez faire un minimum fois 10. Donc ça, c'est quelque chose qui est très spécifique, qui ne se rencontre pas dans les filiales industrielles, et qui ne se voit pas forcément dans les sociétés qui sont possédées par leurs fondateurs.
Je vais conclure, en essayant de vous donner quelques clés, si parmi vous, il y a des Rémi, des Fabrice, des Nicolas ; posez-vous quelques questions : la première, c'est, est-ce que j'ai des idées disruptives ? Si vous en avez, super, fondez une startup. Si vous n'en avez pas, le LBO est peut-être pour vous.
Si vous avez beaucoup d'argent, super, ne travaillez pas, ou alors achetez une entreprise. Si vous n'en avez pas, si vos parents n'ont pas eu la chance d’être riches avant vous, le LBO est peut-être pour vous.
Troisième élément : si vous n'avez pas peur de perdre votre job, si vous gérez plutôt bien le stress en mode stress moteur, plutôt que stress paralysant, peut-être que le LBO est pour vous.
Mais la quatrième condition, c'est peut-être la plus importante. Si vous êtes meilleur quand vous avez tous les leviers en main, les opérations, le commerce, la comptabilité, le financement et la vision stratégique, alors définitivement, le LBO c'est pour vous. Et je ne sais pas si vous connaissez cette chanson de Frank Sinatra, dont la mélodie a été écrite par Claude François, si ça a bien marché pour vous, plus tard, vous pourrez vous retourner et vous vous direz « I did it my way ».
La totalité de l’intervention de Nicolas Milési, y compris une série de questions/réponses est disponible sur le site Vernimmen.net en cliquant ici.
Tableau : Les taux d'impôt sur les sociétés dans le monde
Les taux d'imposition des résultats des sociétés dans le monde ont très légèrement diminué en 2023 et s'établissent désormais en moyenne à 23,37 % (23,53 % en 2022). Au contraire, les pays de l'OCDE ont commencé à remonter leur taux le plus bas atteint en 2022 (23,04 %) pour atteindre 23,57 % en 2023, principalement en raison du bond enregistré au Royaume-Uni, qui est passé de 19 % à 25 %.
Dans l'Union européenne, les taux d'imposition sont d'environ 21 % pour la deuxième année consécutive, mais ils restent faibles en raison des taux d'imposition des sociétés plus bas en Europe de l'Est.
Recherche : Clap de fin pour les SPACs ?
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
Les SPACs (Special Purpose Acquisition Companies) existent depuis longtemps mais ont rencontré un succès soudain depuis la fin des années 2010, atteignant un pic de 613 opérations aux États-Unis en 2021[1]. Ces sociétés « chèques en blanc » sont constituées par une levée de fonds pour une coquille vide cotée en Bourse, avec pour mission d’utiliser le capital ainsi levé pour acquérir une cible non cotée. Concrètement, il s’agit d’un mode d’introduction en Bourse alternatif à la méthode classique, dont le principal avantage est la réduction des asymétries d’information entre la société introduite et les investisseurs extérieurs.
Les partisans des SPACs mettent en avant la possibilité d’entrer en Bourse plus facilement pour de jeunes sociétés en croissance, ainsi que l’opportunité pour les investisseurs d’entrer facilement au capital d’entreprises qui n’auraient autrement été accessibles que par le private equity.
Les contempteurs de la méthode pointent l’effet de mode (souvent mauvais signe en finance), les performances décevantes en sortie de SPAC, ainsi que le manque de transparence lié à une réglementation qui n’a pas encore pris la mesure du phénomène.
L’article que nous présentons ce mois[2] propose une étude empirique des SPACs sur le marché américain entre début 2010 et fin 2021. Le résultat principal est le suivant : cette méthode d’introduction en Bourse est extrêmement coûteuse pour les actionnaires de la société fusionnée. Les auteurs reconnaissent que cette technique peut, dans certains cas, faciliter les introductions en Bourse en alignant les intérêts de l’initiateur du SPAC (le sponsor) sur ceux des investisseurs, mais pour l’essentiel leurs résultats montrent que la vague de SPACs des années 2019 à 2022 n’était pas financièrement justifiée.
L’analyse de la performance des SPACs distingue les trois parties impliquées : le sponsor (l’institution financière qui crée le SPAC), la société fusionnée dans le SPAC (plus précisément ses actionnaires), et les investisseurs externes qui souscrivent au SPAC.
Pour le sponsor, il s’agit incontestablement d’une bonne opération. L’objectif est de trouver une cible à fusionner pour que le SPAC soit réalisé (dans le cas contraire, le cash placé dans un fonds à intérêt est rendu aux investisseurs). Lorsque le SPAC est réalisé, la rentabilité moyenne observée (annualisée, entre 2010 et 2020) est de 23,9 %. Et le risque est très limité voire inexistant : la totalité des 458 SPACs réalisés sur la période ont apporté une rentabilité positive. Pour les auteurs, investir dans un SPAC en tant que sponsor est assimilable à l’acquisition d’une obligation convertible sans risque de défaut et à prix cassé. Une bien belle opération !
S’agissant des investisseurs externes, les performances sont très variables mais négatives en moyenne, de l’ordre de - 3 %. Le résultat serait pire encore sans la possibilité pour les investisseurs de sortir au moment de la fusion. Les investisseurs institutionnels qui sont sollicités pour compléter la levée de fonds en fin de SPAC (une opération appelée PIPE, Private Investment in Public Equity) s’en sortent mieux car ils bénéficient d’une décote, mais la performance reste décevante.
Enfin, et c’est le résultat principal, pour la période située entre janvier 2015 et mars 2021, le coût total de l’introduction en Bourse pour l’entreprise fusionnée est de 15,1 % de sa valeur post-introduction, à comparer à 3,2 % pour une introduction classique de caractéristiques équivalentes. L’écart est considérable, entrer en Bourse via la fusion avec un SPAC s’avère extrêmement coûteux. Pour l’essentiel, ce coût provient de la détention d’actions « gratuites » qui rémunèrent le sponsor en cas d’acquisition.
Dès lors, comment expliquer leur succès considérable entre 2020 et 2022 (qui a vu le nombre de SPACs dépasser le nombre d’introductions en Bourse classiques aux États-Unis) ? Pour les auteurs, les sponsors ont su se montrer particulièrement convaincants et ont joué sur les avantages réglementaires de la méthode. Les règles applicables aux SPACs sont celles des fusions plutôt que des introductions en Bourse, et les premières sont moins exigeantes que les secondes, notamment en ce qui concerne les obligations de transparence.
Cet article a été finalisé début 2023, à un moment où les auteurs constatent que beaucoup de SPACs ont du mal à trouver une cible. La suite de l’histoire leur donne raison. En 2023, près de la moitié des SPACs ont été liquidité sans acquisition, et plusieurs sociétés introduites en bourse par ce moyen ont fait faillite. Très récemment (en janvier 2024), la SEC a annoncé un durcissement de sa réglementation, alignant les SPACs sur les introductions en Bourse classiques pour protéger davantage les investisseurs. L’année 2024 pourrait voir se refermer la parenthèse ouverte il y a dix ans, le SPAC redevenant une opération très exceptionnelle.
Q&R : Qu'est-ce-que la règle des 40 % (rule of forty) ?
C’est une règle que les investisseurs professionnels ont développée pour identifier ce qui leur semble être les meilleures entreprises dans le secteur des logiciels vendus par abonnement (SaaS). Et les 40 en question sont la somme du taux de croissance de l’activité (mesurée par le chiffre d’affaires annuel, ou les revenus mensuels récurrents) et de la marge d’EBE.
Autrement dit, pour franchir cette barre au-delà de laquelle figurent à peu près le tiers des entreprises du secteur, une firme peut avoir une croissance champignon, par exemple 70 %, mais des pertes représentant 30 % au plus des ventes ; ou une moindre croissance (20 %) et avoir atteint déjà une profitabilité significative (marge d’EBE de 20 %). Bien évidemment la première situation se rencontre au début de la vie d’une start-up, car des croissances de 70 % par an vont naturellement s’épuiser assez vite (croître chaque année de 70 % multiplie la taille initiale de l’entreprise par 202 en 10 ans, et par 40 642 sur 20 ans). Cela dit, si l’on a vraiment un taux de croissance champignon, il n’est pas exclu que l’intérêt des clients pour le produit justifie l’espérance qu’un jour ou l’autre, l’entreprise soit capable de franchir le point mort.
Et si la croissance de l’entreprise se ralentissant, celle-ci n’est pas capable de dégager rapidement des marges positives, gagnant en taux de marge ce qu’elle perd en taux de croissance, sa durée de vie résiduelle va rapidement se réduire, surtout dans un environnement qui privilégie depuis quelques semestres la rentabilité sur la croissance. À l’autre extrémité du spectre, même avec une croissance de 5 %, un taux de marge d’EBE de 35 % rend heureux plus d’un actionnaire, comme peuvent en témoigner ceux qui ont investi dans Dassault Systèmes qui présente maintenant ce type de ratios.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière. En voici quelques-uns :
La lettre 2024 de Warren Buffett à ses actionnaires (26 février)
Warren Buffett rappelle dans cette lettre que ce qui crée de la valeur est la capacité d’une entreprise à réinvestir ses profits à un taux de rentabilité supérieur au coût du capital. A contrario, une entreprise qui réinvestit ses profits à un taux de rentabilité inférieur à son coût du capital détruit de la valeur. C’est ce qui explique que le cours de ces entreprises bondisse quand leurs dirigeants promettent des retours significativement plus élevés.
Ainsi Barclays qui vient de promettre de rendre à ses actionnaires 10 Md£ sur les trois prochaines années (pour une capitalisation boursière de 23 Md£). Le cours a bondi de 10 %. Non pas que les actionnaires soient des sangsues assoiffées de dividendes. Mais simplement, ils savent compter. Pour le comprendre, il faut se rappeler que les capitaux propres de Barclays de 71 Md£ ne valent que 23 Md£ en Bourse, sanction d'une rentabilité des capitaux propres de Barclays (7,3 % en 2023) inférieure à son coût du capital depuis des années. D'où une décote de 68 %, et une destruction de valeur de 48 Md£.
10 Md£ de dividendes versés, c’est 10 Md£ de cash qui arrivent sur les comptes des actionnaires et qui valent 10 Md£. Ce sont aussi des capitaux propres comptables qui baissent de 10 Md£ ; soit à décote constante à 68 %, une valeur des capitaux propres qui baisse de seulement 3,2 Md£. En net, + 10 - 3,2 = + 6,8.
De l’autre côté, 10 Md£ de résultats réinvestis, c’est une progression du montant comptable des capitaux propres de 10 Md£, et une hausse de leur valeur, à décote constante à 68 %, de 3,2 Md£.
+ 6,8 Md£ si Barclays restitue 10 Md£ aux actionnaires, versus + 3,2 Md£ si Barclays réinvestit les 10 Md£ dans son activité dont la rentabilité marginale est inférieure au coût du capital conduisant à des destructions de valeur ; la comparaison est vite faite. Pas étonnant que les actionnaires applaudissent à deux mains. D’autant qu’un effet de second tour pourrait se produire, car au moins 60 % des retours prendront la forme de rachats d’actions, conduisant ipso facto à accroître les capitaux propres par action, et à décote constante, à accroître le cours d’autant.
De l’autre côté de l’Atlantique, cette année encore, les actionnaires de Berkshire Hathaway voteront à une écrasante majorité l’absence de dividende, préférant le réinvestissement, confiants dans la capacité de son dirigeant à dégager des rentabilités supérieures au coût du capital.
Cela dit, Warren Buffett prévient que du fait de la taille atteinte par Berkshire Hathaway (900 Md$), ses performances futures ne pourront plus être aussi exceptionnelles que celles du passé.
Le jour où Berkshire Hathaway versera des dividendes n’est probablement plus très loin ; sans doute après le décès de son fondateur, comme Apple a attendu le décès de Steve Jobs pour s’y livrer, tant est forte l’empreinte de ces hommes d’exception.
Uber et les rachats d’actions (17 février)
À l’occasion de la publication de ses résultats 2023, les premiers à montrer un résultat net positif (1,9 Md$), Uber a annoncé le lancement d’un plan de rachat d’actions de 7 Md$.
Pourquoi initier des rachats d’actions alors que le groupe a encore un endettement net de 5,8 Md$, soit trois fois l’EBE (ou 1,5 fois si l’on considère les rémunérations payées en actions et passées au compte de résultat comme des charges non-cash) ? Certes, Uber annonce des taux de croissance pour les trois ans qui viennent entre 15 et 20 % et une croissance des flux de trésorerie deux fois plus forte, ce qui rend non pertinent le doute sur sa capacité à faire face à ses dettes.
Ce n’est donc pas pour rendre des capitaux oisifs et excédentaires comme chez Apple ou Google. Ce n’est pas non plus que l'action soit nettement sous-évaluée, cela ne saute pas spontanément aux yeux à cinquante fois les flux opérationnels moins les investissements corporels. Ce sont là les deux motifs les plus fréquents du rachat d’actions. Le sujet est plutôt celui de la croissance du nombre d’actions.
En effet, comme quasiment tous les groupes de technologie, Uber rémunère ses salariés par l’octroi d’actions gratuites, en moyenne pour 58 k$ en 2022, mais probablement beaucoup, beaucoup plus pour les salariés du département clé de R&D et technologie, qui concentre 1 215 M$ de rémunération en actions sur les 1 935 M$ comptabilisés en 2023. Puisque les rémunérations en actions de ces salariés font 38 % des coûts de ce département, la part dans la rémunération de ces salariés doit probablement dépasser la moitié de leur rémunération totale, et donc dépasser le montant de leurs salaires versés en cash.
Un cours qui a doublé depuis l’IPO de 2019 est une bénédiction pour tout le monde (pardon pour les vendeurs à découvert), mais le jour où s’enclencherait une phase baissière, certains feront triste mine dans le département R&D et technologie, et risquent de regarder dehors si l'herbe est plus verte, dès lors que le mouvement de baisse du cours ne serait pas général, mais propre à Uber.
Le nombre d’actions chez Uber a crû en moyenne depuis l’IPO de 5 % l’an sous cet effet et celui du paiement d’opérations de croissance externe en actions. Racheter ses actions permet alors de limiter la croissance du nombre d’actions qui viendrait, sinon, réduire les taux de croissance des paramètres opérationnels et menacer une bonne valorisation. Cela montre une discipline qui plaît aux investisseurs, c’est la force de l’usage de place auquel Uber vient d’adhérer (dans son intérêt bien compris).
P.S. : pour ceux qui croient que les rachats d’actions font monter les cours. Les 7 Md$ annoncés par Uber, à supposer qu’ils soient intégralement réalisés en 2024, ne feraient que 2,4 % du volume quotidien moyen des transactions sur l’action. Pas de quoi, en soi, faire monter mécaniquement et significativement le cours. Et la recherche académique montre que l’idée selon laquelle les rachats d’actions feraient monter les cours est fausse[2].
Le retrait de cote de Believe, cherchez l'erreur (13 février)
Believe, une major en puissance de la musique indépendante (Jul, Naps…), cotée en Bourse depuis juin 2021, a annoncé hier son projet de retrait de Bourse. Il est vrai que sa vie boursière avait mal commencé avec la fixation d’un prix d’introduction au bas de la fourchette annoncée (19,5 € - 22,5 €), et une cotation au soir de l’introduction en recul de 15 %. Mais Believe avait pu lever à cette occasion 300 M€ dans une opération purement primaire pour financer son développement et capitalisait 1,5 Md€ sur cette base.
Le cours avait progressivement chu à 8 €, puis s’était stabilisé aux environs de 10 €. Hier le management, le principal fonds de private equity actionnaire de Believe (TCV) et un autre fonds de private equity (EQT) ont annoncé une offre à 15 € et un retrait de cote si l’offre réunit plus de 90 % du capital (elle en fédère déjà 75 %). Le fondateur et dirigeant déclare à cette occasion : « Depuis son introduction en Bourse, Believe poursuit une excellente dynamique de croissance, lui ayant permis d’atteindre, deux ans en avance, les objectifs fixés lors de la cotation. »
Et là, on ne peut pas s’empêcher de penser qu’il y a soit un problème avec le cours d’introduction en 2021, soit avec le prix de sortie proposé en 2024, soit avec la déclaration du président. Éliminons cette dernière option car un tel communiqué est relu par les avocats qui savent faire des comparaisons. Restent les prix. En effet si Believe est en avance de 2 ans sur son plan d’affaires moins de 3 ans après son introduction, la logique voudrait que le prix de 2024 (15 €) soit plus élevé que celui de 2021 (19,5 €), d'autant que dans l’intervalle la Bourse a été bonne : + 20 % pour le SBF 120 (dividendes réinvestis). D’ailleurs l’investisseur qui a investi dans le SBF 120 en juin 2021 dispose d'un équivalent action Believe à 23,4 €, contre un cours à vendredi soir de 12 € et une offre à 15 €.
Donc soit le prix de l’introduction était bon et dans ce cas le prix de sortie est sous-évalué, et on lira avec intérêt le rapport de l’expert indépendant. Soit il n’était pas bon, et le prix de sortie est correct. Ce qui ne serait pas une surprise quand on sait qu’à fin 2022, sur les 139 entreprises qui se sont introduites sur la Bourse de Paris depuis 2014, et encore existantes, 77 % avaient un cours inférieur à leur prix d’introduction.
Quand on parle d’attractivité de la place boursière, et le sujet est loin de se limiter à Paris, on peut se demander si les banquiers introducteurs ne devraient pas se poser des questions sur leurs pratiques en matière de conseil sur le prix d’introduction, où la bataille pour obtenir le mandat peut les conduire à surenchérir sur les évaluations et à sur-promettre. Et il est très difficile pour une entreprise de remonter un premier effet très négatif quand, au soir de l’introduction, les investisseurs qui ont souscrit réalisent qu’ils ont perdu en un jour 15 % de leur investissement.
La pensée magique en Chine : interdire les ventes à découvert (31 janvier)
Alors que depuis son plus haut de février 2021, l’indice chinois phare CSI 300 a reculé de 44 % contre une hausse de 51 % pour le DAX, de 53 % pour le CAC 40 et de 82 % pour le S&P 500, les autorités boursières chinoises ont recouru ce week-end aux vieilles recettes éculées : l’interdiction de la vente à découvert dans l’espoir magique de soutenir les cours.
Rappelons que la recherche académique a régulièrement démontré que l’impact sur les cours d’une interdiction des ventes à découvert est non perceptible, accroît la fourchette bis-ask et réduit la liquidité des marchés. Autrement dit, elle n’atteint pas son objectif et réduit l’efficacité du marché.
Comme nous l’illustrions dans notre précédent billet consacré au 15e anniversaire de la mort d’Adolf Merckle, vendre à découvert est hautement risqué et ceux qui s’y livrent sont soit des incompétents qui disparaissent rapidement tant le risque est élevé, soit des escrocs qui essaient de manipuler les cours et qui vont vite se heurter aux autorités de contrôle des marchés, ou des investisseurs qui ont fait un travail approfondi et transmettent au marché une information que d’autres n’ont pas perçue (cf. Muddy Waters qui, dès la fin 2015, vend à découvert Casino avec prescience). Vouloir se priver de ce type d’informations, c’est comme interdire les porteurs de mauvaises nouvelles. Ce n’est pas avec cela que vous développez la confiance dans votre marché financier, bien au contraire comme en témoigne le recul de 2,8 % hier et avant-hier de l’indice CSI 300.
Si les marchés financiers chinois se portent si mal en comparaison des nôtres, c’est que la primauté n’est plus donnée au développement économique, mais au renforcement du rôle dirigeant du Parti communiste et à des rêves impérialistes, de nature à convaincre les investisseurs d’aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte. Même pour un dictateur, il n’est pas possible d’avoir le beurre et l’argent du beurre.