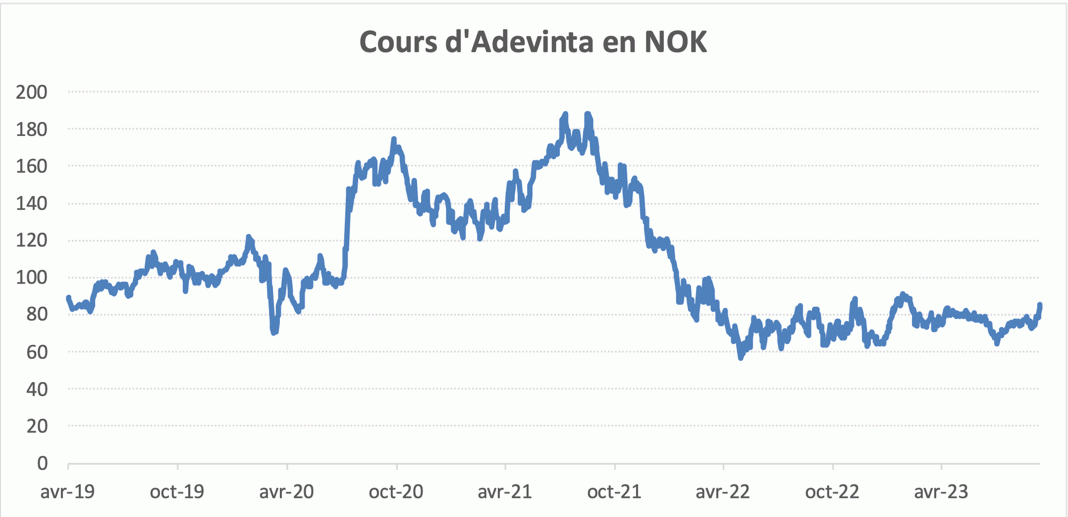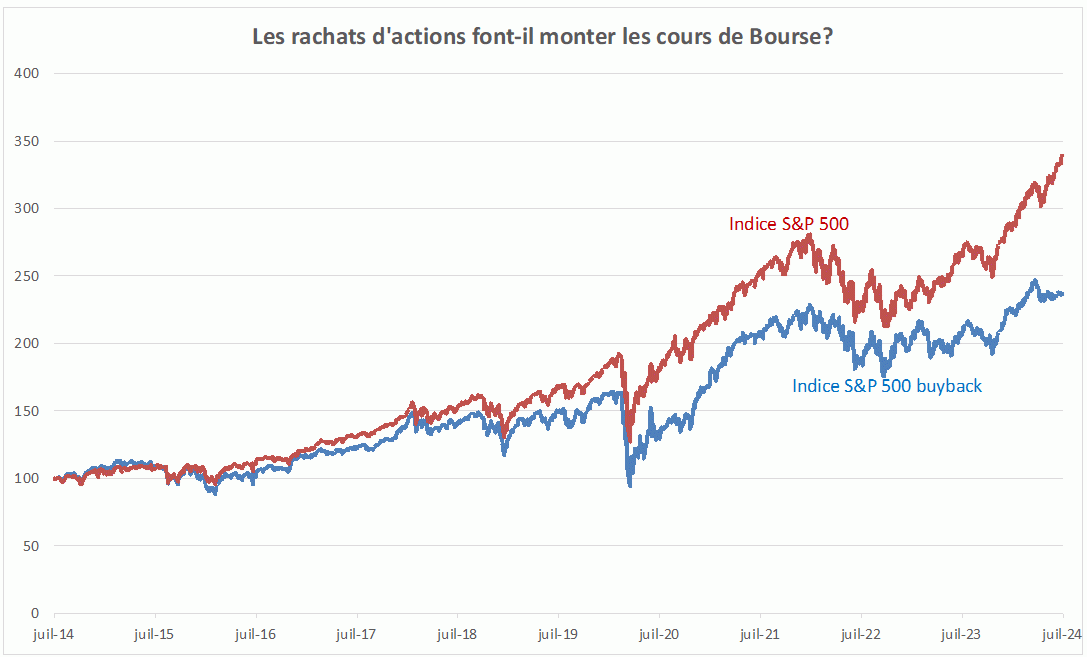La Lettre n°218 de Juillet 2024
Actualités : Trois idées à retenir de la sortie de Bourse d'Adevinta
Adevinta, plus connu en France sous le nom de son principal actif, Le Bon Coin, était jusqu’à peu un groupe coté à la Bourse d’Oslo, exploitant différentes places de marché numériques dans 14 pays d'Europe, d'Amérique latine et d'Afrique du Nord. Les plateformes d’Adevinta mettent en relation les acheteurs et les vendeurs pour faciliter les transactions, de l'immobilier aux voitures, en passant par les biens de consommation, couvrent 1 Md de personnes et attirent environ 3 Md de visites mensuelles moyennes.
En 2023, Adevinta a réalisé 1 826 M€ de ventes, en progrès de 11 % par rapport à 2022, un résultat d’exploitation de 295 M€ en progrès de 31 % sur 2022. Avec 1,8 Md€ de dettes, soit 3 fois l’EBE, l’endettement net n’est pas inquiétant.
Scindé d'avec Schibsted, groupe de médias norvégien, Adevinta est venu en Bourse en mai 2019 pour une valeur de 5,5 Md€, et cotait le 21 septembre 2023 9,5 Md€, soit 15,3 fois l’EBE 2023.
Les principaux actionnaires étaient eBay (33 %) qui avait apporté ses actifs allemands et du Bénélux à Adevinta, Schibsted (28 %), et le fonds de private equity Permira (11 %). Mais eBay était clairement vendeur de sa participation, et Schibsted, lui-même coté en Bourse pour environ 6 Md€, était sous pression, puisque sa participation dans Adevinta cotée représentait un bon 40 % de celle-ci, qui extériorisait une décote significative sur sa somme des parties.
Bref une situation très instable de l’actionnariat, créant un effet d’overhang pesant probablement sur le cours de Bourse.
Tirant parti d’une sous-performance boursière nette depuis 2 ans (- 50 % pour le cours contre + 5 % pour l’indice média), Permira monte un consortium de fonds de LBO (Blackstone, General Atlantic, TCV) et remet une offre indicative en août 2023.
Une fuite dans la presse le 21 septembre conduit Adevinta à confirmer avoir reçu une offre indicative et non liante, sans en donner les conditions financières. À cette annonce le cours bondit de 27 % à 108,5 NOK.
Le 21 novembre, une offre liante à 115 NOK est annoncée, valorisant l’actif économique d’Adevinta à 14 Md€, soit 18,9 fois l’EBE 2023, et représentant une prime de 52,6 % sur le cours moyen des 3 mois précédant la fuite dans la presse.
La partie dette de l’offre est assurée par une dette unitranche de 4,5 Md€ (6,1 x l’EBE 2023), à Euribor 6 mois + 5,75 % tant que le ratio Dette nette / EBE reste supérieur à 5. Cette dette unitranche est entièrement souscrite par des institutionnels (CPPIB, GIC, Goldman Sachs AM, CDPQ) et des fonds de dettes (Blackstone, Apollo, Sixt Street Partners, Arcmont, Blue Owl, Oaktree, Oakhill, etc.).
C’est le premier enseignement de cette transaction. Une dette de 4,5 Md€ peut se monter sans aucun recours aux banques commerciales ni au marché obligataire, uniquement auprès de fonds de dette privée, en l’occurrence plus d’une dizaine, qui ont ainsi le quatrième LBO le plus important en Europe de tous les temps (et le plus gros de ces dernières années).
Ce n’est donc pas le moindre paradoxe qu’un des plus gros LBOs en Europe ait pu se financer à un moment où les banques traditionnelles avaient réduit drastiquement leurs capacités de financement d’acquisition, en laissant ainsi aux fonds de dette leur prendre une part de marché significative.
Et dans cette transaction, les fonds de dette privée ont dû laisser une part du barème à certains de leurs investisseurs qui se sentent suffisamment équipés dorénavant pour investir dans de la dette de LBO en direct, en co-investissement, selon un schéma devenu classique pour les capitaux propres du financement de LBOs.
Il n’aura pas échappé à notre lecteur attentif que Blackstone, actionnaire à 35 % de la holding de contrôle du LBO sur Adevinta, (aux côtés de Permira à 45 %, General Atlantic à 14 % et TCV à 6 %), via des fonds de LBO qu’il gère, est aussi du côté de la dette via des fonds de dettes qu’il gère aussi. D’une certaine façon, ce n’est pas sans rappeler les Deutsche Bank, Paribas ou Mediobanca du temps jadis, prêteurs et actionnaires d’entreprises, avant que les contraintes prudentielles ne les conduisent à se séparer de leurs activités d’investissement pour compte propre. Et aussi parce que quand l’affaire tournait mal, les conflits d’intérêts entre les deux rôles éclataient en général au détriment de ces porteurs de doubles casquettes, les autres banques refusant d’accroître leurs engagements sachant que le prêteur aussi actionnaire aurait bien peu d’appétence pour aller au dépôt de bilan.
Ici Blackstone est très minoritaire dans la dette d’Adevinta, et c’est de l’argent géré pour compte de tiers différents (actions et dettes) et non pour compte propre. S’il tient à sa réputation, ce que l’on peut croire volontiers, il a tout intérêt à rester dans cette situation qui lui évite d’être moteur du côté de la dette comme il l’est du côté des capitaux propres.
Le second enseignement de cette transaction est la réaction des administrateurs indépendants qui ont fait un vrai travail de défense des actionnaires minoritaires, face à une situation d’asymétrie d’information caractérisée. En effet Permira dispose d’un siège au conseil d’administration, ce qui lui donne de toute évidence une vision claire de la situation d’Adevinta, lui permettant de lancer une offre de sortie de Bourse au moment où les cours sont les plus bas, en retrait de 60 % par rapport aux plus hauts de l’été 2021, et n’intégrant pas encore les effets d’investissements récents.
Au demeurant Schibsted et eBay, aussi représentés au conseil d’administration, décident de réinvestir aux côtés des fonds de LBO respectivement 40 % et 50 % de leurs actions, devenant ainsi actionnaires à 34 % du nouveau Adevinta sous LBO.
Ayant engagé deux banques d’affaires pour les conseiller, le conseil d’administration, réduit à ses 5 administrateurs indépendants (pour cause de conflit d’intérêts, les autres administrateurs représentant les 3 grands actionnaires qui réinvestissent) émet l’avis suivant :
Le conseil d'administration est unanimement d'avis que la société peut, au fil du temps, générer une valeur supérieure à celle qui est reflétée dans la contrepartie en espèces. En conséquence, pour les actionnaires qui se concentrent sur le potentiel de valeur à long terme de la société, le conseil d'administration n'est pas en mesure de recommander l'acceptation ou non de l'offre.
Toutefois, étant donné que la contrepartie en espèces se situe dans la fourchette de ce qui est équitable, d'un point de vue financier, pour les actionnaires de la société, et qu'elle représente une prime de 52,6 % par rapport au prix non perturbé, ce qui se situe dans la fourchette de ce qui a été offert dans le cadre d'offres publiques récentes en Norvège, elle peut représenter une opportunité intéressante pour les actionnaires qui cherchent à monétiser leur investissement à court terme.
Par conséquent, le conseil d'administration estime que les actionnaires de la société devraient avoir la possibilité de se faire leur propre opinion sur les mérites de l'offre. Le Conseil d'administration recommande à chaque actionnaire de la Société d'examiner attentivement l'offre à la lumière des facteurs exposés dans le présent document, des perspectives d'investissement de l'actionnaire, ainsi que d'autres informations pertinentes, y compris le document d'offre. Chaque actionnaire doit évaluer de manière indépendante s'il souhaite ou non apporter ses actions à l'offre, consulter ses propres conseillers financiers, fiscaux et juridiques, et procéder à toute autre investigation concernant l'offre qu'il juge nécessaire afin de prendre une décision éclairée à l'égard de l'offre.
Même par rapport à des cours bas, il est difficile de résister à une prime de plus de 50 %, d’autant que les fonds de LBO avaient mis la condition d’obtenir au moins 90 % des actions et des droits de vote pour donner une suite positive à leur offre, permettant de mettre en œuvre une sortie de cote subséquente. Autrement dit, la barre était assez haute, et en cas d’échec de son atteinte et d’un avis négatif sur l’offre, les administrateurs indépendants auraient pu se faire reprocher de priver une partie des actionnaires minoritaires d’une prime de plus de 50 %. Les administrateurs indépendants sont donc probablement allés jusqu’au bout de ce qu’ils pouvaient dire dans une recommandation aux actionnaires ; conseiller de ne pas apporter les titres à l’offre semblant irréaliste avec 2 attestations d’équité
de JP Morgan et Citigroup n’allant pas dans ce sens.
Mais les administrateurs indépendants ne se sont pas contentés d’écrire, ils ont aussi agi, et c’est le troisième enseignement de cette opération.
Compte tenu de la possibilité pour les grands actionnaires d’Adevinta de réinvestir tout (pour Permira) ou partie (pour eBay et Schibsted) de leurs actions Adevinta dans le LBO en devenant ainsi actionnaires, les administrateurs ont obtenu du consortium que les actionnaires minoritaires détenteurs de 28 % du capital puissent eux aussi réinvestir dans le LBO jusqu’à en détenir 10 % du capital. L’offre a alors été structurée en 3 branches : une branche 100 % en numéraire à 115 NOK par action Adevinta, une branche 100 % titres de la holding de LBO, et une branche 50 % en numéraire à 115 NOK et 50 % rémunérés en titre de la holding de LBO.
Si les demandes d’une rémunération contre des titres du LBO avaient dépassé 10 % de son capital, soit environ 6,8 % du capital d’Adevinta, les titres apportés à l’offre à 100 % titres auraient eu la priorité sur ceux apportés à la branche à 50 %.
Il n’a pas été utile de mettre en place cette restriction, puisque seulement 5 % des titres apportés à l’offre l’ont été contre rémunération en titres du LBO, soit environ 1,6 % du capital d’Adevinta.
L’offre ayant recueilli plus de 90 % des actions d’Adevinta, cette dernière a été rayée de la cote et le consortium a acquis 100 % de ses actions.
Les actionnaires d’Adevinta ayant opté pour le réinvestissement en titres du LBO ont été regroupés dans un premier holding qui détient 100 % du capital d’Adevinta ; ce premier holding étant contrôlé par un second holding avec eBay à 20 % du capital et Schibsted à 16 %, ce second holding est lui-même détenu à 64 % par un troisième holding où l’on retrouve les membres du consortium (Permira, Blackstone, General Atlantic et TCV).
Cette possibilité offerte aux actionnaires qui voudraient réinvestir aux côtés des fonds de LBO nous paraît une façon élégante de réduire les frictions et les conflits d’intérêts entre actionnaires lors d’une sortie de côte.
Comme l’illustre l’exemple d’Adevinta, elle ne peut concerner qu’une petite partie des actionnaires car certains investisseurs ne peuvent pas du fait de leur objet ou statut investir dans des titres non cotés (les SICAV par exemple). Par ailleurs, d’autres ne sont pas à l’aise avec un niveau d’endettement très largement supérieur à celui observé habituellement pour les sociétés cotées (dans ce dossier on passe de 3 fois l’EBE 2023 à 6,1 fois). Enfin d’autres ne voudront pas abandonner la faculté qu’offre la Bourse de pouvoir vendre à tout moment, pour celle de ne retrouver une liquidité que lorsque les membres du consortium décideront de vendre le contrôle d’Adevinta dans quelques années en dénouant alors le LBO qui vient d’être mis en place.
Bref, la branche réinvestissement en titres ne peut concerner principalement que des investisseurs professionnels, des family offices, etc. qui trouvent ainsi l’occasion de participer à un LBO en direct sans passer par un investissement dans un fonds de LBO, avec ses avantages (la diversification) et ses inconvénients (la diversification pour celui qui croit en Adevinta et n’a pas envie d’avoir d’autres expositions).
On notera que cette technique a déjà été mise en place sur la Bourse de Paris, par exemple lors de la sortie de Bourse de Nextstage en 2022, mais sur une échelle bien plus réduite puisque Nextstage au prix d’offre valait 300 M€. La quasi-totalité des investisseurs institutionnels et professionnels de Nextstage avaient choisi la voie du réinvestissement en titres et 10 % du capital la sortie en numéraire.
Enfin, L’Occitane en Provence qui souhaite sortir de côte (à Hong Kong), avec un rachat pour 1,7 Md€ des 27,4 % non détenus par l’actionnaire majoritaire, propose actuellement un dispositif similaire : une offre à 100 % en numéraire, ou à 100 % en titres de la holding de contrôle non cotée, limitée à 5 % du capital actuel de l’Occitane en Provence. À la différence d’un réinvestissement dans un LBO où la liquidité intervient au bout de quelques années quand le montage est débouclé, réinvestir aux côtés d’un majoritaire n’offre pas cette possibilité, sauf à créer une bourse interne entre actionnaires ayant réinvesti.
Tableau : Les rachats d'action font-ils monter les cours de Bourse ?
Trop souvent lisons-nous ou entendons-nous cette croyance, ce sophisme selon lequel les rachats d’actions auraient pour principal objectif et conséquence de faire monter les cours des entreprises qui y procèdent.
Rien n’est plus faux tant sur la cause que sur la conséquence comme l’illustre ce graphique sur les 10 dernières années.
En plus de l’indice S&P 500 qui témoigne de l’évolution du cours des 500 plus grosses capitalisations boursières des États-Unis, est aussi publié l’indice S&P 500 Buyback, qui regroupe les 100 groupes du S&P 500 qui ont fait l’année précédente les plus gros rachats d’actions.
Si racheter ses actions permettait de faire monter les cours, on pourrait s’attendre à ce que la performance de l’indice S&P 500 Buyback soit supérieure à celle de l’indice S&P 500. Or c’est exactement l’inverse que l’on observe sur les 10 dernières années comme l’illustre le graphique de ce mois :
Si le S&P 500 Buyback a rapporté, dividendes réinvestis, 9 % en taux actuariel sur 10 ans, le S&P 500 a lui rapporté 13 %, et avec un risque moindre (écart-type des rentabilités quotidiennes inférieur de 12 % à celui des rentabilités du S&P 500 Buyback). Pourquoi ?
Car l’objectif des rachats d’actions n’est pas de faire monter les cours, mais plus simplement de rendre aux marchés financiers qui ont financé l’entreprise y procédant, des capitaux propres devenus excédentaires, au moins transitivement, par rapport à ses besoins[1].
[1] Pour plus de détails sur cette thématique, voir les chapitres 38 et 39 du Vernimmen 2024.
Recherche : Quand sortir de la cote ?
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
Si les années 1980 et 90 furent celles des introductions en Bourse, les 25 dernières années ont vu un succès croissant du private equity avec des entreprises qui se financent très longtemps par des business angels et des fonds de capital-risque[1]. Aussi, beaucoup d’entreprises cotées ont décidé de sortir de la cote. Pour la première fois en 2016, aux États-Unis, les sorties de cote ont été plus nombreuses que les introductions en Bourse. La sortie de la cote de Dell en 2014 a particulièrement marqué les esprits, Michael Dell expliquant qu’elle résultait d’un choix stratégique de privilégier l’innovation et de se détacher de la pression court-termiste des marchés.
L’article que nous présentons ce mois[2] s’interroge sur les raisons et le timing des sorties de la cote volontaires, du type de celle de Dell. Il propose pour la première fois (en tout cas dans une revue majeure) un modèle théorique de sortie de la cote, et teste ce modèle sur un large échantillon international.
L’idée du modèle est de présenter la sortie de la cote comme une décision prise par le majoritaire selon ses intérêts propres, et dans certains cas au détriment des minoritaires. Cette décision résulte d’un compromis[3] entre les avantages pour le majoritaire de rester coté (principalement l’extraction de bénéfices privés au détriment des minoritaires) et les inconvénients (par exemple les coûts liés aux obligations de divulgation).
Remarquons que la construction même du modèle par les auteurs n’est pas flatteuse pour le financement coté, puisque l’argument de la performance de l’entreprise joue toujours en faveur de la sortie. Le maintien dans la cote n’est ici justifié que par des problèmes d’agence[4]. Cette vision est bien entendu simpliste mais c’est le principe même d’un modèle que de simplifier la réalité pour tenter d’en comprendre un aspect.
L’article ne porte pas sur l’optimalité de la cotation en tant que telle, les auteurs cherchent surtout à identifier ce qui déclenche, à un moment donné, la décision de sortir de la cote. Pour cela, des variables telles que le pourcentage de détention du majoritaire, le degré de protection légal des minoritaires, la politique de distribution, le taux de croissance et le risque de l’entreprise sont pris en compte. Aussi, dans le modèle, la sortie de la cote permet au majoritaire de s’approprier l’information sur les perspectives de l’entreprise, alors que les obligations liées à la cotation en font une connaissance commune.
Le modèle sert de support à une étude statistique permettant de mesurer l’impact de ces différents facteurs sur la décision de sortir de la cote. Les auteurs ont utilisé un échantillon très large de plus de 26 000 entreprises cotées dans 26 pays différents entre 1990 et 2020. La dimension internationale de l’échantillon permet d’inclure le degré de protection légal des minoritaires et le coût des obligations de divulgation dans l’analyse. Parmi ces entreprises, 8 575 sortent de la cote pendant la durée d’observation. Les auteurs focalisent leur attention sur les 832 sorties volontaires. En effet, dans la grande majorité des cas, les sorties de la cote ne résultent pas d’un choix spécifique, mais sont la conséquence d’un autre événement (fusion, acquisition, faillite…). L’analyse permet de mesurer l’importance des différents arguments dans la décision de sortir de la cote.
Le facteur le plus déterminant statistiquement est le taux de détention par le majoritaire. En moyenne, le majoritaire détient 35 % lorsque l’entreprise est volontairement sortie de la cote, contre 31 % sur l’ensemble de l’échantillon. L’écart peut sembler faible, mais compte tenu de la taille de l’échantillon il est très significatif. L’interprétation proposée par les auteurs est que les majoritaires peuvent extraire davantage de bénéfices privés au détriment des minoritaires lorsque ces derniers détiennent une plus grande part du capital, donc lorsque la part du majoritaire est plus faible. De même, la sortie de la cote est plus fréquente, toutes choses égales par ailleurs, lorsque la réglementation protège les minoritaires. Ces deux observations sont compatibles avec l’idée que le majoritaire pourrait éviter ou retarder les sorties de la cote en raison de problèmes d’agence. Aussi, les sorties de cote sont un peu plus fréquentes lorsque les perspectives de croissance sont importantes.
L’existence d’un compromis entre bénéfices privés du majoritaire et perspectives économiques tel que modélisé par les auteurs est corroborée par l’observation, sur un échantillon très large. Il convient cependant de rester prudent sur l’interprétation des résultats, l’analyse étant fondée sur un modèle aux hypothèses fortes et qui présuppose une supériorité du financement non coté pour favoriser la croissance. Pour autant, retenons l’élément le plus factuel de cette analyse : les facteurs associés à des problèmes d’agence (taux de détention, environnement réglementaire) sont plus déterminants que les facteurs économiques (risque et perspectives de croissance) lorsqu’il s’agit de sortir volontairement de la cote.
[1] Voir à ce sujet l’article sur le financement entrepreneurial dans La Lettre Vernimmen.net n° 190 de juillet 2021.
[2] A.Azevedo, G.Colak, I. El Kalak Et R.Tunaru (2024), “The timing of voluntary delisting”, Journal of Financial Economics, vol. 155.
[3] En anglais trade off
[4] Pour les problèmes d’agence, voir le chapitre 28 du Vernimmen 2024.
Q&R : Devinette pour votre été
Mais elle ne vous occupera pas tout l’été !
BlackRock est le plus grand gestionnaire d’actifs au monde avec environ 10 500 Md$ d’actifs en gestion. Son cours de Bourse a progressé de 9 097 % depuis son introduction en Bourse en 1999.
Blackstone est le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, avec 1 100 Md$ d'actifs sous gestion. Depuis son introduction en Bourse en juin 2007, son cours a progressé de 317 %.
Lequel des deux a la capitalisation boursière la plus élevée ?
Q&R : Réponse à la devinette estivale
Bien qu’ayant des actifs sous gestion 10 fois inférieurs, Blackstone capitalise en Bourse à la mi-juillet 2024 plus que BlackRock : 156 Md$ contre 123 Md$.
Au-delà de la proximité des noms, les deux groupes ne sont pas sur les mêmes métiers comme l’illustrent par exemple la marge nette sur actif gérés : 0,046 % pour BlackRock contre 0,21 % pour Blackstone ; ou les actifs gérés par 1 000 employés : 232 Md$ pour Blackstone et 553 Md$ pour BlackRock. Témoin du levier d’endettement d’origine, la rentabilité des capitaux propres de Blackstone est 50 % plus élevée que celle de BlackRock : 21 % contre 13 %.
Enfin Blackstone est bien aidé par un PER (45) plus du double de celui de son confrère (21).
Ce résultat qui vous a peut-être surpris, est l’illustration de la réussite de la stratégie de diversification tous azimuts de Blackstone, comme d’autres de ses pairs, hors de leur activité de départ, le LBO, pour couvrir les infrastructures, les dettes privées, l’immobilier, etc.
Pour terminer, la similitude des noms n’est pas une coïncidence puisque Blackrock et Blackstone ne formait qu’une seule entreprise avant 1995, Blackrock étant un spin off de Blackstone.
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière. En voici quelques-uns :
Believe, alors, équitable ou pas ? (25 mai)
La lecture du projet de note d’OPA et de note en réponse laisse songeur sur deux points.
Believe avait été introduit en Bourse en juin 2021 à un prix au bas de la fourchette annoncée à 19,5 €. Le premier jour, le cours chute à 16,1 € et poursuit sa glissade ensuite.
En février 2024, le management, avec l’un des fonds actuellement actionnaire et un nouveau fonds d’investissement, forme un consortium et propose de sortir Believe de la cote à 15 € en rachetant le flottant de 28 %, alors que la société a 2 ans d’avance sur son plan d’affaires et que l’indice boursier utilisé par Believe (dans le cadre de sa politique de rémunération par actions, l’Eurostoxx 600) a progressé de 14 % depuis l’introduction en Bourse. Certes un indice cache une dispersion, et la hausse des taux a frappé plus lourdement les entreprises dont les flux de trésorerie disponible sont loin dans le temps, comme Believe dont le flux de trésorerie disponible est encore négatif. La tâche de l’expert indépendant s’annonçait ardue car attester dans ces conditions de l'équité d’une offre, pouvant entraîner l’expropriation des actionnaires, et qui causait quelques remous, ne tombait pas sous le sens.
Mais un deus ex machina, prenant les traits de Warner Music, survient qui annonce pendant un temps réfléchir à faire une offre à un prix d’au moins 17 € ; puis, à la réflexion, se retire. Dès lors, l’expert indépendant a beau jeu de dire au consortium : Relevez votre prix à 17 € si vous voulez que j’atteste de l’équité d’une offre pouvant conduire à une expropriation. Réponse du consortium : Nous l’avons déjà relevé de 14 à 15 € à la demande des administrateurs indépendants, et notre prix est final. Réponse de l’expert : Je ne peux pas attester de son équité, à moins que vous ne fassiez tomber la possibilité d’une sortie de cote par expropriation des minoritaires restants si votre offre dépasse les 90 %. Réponse du consortium : Nous modifions notre offre et abandonnons la sortie de cote. Réponse de l’expert : Je peux alors attester de l’équité d’une offre qui n’entraînera en aucun cas une expropriation à 15 €.
Ce n’est pas la première fois que l’on observe ce ballet (cf. SMTPC), et que l’on aboutit au concept d’un prix qui est équitable (15 €), mais toutefois pas suffisamment équitable pour permettre une expropriation (à 17 ou 18 € ?). C’est à chacun de se faire son avis, car être investisseur est une activité qui, comme tout métier, nécessite de travailler et où le dilettantisme a peu de place. Le rapport de l’expert indépendant donne beaucoup d’informations et d’arguments pour qui veut vendre à 15 €, ou qui veut poursuivre l’aventure. Cela dit, on ne va pas se plaindre d’un expert indépendant qui ne s’est pas laissé marcher sur les pieds, et qui a obtenu l’essentiel, éviter l’expropriation obligatoire à 15 €, même s’il peut dire, comme les minoritaires : Merci Warner Music.
À samedi pour le second élément qui laisse songeur dans cette opération.
Believe, un expert qui surclasse les banques conseils (29 mai)
Voici le second élément qui nous a laissé songeur à la lecture des notes d’offre, après le concept d’un prix équitable, mais pas suffisamment équitable toutefois pour permettre une expropriation comme vu ce samedi.
Si le consortium a fait une offre à 15 € pour racheter le flottant, l’évaluation des 2 banques conseils est nettement inférieure, alors qu'habituellement il y a peu de différences entre cette évaluation et le prix d’offre. Ici, c’est tout l’inverse. Les banques conseils arrivent à un DCF de 10 €, là où l’expert indépendant est à 17 € ; avec les multiples c’est à une fourchette de 5 à 10 €, là où l’expert indépendant est entre 10 et 20 €.Avec des conseils qui valorisent la cible à 10 € avec un DCF et entre 5 € à 10 € par les multiples, on se demande comment le consortium, qui n’est pas constitué d’enfants de chœur de la finance, a pu mettre sur la table 15 €, et Warner Music articuler un prix de 17 €.
Quand on regarde le détail de l’évaluation des banques, on est frappé des erreurs commises :
1/ Le taux de rentabilité requis estimé à partir du modèle du MEDAF est : taux sans risque + beta x (espérance de rentabilité du marché - taux sans risque). Ce qui est entre parenthèses est la prime de risque. Mais si on en prend une en bloc, on s’assure qu’elle a été calculée avec le même taux sans risque que l’on retient par ailleurs dans la formule, de sorte à ne pas avoir 2 taux sans risque différents. Or ici, la prime de risque prise n’a aucune chance d’avoir été calculée avec le taux de l’argent sans risque retenu (OAT 20 ans), comme pourtant requis.
2/ Prendre comme taux sans risque justement le taux des OAT à 20 ans, alors que la pratique est de prendre, à défaut d’un taux à court terme qui est vraiment sans risque de fluctuation de valeur, le taux des OAT à 10 ans. Ainsi est gonflé le taux d’actualisation et réduite la valeur.
3/ Ajouter des coûts de consultants non prévus au plan d’affaires préparé par le management, ce qui réduit la valeur.
4/ Se contenter de prendre les multiples de deux sociétés comparables, Warner Music et Universal Music (UMG), pour les appliquer paresseusement à Believe, en faisant mine d’oublier que le niveau d’un multiple dépend avant tout du taux de croissance, et qu’à cette aune, Believe laisse sur place ces deux groupes : + 22 % par an depuis 2019 contre + 12 % pour UMG et 6 % pour Warner. Rien qu’à comparer le multiple calculé par les banques pour Warner (14) et celui d’UMG (22), dont la substantielle différence s’explique par la non moins substantielle différence entre les taux de croissance de ces deux groupes (6 % et 12 %), on voit instantanément que l’on ne peut pas appliquer ces multiples à Believe qui croît 2 ou 4 fois plus rapidement. C’est ce qu’a bien compris l’expert indépendant qui a fait un vrai travail de réflexion et parvient à intégrer, comme il se doit, l’impact du taux de croissance dans le niveau du multiple retenu pour valoriser Believe.
Étrange.
Privatiser France Télévisions ? (16 juin)
Le groupe France Télévisions a réalisé en 2023 3 Md€ de chiffre d’affaires, dont 2,4 Md€ de subventions publiques (la redevance a été supprimée en 2022), et 432 M€ de recettes publicitaires prises sur un marché de la publicité télévisuelle en déclin de 1,4 % par an et qui totalise 3,5 Md€. France Télévisions a 429 M€ de capitaux propres, et un flux de trésorerie disponible négatif de 67 M€ en 2023, autant qu'en 2022. Son résultat net 2023 était de 14 M€ contre - 48 M€ en 2022.
Comme le projet du Rassemblement national prévoit de rendre aux Français les 2,4 Md€ de subventions annuelles versées, c’est donc 2,4 Md€ de recettes publicitaires supplémentaires qu’il faut aller chercher pour rester à l'équilibre, soit 69 % du volume de ce marché, donnant alors à France Télévisions une part du marché de la publicité télévisuelle de 80 % avec seulement 29 % de l’audience.
Même si cet exploit était réalisé, ce qui reviendrait à priver Groupe TF1 et M6 de 90 % de leurs recettes publicitaires, France.tv ne serait toujours qu’à l’équilibre. Pour justifier la valeur de 3 Md€ donnée par Sébastien Chenu (vice-président du Rassemblement national) comme produit de la privatisation de France Télévisions, et compte d’un PER de M6 et TF1 de l’ordre de 8, il faudrait que France.tv fasse 375 M€ de résultat net, soit de l’ordre de grandeur du cumul des résultats de Groupe TF1 et M6 (429 M€). Ce qui est assez cohérent, puisque 3 Md€, le produit de la privatisation de France.tv selon Sébastien Chenu, c’est environ la somme de la capitalisation boursière de M6 et de TF1.
Pour arriver à ces 375 M€, il suffirait de faire 500 M€ de recettes publicitaires supplémentaires, conduisant à prendre 96 % du marché publicitaire télévisuel avec 29 % de l'audience. Alternativement, licencier la moitié des 8 950 salariés de France.tv (salaires de 1 030 M€ en 2023).
Quant à un rachat de France.tv par M6 ou TF1 mentionné par Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement national, outre qu’il ne pourrait être que partiel et induisant un démantèlement pour respecter les règles anti-trust (pas plus de 7 programmes nationaux de télévision pour une même personne), il ne règle en rien le problème de trouver 2,4 Md€ par an pour compenser la perte des actuelles subventions publiques, soit l’équivalent du chiffre d’affaires de TF1, ou de 185 % de celui de M6.
Si vous avez du mal à croire à la faisabilité de ces plans d’affaires, peut-être vous demandez-vous comment en 1987, TF1 a-t-il pu être privatisé, et survivre à l’absence de redevances audiovisuelles ? C’est que le marché de la publicité télévisuelle était alors en plein boom, avec des taux de croissance annuelle de 10 à 15 %, contre l’actuel - 1,4 %. Cela change tout.
Un fonds souverain de 500 Md€ ? Facile ! (30 juin)
Et c’est Jordan Bardella, dont les connaissances en économie financière ne cessent de nous impressionner pour un jeune homme de 28 ans, qui a eu cette excellente idée. On aurait ainsi le huitième plus gros fonds souverain au monde devant celui du Qatar (487 Md€), reléguant Bpifrance (un misérable 34 Md€ au bout de 12 ans) dans les poubelles de l’histoire. En trois ans on vous dit.
Aux esprits grincheux qui rappellent que les Norvégiens ont mis 17 ans pour que leur fonds souverain atteigne ce niveau, malgré la rente pétrolière et gazière qui l’alimente, précisons qu’il suffirait de réduire d’un quart toutes les dépenses de l’État (salaires des fonctionnaires, intérêts de la dette, entretien des bâtiments, achats d’armement, reversements aux collectivités locales, etc.), chaque année de 2024 à 2027 pour y arriver, puisque le budget 2024 de l’État français est de 512 Md€.
Comme Jordan Bardella n’a pas voulu préciser comment il y parviendrait, on pourrait lui suggérer des alternatives moins violentes, comme convertir 90 % des encours du livret A et assimilés (565 Md€) pour créer ce fonds, et tant pis pour le logement social ; ou demander aux Français d’apporter à ce fonds la moitié des leurs actions cotées d’entreprises françaises et du monde entier (1 017 Md€) détenues en direct ou via des SICAV et autres véhicules de placements collectifs. Peut-être plus simple, flécher les deux tiers de dépôts à vue des ménages français (751 Md€) vers ce fonds, et tant pis pour l’argent mis de côté pour payer le loyer à la fin du mois, ou les vacances.
Et pour donner aux Français une vraie culture actions qui leur manque cruellement, faite de risque, de rentabilité et de long terme, le capital et la rentabilité seront garantis par l’État, à 2 % par an au-dessus de l'inflation. Génial ! Comment se fait-il que personne n’y ait pensé plus tôt, particulièrement hors de France ? Bravo Jordan ! Enfoncés les Américains qui, eux, ont une vraie culture actions avec 45 % de leur épargne investie en actions contre 17 % dans l’Europe des 27 (et 23 % en France), sans la moindre garantie de leur État. Enfoncés les gestionnaires du capital investissement français qui ont délivré depuis 1987 une rentabilité annuelle de l’ordre de 9 % au-dessus de l’inflation. Enfoncé le CAC 40 à dividendes réinvestis qui a délivré du 6 % au-dessus de l’inflation depuis 1988.
Et comme il n’y a aucun doute que l’on y arrive, on parviendra aussi, en même temps ; à augmenter les dépenses, réduire le déficit budgétaire et la dette de l’État, sans accroître les impôts.
Facile, on vous dit.
Vive la magie !
Les chiffres de l’épargne des Français cités dans ce billet sont ceux de fin 2023 publiés par la Banque de France dans sa note de 4 pages Stat Info du 15 mai 2024.
Le PDG d'un groupe du CAC 40 peut-il publiquement affirmer des choses fausses inexactes ? (13 juillet)
À un journaliste d’Investir qui lui demandait si l’indemnisation (d’une éventuelle nationalisation des autoroutes) pourrait être nulle, puisque les dividendes obtenus des concessions autoroutières couvrent depuis 2022, l'investissement de départ et sa rémunération normale, le PDG de Vinci répond le 29 juin dernier : « C’est inexact. Il y a toujours inscrit dans nos bilans une dette portée par ces réseaux autoroutiers et celle-ci se chiffre à plus de 16 Md€ ! ».
Le fait qu’il y ait toujours une dette inscrite au bilan des concessions autoroutières ne veut pas dire que l’actionnaire Vinci n’a pas retrouvé, et bien au-delà, son investissement, contrairement à ce que son PDG affirme.
Prenons l’exemple des Autoroutes du Sud de la France, ASF, cotées en Bourse jusqu’en 2006 et privatisées en 2006. C’est la principale concession autoroutière de Vinci qui avait acquis 23 % de son capital avant la privatisation de 2006. Lors de cette dernière, Vinci a acquis les 77 % du capital restant en contrepartie d’un investissement de 8,8 Md€. L’endettement net fin 2005 d’ASF était de 7,6 Md€, soit à peu près celui de fin 2023 : 7,2 Md€.
Dans l’intervalle, les dividendes touchés par Vinci sur les 77 % d’ASF ainsi acquis ont été de 15,8 Md€, donnant un TRI de plus de 8 % à son investissement de 2006, et ceci en supposant nuls les flux jusqu’à la fin de la concession en 2036, alors qu’ils ont été de 2,2 Md€ en 2023. Les flux de trésorerie disponible après frais financiers générés par ASF sur les 12 années à courir serviront à rembourser l’endettement net (7,2 Md€), et pour le solde seront versés en dividendes. Le TRI réalisé par Vinci sera donc bien largement supérieur à 8 % et, partant, au coût du capital de cette activité, qui est de l’ordre de 5 % sur la période.
Et si l’endettement net d'ASF, malgré la génération de flux de trésorerie disponible des autoroutes, n’a quasiment pas été réduit depuis 2005, c’est qu’en bonne gestion financière, Vinci a préféré retirer des capitaux propres de ce métier peu risqué pour les investir dans des métiers plus risqués les requérant. Ainsi dès 2007, un dividende de 3,8 Md€ largement supérieur au résultat net a été payé par ASF à Vinci, financé par une hausse de l’endettement net de 3,2 Md€ et induisant une chute des capitaux propres comptables de 3,8 Md€ à 0,5 Md€.
Le fait que le PDG de Vinci utilise un argument dont il sait qu’il est faux, euh…pardon, inexact, pour répondre à un journaliste, montre bien qu’il est à court d’arguments financiers pour réfuter la réalité des surprofits réalisés. Nos calculs réalisés sur la base des rapports annuels d’ASF depuis 2006 ne doivent donc pas être trop…inexacts.