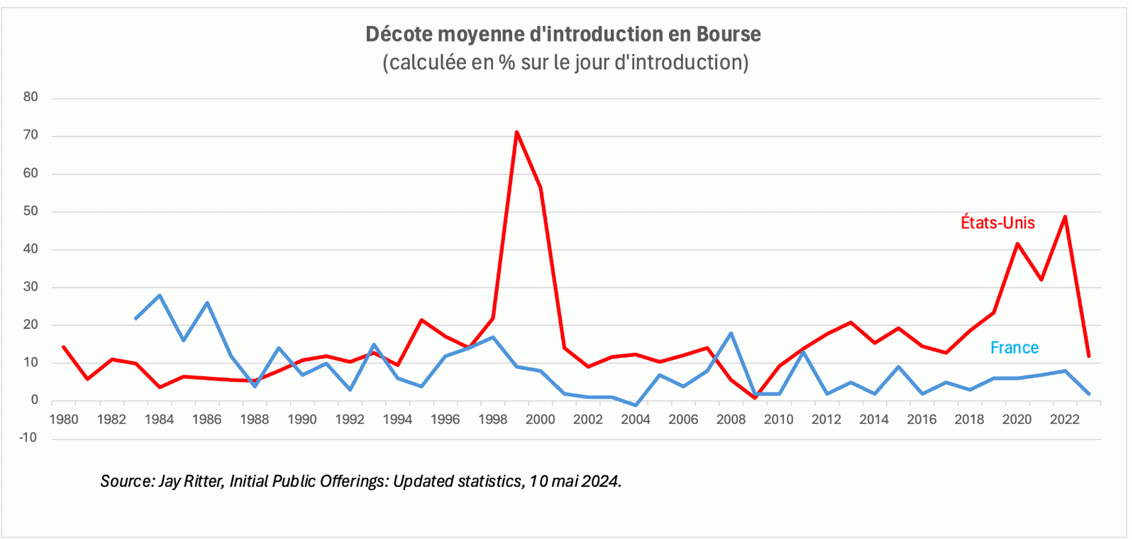La Lettre n°220 de Octobre 2024
Actualités : 50 ans de finance d'entreprise
Il y a cinquante ans paraissait la première édition du Vernimmen dont nous vous reparlerons à la fin de cet article. C’est pour nous l’occasion de revenir en arrière sur les grandes tendances qui ont bouleversé la pratique de la finance d’entreprise et la finance d’entreprise elle-même.
Avec le recul, ce qui nous paraît fondamental pour expliquer ces 50 dernières années, c’est la fin des taux d’intérêt réels négatifs en 1976[1] en France, qui permet le passage d’une économie d’endettement à une économie de marchés. Par coïncidence, ceci se produit à peu près au même moment où parait la première édition du Vernimmen (1974 et 1976).
Dans un monde de taux d’intérêt négatifs, les entreprises ont tout intérêt à s’endetter, car pour peu qu’elles soient protégées de l’inflation en ayant la capacité de pousser auprès de leurs clients les hausses de prix qu’elles subissent de l’amont de leur filière, le taux d’intérêt de la dette, un fois déduit le taux d’inflation est négatif. Certes, il n’est pas négatif au moment où la dette est contractée, mais comme celle-ci est contractée auprès de banques à taux fixe, et que le taux d’inflation ne cesse de progresser (de 3,3 % en 1961 à 13,3 % en 1981), très vite le taux d’intérêt réel d’un emprunt contracté il y a 2 ou 3 ans devient négatif.
Les entreprises ont donc tout intérêt à se financer pour l’essentiel par endettement et ne se privent pas de le faire. Le concept de coût du capital est ignoré puisqu’il se limite au coût de l’endettement ou peu s’en faut, et que celui-ci s’avère très vite négatif.
Pourquoi alors essayer de lever des capitaux propres sur une Bourse moribonde, ou auprès d’une industrie du capital investissement inexistante ? Les seules sources un peu significatives de capitaux propres étaient les compagnies financières de Paribas, de Suez, et hors de France la Société Générale de Belgique, Mediobanca ou Deutsche Bank qui, elles, pouvaient lever des capitaux propres en Bourse pour financer leurs activités de prises de participations et d’accompagnement de leurs participations (Club Med, Bonduelle, Thomson, Lyonnaise des eaux, etc.).
Bien évidemment dans ce contexte, l’épargne financière n’est pas rémunérée, et l’épargne s’investit prioritairement dans l’immobilier, faute de mieux. Ainsi, entre octobre 1944 et octobre 1974, un placement dans le CAC 40, dividendes réinvestis, a rapporté 0,8 % par an[2] (sic), soit nettement moins que l’inflation. Comment voulez-vous que la Bourse soit autrement que moribonde quand l’épargne n’est pas rémunérée à hauteur du risque pris ?
L’analyse financière, qui sert, à l’époque, essentiellement pour mesurer le risque pris par les prêteurs, est donc encore très marquée par la gangue comptable et juridique dont elle s’extrait peu à peu, en développant le concept de BFR à la fin des années 1960 ; puis en faisant émerger les premiers tableaux de flux (Geoffroy de Murard) dont la publication, au bout de plusieurs dizaines d’années, deviendra obligatoire, entraînant une normalisation bienvenue.
* * *
En France, c’est Raymond Barre, alors Premier ministre et ministre de l’Économie et des Finances qui décide en 1976, dans le cadre de sa politique de lutte contre l’inflation (11,7 % en 1975), d’être cohérent et de ne pas céder à la facilité des emprunts à taux d’intérêt réels négatifs qui faisait de l’État le complice de l’inflation puisque cette dernière réduisait d’autant ses charges d’intérêt et de remboursement. Il est vrai que l’on était alors probablement au bout d’un système avec un risque d’une inflation échappant à tout contrôle (24 % au Royaume-Uni en 1975), avec des investisseurs refusant progressivement de continuer à prêter à taux fixe pour ne pas se faire spolier en termes réels après quinze ans de hausse ininterrompue de l’inflation. Il est décidé que l’État doit donner l’exemple et que ses emprunts soient portés à un niveau tel qu’ils offrent un taux d’intérêt réel positif. C’est à nos yeux l’élément fondateur d’une mutation profonde du système financier en France, l’économie d’endettement cédant le pas à une économie de marchés financiers[3], que le changement politique de 1981 n’allait pas remettre en cause, mais accentuer après une phase initiale d’hésitations.
* * *
Les entreprises trouvent progressivement une plus grande liberté de choix de financements, car les taux d’intérêt réels, en devenant positifs, redonnent un attrait aux capitaux propres, et déprécient l’endettement dont le coût réel après inflation devient largement supérieur au taux de croissance en volume et donc insupportable (entre 5 et 6 % entre 1981 et 1995). Parallèlement les épargnants retrouvent progressivement le chemin de la Bourse, aidés au départ par un avantage fiscal (les Sicav Monory qui devaient contenir au moins 60 % d’actions françaises et 30 % d’obligations pour atténuer le risque).
Dans un contexte qui change du tout au tout et où l’épargne redevient rémunérée en termes réels, on ne s’étonnera pas qu’entre octobre 1974 et octobre 2024, un placement dans le CAC 40, dividendes réinvestis, ait rapporté 10,2 % par an en moyenne, soit nettement plus que l’inflation moyenne de la période (3,9 %).
Parmi les nombreuses évolutions induites par cette révolution, soulignons :
- L’apparition des emprunts à taux variable, pour protéger les prêteurs contre des variations inattendues de l’inflation comme dans les années 1960-1980, qui se généralisent rapidement, sauf auprès des TPE et PME, et sauf sur le marché obligataire.
- Le pivot de l’analyse financière, de l’analyse centrée sur la solvabilité de l’entreprise, préoccupation centrale du prêteur dans une économie d’endettement, à une analyse devenant le préalable inévitable pour qui veut faire un travail de qualité d’évaluation de l’entreprise dans une économie de marchés financiers.
- L’évaluation par les flux de trésorerie disponible (DCF) qui sort des manuels théoriques pour entrer dans la pratique concrète (milieu des années 1990), dès lors que tout financier est équipé d’un micro-ordinateur, d’abord pour lui permettre d’écrire ou de répondre lui-même à ses courriels sans les dicter à une secrétaire ou à un assistant (début 1993). Essayez donc de faire à la main une actualisation de flux de trésorerie disponible sur 20 ans ![4] C’est donc par les courriels que les ordinateurs sont apparus sur les bureaux des financiers, et non plus uniquement de leurs assistantes ; et qui dit ordinateurs, dit tableur installé (Lotus 1 2 3, puis Excel). Dès lors, les méthodes d’évaluation directes s’effacent (sauf dans le secteur financier, PER et PBR) au profit des méthodes de valorisation indirectes (évaluation de l’actif économique avant de retrancher la valeur de l’endettement net) qui sont plus précises et moins restrictives dans le choix de comparables, en ne requérant pas de partager aussi une structure financière similaire[5].
- La notion de coût du capital, qui de théorique devient pratique, calculable grâce au MEDAF[6], permettant de mieux allouer le capital, maintenant que les tableurs rendent possibles des calculs décentralisés. Elle permet de faire prendre conscience que le capital, n’existant pas en montants infinis, a un coût qu’il faut au moins couvrir pour éviter les gaspillages. Et qu’à défaut de trouver des investissements présentant une rentabilité au moins égale à ce coût du capital, que le capital peut être rendu aux investisseurs, à charge pour eux de trouver ailleurs de nouveaux projets d’investissement dégageant une rentabilité correcte. D’où le développement des rachats d’actions, si mal compris, d’abord aux États-Unis dans les années 1980, puis en Europe 10-15 ans après ; et la disparition corrélative des conglomérats dont la plupart ne gagnait plus leur coût du capital (ITT, Générale des Eaux, GEC, etc.) ou leur recentrage sur un métier unique (Schneider, GE).
-
L’intermédiation cède le pas à l’intermédiaire, les établissements financiers font évoluer leur rôle en développant fortement les activités de placement des titres émis par les entreprises auprès des investisseurs, et en utilisant moins leurs bilans. C’est ainsi que Suez vend ses actifs bancaires (au Crédit Agricole), et devient un groupe énergétique (Engie) en fusionnant avec ses participations dans le secteur ; que Paribas regroupe ses participations industrielles et commerciales dans PAI qui prend alors son indépendance totale, et réinvestit dans la croissance organique de ses activités de marché ; que Deutsche Bank vend toutes ses participations industrielles, et fait l’acquisition de Bankers Trust pour se développer dans les activités de marché.
Dans une économie de marchés financiers, l’essentiel des besoins de financement est couvert par l’émission de titres financiers par les entreprises (actions, obligations…) souscrits directement par les investisseurs. Une économie de marchés financiers est caractérisée par l’appel direct à l’épargne. Une part très importante des placements des agents excédentaires se fait directement sur les marchés financiers par souscriptions ou achats d’actions, d’obligations, de NEU CP, d’actions de SICAV, de parts de fonds communs de placement (FCP). Les crédits bancaires sont alors essentiellement destinés aux ménages (crédits à la consommation, crédits immobiliers…) et aux entreprises, souvent petites et moyennes, qui n’ont pas accès aux marchés financiers. -
Le développement des marchés financiers induit nécessairement une internationalisation des activités financières, que favorise et induit en même temps une évolution des réglementations. Nos jeunes lecteurs n’en croiront pas leurs yeux quand ils sauront que dans les années 1970 les très rares grands groupes qui émettaient des obligations devaient obtenir l’autorisation préalable du Trésor, qui gérait ensuite la file d’attente d’accès au marché ! C’est Pierre Bérégovoy (ministre de l’Économie et des Finances entre 1984 et 1986) qui mis fin à cette réglementation antinomique d’un marché.
Quant à l’internationalisation, elle est finalement arrivée assez tard. Ainsi la première fois où une banque américaine conseille un groupe français dans une opération de fusion-acquisition purement nationale date de novembre 1996 : acquisition de l’UAP par AXA conseillé par Paribas et Goldman Sachs. Ce fut d’ailleurs la dernière opération majeure que Pierre Vernimmen supervisa avant son décès un mois après. -
Le développement des marchés financiers induit des risques qui leur sont propres. Dans une économie d’endettement, le risque est le non-paiement d’une échéance d’intérêts ou de remboursement de capital qui se traduit par le passage d’une provision ponctuelle. Dans une économie de marché, le risque se matérialise par une fluctuation de la valeur de l’actif en question. D’où le développement considérable des outils de gestion des risques financiers portant sur les taux de change et les taux d’intérêt qui, n’étant plus administrés par la puissance publique, deviennent nettement plus volatiles[7], entraînant dans leurs sillages les matières premières.
La croissance de ces outils à base d’options ou de contrats à terme a été grandement facilitée par la mise au point de la formule de Black-Scholes en 1972 qui permet de valoriser aisément les options.[8] - Qui dit marché, dit clients, et donc tôt ou tard une segmentation plus fine de leurs besoins en termes de risques et de rentabilité. D’où le développement, par exemple, des fonds de LBO à partir des années 1980 pour des investisseurs aimant le risque et avec un autre mode de gouvernance interne qui a démontré son efficacité. C’est la version moderne du bâton et de la carotte, avec le risque de faillite qui affecte toute réputation personnelle, et le management package qui peut rendre riche pour plusieurs générations les dirigeants d’entreprise sous LBO. Mais les fonds de LBO ne sont qu’un exemple de fonds spécialisés sur un couple risque/rentabilité, il en existe bien d’autres (fonds de capital-risque, d’infrastructure, etc.).
- Le surcroît de liberté induit par le développement des marchés a requis non seulement un assouplissement ou la suppression de certaines réglementations comme vu plus haut, mais aussi le développement de nouvelles réglementations pour lutter contre des abus. Ainsi, il n’est plus possible de prendre le contrôle d’une entreprise cotée sans offrir le même prix aux autres actionnaires depuis la prise de contrôle du Printemps par le groupe Pinault en 1992[9]. Ou, depuis la démonstration de l’incapacité des régulateurs bancaires à contrôler effectivement les risques pris par les banques au début des années 2000, le durcissement considérable des capitaux propres minimum requis pour une banque dont le montant proportionnel aux encours pondérés a triplé environ.
- On rappellera enfin le développement des problématiques ESG qui sont bien connues de nos lecteurs, chronologiquement apparues dans l’ordre gouvernance, environnement et social, et qui montrent que la finance n’est pas nécessairement que le triomphe de l’égoïsme le plus pur.
* * *
Quant au Vernimmen que vous connaissez actuellement, il est lui aussi le produit de son histoire. Créé en 1974 par un professeur à HEC Paris de 28 ans, Pierre Vernimmen, regroupant en 380 pages d’un format légèrement plus petit que l’actuel, sous le titre Finance d’entreprise, et avec le sous-titre Analyse et gestion, l’équivalent de l’actuelle partie 1 et de la fin de la partie 5, consacrées à l’analyse financière et à la gestion de trésorerie.
L’ouvrage est publié par un éditeur juridique, Dalloz, qui souhaitait se développer dans le milieu universitaire et des grandes écoles dans lequel il venait de lancer le Mercator, par Jacques Lendrevie et Denis Lindon, deux professeurs de marketing à HEC Paris. Le premier convainquit Pierre Vernimmen, qui avait déjà commencé son ouvrage, que Dalloz était un bon éditeur pour son projet. 50 ans après, c’est toujours vrai.
Puis Pierre Vernimmen publia en 1976, un second tome consacré à la finance d’entreprise, sous-titré Logique et politique, recoupant en 390 pages une partie des contenus des actuelles parties 2, 3 et 4. Ce fut alors le premier ouvrage de finance à introduire des éléments de finance de marché au sein de la finance d’entreprise et à souligner avec force l’importance du risque, de la rentabilité et du coût du capital pour la gestion financière des entreprises.
Ces 2 tomes ont connu plusieurs éditions (5 et 3 respectivement), avant que Pierre Vernimmen, en 1994, ne les fusionne en un seul ouvrage de 660 pages, qui est devenu le Vernimmen, vendu depuis lors à plus de 225 000 exemplaires en 23 éditions, sans compter l’édition en anglais lancée en 2005 qui en est à sa 6e édition.
[1] Voir le chapitre 37 du Vernimnen pour plus de détails.
[2] Merci à David Le Bris pour son travail de reconstitution du CAC 40 depuis 1854, source de nos chiffres.
[3] Distinction due à John Hicks, voir le chapitre 16 du Vernimmen pour plus de détails.
[4] Nous avons vu Pierre Vernimmen, aussi investisseur et homme de fusion-acquisition à Paribas, négocier pour le compte de la famille Louis Vuitton qu’il conseillait, la fusion de l’entreprise familiale avec Moët-Hennessy faisant ainsi naître LVHM, armé d’une seule feuille de papier tapée par sa secrétaire, avec un tableau des parités possibles et leurs impacts sur la structure actionnariale du nouveau groupe et son BPA. C’était en 1987...
[5] Voir le chapitre 33 du Vernimmen pour plus de détails.
[6] Voir les chapitres 21 et 31 du Vernimmen pour plus de détails.
[7] Voir le chapitre 53 du Vernimmen pour plus de détails.
[8] Voir le chapitre 25 du Vernimmen pour plus de détails.
[9] Quoique le groupe Bolloré montre une réelle dextérité pour encore parvenir à ses fins en ce domaine (Havas, puis Vivendi).
Tableau : La décote d'introduction en Bourse aux États-Unis et en France depuis 1980
C‘est Jay Ritter qui met à jour une fois l’an ce graphique dans le domaine de recherche dont il est devenu un spécialiste mondial, les introductions en Bourse.
Notre lecteur ne manquera pas de constater :
- Que, pour les émetteurs, le marché français des introductions en Bourse est devenu beaucoup plus efficient que le marché américain, avec une décote moyenne nettement plus faible, mais qui le rend peut-être moins attractif pour les investisseurs.
- Les deux pics atteints aux États-Unis, en 1999 et 2000, où il suffisait d’accoler à la moindre blanchisserie le suffixe « .com » pour que son cours décolle comme une fusée[1] ; et celui plus récent post-covid, avec l’impact des SPACs.
[1] Voir la Lettre Vernimmen.net n° 7 de janvier 2002, p. 3.
Recherche : Les obligations rachetables, un mode de financement qui réduit les conflits entre actionnaires et créanciers
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
L’article que nous présentons ce mois[1] porte sur les obligations rachetables (en anglais, callable bonds), des titres de dette que l’émetteur peut rembourser avant l’échéance. Cette option permet à l’émetteur de se refinancer, en particulier si les conditions de crédit se sont améliorées. Les obligations rachetables sont le plus souvent perçues comme offrant de la souplesse dans la structuration de la dette des entreprises, en contrepartie d’un taux d’intérêt servi supérieur à celui des obligations classiques. Les auteurs de l’article exposent et mesurent un autre avantage des obligations rachetables, lié à la théorie de l’agence et plus précisément aux conflits entre actionnaires et créanciers : elles permettraient de limiter le phénomène de debt overhang.
Difficilement traduisible en français, le debt overhang désigne la situation dans laquelle un montant de dette élevé induit des effets pervers sur les décisions d’investissement. Lorsque la dette est élevée et que le risque de faillite n’est pas négligeable, un investissement créateur de valeur est une aubaine pour les créanciers qui voient le risque de défaut diminuer, et donc la valeur de marché de leurs titres augmenter. Ils captent ainsi une partie de la valeur créée[2]. Dans certains cas, la captation est telle que les dirigeants, dans l’intérêt des actionnaires, sont conduits à renoncer à de bons projets. Le terme « surendettement » n’est pas approprié car il désigne plutôt une situation dans laquelle le stress financier empêche l’entreprise de financer les investissements nouveaux. Dans le cas du debt overhang, c’est volontairement que les bons projets sont abandonnés, en raison de transferts de valeurs excessifs des actionnaires vers les créanciers.
Les obligations rachetables évitent ce phénomène, parce que le rachat empêche les détenteurs de bénéficier pleinement de la valeur créée. Ces derniers obtiennent un taux d’intérêt supérieur à celui des obligations classiques en contrepartie de la renonciation à bénéficier d’une création de valeur dans l’entreprise. Pour leur étude empirique, les auteurs de l’article s’appuient sur un échantillon large d’émissions obligataires (classiques et rachetables) entre 2000 et 2017, période durant laquelle le taux de rachetables est passé aux États-Unis de 35 % à près de 90 %. Toutes choses égales par ailleurs, le taux d’intérêt des rachetables est supérieur de 27 points de base à celui des obligations classiques, pour un rendement à l’échéance moyen de 6 %. Autrement dit, la possibilité de racheter les titres avant l’échéance coûte 27 points de base d’intérêts à l’émetteur, soit l’équivalent de deux crans de dégradation dans sa note de crédit.
Il est notable que ce surcoût est encore plus élevé pour les entreprises dont la dette est mal notée (high-yield) : 38 points de base. Les créanciers de ces entreprises sont ceux qui pourraient le plus bénéficier de transferts de valeur en cas de bons projets ; il faut donc davantage rémunérer ceux qui renoncent à cette possibilité. Aussi, lorsque la situation s’améliore, la possibilité de rachat est presque toujours utilisée. Moins d’une obligation rachetable sur 20 se négocie à 1,03 fois (ou plus) sa valeur nominale, alors que c’est le cas du tiers des obligations classiques.
Mesurer l’impact sur le debt overhang est particulièrement difficile car cela nécessiterait des données sur des projets abandonnés. Les auteurs ont eu une bonne idée. Ils se sont intéressés à la probabilité pour les entreprises émettrices d’être ciblées par des acquéreurs. Un niveau élevé de dette dans le capital de la cible peut entraîner du debt overhang dans le cas où l’acquéreur améliore la gestion de la cible[3]. L’astuce consiste à utiliser le fait que les obligations rachetables ne peuvent être effectivement rachetées qu’à partir d’une certaine date, correspondant généralement à la moitié de la maturité à l’origine. En mesurant l’augmentation de la probabilité pour l’entreprise d’être ciblée après cette date, les auteurs arrivent à capter une partie de ce debt overhang. En l’occurrence, l’effet mesuré est spectaculaire puisque la probabilité d’être ciblée augmente de 55 % lorsque les titres deviennent rachetables. L’interprétation de ce résultat est la suivante : tant que les obligations n’étaient pas rachetables, le debt overhang conduisait à annuler ou reporter l’acquisition.
Finalement, les auteurs vérifient également que la présence d’obligations rachetables augmente la sensibilité de la politique d’investissement aux chocs positifs sur les prix. Tous ces indicateurs soutiennent l’argument selon lequel il s’agit d’un instrument utile pour réduire les conflits entre actionnaires et créanciers. Il est plaisant de remarquer que l’argument d’aligner les intérêts entre apporteurs de capitaux est aussi fréquemment utilisé au sujet des obligations convertibles, qui permettent aux créanciers de bénéficier de la création de valeur en cas de hausse significative du cours de Bourse. Ici, c’est au contraire en empêchant les créanciers de capter la moindre valeur que l’on évite le debt overhang et que l’on réduit les conflits. Il n’y a pas de financement magique en finance, mais beaucoup d’instruments permettant de répondre à des objectifs spécifiques.
[1] B. Becker, M. Campello, V. Thell et D.Yan (2024), “Credit risk, debt overhang, and the life cycle of callable bonds”, Review of Finance, vol. 28, p.945 à 984.
[2] Voir le chapitre 36 du Vernimmen pour plus de détails.
[3] Un point de vue théorique est proposé par l’auteur de cette chronique dans : H. de La Bruslerie et S. Gueguen , “Creditor’s holdup, releveraging and the setting of private appropriation in a control contract between shareholders”, International Review of Law and Economics, vol. 68, 2021.
Q&R : Deux exercices de fusion-acquisition
L’entreprise A fait un EBE de 100 en comptes consolidés et a un endettement bancaire et financier net consolidé de 8 fois cet EBE.
L’entreprise B fait un EBE de 20 en comptes sociaux et a un endettement bancaire et financier net de 3 fois cet EBE.
A achète B, qui était indépendant, pour 12 fois son EBE en numéraire. Quel est l’endettement bancaire et financier de A en pourcentage de son EBE consolidé après cette acquisition ?
Post acquisition de B par A, l’EBE du nouveau groupe sera la somme des EBE, soit 100 + 20 = 120. L’endettement net consolidé sera la somme des endettements nets de A et B, plus le prix payé par A pour acquérir B en numéraire qui est de 12 x 20 – 3 x 20 = 180, d’où une dette nette de 8 x 100 + 3 x 20 + 180 = 1 040, soit 8,7 fois l’EBE consolidé, ce qui est vraiment beaucoup !
Maintenant la seconde question.
Supposez que A qui possède B, vende B en numéraire pour 12 fois son EBE. Quel est l’endettement net de A après cette cession en fonction de son EBE ?
Post cession de B par A, l’EBE du nouveau groupe sera l’EBE consolidé de A moins celui de B, soit 100 – 20 = 80. L’endettement net sera l’endettement net consolidé de A moins l’endettement social de B, moins le prix de B cédé en numéraire qui est de 12 x 20 - 3 x 20 = 180. Soit 8 x 100 - 3 x 20 - 180 = 560, soit 7 fois l’EBE consolidé, ce qui n’est pas rien quand même !
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière. En voici quelques-uns :
Vivendi, ou les créanciers qui applaudissent des 2 mains à une scission (21 septembre)
En règle générale, une scission qui réduit la diversité des métiers d’un groupe est peu appréciée des prêteurs puisque leur niveau de risque s’accroît avec la concentration des activités qui résulte d’une scission. En effet, les flux de trésorerie générés par chaque division d’un groupe sont naturellement mutualisés au sein du groupe qui les réunit pour servir la dette de ce dernier. Une fois scindés en entités indépendantes, les flux de trésorerie ne sont naturellement plus mutualisés, et les prêteurs de chacune de ces divisions devenues indépendantes ne peuvent plus compter que sur les flux de trésorerie générés par chaque division pour faire face à la dette qui lui a été allouée dans la scission.
De ce fait, et de longue date, les prêteurs se sont réservés dans les contrats de prêts/d'obligation en cas de scission (voire en cas de simple annonce), la faculté d’obtenir le remboursement anticipé de leurs prêts/obligations au nominal, voire un peu plus.
Lorsqu’une phase de hausse brutale des taux d'intérêt pousse la valeur des obligations largement en dessous du pair, l’annonce subséquente d’une scission est du pain béni pour les prêteurs qui voient d’un seul coup la valeur de leurs obligations se rapprocher du pair, malgré un taux de rendement de ces prêts inférieur au taux du marché.
C’est exactement ce qui se produit depuis plusieurs mois sur les obligations émises par Vivendi. Ainsi, l’obligation 2016 à échéance 2026, rapportant du 1,875 %, cotait il y a un an, avant toute annonce du projet de scission, 94,3 % du nominal, en raison d'un taux du marché de 4,10 %. Actuellement, la cotation dépasse les 99 % dans l’anticipation d’un remboursement au nominal d’ici la fin de l'année, échéance prévue de cette scission. Pour un investisseur obligataire, une progression du cours de 7 % en un an, coupon compris, est considérable pour un emprunt noté BBB.
Le groupe candidat à la scission doit refinancer ses dettes, c’est-à-dire négocier avec des banques pour contracter des emprunts qui seront utilisés pour rembourser par anticipation les emprunts obligataires. Ces crédits bancaires sont ensuite alloués entre les différentes entités qui seront scindées. Ce n’est que lorsque la scission est effective, que les entités scindées peuvent alors éventuellement émettre des obligations pour rembourser les crédits bancaires mis en place qui ont un caractère de crédit relais. Pour Vivendi, c’est 2 750 M€ qui sont ainsi concernés.