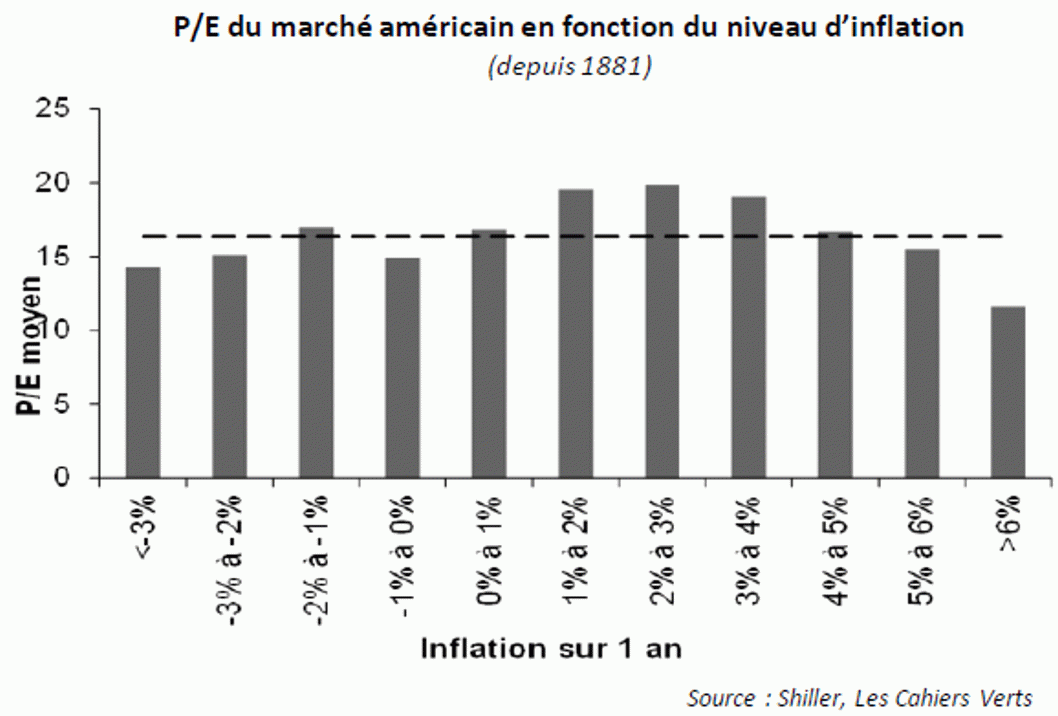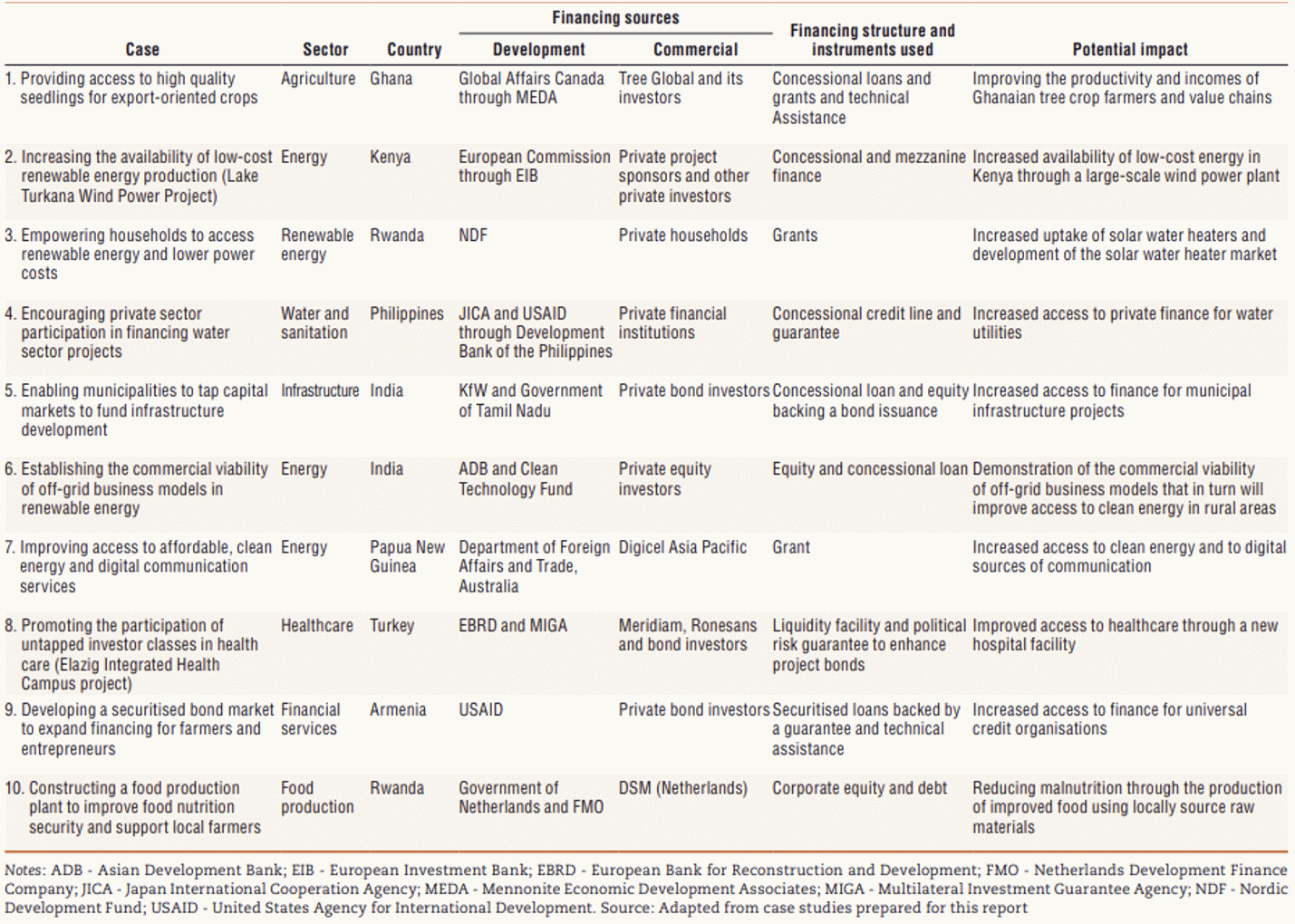La Lettre n°221 de Novembre 2024
Actualités : Warren Buffett, Apple et l'efficience des marchés
Pourquoi Warren Buffett vend-il ses actions Apple ? Comme le dirait Monsieur de la Palice, pour une raison simple : il doit penser que leur prix est trop élevé.
Sa participation a culminé à 5,9 % du capital, faisant de lui le second actionnaire derrière le gestionnaire de fonds principalement passifs Vanguard (8,9 % du capital). Avec une valeur de 178 Md$, sa participation dans Apple représentait un peu moins de 20 % de la capitalisation boursière de Berkshire Hathaway.
Warren Buffett a commencé à investir dans Apple en 2016, lorsque le PER de cette action était de 13. Depuis, le bénéfice par action a quasiment triplé et le cours de l’action a été multiplié par 9, donnant aujourd’hui un PER de 37. Comme le cash net est assez négligeable par rapport à la capitalisation boursière d’Apple (1,5 %), raisonner en PER et non en multiple du résultat d’exploitation n’est pas biaisé[1].
Selon le consensus actuel des analystes, les ventes d’Apple devraient croître de 10 % l’an jusqu’en 2029 passant de 361 Md$ en 2024 à 572 Md$, tandis que le résultat net devrait progresser de 14 % par an, de 92 Md$ en 2024 à 179 Md$ en 2029.
La réalisation de ces prévisions implique que :
- la marge d’exploitation passe de 31,7 % des ventes 2024 à 36,7 % en 2029 ; alors qu’Apple a publiquement averti que la marge de ses futurs produits aura du mal à atteindre celle de son produit phare, l’iPhone ;
- la rentabilité économique avant impôt, passée de 41 % en 2016 à 128 % (sic) en 2024, soit encore capable de progresser pour atteindre 150 % environ.
On peut être pardonné de ne pas y croire. Si les pommes tombent des pommiers, les arbres ne montent pas au ciel.
Certains penseront que sur les grandes valeurs comme Apple le marché est efficient, voulant dire par là que le cours d’Apple correspond à tout moment à sa valeur intrinsèque, pour autant que l’on puisse la mesurer, parce qu’il intègre fidèlement le consensus du marché. Dès lors, son acquisition permettrait de gagner ni plus ni moins que le taux de rentabilité exigé compte tenu de son risque de marché. Ils seront donc étonnés que Warren Buffett ait pu transformer en moins de 8 ans son investissement de 39 Md$ en une somme de 178 Md€, rapportant ainsi à ses actionnaires largement plus (de l’ordre de 25 % l’an) que le taux de rentabilité exigé de l’action Apple (de l’ordre de 10 %).
Mais ceci un malentendu sur la notion d’efficience, nourri d’abus de langage.
Eugene Fama[2] (Prix Nobel 2013) qui a fait les travaux fondamentaux en ce domaine, distingue 3 formes d’efficience des marchés :
- la forme faible qui dit que le prix d’aujourd’hui reflète toute l’information contenue dans les prix et les volumes passés. Elle dénie ainsi toute pertinence à l’analyse chartiste, surtout si on prend en compte les frais de transaction. C’est une forme d’efficience sur laquelle il y a un quasi-consensus des chercheurs ;
- la forme semi forte selon laquelle les prix reflètent toute l’information disponible et qu’une nouvelle information arrivant fait varier les cours en conséquence (comme l’élection de Donald Trump a fait varier les prix de certaines valeurs) ;
- la forme forte qui dit que les prix intègrent même l’information privée détenue par ceux qui disposent d’une information privilégiée. Quasiment aucun chercheur n’y croit. Sinon il n’y aurait pas besoin des réglementations sur les initiés pour préserver l’intégrité des marchés, qui seraient inutiles puisqu’en moyenne les transactions des initiés ne seraient pas rentables. C’est l’inverse de ce que l’on voit, d’où la très faible popularité de cette forme d’efficience.
Ces 3 niveaux d’efficience n’impliquent pas que le cours d’une action corresponde à sa valeur intrinsèque comme on l’entend assez souvent dire dans le langage courant. En effet :
- Que l’information nouvelle soit incorporée dans le cours ne garantit pas que cette information soit correctement intégrée compte tenu de nos biais, émotions et autres croyances.
- Par ailleurs, tout au plus, ce sera l’interprétation moyenne (le consensus de marché) qui sera incorporée, et elle peut être erronée, en particulier quand des événements à faible probabilité d’occurrence se produisent.
En effet, le fait que les marchés financiers puissent être efficients au sens des formes faibles et semi-fortes n’empêche pas que l’on puisse se tromper sur la valeur actuelle ou future d’une action. Qui aurait pensé que Boeing, leader mondial des constructeurs d’avions, allait accumuler à ne plus en finir les difficultés opérationnelles depuis 2019, culminant (enfin nous l’espérons pour eux) avec une porte d’avion se détachant en plein vol ? Certes le cours intégrait peut-être cette possibilité avec une faible probabilité, mais quand la série de problèmes arrive et que la probabilité faible devient un fait, le cours s’ajuste naturellement. De la même façon, qui aurait pu prévoir que Tesla allait, partant de rien, devenir un constructeur automobile majeur ? Là encore, la petite probabilité de cette évolution proprement stupéfiante était peut-être dans les cours, mais il est tout à fait logique que ceux-ci s’ajustent fortement quand cette chimère devient une réalité.
Certes, on peut dire dans le langage courant que le marché n’a pas été efficient pour Tesla et Boeing, tout en ayant été efficient au sens scientifique sur ces deux titres pris comme exemples. Mais le marché ne pourra jamais être efficient au sens du langage courant, avec un cours qui donnerait toujours une rentabilité à l’investisseur correspondant au taux requis compte tenu du risque ; faisant ainsi du cours actuel un excellent prédicteur des cours futurs.
Répétons que le fait que le prix actuel intègre fidèlement le consensus de marché, ne garantit pas que dans quelques années, les résultats attendus aujourd’hui se produisent exactement, surtout pour des actions qui ne sont pas parmi les moins risquées du marché.
Aussi nous paraîtrait-il pertinent de bannir le mot efficient dans son acception courante qui correspond à un leurre. C’est ce que nous rappelle Warren Buffett qui vient de réaliser l’investissement financier le plus grand jamais réalisé dans l’histoire de l’humanité et le plus profitable.
Ce n’est pas parce que les marchés sont inefficients que Warren Buffett a pu faire gagner beaucoup d’argent à ses actionnaires. C’est parce qu’il a vu plus tôt que la moyenne du marché la capacité d’Apple à augmenter ses prix sans décourager les achats de ses aficionados, sa capacité à se développer dans les services, etc. Mais est-ce surprenant pour quelqu’un dont la première tâche telle que décrite par son co-investisseur de longues décennies et vice-chairman de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, récemment décédé, est : « de se réserver beaucoup de temps pour lire et réfléchir en toute tranquillité »[3]
Quant à savoir si le développement des fonds passifs et autres ETF, sans parler de la réduction du nombre de personnes qui se ménagent du temps libre pour lire et réfléchir tranquillement, réduiront la vitesse d’incorporation des informations nouvelles, voire même l’incorporation des informations nouvelles dans les cours, nous ne sommes pas inquiets.
En effet, dans un monde concurrentiel, si une telle évolution devait se produire, elle ouvrirait un boulevard à ceux qui lisent et réfléchissent, dopant leurs performances et dans un mouvement de balancier logique redonnerait de l’intérêt et de la sur-performance à la gestion active. Ceci ne passerait pas durablement inaperçu, et conduirait à un mouvement inverse à celui que l’on observe actuellement, avec un afflux de fonds à placer en gestion active et une part moindre réservée aux fonds indiciels.
Ainsi, il n’est pas interdit de penser que les marchés actions sont structurellement inefficients au sens commun du terme, mais sont efficients au sens scientifique du terme, dans son acceptation faible et semi-forte.
[1] Pour plus de détails, voir le chapitre 33 du Vernimmen.
[2] Pour plus de détails, voir le chapitre 16 du Vernimmen.
[3] Voir La Lettre Vernimmen.net n° 212 d’octobre 2023.
Tableau : PER et inflation aux États-Unis depuis 1881
Ce graphique, produit par Les cahiers verts à partir des données de Robert Shiller, montre que ni la déflation, ni l’inflation ne sont bonnes pour les marchés actions.
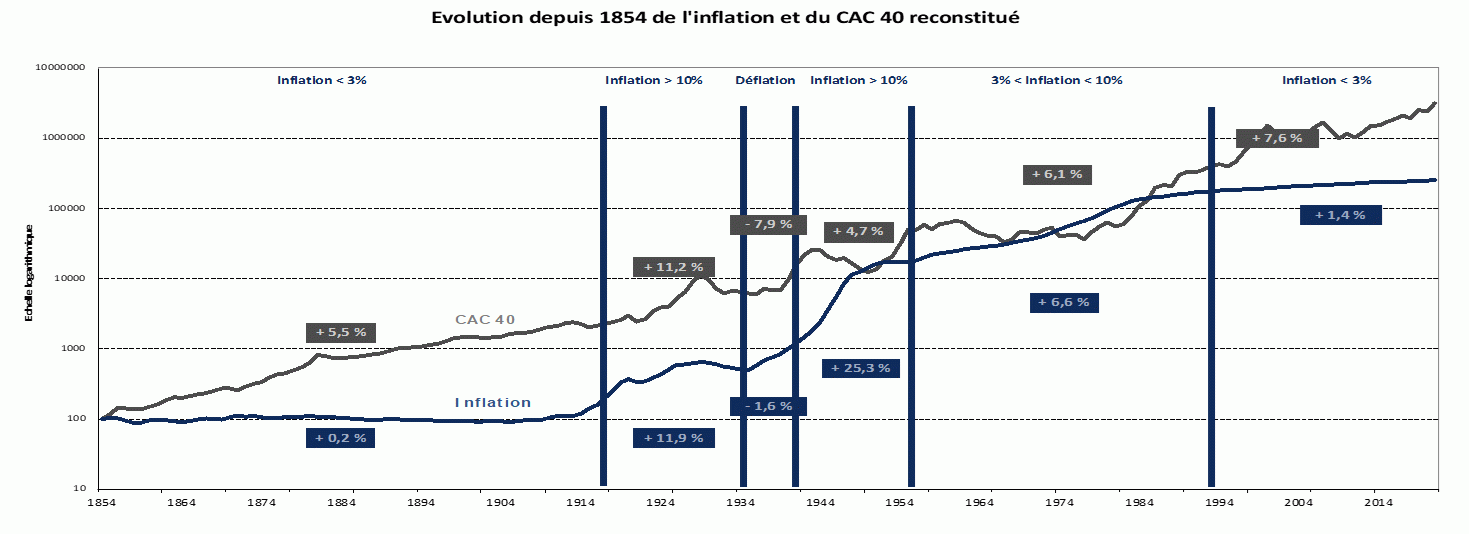 La déflation, car elle induit une baisse d’activité qui réduit les flux de trésorerie disponibles dégagés par les entreprises.
La déflation, car elle induit une baisse d’activité qui réduit les flux de trésorerie disponibles dégagés par les entreprises.
L’inflation, car elle induit elle aussi une baisse des flux de trésorerie disponible via le gonflement des BFR[1].
Ces résultats sur le marché américain ne sont pas différents de ceux qui ont été observés sur le marché français par David Le Bris et que nous avions reproduits dans l’avant-propos du Vernimmen 2023 qui montrait de claires sous-performances du marché action en période de déflation ou d’inflation :
[1] Voir La Lettre Vernimmen.net n° 209 de juin 2023.
Recherche : Crise covid, bien d'équipements et intérêt de la recherche en finance
Avec la collaboration de Simon Gueguen, enseignant-chercheur à CY Cergy Paris Université
Nous présentons ce mois un article[1] qui montre empiriquement que la pénurie de biens d’équipements pendant la crise Covid a entraîné pour les entreprises une difficulté à en acquérir. Le lecteur est en droit de se demander, hors du cercle restreint de la recherche, l’intérêt d’une étude sur cet effet apparemment évident. En réalité, cet article est exemplaire non seulement pour ses résultats mais aussi parce qu’il nous donne l’occasion de revenir sur l’intérêt de la recherche en finance pour les praticiens.
Pour mesurer proprement les conséquences de cette pénurie, les auteurs ont besoin d’une large base de données. Cela permet non seulement d’obtenir des liens statistiques solides, mais aussi d’appliquer un certain nombre de tests pour identifier, par exemple, les entreprises les plus touchées. Dans l’idéal, les méthodes économétriques permettent de dépasser la simple corrélation statistique et de prétendre à un lien de causalité entre deux phénomènes.
Dans le cas présent, les auteurs ont utilisé le fait que les transactions sur les biens d’équipement financées par une créance commerciale donnaient lieu à une déclaration légale publique (Uniform Commercial Code filings, ou UCC filings) riche d’informations sur l’acheteur et le vendeur, leur localisation, la nature et l’âge du matériel, etc. Ce type de transaction ne constitue pourtant pas l’objet de l’étude. Le problème est qu’ils ne pourront probablement jamais trouver ou constituer une base de données aussi riche sur les transactions en cash. Ils ont donc travaillé à partir des UCC filings et ont mis en œuvre une série de tests et de méthodes corrigeant les effets possibles de ce mode d’acquisition. Ces tests et méthodes développés au fil du temps par les chercheurs permettent de comprendre ce qu’il se passe dans l’ombre à partir de ce que l’on peut voir dans une zone éclairée.
La base de données est énorme, elle couvre 10 millions de contrats souscrits aux États-Unis entre 1997 et 2022. Les acquéreurs (en l’occurrence, les emprunteurs) de la base sont plus de 2 millions d’entreprises différentes. Le premier résultat notable de l’étude est la forte hausse du marché secondaire des biens d’équipement à partir de 2021. Non seulement les biens acquis sont moins souvent neufs, mais la durée de détention des biens d’occasion est plus courte de 6 mois, passant de trois ans et demi avant à la crise à trois ans en 2021. Dans le même temps, la distance géographique et sectorielle entre les co-contractants augmente. Les données permettent de montrer que les acquéreurs vont chercher des biens d’équipement plus lointains et éventuellement moins adaptés à leur activité. La probabilité que les co-contractants se situent dans la même zone géographique (comté américain) passe de 20 % à 18 %, et l’effet est similaire pour le secteur.
Pour confirmer ces résultats, les auteurs ont étudié les conséquences de la grève qui a frappé le fournisseur d’équipement agricole John Deere en pleine crise (fin 2021). Plus élevée était la part de marché de John Deere sur un type de bien, plus forte fut la hausse de prix : 25 % de hausse pour un écart-type de part de marché, un effet gigantesque.
Si la mesure n’est pas sans intérêt, tout cela ne surprend pas. C’est dans la suite de l’article que se trouve un résultat difficile à prévoir sans l’aide des chercheurs. Statistiquement, ce sont les sociétés les plus anciennes qui acquièrent des biens d’équipement neufs, et les plus récentes des biens d’occasion. Les auteurs ont eu l’idée de diviser l’échantillon en trois groupes : les entreprises anciennes (30 ans et plus), intermédiaires (4 à 29 ans) et jeunes (3 ans et moins). Le résultat non trivial est que l’explosion du marché secondaire est entièrement attribuable aux entreprises d’âge intermédiaire. Les plus anciennes ont continué à acquérir les biens neufs disponibles, et les intermédiaires se sont rabattues sur le marché de l’occasion. Les jeunes entreprises ont pour leur part été évincées du marché des biens d’équipement. Comme les autres, elles sont allées chercher les biens plus loin géographiquement et sectoriellement, mais leur part dans les acquisitions s’est effondrée. La conséquence est la suivante : une chute de plus de 20 % de leurs investissements, nette de tous les effets liés à la crise covid.
À l’aide de données imparfaitement adaptées et en analysant un phénomène a priori sans surprise, les chercheurs identifient une non-linéarité dans le recours au matériel d’occasion. Les entreprises les plus affectées par l’indisponibilité des biens d’équipement neufs sont celles qui en achetaient le moins avant la crise. Le marché de l’occasion, qui a servi d’amortisseur, a été capté par les entreprises de taille intermédiaire. Les plus anciennes ont pu s’en passer et se partager les biens neufs disponibles, les plus jeunes ont dû couper leurs investissements.
[1] O.Darmouni et A.Sutherland, « Investment when new capital is hard to find », Journal of Financial Economics, vol. 154, 2024
Q&R : Qu'est-ce que la finance blended ?
La finance blended ou financement mixte désigne une combinaison de financement public ou philanthropique et privé, qui implique généralement une forme de subvention. Ce type de montage est utilisé pour permettre au secteur privé d'investir là où il ne serait pas possible de le faire autrement.
Le terme est généralement utilisé dans le contexte du financement des pays en développement et plus particulièrement de la politique de développement durable de ces pays.
Le terme finance blended est utilisé pour caractériser des montages financiers de projets spécifiques et dont la durée est limitée dans le temps. Conceptuellement ces montages visent à amorcer le développement afin de permettre la mise en place à terme de moyens de financement privés non subventionnés.
Bien que ce ne soit pas systématiquement le cas, la finance blended prévoit généralement une forme de subvention de la part de l’acteur publique (état, agence de développement) ou philanthropique (fondation, fonds privé pour l’aide au développement). Cette subvention peut prendre la forme d’un investissement à des conditions hors marché (dette absorbant les premières pertes, subvention, …), d’une garantie fournie à l’acteur privé sur son financement, d’un avantage fiscal ou un contrat commercial limitant le risque opérationnel (accord d’offtake, tarifs subventionnés, …).
Ce type de schéma permet donc de démultiplier les capacités d’intervention de l’aide au développement ce qui paraît aujourd’hui essentiel au vu des besoins très importants de la transition énergétique.
Le tableau ci-après (source OCDE) présente quelques exemples de projets financés avec de la finance blended :
Commentaire : Sur l'actualité financière, postés sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen
Régulièrement, nous publions sur les pages Facebook et LinkedIn du Vernimmen[1] des commentaires que nous inspire l’actualité financière. En voici quelques-uns :
Boeing : la plus grosse augmentation de capital jamais réalisée aux États-Unis (2 novembre)
16,1 Md$ ! Sans compter, comme souvent dans ces cas-là pour solliciter une autre poche d’investisseurs, 5 Md$ d’obligations convertibles, et une extension possible (greenshoe) de 3,2 Md$, soit un total de 24,3 Md$.
Mais il y avait péril en la demeure. Si en 2018 Boeing a fait 101 Md$ de ventes en livrant 806avions et en dégageant 14 Md$ de flux de trésorerie disponible ; sur les 9 premiers mois de 2024, ses ventes sont tombées à 51 Md$, avec 291 avions livrés et un flux de trésorerie disponible négatif de 10 Md$. Depuis 2019, début de ses déboires industriels, Boeing a perdu 24 Md$, dont 8 sur les 9 premiers mois de cette année.
Depuis cette même date, Boeing a des capitaux propres comptables négatifs (sic) – 24 Md$ au 30 septembre – car, s’il a beaucoup de dettes nettes (55 Md$ soit 9,3 fois l’EBE 2025 ; l’EBE 2024 est négatif), il a finalement peu d’immobilisations (29 Md$) après des années d’externalisation, et un BFR très faible grâce aux avances des clients (2 Md$). Mais cette source de financement pourrait se réduire, car avec 5 400 avions à livrer, les commandes prises aujourd’hui pourraient n’être livrées qu’à la prochaine décennie. Et comme 2025 est aussi attendu en perte, la dette ne pouvait que continuer de monter.
Pour augmenter son nombre d'actions de 18 %, Boeing n'a eu besoin de concéder qu'une décote de 5 % par rapport au cours de clôture de lundi soir pour le syndicat de banques placeuses. Cela montre toute la profondeur du marché financier américain qui contraste douloureusement avec celle des marchés européens. Rappelons notre billet d’il y a un mois sur l’augmentation de capital d’ID Logistics, une star dans son segment, qui a dû concéder une décote de 10 % sur le cours de clôture pour placer un misérable 6 % de nouvelles actions. Une décote double pour placer 3 fois moins d’actions relativement à la taille des entreprises…
Comme nous l’expliquons dans l’avant-propos du Vernimmen 2025, intitulé Make equity great again, ceci est dû au système de retraite par capitalisation aux États-Unis qui a créé des fonds de pension acheteurs d’actions sur le long terme ; et en France, à notre préférence pour les placements en rentes liquides, protégés de l’inflation, défiscalisés pour une large part et dotés d’avantages fiscaux. Il serait grand temps dans cette période de disette budgétaire que les avantages fiscaux de l’assurance-vie soient réservés aux placements risqués en actions, et non à ceux en rentes (contrat en euros) qui font 74 % des encours. C’est exactement ce qu’ont fait les Suédois depuis 1980 avec aujourd’hui un marché financier 2,6 fois plus profond que ceux des autres pays européens, 16 % des entreprises suédoises de plus de 250 salariés cotées (3 % en France), et un nombre d’introductions en Bourse depuis 2013 (501) qui dépasse les volumes cumulés d’introduction de Paris, Francfort, Amsterdam et Madrid.
Robertet ou la valeur d’un droit de vote (23 novembre)
La valeur d’un droit de vote
Il arrive que l’on ait besoin de se pencher sur la valeur d’une action sans droit de vote et le sujet n’est pas simple.
La sortie la semaine passée de Firmenich du capital de Robertet, leader mondial des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes, est éclairante. Robertet a la particularité d’être la seule société parmi les 818 firmes cotées actuellement à Paris à avoir des titres cotés avec droit de vote et d’autres sans droits de vote.
En 1987, et parce que le contrôle familial sur Robertet était fragile, l’entreprise avait démembré des actions ordinaires en certificats d’investissement (CI) et certificats de droit de vote (CDV) : un CI, c’est une action privée de son droit de vote.
Les CI ont été créés en 1983 par l’État français pour financer les firmes nationalisées. BNP, Saint Gobain, etc. avaient ainsi émis des CI dans le public sans diluer la participation de l’État à leur capital qui avait gardé les CDV associés. Puis des firmes privées ont suivi comme Bouygues ou L’Oréal. Mais l’innovation, au moins pour les sociétés cotées, n’a pas pris, et assez vite tous ces CI ont disparu par rachat ou transformation en actions ordinaires avec droit de vote.
Tous, sauf ceux de Robertet qui dispose, de ce fait, de 3 lignes de cotation en Bourse : les actions ordinaires, les CI et les CDV. Ces derniers sont très rarement côtés car détenus pour l’essentiel par la famille. Les CI le sont nettement plus, mais leur liquidité est réduite puisque Firmenich en détenait 85 %.
Firmenich a cédé l’essentiel de ses actions et de ses CI à FSP et Peugeot Invest. Ces derniers ont négocié avec la famille fondatrice de pouvoir transformer leurs CI en actions ordinaires. La parité retenue valorise les CDV à 10 % de la valeur des actions, ce qui correspond à la décote moyenne observée en 2024 entre la valeur du CI et celle de l’action.
Au fur à mesure où la famille fondatrice a consolidé son pouvoir sur Robertet (elle détient aujourd’hui 63 % des droits de vote avec 38 % du capital), la décote des CI s’est logiquement réduite passant de 30 % en 2010 à 20 % en 2019, et 10 % maintenant, les droits de vote ayant ainsi perdu une bonne part de leur enjeu.
Ainsi la valeur d’un droit de vote dépend beaucoup de la configuration de l’actionnariat. D’autres facteurs jouent comme la capacité d’un tiers acheteur du contrôle à améliorer les marges ou une éventuelle compétition entre plusieurs tiers acheteurs.
On comprend mieux pourquoi il est difficile de voir une décote sur les actions Hermès où la structure de commandite conduit à un contrôle familial solide, et où il est difficile de voir comment faire mieux que les actuels dirigeants. Ou pourquoi dans les coopératives agricoles, le principe de « un vote par coopérateur », indépendamment du nombre de parts détenues, fait perdre toute valeur au droit de vote. Dès lors, tous les titres de capital d'une coopérative ont la même valeur, qu’ils aient ou non un droit de vote, puisqu’un droit de vote ne vaut rien. Dans ce cas, l’absence de droit de vote ne justifie aucune décote.