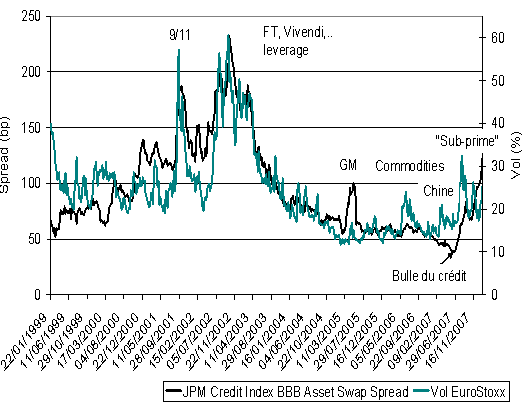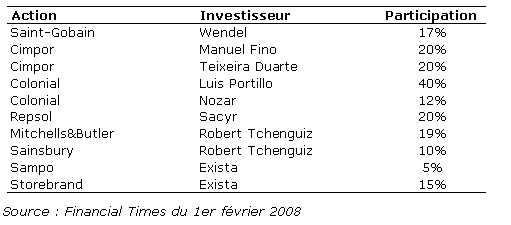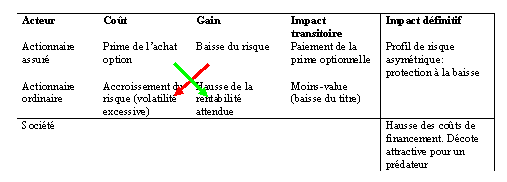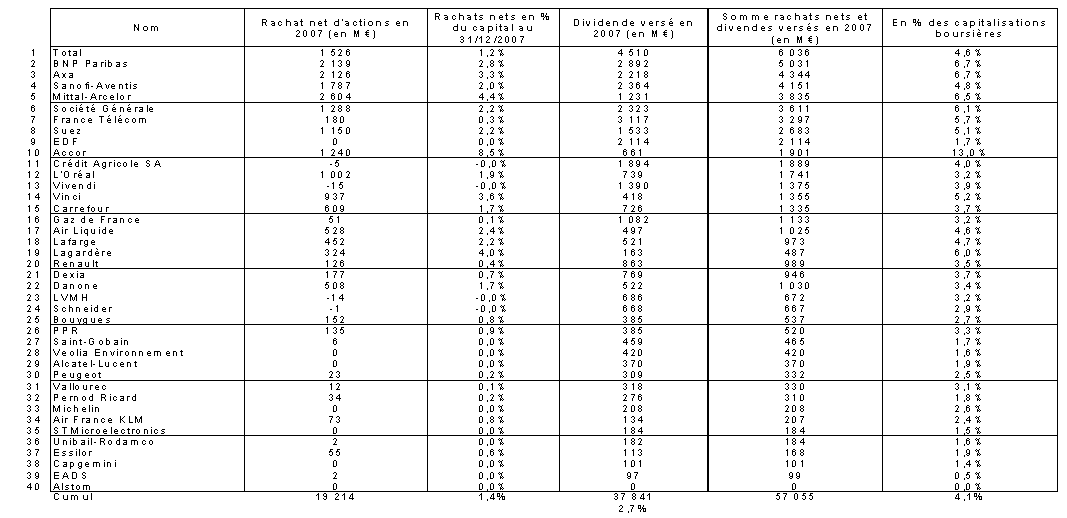La Lettre n°63 de Mars 2008
Actualités : Comment les mécanismes de protection peuvent affecter significativement le cours d'une action
Par Yann Ait-Mokhtar, responsable de la recherche quantitative d’Exane BNP Paribas
1. Première illustration : la crise du crédit 2001-2002 et ses suites
Situation de stress du crédit
Lors de la crise du crédit qui avait suivi le dégonflement de la bulle « internet », de nombreuses sociétés comme France Télécom, Suez ou PPR avaient souffert de la mise en place de mécanismes de protections générant des flux massifs d’achats ou de ventes de titres dans le sens du marché. A cette époque, ces mécanismes étaient mis en place pour couvrir du risque de crédit.
En simplifiant le mécanisme, lorsque la situation d’une entreprise se dégrade, la valeur de ses dettes comme celle de ses actions baisse. Pour couvrir son risque de crédit, le prêteur peut donc vendre à découvert des actions, actif bien plus liquide que les dettes. Les pertes sur le crédit sont compensées par les gains réalisés sur la vente à découvert des actions.
Ce mécanisme n’a pas d’effet secondaire préjudiciable sur une action tant que les flux générés par cette couverture du risque crédit restent marginaux. Dès que les flux augmentent, les ventes d’actions en bourse diminuent la valeur de marché de l’entreprise, ce qui déprécie en retour son crédit puisqu’une fraction plus importante de l’actif économique de l’entreprise se trouve financée par endettement[1]. Les arbitragistes et ceux qui cherchent à se couvrir vendent alors à nouveau des actions : le mécanisme devient auto-réalisateur. Toutefois, ce mouvement n’est pas sans fin, il s’arrête lorsque la baisse de l’action justifie des flux acheteurs, sur la base d’arguments fondamentaux suffisants.
Intrinsèquement, les mécanismes de couverture du risque de crédit génèrent des ventes de titres quand l’action baisse et génèrent des achats de titres quand l’action monte. Ce faisant, ils transfèrent le risque de crédit au marché actions. Les titres sont alors excessivement volatils et dépréciés. La dépréciation correspond à une prime de risque supplémentaire rémunérant le risque de crédit et de liquidité transféré par les arbitragistes crédit.
Bull Market sur le crédit
Entre 2003 et mi-2007, la pénurie de crédit (causée par le désendettement des groupes cotés) a progressivement inversé les mécanismes. Le risque actions était acheté par le marché obligataire sous forme synthétique, ce qui a contribué à diminuer significativement la volatilité du marché actions. Le mécanisme était inversé par rapport à celui constaté en phase de stress de crédit : à la hausse les arbitragistes vendaient les actions, à la baisse ils en achetaient. Cela créait donc un effet « amortisseur » des mouvements de marché.
L’évolution exponentielle des dérivés de crédit au cours des dernières années a donné à ces mécanismes d’arbitrage une dimension macro-économique. Dans des conditions usuelles de marché, ils régulent les marchés en consommant un peu de liquidité quand le marché du crédit est excédentaire et en apportant de la liquidité lorsque le marché du crédit est en pénurie. Lors de phase de crises de crédit, les mécanismes d’arbitrage les amplifient.
Le graphique suivant illustre ces arbitrages. L’indicateur de risque actions (la volatilité) est totalement corrélé à l’indicateur de risque obligataire (le spread).
2. Seconde illustration : La situation actuelle
Un certain nombre de groupes ou de fonds ont pris des positions dans le capital d’entreprises en se finançant par un endettement sans recours auprès de banques. Le tableau suivant liste quelques situations actuelles en Europe :
La banque qui prête sans autre recours contre l’investisseur que la valeur des actions acquises le fait sur la base d’un pourcentage de la valeur des actions ainsi financées, le Loan To Value (LTV). En cas de baisse de la valeur des actions, elle demandera à l’investisseur de compenser la baisse de la valeur de sa garantie par des appels de marge en cash ou en titres. A défaut, elle vendra d’office tout ou partie des actions pour couvrir son risque, accélérant potentiellement ainsi la baisse de l’action.
L’investisseur, ou la banque, aura pu aussi immuniser partiellement son portefeuille en achetant des options de vente, ce qui revient à vendre à découvert un nombre d’actions correspondant au nombre d’actions protégées fois le delta de l’option. Quand le cours de l’action baisse, le delta de l’option de vente s’accroît[1] rendant nécessaire afin de maintenir l’efficacité de la couverture de vendre plus d’actions à découvert. Si à l’inverse l’action monte, il convient de racheter des actions pour ajuster la position de couverture. Dans tous les cas, ces opérations démultiplient les fluctuations du marché et accroissent la volatilité de l’action à l’instar des mécanismes de situation de stress de crédit du début de la décennie.
3- De l’accroissement de la volatilité à un accroissement du coût du capital
La hausse de la volatilité générée par les mécanismes récemment mis en place de couverture des positions minoritaires accroît le levier « beta » de l’action par rapport à son indice de référence au sens du MEDAF et donc le coût du capital de l’entreprise[2]. L’accroissement du coût du capital pénalise alors la valeur de l’action et les actionnaires
Cette hausse de la volatilité se traduit aussi par une hausse du risque de crédit, tel qu’évalué par des modèles optionnels (hausse de la probabilité de défaut). Financièrement, la société est donc aussi pénalisée dès qu’elle doit s’endetter en payant une prime de risque exagérée.
De manière schématique, un tel mécanisme de protection transfère le risque de « l’actionnaire assuré » aux actionnaires ordinaires de la société. L’action est décotée par l’accroissement du coût du capital. Cet accroissement du coût du capital correspond à la rentabilité théorique supplémentaire obtenue par l’actionnaire ordinaire en échange du risque qui lui est transféré à son insu par « l’actionnaire assuré ». Mais cette hausse de la rentabilité future, qui rémunère un risque accru, passe au préalable, pour pouvoir se réaliser, par une baisse du cours de l’action, ce qui peut rendre bien amère l’actionnaire ordinaire…
[1] NDLR : Pour ceux de nos lecteurs férus d’options, la dette d’une entreprise peut s’analyser comme une obligation sans risque et une option de vente vendue par le prêteur à l’actionnaire avec un prix d’exercice correspondant au montant à rembourser. La valeur de cette option croit quand la valeur de l’actif économique s’accroît puisque sa probabilité d’exercice augmente. Si la valeur de l’option de vente qui a été vendue s’accroît, la valeur de la dette baisse. Pour plus de détails, voir le chapitre 36 du Vernimmen.
[1] NDLR : Pour plus de détails, voir le chapitre 29 du Vernimmen
[2] NDLR : Pour plus de détails, voir le chapitre 39 du Vernimmen
Tableau : Rachats d'actions et dividendes en 2007
En 2007, et selon nos estimations, les sociétés du CAC 40 ont racheté (en net de cessions d’actions) pour environ 19,2 Md€ d’actions, soit 1,4 % de leur capitalisation boursière moyenne 2007.
La progression est très forte par rapport à l’an passé (7,9 Md€ et de 0,6 % de la capitalisation boursière), témoin une nouvelle fois de l’excellente santé de la quasi-totalité des membres du CAC 40 et d’opportunités de marché entrainées par le recul des cours du second semestre.
La pratique du rachat d’actions s’est en quelque sorte démocratisée puisque là où, l’an passé, les trois premiers groupes faisaient 71 % des rachats, il faut en chercher 8 aujourd’hui (Arcelor Mittal, BNP Paribas, Axa, Sanofi–Aventis, Total, Société Générale, Accor et Suez) pour atteindre ce même pourcentage. Seuls onze groupes n’ont pas procédé en 2007 à des rachats d’actions ou à des cessions nettes contre dix huit en 2006.
Source : Compilations de données AMF et des sociétés
En montant, la palme revient cette année à un «petit nouveau», Arcelor Mittal qui démontre que l’endettement contracté pour financer partiellement l’acquisition d’Arcelor a été vite résorbé. En montant relatif, Accor reste le champion en 2007 avec environ 9 % de son capital racheté.
Avec une progression de 21 % par rapport à 2006, la masse de dividendes versés en 2007 par les membres du CAC 40 atteint 37,8 Md€ et présente la même concentration qu’en 2006. Le trio de tête (Total, France Télécom et BNP Paribas) verse toujours 28 % des dividendes du CAC 40.
Par rapport 2006, le cumul des dividendes versés et des rachats d’actions progresse de 46 % à 57 Md€. Avec le retour au dividende de Alcatel-Lucent, Alstom est le seul groupe du CAC 40 à ne verser ni dividende ni à procéder à des rachats d’actions, mais ses actionnaires auraient du mal à s’en plaindre avec un cours en progrès de 43 % en 2007. Vive l’industrie !
Le taux de distribution moyen des dividendes, à 39 %, est sans surprise pour des groupes faiblement endettés et ayant des résultats en croissance, fruit le plus souvent d’investissements importants. Avec les rachats d’actions, on atteint un taux de distribution global de 60 % environ, ce qui laisse environ 40 Md€ de profits réinvestis, de quoi nourrir la progression des résultats 2008 si tout va bien.
Pour 2008, on peut s’attendre à une poursuite de la progression des dividendes car les résultats 2007 annoncés sont de bonne qualité malgré quelques accidents ponctuels. Nous pouvons vous donner rendez-vous dans la Lettre Vernimmen.net de février 2009, pour vérifier cela!
Sur le front des rachats d’actions, la probable moindre activité des financières (La Société Générale après une augmentation de capital de 5 Md€ aura peut être du mal à faire en 2008 1,3 Md€ de rachats d’actions comme en 2007), pourrait être compensée par le retour en première ligne de Sanofi-Aventis (3 Md€ annoncés) et le dynamisme d’Arcelor Mittal qui commence l’année avec déjà plus d’un milliard d’euros d’actions rachetées.
Pour plus de détails sur la politique de dividendes et de rachats d’actions, voir le chapitre 42 du Vernimmen.
Recherche : Rachats d'actions et impact sur la liquidité
Nous présentons ce mois-ci les résultats d’une étude menée par deux chercheurs français sur les rachats d’actions, un thème sur lequel les travaux empiriques sont rares en raison d’un manque de données disponibles. E. Ginglinger et J. Hamon (1) ont eu accès à une base de données concernant les rachats d’actions effectués par les sociétés cotées françaises entre 2000 et 2002. Ils contribuent ainsi à la compréhension des motivations et des conséquences des rachats d’action.
Les raisons pour lesquelles les dirigeants d’entreprise procèdent à des rachats d’action voient s’opposer principalement deux théories. Selon la théorie du market timing, les dirigeants procéderaient au rachat d’actions au moment où le titre de la société est sous-évalué. Ils bénéficient d’un avantage informationnel leur permettant de détecter cette sous-évaluation et en profite pour racheter des actions à bas prix. Alternativement, la théorie du price support explique que le rachat d’actions est destiné à soutenir la valeur du titre quand celui-ci est en baisse. Il s’agit bien d’une autre théorie : le titre n’est pas nécessairement sous-évalué et le rachat d’actions n’est pas dû à l’exploitation d’une asymétrie d’information (2).
L’étude montre que la valeur du titre des sociétés est significativement plus faible le jour du rachat que dans les mois précédents (de près de 3%). Ceci est compatible avec les deux théories : la baisse du prix peut justifier un rachat pour profiter de la sous-évaluation ou pour soutenir le titre. Mais la suite de l’étude soutient la seconde théorie plutôt que la première : la rentabilité des titres dans les 5 jours qui suivent un rachat n’est pas différente de celui des titres qui n’ont pas fait l’objet de rachat. Autrement dit, les sociétés qui ont procédé à un rachat d’action n’ont pas bénéficié d’un avantage informationnel. Les auteurs préfèrent donc conclure en faveur de la seconde théorie : le rachat d’actions aurait pour but de stabiliser la valeur boursière en cas de tendance baissière.
L’autre résultat important de l’étude concerne les effets des rachats d’actions sur la liquidité des titres concernés. Deux effets contradictoires sont attendus. D’un côté, le fait même de racheter des actions a pour conséquence de rajouter des ordres sur le carnet et donc de réduire le bid-ask spread (écart entre la meilleure offre et la meilleure demande). Mais d’un autre côté, l’asymétrie d’information (dans le cas du market timing) comme l’hétérogénéité des comportements (cas du price support) sont des facteurs classiques d’augmentation de spread et de réduction de la liquidité. Dans le cas français, c’est bien à une réduction de la liquidité que conduisent les rachats d’actions, le spread moyen passant de 2,33% avant le rachat à 2,4% après, ce qui est statistiquement significatif.
(1) E.Ginglinger et J.Hamon, 2007, Actual Share Repurchase, Timing and Liquidity, Journal of Banking and Finance, 31 (3), p.915-938
(2) Pour plus de détails, voir le chapitre 42 du Vernimmen 2005.
Q&R : Qu'est-ce que la directive MIF ?
C’est une directive européenne qui est entrée en application le 1er novembre 2007 dans tous les pays de l’Espace Économique Européen (1) et qui porte sur les marchés d’instrument financiers (d’où son nom).
Elle trouve son fondement dans une volonté politique très claire de renforcer la concurrence sur les marchés financiers afin d’en abaisser le coût des transactions. Souvent les bourses de valeurs sont un monopôle de fait ou de droit (règle de concentration des ordres), ce qui n’est pas la meilleure garantie que le prix des services rendus y soit le plus bas possible puisque la concurrence est inexistante ou faible.
La directive MIF supprime l’obligation d’exécution des ordres sur un marché réglementé comme Euronext à Paris par exemple et instaure, aux cotés des marchés réglementés (Eurolist, MATIF et MONEP, tous gérés par Euronext en France), deux modes alternatifs d’exécution des ordres :
• des systèmes multilatéraux de négociation (Multilatéral Trading Facility, MTF ; Alternative Trading System, ATS ; Electronic Communication Network, ECN ; …) comme Chi-X, Turquoise ;
• des internalisateurs systématiques : c’est-à-dire des prestataires de services d’investissement (PSI c’est-à-dire les banques, les agents de change, …) qui se porte contrepartie des ordres reçus de leurs clients, de façon organisée, fréquente et systématique sur la base de prix affichés pour les actions considérées comme liquides et pour des tailles d’ordre inférieures ou égales à une quantité standard, et sur la base de prix divulgués à la demande pour les autres.
Les risque d’introduction d’une concurrence dans l’exécution des ordres sont doubles :
• en divisant les volumes traités entre les places d’élargir la fourchette entre le prix offert et le prix demandé. Le développement continu des volumes des transactions et l’introduction d’une concurrence accrue pourraient éviter ce risque ;
• rendre bien compliqué pour le quidam investisseur le choix de telle ou telle place pour l’exécution de son ordre où il soit sûr d’obtenir à l’instant t le meilleur prix.
Afin d’y parer, il est prévu à la charge du prestataire de service d’investissement l’obligation de meilleure exécution qui l’oblige à exécuter l’ordre reçu de son client sur la place qui offre, à ce moment, les meilleures conditions pour son client.
Cette règle de meilleure exécution ne s’applique qu’à la clientèle de détail (les particuliers et les petites entreprises) et à la clientèle professionnelles (banques, assurances, OPCVM, sociétés de gestion, entreprises répondant à deux des trois critères suivante : chiffre d’affaires de plus de 40 M€, total bilan de plus de 20 M€, capitaux propres de plus de 2 M€, gouvernements, banques centrales). Elle ne s’applique pas à une troisième catégorie de clientèle, les contreparties éligibles (PSI, banques assurances, OPCVM). Cette classification s’appuie sur des questionnaires remplis par les clients que nos lecteurs ressortissants de l’EEE ont dû remplir à la fin de l’année passée.
Grâce à Dieu (ou plutôt au législateur européen), cette classification n’est pas rigide. Ainsi, un particulier pourra être classé client professionnel s’il remplit deux des trois critères suivants : avoir réalisé dix transactions par an, avoir un portefeuille d’une valeur supérieure à 0,5 M€ ou avoir occupé un poste dans le secteur financier.
La protection dont il bénéficiera légalement sera moindre mais il pourra accéder à des produits plus complexes. En effet, avant de proposer un produit financier à un client, un PSI devra s’assurer que le client comprend bien le produit, qu’il est compatible avec sa situation financière et avec les objectifs de son client.
La directive prévoit aussi des obligations de transparence pré-négociation sur l’affichage des prix pratiqués au moment présent et post-négociation puisque les marchés réglementés, les MTF et les internalisateurs systématiques doivent déclarer les caractéristiques des transactions réalisées au régulateur (l’AMF en France).
(1) Les pays de l’Union Européenne plus l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.