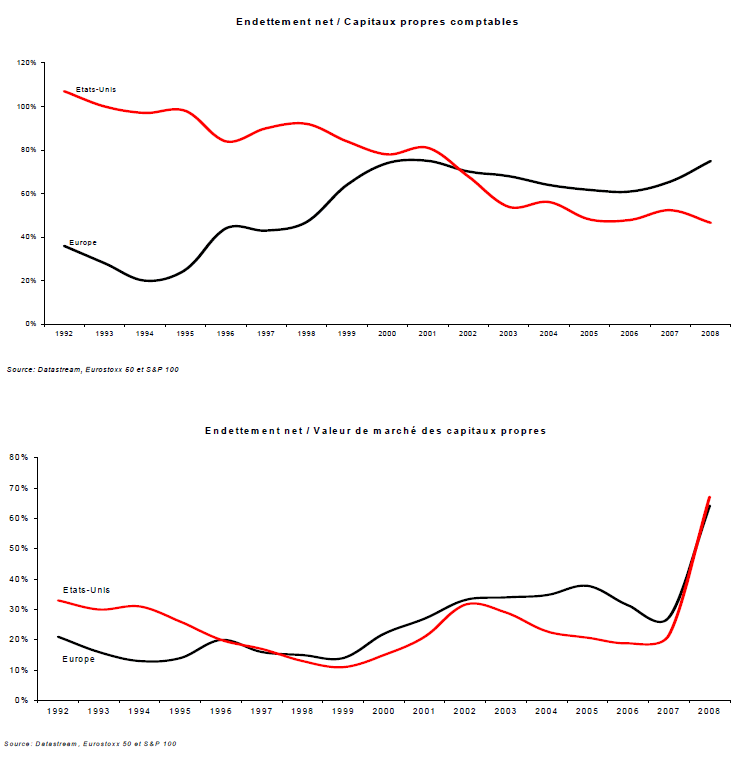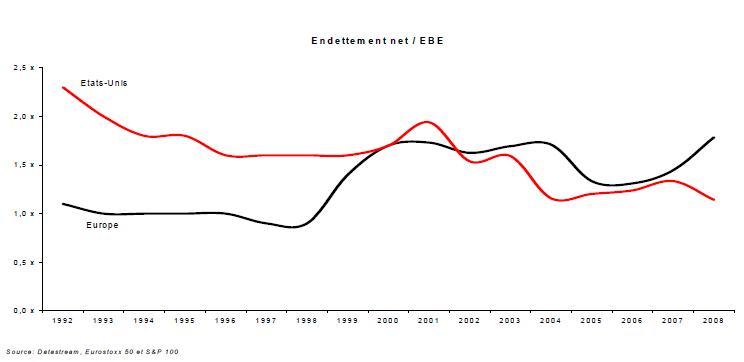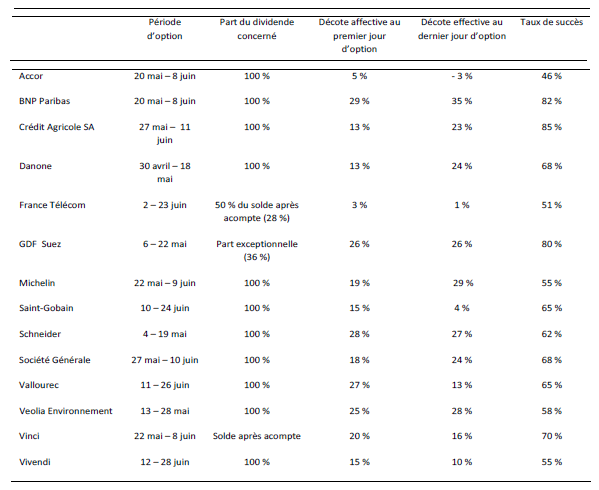La Lettre n°79 de Septembre 2009
Actualités : Finance et stratégie
Le nouveau Vernimmen 2010 est disponible
L’édition 2010 contient un chapitre nouveau consacré à un thème que vous avez été nombreux à nous demander de couvrir, à savoir les liens entre la finance et la stratégie. En voici les trois premières pages.
Nous espérons que la lecture des 52 chapitres du Vernimmen ne vous aura pas laissé croire que la finance est la fonction la plus importante de l’entreprise !
L’expérience montre que des groupes gérés dans une logique financière exclusive et hypertrophiée ne peuvent pas survivre. Ainsi Havas, premier groupe européen des médias au début des années 1990 (télévisions, radios, affichage, édition, presse professionnelle, etc …) a disparu en moins de huit ans, condamné à l’immobilisme par la dictature du BPA, par des dilutions régulières dans le capital de ses filiales pour dégager des profits exceptionnels prétendument récurrents, et par des actionnaires financiers trop préoccupés à se neutraliser mutuellement pour voir que, dans un monde changeant, seul Havas restait immobile. Hanson au Royaume-Uni, ITT aux Etats-Unis ont connu la même fin pour les mêmes raisons.
A l’inverse, une stratégie industrielle sans finances saines est aussi vouée à l’échec. C’est ce qui est arrivé à Vivendi Universal, résultat de l’absorption d’Havas par le conglomérat Générale des Eaux. Pour financer une expansion tous azimuts dans les médias et l’internet il eut recours à un endettement à court terme, sans cesse croissant, jusqu’à exploser spectaculairement en plein vol en 2002 à cause d’une sévère mais banale crise de liquidité.
Ceci ne veut pas dire qu’un directeur financier ne puisse pas devenir président d’un groupe, bon nombre de compétences qu’il doit démontrer dans son poste l’y préparent, mais il doit alors prendre une autre ampleur et muer. Le directeur financier de Saatchi & Saatchi a ainsi créé WPP dont il est le président et qui est devenu en 20 ans le premier groupe mondial de publicité.
Il est donc sain que la politique financière de l’entreprise soit subordonnée à sa stratégie. Celle-ci est certes guidée par des critères financiers (dégager une rentabilité sur les investissements supérieure au coût du capital) mais elle demeure primordiale par rapport à la politique financière.
Comme la stratégie est déterminée par les actionnaires et qu’elle dépend, même si peu l’avoueront, du contexte macro-économique, la politique financière est fonction à la fois de la stratégie de l’entreprise, de son actionnariat et de l’environnement macro-économique.
Section 1 – Les stratégies de l’entreprise
Les stratégies de l’entreprise peuvent prendre de nombreuses formes : diversification, recentrage sur un métier, intégration vers l’amont ou l’aval, conquête de parts de marché, internationalisation, etc. ; et s’appuient sur la croissance interne ou la croissance externe. C’est l’une des faces visibles de la main invisible…
1/ La lecture financière de la stratégie
Pour un financier, ces stratégies quelles qu’elles soient, n’ont qu’un seul but : permettre à l’entreprise de s’extraire d’un marché concurrentiel pour se constituer une « rente », lui permettant de dégager une rentabilité supérieure à celle de ses concurrents, qui ne la concurrencent d’ailleurs plus tout à fait. Les marques, les brevets, les barrières à l’entrée industrielles (taille minimale des usines, budgets de publicité importants, …) ou légales (concessions, droits, …) ne sont que des instruments au service de ce but. Pour un financier, le rôle premier d’un industriel est d’analyser l’environnement économique, industriel, commercial, technologique … concurrentiel de son entreprise pour développer une politique devant se traduire par une rentabilité supérieure.
Mais comme Sisyphe, l’entrepreneur doit en permanence refaire son « ouvrage ». En effet, une rentabilité supérieure attire de nouveaux entrants dans le secteur : ceux-ci se chargent de contourner ou de faire tomber les barrières à l’entrée qui en protègent la forte rentabilité. Tôt ou tard, ils y parviennent, ce qui ne manque pas de réduire les marges par l’intensification de la concurrence en résultant.
Quand le risque est trop rémunéré (le luxe, par exemple), de nouveaux concurrents entrent dans le secteur, ce qui fait baisser sa rentabilité. Quand le risque est insuffisamment rémunéré, des entreprises abandonnent le secteur, certaines sociétés font faillite, le secteur se consolide ou s’intègre (les équipementiers automobiles), ce qui en réduit la concurrence et en augmente la rentabilité. On retrouve ici le raisonnement qui nous avions vu pour les titres financiers trop rentables ou trop peu rentables compte tenu de leurs risques. Sur les marchés industriels, comme sur les marchés financiers, une relation nécessaire s’instaure donc entre le risque et la rentabilité.
Sur les marchés financiers, beaucoup plus liquides par définition que les marchés industriels, l’équilibre entre la rentabilité et le risque s’établit beaucoup plus vite que sur les marchés industriels où l’entrée est plus difficile que le simple achat d’un titre, et la sortie beaucoup plus compliquée que la simple vente d’un titre.
Ainsi, il existe des secteurs où la rentabilité dégagée peut être durablement supérieure à la rentabilité normale compte tenu du risque. Cependant, il ne faut pas se leurrer : même si les ajustements sont souvent longs, tôt ou tard, ils finissent par se produire, et une rentabilité anormalement élevée disparaîtra, quelle que soit la stratégie poursuivie par l’entreprise (voir Coca-Cola, par exemple (1)).
2/ Les stratégies reposant sur la croissance interne
Une politique de croissance interne a pour objectif de développer l’activité et les profits de l’entreprise en s’appuyant sur ses ressources et ses capacités sans procéder à des acquisitions d’entreprises tierces. L’entreprise joue soit sur le levier de l’innovation pour se différencier par rapport à ses concurrents, soit sur celui de l’abaissement des coûts. Ces deux stratégies peuvent être combinées. Dans un premier temps un nouveau marché est créé grâce à de nouveaux produits ou de nouvelles fonctionnalités (Apple par exemple avec l’IPod et l’IPhone), puis le prix de revient en est abaissé (transport aérien low-cost ou le PC portable).
Obtenir les coûts de revient les plus bas possible permet à l’entreprise de lutter contre la concurrence, voire de l’éliminer ou de l’empêcher d’entrer dans son secteur d’activité. La politique industrielle a alors pour objectif principal de minimiser un prix de revient unitaire comptable des produits fabriqués.
Dans ce cadre, les cabinets de conseil en stratégie d’entreprise, et plus particulièrement le BCG, ont démontré au début des années 1960, à partir d’études sectorielles, qu’une relation statistique existe entre le volume cumulé de la production et le prix de revient unitaire. Plus le volume cumulé de la production est important, plus le prix de revient unitaire est faible.
Le caractère un peu simpliste de la relation n’a pas manqué d’être critiqué. Néanmoins, dans la majorité des cas, chaque secteur peut être « caricaturé », à un moment donné, par une courbe d’expérience sur laquelle les entreprises se situent plus ou moins bas. Ce type de relation met en évidence le paramètre crucial qu’est le taux de croissance de l’entreprise par rapport à ses concurrents, et plus généralement par rapport à son secteur d’activité. Plus l’entreprise croît vite par rapport à son secteur (c'est-à-dire accroît sa part de marché), plus ses coûts industriels sont bas, et plus elle est en mesure de résister à la concurrence, et donc de survivre. Elle impose en effet une barrière à l’entrée de nouveaux concurrents sous forme de perspective de rentabilité faibles. En effet, ceux-ci devront aligner plus ou moins leurs prix de vente sur ceux pratiqués par l’entreprise déjà en place, alors qu’ils ont des prix de revient supérieurs. D’où des marges plus faibles, voire négatives ! Grâce à l’importance de sa part de marché, l’entreprise réussit à dissuader l’entrée de nouveaux concurrents (fournisseurs d’accès à Internet). Ce modèle est particulièrement vrai pour les secteurs en fort développement.
A côté de la courbe d’expérience, des chercheurs ont aussi constaté qu’une innovation ou qu’un nouveau domaine d’activité stratégique avait une montée en puissance par phase. Le taux de croissance est faible au démarrage, devient très fort ensuite puis redevient faible en phase de maturité pour devenir négatif en phase déclin. A chaque étape de ce cycle de vie correspond des stratégies financières spécifiques. Par exemple, en phase de lancement, l’entreprise aura des besoins de financement importants et recourt aux capitaux propres. Au contraire, en phase de maturité, l’objectif est de traire la rente et l’endettement y aide puissamment.
Le rôle du financier est alors de fournir à l’entreprise les moyens financiers de cette politique de croissance interne. En effet, dans le cadre d’une telle stratégie, l’entreprise se fixe un taux de croissance de l’activité qui, pour être atteint, nécessite la réalisation d’investissements de R & D (innovation), de marketing (politique commerciale agressive) ou corporels et d’exploitation (prix de revient), d’où des besoins de financement. Ces besoins peuvent être couverts partiellement, totalement, ou en excès, par les ressources que l’entreprise sécrète (sa rentabilité). D’un point de vue financier, une stratégie de croissance interne débouche nécessairement sur l’analyse de l’adéquation entre le taux de croissance de l’activité (mesuré par l’évolution du chiffre d’affaires) et le taux de rentabilité de l’entreprise, comme nous l’avons vu au chapitre 42.
On démontre en effet aisément que le taux de croissance interne que l’entreprise peut supporter sans faire appel à ses actionnaires et sans modifier sa structure financière est égal au taux de rentabilité des capitaux propres multiplié par (1 – taux de distribution des bénéfices).
Le rôle de la politique financière est alors :
• de gérer au mieux les besoins de fonds de l’entreprise, en évitant que leur taux de croissance ne dépasse celui de l’activité : contrôle très strict des stocks, suivi des clients, utilisation au mieux du crédit fournisseur, absence d’investissements non directement productifs ;
• d’obtenir une forte rentabilité des capitaux propres, malgré une faible rentabilité économique, en « jouant » sur l’effet de levier ;
• d’abaisser le coût du crédit par une gestion rigoureuse de l’endettement ;
• d’ouvrir modestement le capital (entrée de nouveaux actionnaires) sur la base d’une valorisation élevée.
Si, dans le cadre de la croissance interne, la politique industrielle correspond à une fuite en avant pour abaisser les coûts unitaires de production ou sortir innovation après innovation, la politique financière a, au contraire, pour exigence la rigueur et la continuité.
(1) Voir page 306.
Actualités : Le nouveau Vernimmen 2010 est disponible
Avec plus de 13 000 exemplaires vendus en 10 mois, plus de 6 000 visiteurs uniques par jour sur le site Vernimmen.net, 45 000 abonnés à la Lettre Vernimmen.net et 900 fans sur Facebook, le succès du Vernimmen n’a jamais été aussi important qu’en 2009.
Avec une telle communauté autour du livre, du site et de la lettre, il nous a semblé nécessaire d’offrir encore plus à nos lecteurs.
C’est pourquoi avec l’édition 2010 nous lançons deux innovations majeures : le passage à une édition annuelle et le lancement d’une version électronique de l’ouvrage.
Le passage à une édition annuelle nous est apparu comme une nécessité compte tenu de l’évolution rapide du contexte économique et des techniques financières. En effet, même si nous demeurons convaincus que les concepts de base de la finance sont pérennes (et vous les retrouverez expliqués dans l’ouvrage), leur déclinaison dans la pratique quotidienne et leur adaptation à l’environnement nécessite clairement une mise à jour du livre plus fréquente que tous les trois ans comme jusqu'a présent.
Nous avons ainsi inclus dans cette édition l’ensemble du développement de la crise économique et financière. En effet, si la crise des subprimes a débouché sur une crise financière majeure, elle a provoqué une crise économique, elle aussi majeure, et ce n’est qu’à la toute fin de 2008 et en 2009 que les effets importants pour les entreprises se sont fait ressentir. Ainsi l’édition 2010 tient compte de ces développements récents et commence par une introduction synthétisant l’année financière. D'une certaine façon, nous avons de la chance, elle a été riche !
Naturellement nous avons fait notre travail habituel de mise à jour pour vous offrir un outil de travail précis, fiable, exhaustif et pertinent : l’ensemble des statistiques et graphiques ont été actualisés et présentent les données les plus récentes à juin 2009, les dernières innovations de la pratique financière sont traitées, les derniers changements de normes comptables intégrés et les derniers développement du droit fiscal, boursier, et des sociétés pris en compte. Les chercheurs n'ont pas été de reste en 2009, en particulier avec les travaux de Yann Ait-Mokhtar sur l'incidence de l'inadéquation entre la liquidité des actifs de l'entreprise et les échéances de ses dettes sur la valeur des capitaux propres de l'entreprise. Bon nombre d'entreprises qui ont augmenté leurs capitaux propres en 2009 ont pu mesurer la pertinence de ces réflexions qui améliorent celles de Robert Merton de 1974 en tenant compte de ce que la pratique nous a fait découvrir : la liquidité peut disparaître très vite !
Nous avons créé un nouveau chapitre sur les liens entre finance et stratégie dont vous avez pu lire les premières pages plus haut.
Thème au combien d’actualité en 2009, nous en avons profité de cette nouvelle édition pour revoir en profondeur la manière dont nous présentions la politique de distribution et de rachat d’actions, deux chapitres sont désormais consacrés à ce thème pour faire le tour complet des aspects théoriques et pratiques.
Comme tout grand classique, le Vernimmen offre à ses lecteurs des socles de savoir forgés par la pratique et enrichis par des réflexions conceptuelles qui ne les laissent jamais désarmés face à un problème ou une situation financière :
• le plan type d'une analyse financière,
• les outils de mesure de la création de valeur,
• les techniques de placements des actions, des obligations, des crédits syndiqués,
• etc….
Pour vous aider à mieux utiliser "votre Vernimmen", chaque chapitre se clôt sur un résumé, des exercices (159 en tout) et des questions (731) corrigés. Nous avons utilisé le rabat de couverture pour présenter dans un lexique français-anglais-américain les principaux termes de la finance, ainsi qu'une antisèche ( "Le Vernimmen" résumé en une page !). Pour vous aider à aller au-delà si besoin, chaque chapitre est doté d'une bibliographie avec des conseils d'orientation tant vers des papiers de recherche fondamentale, que vers des articles de presse ou des livres. Tant en annexe que dans le corps du texte de très nombreux graphiques et tableaux (plus de 100) vous donnent des éléments de référence et de comparaison. L'index enfin comprend plus de 1 500 entrées.
Pour vous procurer le Vernimmen 2010, cliquez ici.
Enfin, beaucoup nous l’avaient réclamée, l’édition électronique du Vernimmen est désormais disponible par Internet. Au-delà de l’aspect pratique (les 2,2 kg de l’ouvrage papier sont parfois lourds surtout quand il faut le transporter. . . ), l’édition électronique offre des possibilités de recherche que l’ouvrage papier ne permet pas et surtout une actualisation en temps réel d'autant plus utile que nous ne publierons pas une édition papier tous les mois et que les changements en finance n'interviennent pas tous au 30 juin ! De surcroît nous réservons dorénavant l'exclusivité des archives de La Lettre vernimmen.net aux abonnés du Vernimmen en ligne.
Pour découvrir le Vernimmen en ligne 2010 , cliquez ici.
Voici ce que certains de ses utilisateurs ont dit sur le Vernimmen 2010 :
« Le Vernimmen, un ouvrage que l’on découvre, avec curiosité, au cours de ses études et que l’on retrouve, avec plaisir, durant sa vie professionnelle. Il explique de manière assez simple des mécanismes souvent complexes. Les lettres du site Internet collent plutôt bien à l’actualité. "Vernimmen" est un outil de travail précieux. »
Marina Alcaraz, Journaliste aux Echos
« Je ne pensais pas un livre capable de rendre la finance limpide à ce point ! »
Florian Chauvin, Etudiant en Master Finance à l’IAE Université Jean Moulin, Lyon 3
« Qualité, Clarté et Efficacité »
Hervé Dissaux, consultant pour les PME
« Le Vernimmen est l’ouvrage de référence de la finance d’entreprise. C’est-à-dire que je m’y réfère très souvent. C’était le cas quand j’étais banquier d’affaires ; et encore maintenant dans l’enseignement. Comme l’était notre regretté ami Pierre Vernimmen, l’ouvrage éponyme manifeste une pensée juste, à la pointe des développements théoriques et pratiques et surtout une méthode d’analyse cohérente. Je ne lui connais pas d’équivalent en langue française ou anglaise. »
Michel Fleuriet, Professeur associé et fondateur du Master "Banque d’investissement et de marché" de Paris Dauphine.
« Le Vernimmen est pour moi un incontournable de la finance. C’est un ouvrage complet, en permanente évolution et dont l’extrême richesse réside dans ce parfait dosage entre la théorie financière et les pratiques de la gestion financière.
Dans mon métier de conseil, quand une question/problématique se pose, qu’elle soit d’ordre général ou spécifique, mon premier réflexe est de consulter le Vernimmen ! »
Emna KALLEL, Secrétaire Générale de l’Association Tunisienne des Analystes Financiers
" Le kit de survie du parfait financier !"
François-Charles LUXOR, Directeur de Centre Commercial chez Unibail-Rodamco
« Le Vernimmen : la démonstration qu’une grande pédagogie et une vraie accessibilité sont parfaitement compatibles avec des analyses fines et complètes »
Christian Mulliez, Vice-Président, Directeur Général Administration et Finances de L’Oréal.
Recherche : La structure financière des entreprises non cotées
L’article que nous présentons ce mois (1) porte sur les différences entre les entreprises cotées et non cotées (2). Il a été réalisé à partir d’une thèse d’un doctorant de la Wharton Business School, qui s’est intéressé aux structures du capital et aux moyens de financement des entreprises non cotées. Il utilise les données d’entreprises du Royaume-Uni, mais la taille de l’échantillon et les quelques comparaisons internationales permettent de croire que les résultats sont généralisables.
Les sociétés non cotées font l’objet d’assez peu d’articles empiriques (faute de données suffisantes). Elles représentent pourtant la plus grande part du tissu économique : 97,5% des entreprises au Royaume-Uni, et plus de 2/3 des actifs. L’article met l’accent sur leurs spécificités en matière de taux d’endettement. Il met en évidence un effet niveau et un effet sensibilité :
• L’effet niveau résulte du fait que le coût relatif des capitaux propres par rapport à l’endettement est supérieur dans les sociétés non cotées (puisque l’appel à l’épargne publique n’est pas possible). Le niveau de leur taux d’endettement en pourcentage des actifs, est donc plus élevé : 32,7% en moyenne contre 22,7%. La différence vient presque entièrement de l’endettement à court terme, beaucoup plus élevé dans les sociétés non cotées (64% de l’endettement total, contre 37% dans les sociétés cotées). La dette à court terme y est notamment utilisée pour obtenir les liquidités nécessaires au paiement des créanciers.
• L’effet sensibilité est la conséquence d’un coût plus élevé du financement externe pour les sociétés non cotées. L’accès aux capitaux étant plus compliqué, tout financement externe supplémentaire une fois le taux d’endettement choisi atteint est plus coûteux que pour une société cotée (3). Il en résulte une gestion plus passive du financement : les sociétés non cotées sont moins réactives pour se financer, et leur structure de capital montre une plus grande persistance. Ainsi, à situation comparable en termes de résultats, taille et opportunités de croissance, une entreprise cotée a une probabilité d’augmenter le capital de 3% supérieure à une société non cotée.
L’auteur propose également des pistes pour expliquer de telles différences entre les sociétés cotées et non cotées.
D’une part, les sociétés non cotées se caractérisent par un actionnariat plus concentré et plus proche de la direction. Le risque de perte de contrôle pour les actionnaires y constitue un frein aux augmentations de capital. A l’inverse, dans une société cotée, le dirigeant peut souhaiter augmenter le capital pour diluer encore plus le pouvoir des actionnaires et détenir le contrôle de fait de l’entreprise.
D’autre part, les obligations légales en matière de transparence sont plus faibles pour les sociétés non cotées. En conséquence, le coût des asymétries d’information (les nouveaux actionnaires sont moins bien informés que les anciens) y est plus important en cas d’augmentation de capital, ce qui rend la procédure moins attractive.
Cet article constitue finalement l’un des rares travaux empiriques sur les sociétés non cotées, ces acteurs économiques qui constituent encore un vaste terrain pour la recherche académique.
(1) O.BRAV (2009), Access to capital, capital structure, and the funding of the firm, Journal of Finance, vol.64, p.263-308.
(2) L’article distingue en fait les public firms (celles qui peuvent faire appel à l’épargne publique) et les private firms (qui n’y sont pas autorisées), mais les donnés utilisées sont bien celles des sociétés cotées et des sociétés non cotées (considérant ces dernières comme des private firms et ignorant volontairement les public firms non cotées).
(3) La théorie du trade-off prévoit qu’une entreprise atteint son taux d’endettement optimal lorsque le coût marginal de l’endettement est égal au coût marginal du capital. Alternativement, voir la théorie du pecking order dans le chapitre 39 du Vernimmen 2010.
(3) La théorie du trade-off prévoit qu’une entreprise atteint son taux d’endettement optimal lorsque le coût marginal de l’endettement est égal au coût marginal du capital. Alternativement, voir la théorie du pecking order dans le chapitre 39 du Vernimmen 2010.
Q&R : Pourquoi payer le dividende en actions ?
Cette année, compte tenu du contexte économique et financier, bon nombre de sociétés ont proposé à leurs actionnaires d’opter pour un versement de leur dividende en actions.
14 sociétés du CAC 40 (soit 41% des sociétés du CAC 40 ayant versé un dividende) l’ont ainsi proposé. Mais ces opérations ne sont pas réservées aux seuls grands groupes et de nombreuses sociétés de taille plus modeste l’ont également mis en œuvre (Steria, Eurazéo, Mercialys, ABC Arbitrage, Foncière des Régions, …).
Si ses statuts le permettent, une société peut en effet proposer à ses actionnaires de toucher le montant du dividende en actions. Il convient alors à chaque actionnaire de choisir de percevoir son dividende en cash ou de le toucher en actions nouvellement créées.
Si un nombre important d’actionnaires choisissent les actions, la société conserve ses liquidités et renforce ses capitaux propres. Ainsi les banques de CAC 40 ont renforcé marginalement leur capitaux propres en 2009 en utilisant cette technique.
D’un point de vue pratique, l’option est laissée aux actionnaires durant une période de quelques jours entre l’assemblée générale et la date de paiement du dividende. Au-delà de cette période, les actionnaires n’ayant pas indiqué de choix reçoivent automatiquement du cash. Le prix d’émission des actions nouvelles est fixé à la suite de l’assemblée générale sur la base de la moyenne des 20 jours de bourse précédent l’assemblée. Une décote allant jusqu’à 10% peut être appliquée à cette moyenne de cours.
On a pu observer qu’en moyenne 65% des actionnaires des sociétés du CAC 40 à qui cette possibilité était offerte y ont répondu favorablement. Même si les aspects psychologiques ne sont pas négligeables, ce fort taux de succès est principalement dû à l’attractivité financière de l’opération. En effet, compte tenu de la hausse des cours durant la période précédant les assemblées générale de 2009, les prix d’émission des actions nouvelles affichaient des décotes importantes par rapport aux cours de bourse durant la période d’option : en moyenne, le paiement en actions était plus attractif de 18% que le paiement en cash.
Typiquement l’actionnaire, constatant cette situation mais souhaitant obtenir des liquidités comme chaque année, opte pour le paiement du dividende en actions et cède parallèlement un nombre d’actions identique à celui qu’il va toucher au titre du dividende. Lorsqu’un actionnaire important de la société souhaite réaliser ce type d’opération, le reclassement de titres est organisé sous la forme d’un accelerated bookbuilding (1).
C’est ce qui avait entraîné l’arrêt de cette pratique au début des années 1990 quand les entreprises cotées avaient compris que la conséquence en était une baisse de leurs cours de bourse. Il est difficile d’avoir le beurre et l’argent du beurre !
Cette année, cet effet n’a pas été perceptible compte tenu de la force de la reprise boursière après l’effondrement de fin 2008 / début 2009. Mais il n’a pas pour autant disparu.
(1) Voir le chapitre 31 du Vernimmen 2010 pour plus de détails.