La Lettre n°8 de Février/Mars 2002
Actualités : Quelques réflexions sur les taux de rentabilité exigés
Dans les conditions actuelles de marché, le taux de rentabilité à exiger d'une action de risque moyen (*1) correspond à environ 9%, soit le taux des obligations d'Etat à 10 ans (4,9% environ) majoré d'une prime de risque de l'ordre de 4,5% (*2). Demander du 15% c'est donc beaucoup trop et totalement injustifié, sauf pour les entreprises qui ont un coefficient bêta d'au moins 2,2 : moins de 0,2% des grandes entreprises européennes cotées ont un tel bêta !
Comment une société pourrait-elle durablement obtenir ces 15% exigés ?
-
Par l'effet de levier de l'endettement : l'entreprise s'endette et peut porter la rentabilité comptable de ses capitaux propres à un niveau supérieur à la rentabilité de son actif économique à condition que celle-ci reste supérieure au coût net de l'endettement. Cette déconnexion est d'autant plus forte que le niveau d'endettement est important. Pour une entreprise de risque moyen, une rentabilité des capitaux propres de 15% nécessite probablement des dettes de l'ordre de grandeur de 150% des capitaux propres. C'est à peu près la structure financière actuelle de France Télécom, mais toutes les entreprises sont loin d'avoir la récurrence de ses cash flows ! Plus fondamentalement, obtenir ce taux de 15% en jouant sur l'effet de levier de la dette revient à augmenter très significativement le risque pour l'investisseur et pour l'entreprise. C'est clairement le cas dans un LBO, mais tout le monde alors a conscience du risque d'un LBO.
Est-ce cela que veut l'investisseur qui demande du 15% ?
-
Par la créativité comptable : la technique du pooling dont les jours sont comptés en Europe (*3), les dépréciations massives d'actifs qui ont le même effet et auxquels des groupes (AOL Time Warner, Alcatel …) ont actuellement massivement recours, font disparaître des pans entiers de capitaux propres, et permettent d'atteindre plus facilement l'objectif d'un taux de rentabilité comptable de 15%. Mais évidemment ceci est un leurre. Ce n'est pas parce qu'une partie des capitaux propres apportés par les actionnaires a disparu en toute légalité du bilan que les actionnaires ne réclament pas sur ces capitaux propres le taux de rentabilité qu'ils sont en droit d'attendre !
Est-ce cela que veut l'investisseur qui demande du 15% ?
-
Par des déconsolidations : l'entreprise met dans des sociétés non consolidées ses actifs les moins rentables. Dès lors le taux de rentabilité apparent du groupe s'accroît. C'est se voiler la face et induire la communauté en erreur. C'est malheureusement plus fréquent qu'on ne le croit. Que notre lecteur examine les comptes de Coca-Cola. La rentabilité après impôt de l'actif économique y paraît excellente (18% en 2000) et l'endettement modéré (0,84 fois l'EBE). Certes, mais des actifs (mise en bouteille du Coca-Cola) cinq fois plus importants en montants comptables (41 Md$) que ceux qui restent dans le bilan consolidé (8Md$) ont été opportunément logés avec les 25 Md$ de dettes qui les financent dans des filiales à 40%. Elles ne sont bien sûr consolidées que par mise en équivalence : ni la dette, ni les actifs n'apparaissent au bilan de Coca Cola. La rentabilité économique de ces actifs hors du bilan Coca-Cola est de 2%, leur EBE n'est que de 5,2Md$ (face à 25 Md$ de dettes…). On imagine mal que Coca-Cola laisse ces filiales faire faillite : elles portent son nom et constituent une partie de son activité. Si on les réintégrait dans le bilan consolidé, on se rendrait compte que la véritable rentabilité économique après impôt du groupe n'est pas de 18%, mais de 6,2% et que l'endettement est de 3,3 fois l'EBE (et non 0,84).
Est-ce cela que veut l'investisseur qui demande du 15% ?
-
Par un accroissement du risque opérationnel : pour caricaturer, l'entreprise pourrait s'étendre en Russie ou en Argentine, pays où les taux de rentabilité normaux sont beaucoup plus élevés que chez nous compte tenu de leur risque plus fort.
Est-ce cela que veut l'investisseur qui demande du 15% ?
En fait, la théorie économique et le bon sens enseignent que sur moyenne période le taux de rentabilité dégagé correspond au taux de rentabilité normalement exigé compte tenu du risque. Ceci est de plus en plus vrai compte tenu des déréglementations et des progrès techniques qui érodent de plus en plus vite les barrières à l'entrée protègeant les situations de rente. Des grands groupes, leaders mondiaux de leurs activités avec des brevets, des marques connues, de fortes parts de marché, des outils de distribution puissants dans des secteurs à maturité ne gagnent que leur coût du capital ou marginalement plus : Saint Gobain, Michelin, Air Liquide, et … Coca-Cola.
L'entreprise crée de la valeur lorsqu'elle investit dans des projets qui pour un niveau de risque moyen rapportent à notre époque, du 7 à 9%, pas uniquement à partir de 15%. Exiger du 15%, c'est passer à côté de bon nombre d'investissements créateurs de valeur !
Demander en tant qu'investisseur, pour un niveau de risque moyen, du 15% est tout simplement aussi démagogique que d'exiger une augmentation immédiate du SMIC de 50%, ou la diminution du temps de travail de 33% à salaire constant. Même Madame Laguiller n'y songe pas !
Pour un niveau de risque moyen, dans nos pays, 15% est un taux insoutenable que l'entreprise ne peut durablement pas atteindre, qui est injustifiable d'un point de vue théorique et qui n'a donc d'autre justification chez l'investisseur que la méthode Coué. Cette attitude peut conduire à des comportements dangereux (endettement excessif, déconsolidation agressive). Espérons que les dirigeants qui se fixent cet objectif de 15% le font sur des capitaux amputés de dépréciations exceptionnelles ou de goodwill imputés pour obtenir en fait du 9% sur la base des capitaux propres totaux apportés par les actionnaires. Qu'ils soient alors pardonnés !
2 Voir la lettre Vernimmen.net du mois dernier.
3 Voir la lettre Vernimmen.net de juin 2000.
Tableau : Les introductions en bourse depuis 1987
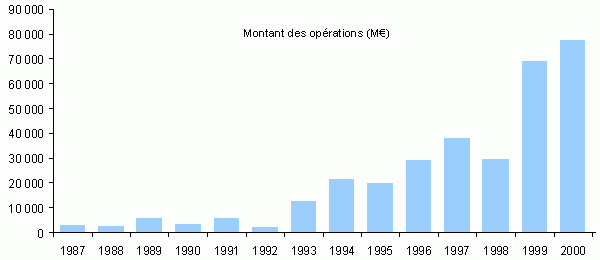
et 2002 ne s'annonce pas meilleur…
Recherche : De nouvelles idées sur la structure financière
Les réflexions sur la structure financière avaient démarré avec une optique très micro-économique de recherche d'un optimum dans le mix endettement / capitaux propres qui minimise le coût moyen pondéré du capital. On se rappelle les travaux véritablement révolutionnaires de Franco Modigliani et de Merton Miller en 1958 qui démontraient que, dans un monde sans fiscalité, il n'y a pas structure financière optimum. Puis en 1963, ces mêmes auteurs ont intégré au raisonnement la fiscalité des entreprises. Ils concluaient qu'il fallait s'endetter au maximum puisque la rémunération de la dette (les intérêts) est fiscalement déductible des profits imposables des entreprises à la différence de la rémunération des capitaux propres (les dividendes). Mais M. Miller en apportant une dernière amélioration en 1977, la prise en compte de la fiscalité des investisseurs (qui a plutôt tendance à être plus lourde sur les revenus de la dette que sur les revenus des capitaux propres), a clos le sujet optimisation du coût du capital en revenant aux conclusions de 1958 : il n'y a pas de structure optimum qui minimise le coût du capital, même après prise en compte de la fiscalité. Dès lors, M. Miller incitait implicitement des recherches dans d'autres directions.
Elles ne furent pas longues à venir, d'abord sur le terrain de l'asymétrie de l'information qui remet en cause le postulat de la théorie classique d'une information partagée également par tous et circulant sans coût. Dans la mesure où les dirigeants ont naturellement plus d'informations sur la bonne (ou mauvaise !) marche de l'entreprise que les investisseurs, le choix d'un financement est analysé comme un signal envoyé par les dirigeants aux investisseurs. Ainsi une société qui s'endette pour financer un investissement signale de façon crédible au marché la confiance qu'elle a dans la rentabilité future de l'investissement et dans sa capacité de remboursement. A l'inverse, une augmentation de capital est plutôt perçue comme le signal d'une surévaluation de l'action puisque les dirigeants nommés par les actionnaires n'iraient pas émettre des actions à un cours qu'ils estiment sous-évalué. S'ils le font, c'est donc qu'ils pensent l'action surévaluée. Ceci explique que l'annonce d'une augmentation de capital entraîne une baisse moyenne du cours de l'action de 3%. Mais si cette théorie expliquait les choix des structures financières, les entreprises devraient alors systématiquement se financer par obligations convertibles (*2), ce qui n'est pas le cas (*3) !
Une autre théorie fut proposée présentant le choix d'un financement comme un mode de résolution des conflits latents entre des actionnaires confiant des fonds à des managers qui doivent les gérer au mieux des intérêts des actionnaires et les dirigeants qui, une fois en place, peuvent alors avoir des objectifs personnels différents…
La dette, avec son obligation contractuelle de rémunération et de remboursement, serait là pour contraindre les dirigeants à ne pas ménager leurs efforts pour la plus grande satisfaction des actionnaires, la dette jouant alors le rôle tenu par le fouet dans les fermes et les mines de l'Antiquité ! Si cette théorie dite de l'agence (ou des mandats) expliquait totalement les choix de structure de financement, l'action d'une société qui émet de la dette devait s'élever à cette annonce. Or cet effet n'a jamais été observé.
Ce que proposent nos deux chercheurs est très pragmatique et a peu à voir avec l'optimisation micro-économique ou la psychologie humaine. En fait, ils montrent simplement que la structure financière d'aujourd'hui d'une entreprise résulte, non d'un choix conscient d'un ratio cible, mais de l'accumulation de décisions prises dans le passé en fonction du contexte boursier du moment: émission d'actions quand les valorisations sont élevées et que le contexte boursier est bon, émission de dettes et rachat d'actions quand les cours sont bas et la bourse déprimée.
Si les dirigeants avaient en tête un ratio dettes / capitaux propres, l'entreprise qui procéde à une augmentation de capital devrait dans la foulée s'endetter pour faire de nouveau converger sa structure financière vers ce ratio cible. Or ce n'est pas ce qui est observé. En revanche, de 1968 à 1998, M. Becker et J. Wurgler montrent que les entreprises peu endettées ont été celles qui ont procédé à des augmentations de capital quand leur valorisation relative (mesurée par le rapport valeur des capitaux propres / montant comptable des capitaux propres) était généreuse et vice versa. De la même façon, ils montrent que 70% de la structure financière actuelle est expliquée par des décisions prises il y a plus de 10 ans et donc par les niveaux de valorisations relatives de l'époque. M. Becker et J. Wurgler en font le principal déterminant de la structure financière actuelle compte tenu de l'attitude très pragmatique et opportuniste des directeurs financiers qui ne fait d'ailleurs que correspondre à l'appétence des investisseurs : émettre des actions quand les cours sont hauts, s'endetter et racheter des actions quand les cours sont bas (*4).
2 L'obligation convertible n'enverrait pas de signal puisque si l'action était surévaluée, l'obligation convertible ne serait jamais convertie en action mais remboursée en cash par l'entreprise, ce qui est le plus inconfortable pour les dirigeants.
3 Voir la Lettre Vernimmen.net n°10 à venir (mai 2002).
4 Pour tous ces sujets de structure financière, voir pour plus de détails les chapitres 33, 34 et 44 du Vernimmen 2000.
Q&R : Quel sont les intérêts et les inconvénients pour un groupe de filialiser ses divisions ? Cela peut-il être considéré comme une protection anti-OPA ?
Ensuite le capital de ces nouvelles filiales peut être ouvert à des tiers. C'est donc un moyen de financement que l'entrée des tiers ait lieu par augmentation de capital (financement de la filiale) ou par cession d'actions (financement de la mère). C'est aussi une façon de pouvoir nouer des alliances capitalistes (prise de participation, fusion) avec un groupe qui peut n'être intéressé que par les activités de la nouvelle filiale et pas par celle de la mère.
La filialisation en tant que telle n'est pas un moyen anti OPA, mais l'ouverture du capital de la nouvelle filiale peut en être un si la filiale est importante relativement au groupe et si le tiers a négocié le droit de racheter la participation (majoritaire) de la mère dans la filiale en cas de changement du contrôle de la mère. Ce type de dispositif doit être mis en place à l'avance et non pas la veille du lancement de l'OPA ! !
En termes d'inconvénients, citons :
- la lourdeur pour remonter les bénéfices sous forme de dividendes (même si les problèmes de délai et de pression fiscale peuvent en pratique être contournées),
- l'obligation de déposer les comptes au greffe du tribunal,
- de manière générale la lourdeur administrative liée à l'existence d'une structure juridique (comité d'entreprise, conseils d'administration ...) que la forme juridique de société anonyme simplifiée (SAS) réduit beaucoup.






