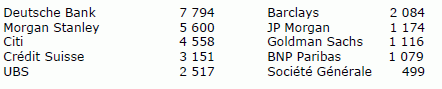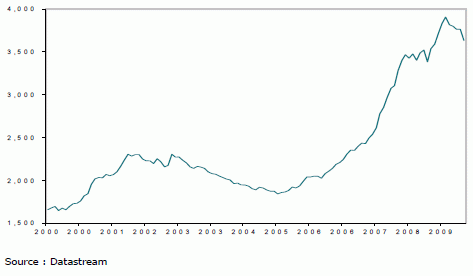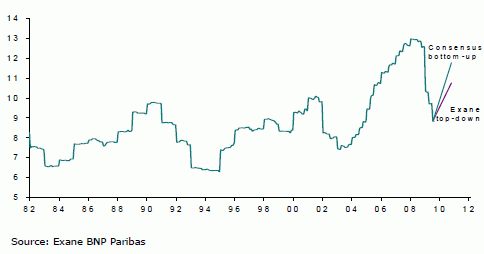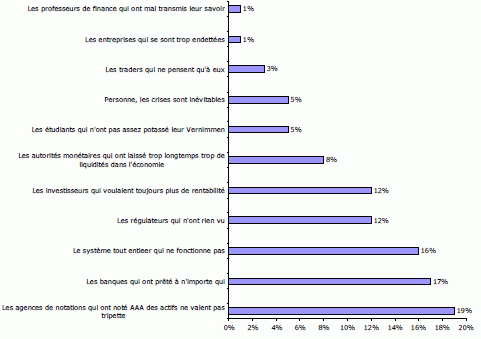La Lettre n°80 de Octobre 2009
Actualités : S'enrichir de sa propre décrépitude ?
Un aspect pour le moins curieux de l’application du principe de juste valeur (fair value) au bilan des banques est leur capacité, en normes IFRS ou en normes américaines, à enregistrer dans leurs comptes de résultat des profits correspondant à la baisse de la valeur de marché de certaines de leurs dettes.
Ainsi, une banque, qui aurait émis une dette de 100 à 6 % qui ne serait plus cotée que 80 du fait d’une hausse du taux de rentabilité exigé par les obligataires pour la détenir compte tenu de la dégradation perçue de sa solvabilité, pourrait enregistrer dans son compte de résultat un profit, non imposable, de 20.
On imagine assez bien que si Lehman Brothers avait pu publier les comptes de son troisième trimestre 2008, ce profit aurait pu être plus important que la perte de dépréciation de ses actifs ! En somme, le failli aurait été profitable et le patient mort guéri !
Sans aller jusque là, Deutsche Bank a pu, en 2008, gonfler ainsi son résultat de 7,8 Md$ qui, sans, cela aurait été négatif non de 3,9 Md€ mais négatif de 9 Md€.
A titre d’illustration, voici les gains sur dépréciation de leurs dettes ainsi enregistrés par les principales banques mondiales en 2008 (en M$) :
L’amélioration de leurs perspectives depuis le printemps 2009 conduit au phénomène inverse. Comme les dettes se revalorisent en se rapprochant de leur nominal, les banques doivent prendre en compte dans leurs comptes de résultat cette appréciation, cette fois-ci en perte. Ceci a pour effet de réduire les résultats dégagés actuellement et dans le futur de la même façon que ce mécanisme les dopait précédemment.
La plupart des banques ont adopté ce traitement optionnel ainsi que quelques sociétés industrielles qui voulaient ainsi se simplifier la comptabilisation des dérivés incorporés dans des titres de dette.
Hors ce cas de figure limité, l’explication est que des actifs bancaires sont adossés à ces dettes qui les financent et que comme ces actifs valent moins chers il est « normal » que les moins values latentes sur ces actifs qui passent au compte de résultat soient compensées par les moins values latentes sur ces dettes qui les financent.
Pour notre part, comme notre lecteur l’aura pressenti au ton sarcastiquement incrédule du titre de cet article, nous pensons qu’il s’agit d’une tartufferie. Que l’actif ait baissé de valeur et que l’on constate donc une moins-value latente en résultat rien de plus normal. Mais de là à en déduire que la banque peut s’enrichir de la moins-value sur ses dettes qui ne fait que traduire une probabilité de faillite plus forte alors qu’elle doit toujours cet argent à ses prêteurs …
Est-ce que cela sert le principe de la bonne information ? Nous en doutons. Certes tout ceci est expliqué en annexe, c’est d’ailleurs là où nous avons trouvé les données du tableau plus haut. Mais quand on sait que le rapport annuel d’une banque ne fait en général pas moins de 300 pages …
Au demeurant cette application du principe de la juste valeur aux dettes nous parait aller contre le principe de la continuité d’exploitation. En effet, si la banque est capable d’enregistrer un gain quand sa dette se dévalorise, c’est bien parce qu’il y a des doutes plus ou moins pressants sur sa solvabilité et donc sa continuité d’exploitation.
La SEC, en décembre 2008, a préconisé l’abandon de cette option et l’IASB a publié en juin dernier un discussion paper qui montre qu’elle réfléchit au sujet.
En revanche l’analyse est bien différente quand l’entreprise ou la banque, pour gérer leur passif, décide de racheter de la dette décotée par rapport au pair, rachat financé par une émission d’une nouvelle dette. Elle enregistre alors un gain comptable, sans caractère de récurrence, qui correspond à une transaction réelle qui gonflera d’autant ses capitaux propres. Si la dette rachetée et émise est perpétuelle, l’opération est neutre au niveau des intérêts à payer. Certes le taux facial est plus élevé sur la nouvelle dette mais il s’applique à un nominal réduit, du fait de la décote de rachat de la dette.
Cela est faux si la dette a une échéance donnée, ce qui explique que les entreprises y recourent moins, sauf pour des dettes très longues.
Ainsi en août 2009, Natixis a émis pour 794 M€ d’une dette perpétuelle nouvelle qui a servi à racheter pour 794 M€ une dette dont le nominal était de 1 187 M€ lui permettant de faire un gain de 353 M€ et de de renfoncer ses capitaux propres de 393 M€.
Tableau : Liquidités et marges en période de crise
Le premier graphique montre l’ampleur des fonds réfugiés dans des placements monétaires à court terme aux Etats-Unis (en Md$) qui ne rapporte aujourd’hui que de 0,2% annuel ce qui est mieux qu’il y a 10 mois où ce rendement fut pour quelques jours … négatif.
Le second graphique montre que la baisse des marges d’exploitation des principales sociétés cotées en Europe est certes impressionnante de 13% à 9% mais que le point bas atteint reste supérieur à celui des crises économiques récentes. On retrouve ainsi l’une des lois du point mort qui veut que plus on est éloigné de son point mort, moins on est sensible à une variation de l’activité économique (1). Quant au rebond prévu par les analystes, c’est une autre histoire !
(1) Pour plus de détails sur les lois du point mort, voir le chapitre 11 du Vernimmen 2010.
Recherche : Pourquoi les LBO se financent-ils par endettement ?
Deux méthodes sont possibles pour imposer une explication académique des phénomènes économiques et financiers. La première consiste à élaborer d’abord un modèle théorique portant sur les phénomènes à expliquer, et à effectuer ensuite une série d’études empiriques pour confirmer ou infirmer l’ensemble des prédictions du modèle. L’article que nous présentons cette semaine (1) appartient à une seconde catégorie : il propose un modèle théorique expliquant des faits déjà établis empiriquement.
L’article porte sur le phénomène des LBOs (leveraged buyouts) (2). Il s’intéresse particulièrement à l’utilisation massive d’endettement dans ces opérations (à l’origine de l’effet de levier ou leverage) et propose une explication liée au mode de financement des fonds d’investissement.
Le phénomène empiriquement avéré est la ressemblance dans le mode de financement de ces fonds partout dans le monde. Ils émettent des titres de propriété (des capitaux propres) au moment de leur création, et complètent leur besoin de financement par de la dette au moment des acquisitions (qui deviennent des LBOs). Pour expliquer cela, l’article montre que deux modes de financement sont possibles : ex ante (à la création du fonds) et ex post (opération par opération), que l’optimum est une combinaison des deux et que la dette s’impose alors pour la partie ex post du financement.
L’intuition du modèle est la suivante. Le financement ex post doit se faire par la dette (gagée sur l’entreprise acquise) pour laisser aux associés-gestionnaires du fonds le bénéfice résiduel des opérations et les inciter ainsi à une gestion active. Le problème posé par ce mode de financement est que le comportement des fonds devient pro-cyclique : lorsque l’économie va bien, il y a surinvestissement (les associés lancent trop d’opérations parce qu’une partie du risque est transférée aux créanciers), et lorsqu’elle va mal, sous-investissement (parce qu’on ne parvient pas à lever des fonds, même pour les opérations rentables).
Le financement ex ante par les capitaux propres permet de résoudre en partie ces problèmes : les associés sont incités à prendre les bonnes décisions et ne manquent pas de capitaux propres en cas de mauvaise conjoncture. Pour se signaler comme bons gestionnaires, puisque tout le financement est effectué à la création du fonds, les associés doivent alors accepter de n’être rémunérés qu’à partir d’un certain niveau de performance. Le problème devient celui de la trop grande liberté accordée aux associés : si peu d’opérations profitables se présentent au cours de la vie du fonds, ils investiront au bout d’un certain temps dans des projets trop risqués, pour tenter d’obtenir la performance requise.
Le mode de financement optimal dans ce modèle est finalement une combinaison de financement ex ante par le capital et ex post par la dette, ce qui est conforme aux observations. Par ailleurs, les autres prédictions du modèle sont fidèles aux études empiriques : en particulier, le fait que les LBOs réalisés par les fonds d’investissement soient pro-cycliques (3), ainsi que la non-linéarité de la rémunération des associés (4), ont été montré
empiriquement par Gompers et Lerner.
La qualité de cet article vient de sa capacité à rendre compte de phénomènes complexes à partir d’un modèle simple dans sa structure.
(1) U.AXELSON, P.STROMBERG et M.S.WEISBACH, Why are buyouts levered ? The financial structure of private equity funds, Journal of Finance, vol 64, n°4, p.1549-1582.
(2) Pour plus de détails sur les LBO, voir le chapitre 49 du Vernimmen 2010.
(3) P.GOMPERS et J.LERNER (1999), The Venture Capital Cycle , MIT Press, Cambridge.
(4) P.GOMPERS et J.LERNER (1999), An analysis of compensation in the U.S. venture capital partnership, Journal of Financial Economics, n°51, pages 3 à 44.
Q&R : Qu'est-ce qu'un profit ou une perte de dilution ?
Si une maison mère ne suit pas ou suit partiellement une augmentation de capital de sa filiale réalisée à un prix qui valorise celle-ci pour un montant supérieur à ses capitaux propres comptables, un profit non récurrent appelé profit de dilution sera enregistré. De la même façon, si la filiale est valorisée à cette occasion pour un montant inférieur à ses capitaux propres comptables, une perte non récurrente, appelée perte de dilution, sera enregistrée.
Soit ainsi une maison mère qui a acheté 200 une participation de 50 % dans une filiale disposant de 100 de capitaux propres. Une augmentation de capital de 80 intervient sur la base d’une valeur totale de la filiale de 400 ; la société mère ne la suivant pas, sa part est diluée de 50 % à 41,7 %. La quote-part des capitaux propres de la filiale qui revient à la maison mère passe ainsi de : 50 % × 100 = 50 à 41,7 % × (100 + 80) = 75, d’où un profit non récurrent de 75 – 50 = 25. Ce profit de 25 correspond exactement à celui qui aurait été réalisé par un actionnaire qui aurait cédé 50 % – 41,7 % = 8,3 % sur la base d’une valeur de 400, et avec un prix de revient de 100 pour 100 %. En effet, 25 = 8,3 % × (400 – 100).
Du point de vue du financier, les profits ou les pertes de dilution correspondent à une extériorisation de résultat alors qu’il n’y a eu aucun flux de trésorerie au profit de la maison mère. Ils sont de nature nécessairement non récurrente, sinon le groupe n’aura bientôt plus de filiales ! Ils ne font, bien sûr, pas partie de la capacité bénéficiaire normale de l’entreprise. L’analyste doit donc raisonner hors profit ou perte de dilution.
C’est ainsi que Wendel a publié une perte de dilution de 742 M€ au premier semestre 2009 due à une souscription partielle à l’augmentation de capital de Saint-Gobain faite à un prix (14€) inférieur aux capitaux propres par action (37€).
Autre : Résultats du sondage : Qui a le plus de reproches à se faire pour sa responsabilité dans la crise financière ?
Vous avez été près de 3 000 à répondre à cette question avec une très grande dipersion des réponses et la gentillesse de nous disculper puisque l’item « les professeurs de finances qui ont mal transmis leur savoir « n’a recueilli que 19 voix !
Le nouveau sondage est consacré à la forme de la reprise économique.
Voyez vous le redémarrage économique :
o en W, avec une rechute rapide
o en V, avec un rebond fort et rapide
o en U, avec un rebond fort mais différé
o en brouette, avec un redémarrage lent
Vous pouvez votez en cliquant ici.