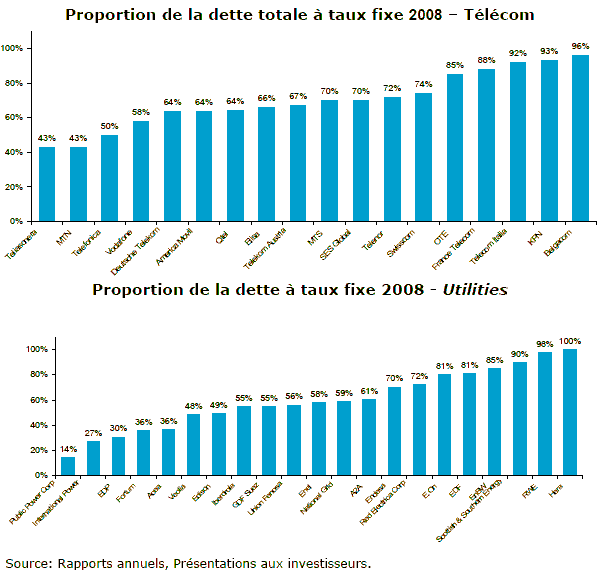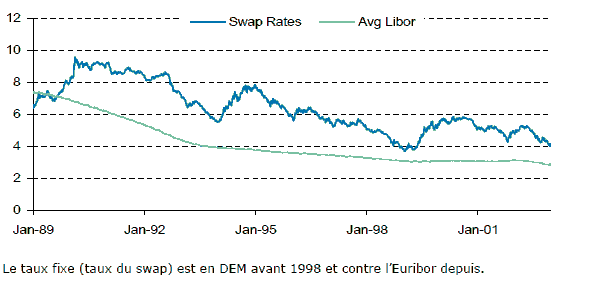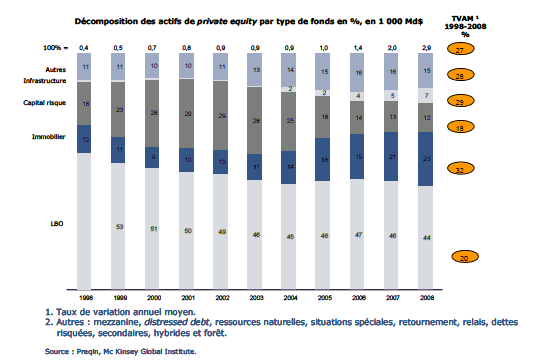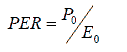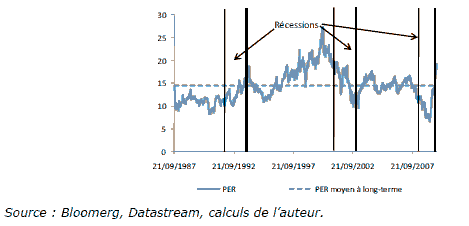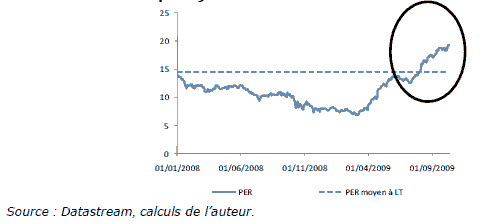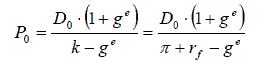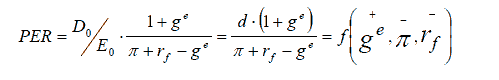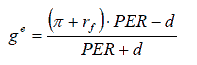La Lettre n°82 de Décembre 2009
Actualités : S'endetter à un taux fixe ou à un taux variable
Il y a tout un monde entre la gestion du risque de change de l’entreprise et celle du risque de taux d’intérêt. La première fait le plus souvent l’objet d’une politique très encadrée, écrite et systématique de couverture pour protéger les marges et éviter de constater des pertes ou des gains comptables. A l’inverse, dans le domaine de la gestion des taux d’intérêt, l'empirisme règne, et la situation à un moment donné dépend beaucoup de l'accumulation au cours du temps de décisions ponctuelles. Le sujet est faussement simple et même diablement compliqué. Essayons donc de clarifier les idées !
D'abord, il convient de rappeler qu’un emprunt à taux voit sa valeur fluctuer dans le sens inverse des taux d’intérêt, conséquence logique (1) du caractère fixe de sa rémunération annuelle. A l’inverse, la valeur d’un emprunt à taux variable est largement insensible aux variations des taux d’intérêt puisque l’ajustement aux conditions de marché se fait au niveau de son coupon qui est fonction du taux du marché du moment.
Par ailleurs, grâce aux techniques et produits disponibles pour la gestion des risques de taux d'intérêt (2) , ce qui compte est moins la nature fixe ou variable du taux d'intérêt mentionné dans les contrats de prêts que la position résultante à la fois de des conditions de taux d'intérêt à l’origine et des instruments dérivés éventuellement achetés par l'entreprise pour modifier sa position initiale. Ainsi, une entreprise endettée à taux fixe pourra passer à une exposition à taux variable grâce à des swaps par exemple, sans avoir besoin de rembourser son emprunt à taux fixe pour en contracter un à taux variable.
Deviner les variations de taux d’intérêt ?
Pour savoir s'il faut s'endetter à taux fixe ou à taux variable, beaucoup se fondent sur leurs anticipations de l’évolution des taux d'intérêt. S'ils pensent que les taux d'intérêt vont monter, ils s'endettent à taux fixe ; s'ils pensent que les taux d'intérêt vont baisser ils s'endettent à taux variable, afin de profiter de la baisse des taux qu'ils anticipent. Et quand les taux auront baissé, si leurs anticipations se réalisent, ils basculeront à taux fixe, espérant se couvrir contre une inévitable remontée des taux d'intérêt.
Qu'on le veuille ou non, et au risque de choquer certains de nos lecteurs, ceci s'appelle de la spéculation (3). En effet, on n'obtiendra le résultat voulu – être protégé contre une hausse des taux ou bénéficier de leur baisse – que si les anticipations se concrétisent. A défaut, l'entreprise perd : celle qui s'est endettée à taux fixe en estimant que l'Euribor ne pouvait pas tomber plus bas que 2 % supporte une perte d'opportunité quand celui-ci tombe à 0,75 %. De même, celle qui s'est endettée à taux variable pour profiter d'une baisse supplémentaire des taux d'intérêt et qui les voit remonter subit une perte.
Un marché existe parce qu'il y a des intervenants qui ont des vues et/ou des contraintes différentes. Aussi Stanley Myint et Adi Shafir ont-t-ils établi les graphes suivants qui montrent bien des attitudes très différentes dans deux industries avec de copieux montants de dettes : les télécoms et les utilities :
Les différences de politique sont aussi très fortes à l'intérieur d'un même secteur (Telia Sonera contre France Télécom, EDF contre EDP).
Se couvrir contre les variations des taux d’intérêt ?
D'autres, plus humbles quant à leurs capacités de deviner l'évolution future des taux d'intérêt, adoptent la règle suivante :
• s'endetter à taux fixe pour être sûr du coût de la ressource,
• placer à taux variable pour être sûr de ne pas réaliser de moins-values sur les excédents (temporaires) de trésorerie.
Sans le vouloir et sans le savoir ils spéculent eux aussi : la combinaison des ces deux positions perçues comme sans risque aboutit à une position fortement exposée à la hausse des taux. En effet, si les taux d'intérêt baissent cette position expose à des pertes d'opportunités sur les dettes (je suis endetté à 10 % par exemple alors que je ne payerais que du 6 % si je m’étais endetté à taux variable) et sur les placements (mon placement me rapporte du 6 % alors qu'il pourrait me rapporter du 10 % s'il avait été fait à taux fixe). Si les taux montent, étant endetté à taux fixe je gagne par rapport à l'être à taux variable. Je gagne aussi sur les placements puisque je ne supporte pas la perte, ayant placé à taux variable, que j'aurais subie si j'avais placé à taux fixe.
Notre lecteur trouvera peut être que nous forçons la dose en mettant sur un même pied pertes comptables et pertes d’opportunité. Les unes sont enregistrées dans le compte de résultat et « font mal », les autres ne se constatent qu’en annexe au mieux si la dette y est évaluée en valeur de marché. Si la comptabilité ne les met pas sur un pied d’égalité, par contre en finance, il n’y pas de doute, elles sont de même nature. Le trésorier le sait bien, lui qui s’acharne à ne laisser non placées que des sommes minimales et incompressibles, même si l’incurie qui consisterait à les laisser non placées pendant quelques jours ne se traduirait par aucune conséquence négative dans son compte de résultat.
Comme on le verra plus loin, s’endetter à taux fixe permet de connaître le coût comptable de sa dette sur la période, mais n’élimine pas le risque sur la valeur des capitaux propres. S’endetter à taux variable rend incertain le coût de l’endettement dans le compte de résultat mais élimine le risque sur la valeur des capitaux propres.
Bornons nous, à ce stade, à constater que la comptabilité joue un rôle important et peut arriver à modifier des décisions de gestion alors qu’elle ne devrait, en tout logique, que traduire une réalité économique sans l’influencer.
Raisonner en termes de coûts ?
On pourrait alors comparer en termes de coût, le coût de l'endettement à taux fixe et à taux variable. Ainsi aujourd'hui l'Euribor 3 mois est de 0,68 % alors que le taux swap 5 ans (pour payer un taux fixe) sur la même durée est de 2,71 %. Ceci parce que la courbe de taux est actuellement dans sa forme pentue la plus fréquente (4). Cette comparaison est toutefois insuffisante car effectuée uniquement à l'instant t ; or le taux variable par définition va varier ; sur toute la durée du crédit. Stanley Myint et Adi Shafir ont eu la bonne idée d'aller comparer d'un côté le taux fixe à chaque instant de janvier 1989 à janvier 2002 et la moyenne des taux variables sur les 7 ans après chaque instant (ce qui explique que leur travail s'arrête à 2002).
Ils montrent (5) que, sur cette période, dans 96 % des cas l'endettement à taux variable a été moins coûteux que l'endettement à taux fixe. Peut-on pour autant en déduire une loi générale que l’on pourrait appliquer dans le futur ? Peut être si l’on pense que la BCE, qui a pour mandat de garantir la stabilité des prix, ne baissera pas la garde et que l’on restera à l’avenir dans une période de faible inflation comme depuis le début des années 1990.
Par ailleurs, Stanley Myint et Adi Shafir montrent, sur la période 1989-2002, qu'il n'y a aucune corrélation entre l'écart à l'instant t entre le taux fixe 7 ans et le taux variable spot et l'écart obtenu sur la période du prêt entre le taux fixe obtenu à l'instant t et le taux variable obtenu sur la durée du prêt (7 ans). Autrement dit, la pente de la courbe des taux à l'instant t n'a donné, sur les 20 dernières années, aucune indication pour choisir entre être endetté à taux fixe ou à taux variable.
Raisonner en valeur
Mais plus fondamentalement, le raisonnement en termes de coût ne mène nulle part car il ignore le risque pris. Comme nous l'écrivons dès le premier chapitre du Vernimmen, seul un raisonnement en termes de valeur, synthèse entre des taux de rentabilité / taux d'intérêt et le risque, a une pertinence en finance. A défaut, on court le risque de la myopie !
Partons du principe que les taux d'intérêt montent lorsque la conjoncture économique est bonne parce que les autorités monétaires veulent lutter contre une résurgence potentielle de l'inflation ou qu'elles retirent des liquidités du système économique qu'elles avaient introduites dans une phase précédente. A l'inverse les taux d’intérêt baissent lorsque les autorités monétaires veulent stimuler l'activité économique qui montre des risques d'anémie.
Etre endetté à taux fixe signifie que, lorsque la conjoncture économique est médiocre pour ne pas dire mauvaise, la dette se revalorisera du fait de la baisse des taux, alors que la valeur de l'actif économique a de bonnes chances de s'affaisser du fait de l'anémie générale, en particulier pour des entreprises dans des secteurs cycliques : Sidérurgie, Chimie, Transportation, Finance, etc. Dès lors la valeur des capitaux propres, différence entre la valeur de l'actif économique et la valeur de l'endettement bancaire et financier net sera doublement affectée et donc sera très volatile. Si l’endettement avait été à taux variable, la valeur de la dette aurait été constante. Dès lors, l’impact des variations de la valeur de l’actif économique sur la valeur des capitaux propres auraient été moindre.
A l'inverse, en cas de bonne conjoncture économique et de montée des taux d'intérêt, la valeur de l'actif économique, en particulier des entreprises cycliques, a de bonnes chances de progresser (l'effet amélioration des flux compensant l'effet hausse des taux d'actualisation), la valeur de la dette à taux fixe baissera. Au total, la valeur des capitaux propres progressera plus que si l’entreprise s’était endettée à taux variable.
L'endettement à taux fixe a donc, par rapport à l'endettement à taux variable, pour effet d'accroître la volatilité des capitaux propres des entreprises, en particulier de celles qui sont cycliques. Ces dernières ont pu avoir le beurre et l’argent du beurre : s’endetter à taux variable réduit la volatilité de la valeur des capitaux propres et en même temps coûte moins cher ; en tous cas, a coûté moins cher historiquement. Par contre, les secteurs non cycliques (nous ne connaissons pas vraiment des secteurs contra cycliques à part des sociétés de restructuration des entreprises en faillite !) ont le choix parfois difficile entre l’appétit pour le risque (s’endetter à taux variable) et s’endetter à taux fixe qui historiquement a coûté plus cher. Ceci n'est pas rédhibitoire en soi mais n'est pas nécessairement ce que l'on pense spontanément, car trop souvent on ne s'interroge pas dans quel contexte économique peut survenir une hausse des taux. Il y a de très bonnes chances que cela se produise dans un contexte économique où les résultats sont à la hausse. La hausse des taux d'intérêt en est alors amortie.
Le cas d'une hausse des taux d'intérêt et d'une dégradation concomitante de la conjoncture économique est suffisamment rare (début des années 1980 pour tuer l'inflation, 1992 au moment de la crise de la livre sterling) et bref pour qu'il ne puisse pas être considéré comme un cas général.
Mais peut être notre lecteur voudra-t-il trouver un rôle dans ce domaine et fera-t-il comme Vodafone qui explique, dans son rapport annuel 2008, qu'il s'endette toujours à taux variable sauf quand le risque de fluctuation des taux d'intérêt est élevé ou quand les taux d'intérêt sont bas. Chasser le naturel …
Merci à Franck Bancel, Bruno Labrosse, Jean-Jacques Guiony, François Meunier et naturellement Stanley Myint qui nous ont permis d’enrichir cet article de leurs remarques.
(1) Pour plus de détails, voir le chapitre 26 du Vernimmen 2010.
(2) Voir le chapitre 52 du Vernimmen 2010.
(3) Voir le chapitre 17 du Vernimmen 2010
(4) Pour plus de détails voir le chapitre 25 du Vernimmen 2010.
(5) A paraître dans BNP Paribas Corporate Solutions Handbook 2010.
Recherche : Protection des prêteurs et caractéristiques des crédits
Les relations entre le droit et la finance ont donné lieu à une littérature abondante depuis une dizaine d’années. En 2000, La Porta et al. (1) ont montré que les actionnaires minoritaires obtenaient des dividendes plus élevés dans les pays où leurs droits étaient le mieux garantis. Dans le même esprit, deux articles récents s’intéressent aux conséquences des droits des créanciers sur les dividendes (2) et les caractéristiques des prêts bancaires (3).
Le premier article montre par une étude empirique que les dividendes versés aux actionnaires sont plus élevés dans les pays où les droits des créanciers sont le mieux garantis. Lorsque ces droits sont faibles, deux effets sur les dividendes s’opposent :
• un « effet revenu » selon lequel les dividendes versés seront plus élevés parce que le pouvoir de négociation et d’influence des créanciers est faible ;
• un « effet substitution » selon lequel les dividendes seront faibles pour garantir aux créanciers un certain niveau de sécurité en se substituant à l’environnement légal.
L’étude montre qu’en matière de droits des créanciers, c’est l’effet de substitution qui l’emporte (alors que La Porta et al., pour les droits des actionnaires, concluent en faveur de l’effet revenu). Ainsi, dans des pays comme le Royaume-Uni ou l’Australie, où les droits des créanciers sont élevés (4), les dividendes sont 2,8 fois plus élevés qu’aux Etats-Unis ou au Canada où ces droits sont faibles (pour des entreprises comparables).
Pour mesurer les droits des créanciers, les auteurs ont construit un indice de zéro à 4, qui tient compte du pouvoir des créanciers en cas de rééchelonnement de la dette, de leur capacité à changer la direction en cas de faillite, et de la priorité accordée aux créances sécurisées en cas de liquidation. Lorsque l’indice passe de 4 (haute protection) à zéro (basse protection), la probabilité qu’une entreprise verse des dividendes est réduite de 41%, et le montant des dividendes versés est réduit de 60%.
Une explication possible serait qu’une faible protection des créanciers s’accompagne d’un faible développement des marchés financiers. Dans ces pays, les entreprises verseraient peu de dividendes pour pouvoir s’autofinancer. Les auteurs rejettent cette hypothèse, en montrant qu’une hausse des dividendes dans ces pays ne se traduit pas par une baisse excessive de la valorisation de l’entreprise, qui devrait résulter d’une intention de financement externe. Ils privilégient la théorie de l’agence : puisque les créanciers ont peu de pouvoir en cas de défaut, ils n’acceptent de prêter qu’aux entreprises qui s’engagent à verser peu de dividendes, ce qui minimise leur risque de défaut.
Le second article s’intéresse aux différences entre les caractéristiques des prêts selon l’environnement juridique. Il distingue pour cela les droits des créanciers au sens strict (mesurés selon des critères comparables à l’article précédent) et la garantie d’exécution des contrats. Cette garantie tient compte du niveau de corruption, du risque d’expropriation et du risque de répudiation des contrats.
Les auteurs montrent que cette garantie d’exécution influe plus encore que les droits des créanciers dans le résultat de la négociation des prêts. En passant du plus faible niveau de protection (indice zéro) au plus élevé (indice 10), le montant des prêts augmente de 63%, la maturité augmente de 2,5 ans et le spread diminue de 67 points de base. En revanche, lorsqu’on tient compte de la garantie d’exécution des contrats, la prise en compte des droits des créanciers a peu de conséquences sur les prêts (de meilleurs droits réduisent un peu plus le spread).
Dans ce même article, les auteurs proposent un développement intéressant sur la crise asiatique de 1997. Ils montrent que le système juridique joue un rôle encore plus important en cas de crise financière. Puisque les rendements des investissements chutent, les actionnaires majoritaires ont davantage tendance à exproprier les créanciers. En retour, ces derniers exigent et obtiennent des maturités plus courtes et des spreads plus importants.
Après les droits des actionnaires, dont les conséquences sur le financement des entreprises ont été beaucoup étudiées, les chercheurs s’intéressent aux droits des créanciers. Ces deux articles offrent une contribution importante à cette littérature.
(1) R.LA PORTA, F.LOPEZ DE SILANES,A.SHLEIFER et R.VISHNY (2000), Agency problems and dividend policies around the world, Journal of Finance, vol.55, p.1-33.
(2) P.BROCKMAN et E.UNLU (2009), Dividend policy, creditor rights and the agency costs of debt, Journal of Financial Economics, vol.92, p.276-299.
(3) K.H.BAE et V.K.GOYAL (2009), Creditor rights, enforcement and bank loans, Journal of Finance, vol.64, p.823-860.
(4) Voir le chapitre 50 du Vernimmen 2010.
Q&R : Le besoin en fonds de roulement peut-il être négatif ?
Oui ! Les sociétés à besoin en fonds de roulement négatif sont caractérisées par la perception du produit de leurs ventes avant d’avoir réglé la totalité de leurs charges de production (notamment leurs fournisseurs de matières premières ou marchandises). Il existe deux cas de figure :
▪ le crédit fournisseurs est très supérieur au rythme de rotation des stocks, alors que, corrélativement, le paiement des clients est très rapide, parfois comptant : grande distribution, sociétés de commerce en ligne, de restauration collective, d’autoroutes ou sociétés avec des cycles de production très courts (yaourts, presse quotidienne…), sociétés dont les fournisseurs sont dans une situation de faiblesse telle (forte concurrence comme dans l’imprimerie…) que les délais qu’ils sont contraints d’accorder sont excessifs ;
▪ les clients paient par anticipation ; tel est le cas des sociétés traitant des marchés militaires, ou relevant des travaux publics, de l’aéronautique, des ventes par abonnement, etc. Toutefois, de telles entreprises sont parfois soumises à la nécessité de bloquer leurs excédents de trésorerie tant que le service n’a pas été « consommé par le client ». Le besoin en fonds de roulement négatif se présente, dans ce cas, comme un moyen de dégager des produits financiers importants (placements bancaires) et non pas comme un moyen de financement librement utilisable par l’entreprise.
Un besoin en fonds de roulement très faible ou négatif constitue un facteur stratégique très favorable au développement d’une politique de croissance financée sans recours à des capitaux extérieurs. Les entreprises performantes, notamment dans la grande distribution, ont toutes bénéficié de besoins en fonds de roulement faibles, voire négatifs. En effet, un nombre restreint d’entreprises a su détourner les ressources du crédit interentreprises à leur profit.
La présence d’un besoin en fonds de roulement négatif peut néanmoins conduire à des erreurs de gestion. Ainsi, tel groupe industriel répugnait à céder une division déficitaire qui dégageait un besoin en fonds de roulement négatif. Cette cession, qui aurait reconstitué la rentabilité du groupe, le confrontait en effet à de graves problèmes de trésorerie. En effet, le besoin en fonds de roulement négatif de la division non rentable finançait les besoins en fonds de roulement positifs des autres divisions. Un raisonnement à court terme conduisait donc à n’envisager que la seule gravité des problèmes de trésorerie consécutifs à la cession.
Nous avons vu également des sociétés à besoin en fonds de roulement négatif dont l’activité était structurellement en perte mais qui perdurait grâce à une forte croissance. En effet, les flux de trésorerie apportés par la variation du besoin en fonds de roulement permettaient de payer les dépenses courantes. Le réveil est alors difficile, en effet, lorsque la croissance s’estompe, les difficultés de paiement apparaissent et bien naturellement aucun banquier ne veut prêter.
Pour plus de détails, voir le chapitre 12 du Vernimmen 2010.
*********** Nouveau sur le site
***********
Nous avons ajouté 26 questions aux quiz qui en proposent dorénavant 306 en tout, de quoi bien peaufiner votre maîtrise de la finance. Pour les découvrire, cliquez ici.
Autre : NOS LECTEURS ECRIVENT : Les cours boursiers sont-ils aujourd'hui trops hauts ?
par William Arrata – Economiste de Marché
La remontée récente et rapide des cours boursiers des principales places boursières mondiales (entre août et octobre 2009, le CAC 40 a gagné 1000 points) appelle la question de savoir si les prix des actions ne sont pas aujourd’hui trop hauts. Pour répondre à cette question, on va utiliser un indicateur bien connu des analystes financiers : le PER.
1. Le PER : une approche empirique
Le PER (Price-Earnings Ratio) se définit comme le prix au comptant de l’action,  , rapporté au résultat net par action de l’année
, rapporté au résultat net par action de l’année  (généralement celui de l’année écoulée), soit
(généralement celui de l’année écoulée), soit
 , rapporté au résultat net par action de l’année
, rapporté au résultat net par action de l’année  (généralement celui de l’année écoulée), soit
(généralement celui de l’année écoulée), soit
En première approche, on compare le prix d’une action avec les résultats de l’entreprise associée, et on ne se soucie pas de la valeur intrinsèque théorique de l’action. C’est une approche de la valorisation en « multiples ». En divisant le prix d’une action par ses résultats, on obtient un indicateur sans dimension, beaucoup moins volatile que le prix de l’action.
On compare généralement le PER (instantané) à sa moyenne de long-terme :
• l’idée sous-jacente est qu’en moyenne, sur longue période, le prix d’une action vaut un multiple fixe des bénéfices dégagés par la société ;
• le prix de l’action ne vaut certes pas toujours exactement ce multiple, mais quand il s’en écarte, à la hausse ou à la baisse, il finit toujours par revenir vers la moyenne de long-terme (cf. graphe 1) ;
• cette propriété statistique de retour vers la moyenne du PER a été testée et validée par de nombreux chercheurs
En première approche, c’est la position dans le cycle économique qui détermine le PER instantané par rapport à sa moyenne de long-terme. En période d’expansion économique, le PER dépasse sa moyenne, en période de récession, il est en-dessous (cf. graphe 1). On voit donc que le niveau du PER d’une action est nettement plus simple à interpréter que le niveau de prix de l’action correspondante.
Le prix d’une action, et donc son PER, comportent une forte composante anticipative sur la croissance future des bénéfices de l’entreprise. Interpréter un niveau de PER consiste donc principalement à juger si les anticipations de croissance des investisseurs sont cohérentes avec le stade du cycle économique.
Le niveau de PER du marché français est aujourd’hui nettement supérieur à sa moyenne historique (cf. graphique 2). Est-ce « normal » ?
1. CAC 40 : PER depuis septembre 1987
2. CAC 40 : PER depuis janvier 2008
2. Le PER : une approche théorique
Certes, c’est principalement la position dans le cycle qui doit permettre d’évaluer le niveau du PER, mais pas seulement. Deux autres facteurs majeurs sont fréquemment cités : les taux d’intérêt nominaux et la prime de risque action (qui inclut une composante d’aversion pour le risque).
Pour effectuer correctement l’analyse, qui fait maintenant appel à 3 facteurs explicatifs, on utilise un modèle d’évaluation des actions. On fait appel au modèle de Gordon-Shapiro qui donne la valeur fondamentale d’une action comme étant :
• k est le taux nominal intertemporel de rentabilité exigé par le marché sur les actions, que l’on exprime comme la somme du taux d’intérêt nominal exigé sur les actifs sans risque rf, et de la prime de risque par rapport au taux sans risque (pour compenser le risque lié à la détention d’actions)
En notant d le taux de distribution correspondant du résultat en dividende, on déduit le PER théorique :
Quels facteurs tirent aujourd’hui les PER à la hausse ? Est-ce normal vu l’état du cycle économique ? On passe en revue les 3 facteurs pour juger de leur influence :
• : dépend notamment de la politique monétaire de la Banque Centrale et des anticipations d’inflation. Les taux se sont stabilisés depuis un an et ne peuvent expliquer toute l’évolution récente, même s’ils ne les affaiblissent pas ;
: dépend notamment de la politique monétaire de la Banque Centrale et des anticipations d’inflation. Les taux se sont stabilisés depuis un an et ne peuvent expliquer toute l’évolution récente, même s’ils ne les affaiblissent pas ;
 : dépend notamment de la politique monétaire de la Banque Centrale et des anticipations d’inflation. Les taux se sont stabilisés depuis un an et ne peuvent expliquer toute l’évolution récente, même s’ils ne les affaiblissent pas ;
: dépend notamment de la politique monétaire de la Banque Centrale et des anticipations d’inflation. Les taux se sont stabilisés depuis un an et ne peuvent expliquer toute l’évolution récente, même s’ils ne les affaiblissent pas ;
•  : s’est également stabilisée depuis plusieurs mois (la décrue de la volatilité implicite sur les actions s’est surtout opérée au H1 09) ;
: s’est également stabilisée depuis plusieurs mois (la décrue de la volatilité implicite sur les actions s’est surtout opérée au H1 09) ;
 : s’est également stabilisée depuis plusieurs mois (la décrue de la volatilité implicite sur les actions s’est surtout opérée au H1 09) ;
: s’est également stabilisée depuis plusieurs mois (la décrue de la volatilité implicite sur les actions s’est surtout opérée au H1 09) ;
•  : dépend de la position dans le cycle économique. Comme les 2 autres facteurs ne sont pas en cause, c’est principalement une amélioration des anticipations des investisseurs sur les résultats (et peut-être à la marge sur le taux de distribution des résultats) qui a fait remonter les cours boursiers au T3 2009. Selon certains économistes, cette hausse place les PER actuels sur un niveau correspondant historiquement à un cycle des affaires dans un état avancé de reprise économique (alors que celle-ci ne fait que s’amorcer).
: dépend de la position dans le cycle économique. Comme les 2 autres facteurs ne sont pas en cause, c’est principalement une amélioration des anticipations des investisseurs sur les résultats (et peut-être à la marge sur le taux de distribution des résultats) qui a fait remonter les cours boursiers au T3 2009. Selon certains économistes, cette hausse place les PER actuels sur un niveau correspondant historiquement à un cycle des affaires dans un état avancé de reprise économique (alors que celle-ci ne fait que s’amorcer).
 : dépend de la position dans le cycle économique. Comme les 2 autres facteurs ne sont pas en cause, c’est principalement une amélioration des anticipations des investisseurs sur les résultats (et peut-être à la marge sur le taux de distribution des résultats) qui a fait remonter les cours boursiers au T3 2009. Selon certains économistes, cette hausse place les PER actuels sur un niveau correspondant historiquement à un cycle des affaires dans un état avancé de reprise économique (alors que celle-ci ne fait que s’amorcer).
: dépend de la position dans le cycle économique. Comme les 2 autres facteurs ne sont pas en cause, c’est principalement une amélioration des anticipations des investisseurs sur les résultats (et peut-être à la marge sur le taux de distribution des résultats) qui a fait remonter les cours boursiers au T3 2009. Selon certains économistes, cette hausse place les PER actuels sur un niveau correspondant historiquement à un cycle des affaires dans un état avancé de reprise économique (alors que celle-ci ne fait que s’amorcer).
• En fait, l’exagération des anticipations peut aussi résulter de la phase actuelle de « normalisation » du marché : après avoir été dirigé pendant plus d’un an majoritairement par des facteurs d’aversion pour le risque, le marché revient progressivement sur l’étude des fondamentaux et est à la recherche de nouveaux repères, ce qui peut expliquer la phase transitoire actuelle.
3. Annexe : un chiffrage du taux de croissance anticipé des résultats des sociétés du CAC 40
En inversant la formule du PER, on peut déduire le taux de croissance anticipé des résultats des entreprises par le marché :
Le taux de croissance qui en ressortira est très sensible au chiffre choisi :
• si on retient 11% (le taux de rentabilité moyen des capitaux propres pour les sociétés CAC 40 de 2001 à 2007, 15%, dont on soustrait le taux sans risque de 3.6%), on obtient pour la France  = 12.3% ;
= 12.3% ;
 = 12.3% ;
= 12.3% ;
Si la croissance réalisée dans les mois à venir s’avérait inférieure aux anticipations, le prix des actions devrait s’ajuster à la baisse sur des niveaux de PER plus en rapport avec l’état du cycle économique.
Cet article, écrit à titre personnel, n’engage que son auteur et non l’institution dans laquelle il travaille.