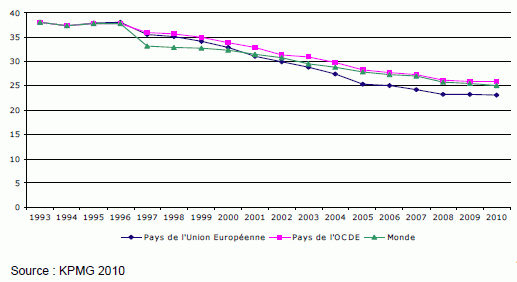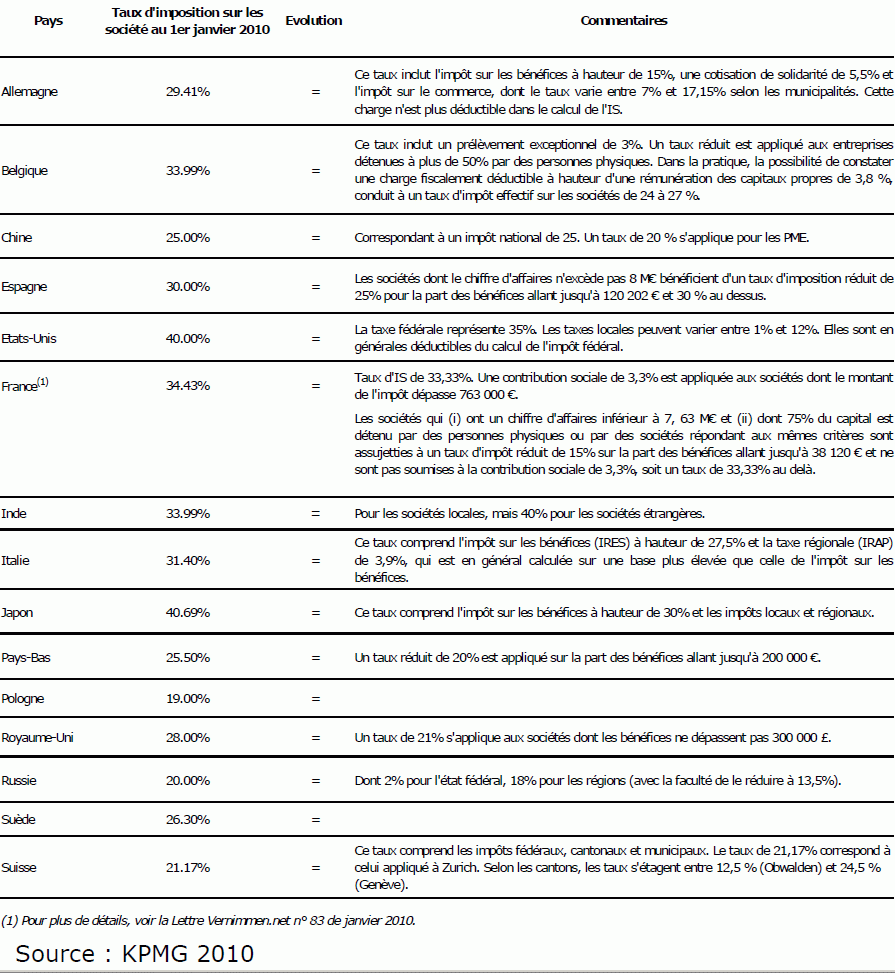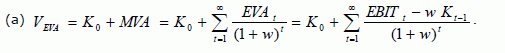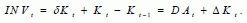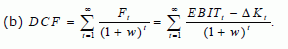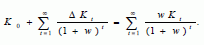La Lettre n°91 de Octobre 2010
Actualités : Comptabilisation des locations et leasings : un bond en arrière de 30 ans ?
L’IASB et le FASB ont le projet commun bien avancé de modifier en profondeur la comptabilisation des contrats de locations sous le prétexte, habituel, de grandement améliorer l’information financière à la disposition des investisseurs. Pour notre part, nous pensons qu’il s’agit d’un grand bond . . . en arrière !
Une fois de plus, par dogmatisme, l’IASB va rendre plus complexe la lecture des comptes, va alourdir inutilement la charge de travail de ceux qui les préparent et contrairement à ce qui est affirmé sans la moindre démonstration, aboutir à compliquer la vie de ceux qui utilisent au quotidien les comptes. D’où notre expression de grand bond en arrière.
Plus grave en complexifiant la comptabilité, l’IASB et le FASB la rendent plus opaque et donc moins crédible pour le commun des mortels alors que sa simplicité est un gage de son acceptabilité.
De quoi s’agit-il ?
Actuellement, la réalité économique :
• des contrats de location, par lesquels un propriétaire met à la disposition d’un locataire un bien pendant une durée définie moyennant le paiement d’un loyer et le retour du bien à l’échéance du contrat de location à moins que celui-ci ait été prorogé ;
et
• des contrats de crédit-bail ou leasing par lesquels une entreprise se voit mettre à disposition un bien pendant une durée proche de sa durée de vie, avec le plus souvent une option d’achat finale du bien à un prix plus faible que la valeur résiduelle du bien à cette échéance, moyennant naturellement le paiement d’un loyer régulier ;
est traduite comptablement par deux traitements distincts qui correspondent à la nature économique différente de ces opérations.
Le contrat de location (simple ou opérationnelle pour le distinguer du crédit-bail aussi appelé leasing ou location financière) donne lieu à des loyers qui sont comptabilisés au compte de résultat en charges d’exploitation.
Le contrat de location financière donne lieu à l’inscription du bien à l’actif du bilan du preneur avec corrélativement une inscription au passif d’une dette de nature financière correspondante à la valeur actuelle des loyers restant à payer. Au compte de résultat, le loyer payé disparaît et fait place à des frais financiers et à la dotation aux amortissements du bien. Tout se passe comme si le preneur avait acquis le bien et s’était endetté pour ce faire (1). Ce traitement n’a rien de choquant et correspond, au contraire, à l’intention de l’entreprise qui entre dans un contrat de location financière : utiliser le bien comme si elle en était le propriétaire effectif car elle sait bien qu’in fine, elle en deviendra propriétaire, tout en le finançant pas un endettement dans l’intervalle. Pour elle, un crédit bail est avant tout un crédit.
Un grand bond en avant a été fait il y a une vingtaine d’années lorsque la comptabilité a fait sienne l’interprétation économique des contrats de crédit-bail au détriment de l’interprétation juridique (juridiquement, le preneur n’est pas propriétaire du bien). Dès lors, les utilisateurs des comptes n’ont plus besoin de procéder à des retraitements extra comptables en inscrivant à l’actif le bien et une dette pour le même montant, ni de retraiter les loyers de crédit-bail en frais financiers et en dotation aux amortissements. Bref, un grand progrès.
Maintenant l’IASB et le FASB veulent caler le traitement des locations simples sur celles des locations financières. La valeur du droit d’utilisation du bien serait inscrite à l’actif. Parallèlement, une dette de nature financière apparaîtrait au passif qui se réduirait progressivement. Le loyer disparaîtrait au profit de frais financiers et de dotations aux amortissements, ces dernières venant réduire chaque année la valeur du droit d’utilisation (2).
Bien évidemment (!), la valeur de ce droit d’utilisation devra être révisée si un changement des conditions économiques et financières affectait négativement sa valeur, donnant lieu à une dépréciation dans le compte de résultat.
Les normalisateurs comptables fondent leurs points de vue sur les postulats suivants :
• une location financière et une location simple sont fondamentalement le même acte économique et il n’est pas normal qu’ils soient traduits différemment dans les comptes ;
• il est difficile de distinguer nettement par des principes, et non par des règles, location simple et location financière ;
• des investisseurs faisant des redressements des contrats de location simple, autant les faire pour eux.
Que l’on nous permette d’être en désaccord net avec ces positions.
L’esprit de la location simple n’a rien à voir avec l’esprit d’une location financière.
Une entreprise recourt à une location simple parce que :
• elle n’a pas les moyens financiers, aujourd’hui ou plus tard, d’acheter le bien ;
• elle veut se garder la flexibilité de pouvoir rendre le bien à l’issue du contrat pour en louer un autre qui corresponde mieux à ses besoins du moment, voire en acheter un ;
• elle préfère consacrer ses ressources financières, le plus souvent en montant limité, à d’autres affectations qu’elle juge plus efficaces pour elle : dépenses de R&D, croissance externe, investissements publics promotionnels, etc.
Une entreprise recourt à un crédit-bail parce qu’elle veut disposer du bien comme si elle en était déjà propriétaire, et in fine (3), l’acquérir. Mais elle ne peut pas ou ne veut pas aujourd’hui l’acquérir sans recourir à un crédit. Comme le prêteur garde juridiquement la propriété du bien en crédit-bail jusqu’à l’échéance du contrat, il s’agit d’une forme de crédit particulièrement bien garanti pour le prêteur ; et donc à des conditions de taux d’intérêt intéressantes pour l’emprunteur.
La logique économique et financière est donc totalement différente entre location simple et location financière.
Il est cependant vrai que dans certains secteurs, comme la grande distribution, l’hôtellerie et le transport aérien, des entreprises ont massivement eu recours à la location, souvent d’ailleurs en cédant des actifs en plein propriété pour les relouer, en location simple auprès de leurs nouveaux propriétaires. Il est vrai aussi que des agences de notation, des banques redressent les comptes des compagnies aériennes ou de groupes hôteliers pour tenir compte d’engagement de paiement de loyers qui peuvent obérer lourdement les flux de trésorerie disponibles. Ainsi Standard & Poors capitalise-t-il les loyer fixes d’Accor, mais ne redresse pas les loyers indexés sur le chiffre d’affaires.
Mais faut-il pour autant jeter le bébé avec l’eau du bain ? Ne suffit-il pas de demander que ces informations figurent en annexe pour permettre à ceux qui le souhaitent, une petite minorité des investisseurs, de procéder aux retraitements qu’ils souhaitent ?
Ce traitement aboutit à faire apparaître des dettes au bilan qui n’en sont pas, car celui qui vous loue des bureaux ou des machines ne vous a pas confié de l’argent comme peut le faire un obligataire ou un banquier. Il fait aussi apparaître des actifs, un droit d’occuper ou d’utiliser un bien, qui, la plupart du temps n’est pas cessible. Avec beaucoup de naïveté, le président de l’IASB déclare que cela permettra de prendre conscience du véritable niveau d’endettement des entreprises et il chiffre à 640 Md$ le surcroît de dettes. Pour un peu, grâce à cette mesure, la crise financière aurait été évitée …
Quant à dire qu’il est difficile de faire la distinction entre location simple et location financière, on se moque du monde. A quoi sert l’IAS 17 ? Mais c’est aussi la limite pratique de définitions conceptuelles qui ont poussé les professionnels à utiliser des règles édictées par le FASB qui reposent principalement sur la comparaison de la valeur actuelle des loyers et de celle de l’actif en question et de la durée de la location avec celle du bien (4).
Certes comme il s’agit de règles, et non de principes, ou plus précisément d’un principe qui, pour pouvoir s’appliquer dans la pratique a besoin de règles, il est possible de structurer des montages qui permettent de les contourner. Mais à quoi servent alors les commissaires aux comptes, les auditeurs et les comités d’audit, si ce n’est à y mettre le holà ?
Si l’on suit la logique de l’IASB et du FASB, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Pourquoi ne pas inscrire au bilan un droit d’utilisation des salariés (car nous devons tous à nos employeurs une période de préavis) avec une dette en contrepartie (les salaires dus pendant cette période de préavis). Idem pour un contrat avec un fournisseur prévoyant un volume d’achat de biens et de services sur plusieurs périodes. Comme en toute chose, il faut mettre une limite qui délimite clairement ce qui relève d’un financement et ce qui relève de la flexibilité (la location simple). A notre avis, cette limite passe là où elle est actuellement, et non là où l’IASB et le FASB ont l’intention de la mettre.
Nous ne saurions donc trop encourager nos lecteurs à faire valoir leurs points de vue auprès d’Acteo (www.acteo.org) qui prépare une réponse française à ce projet, ou directement à l’IASB (www.ifrs.org).
(1) Pour plus de détails, voir le chapitre 8 du Vernimmen 2011.
(2) L’amortissement financier de la dette demeure déconnecté de celui du droit d’utilisation.
(2) L’amortissement financier de la dette demeure déconnecté de celui du droit d’utilisation.
(3) Disposer du bien comme si elle en était propriétaire et effectivement bénéficer de conditions financières plus favorables.
(4) Voir page 153 du Vernimmen 2011.
Tableau : Les taux d'impôt sur les sociétés dans le monde
Pour la seconde année consécutive, les taux d’impôt dans le monde se sont stabilisés aux environs de 25 %, et un peu moins dans l’Union Européenne (23,04 % en raison des pays ayant rejoint ce groupe récemment). Le Royaume-Uni, qui a annoncé vouloir baisser d’un pourcent/an son taux d’impôt de 28 % jusqu’à ce qu’il tombe à 24 % en 2014, entraînera-t-il d’autres pays à sa suite ?
Recherche : Le timing des augmentations de capital
Nous présentons ce mois-ci une étude empirique sur les motivations des augmentations de capital (AC). Trois chercheurs d’universités américaines (1) ont testé sur un large échantillon (plus de 4 000 augmentations de capital par des entreprises cotées américaines entre 1973 et 2001) les différentes théories sur le sujet. Selon leurs résultats, la principale motivation aux AC est le besoin de trésorerie.
Les auteurs expliquent en introduction que les théories du trade-off et du pecking order (2) sont infirmées par les études empiriques :
• Selon la théorie du trade-off, il existe une structure du capital optimale compte tenu des avantages fiscaux de la dette et des coûts liés au risque de faillite en cas d’endettement excessif. Or, les études montrent que les entreprises ont davantage recours aux AC après une hausse importante du cours des actions : elles s’éloignent donc davantage d’une hypothétique structure optimale.
• Selon la théorie du pecking-order, les AC n’ont lieu qu’en dernier recours pour l’entreprise, car elles subissent un important coût lié aux asymétries d’information. Là encore, une hausse du cours de bourse augmente la capacité d’endettement et ne devrait donc pas favoriser les AC.
L’étude se focalise donc sur trois autres explications possibles aux AC : le market timing, la théorie du cycle de vie, et le besoin de liquidités.
Selon le market timing, les dirigeants décident de procéder à une AC lorsqu’ils considèrent que les conditions boursières sont favorables. Les résultats de l’étude confirment que les AC sont plus fréquentes pour les entreprises dont le cours présente une surperformance lors des trois années précédant l’opération, et une sous-performance lors des trois suivantes. L’effet est statistiquement significatif mais de faible ampleur : la probabilité d’AC augmente de moins de 2 points de pourcentage.
La théorie du cycle de vie, selon laquelle les entreprises se financent par capitaux propres les premières années et par dette lorsqu’elles deviennent matures, donne de meilleurs résultats. Dans l’échantillon étudié, la probabilité d’AC pour une société cotée depuis un an est de 9%, contre 2,5% pour une société cotée depuis 20 ans.
Pour conclure sur ces deux théories, les auteurs montrent que la probabilité d’AC d’une entreprise cotée depuis un an et ne bénéficiant pas d’opportunité de marché est bien plus élevée que celle d’une société cotée depuis 20 ans et bénéficiant du market timing (6,5% contre 3,8%). Le cycle de vie l’emporterait sur le market timing.
Toutefois, aucune des théories précédemment citée ne parvient à expliquer à elle seule la majorité des AC. Près de la moitié d’entre elles proviennent de sociétés qui versent ou ont déjà versé des dividendes, contrairement à l’idée de cycle de vie. En revanche, et c’est le résultat central de l’étude, 62,6% des sociétés ayant eu recours à une AC auraient subi une crise de liquidité dans l’année en l’absence d’AC, et 81,1% auraient présenté un niveau de cash anormalement faible (3).
Les auteurs concluent donc en faveur d’une anticipation de manque de liquidité dans l’année comme principale motivation des AC.
(1) H.DEANGELO, L.DEANGELO et R.M.STULZ (2010), Seasoned equity offerings, market timing and the corporate lifecycle, Journal of Financial Economics, n°95, pages 275-295.
(2) Pour plus de détails sur ces termes, voir le chapitre 39 du Vernimmen 2011.
(3) Certains expliquent ce phénomène par la propension des dirigeants à profiter des opportunités de marché pour réaliser une AC, puis à investir rapidement dans des projets qu’ils auraient autrement ignorés. Les auteurs rejettent cette explication en montrant que la plupart des entreprises aurait manqué de cash même à niveau d’investissement constant.
Q&R : L'EVA et la bonne mesure du profit par François Meunier –DFCG -
La finance innove rarement. Elle reprend souvent des notions anciennes et les met au goût du jour. Par exemple, quel mandat doit donner l’actionnaire au manager dans la conduite de l’entreprise ? La réponse, on la connaît depuis que le capitalisme est capitalisme, sans besoin de manuel de finance pour cela : il faut que le manager maximise le profit de l’entreprise à chaque période.
En suivant cette règle, le manager sera assuré de maximiser en même temps la valeur de l’entreprise, c'est-à-dire la somme de ses flux de trésorerie à travers le temps, ceci évidemment avec le bon taux d’actualisation. Cette valeur, on l’appelle valeur des flux de trésorerie actualisés ou DCF (pour Discounted Cash-flows).
Le flux net de trésorerie est, par définition, le montant de cash qui peut être remonté aux bailleurs de fonds, actionnaires ou créanciers, une fois que l’entreprise a payé ses investissements nécessaires en capital fixe et en capital circulant (le BFR). C’est la valeur actuelle du projet « entreprise ».
Au début des années 90, un « nouveau » critère est apparu, celui de création de valeur. Pour la petite histoire, Stern & Stewart, une boutique de Wall Street, a jugé bon, avec le toupet qui caractérise souvent nos amis américains, de déposer le nom commercial de cette découverte en parlant d’EVA ou Economic Value Added. Enfin venait le bon critère de maximisation de la valeur ! Le succès de la formule ne s’est pas démenti.
Voilà une belle porte ouverte enfoncée. Comme on va le voir, l’EVA n’est autre que le profit de l’entreprise. Si on en vient à mettre des copyrights sur le mot de profit, pourquoi pas sur le mot d’entreprise ou sur celui de capital ?
Evidemment, c’est le profit calculé correctement, ce que ne fait pas la présentation habituelle du compte d’exploitation de l’entreprise, où on entend par profit le bénéfice net, c'est-à-dire le résultat d’exploitation après impôts et charges d’intérêt. Cette notion se comprend si on se place du point de vue de l’entreprise qui prend comme charges tous les revenus versés au titre de ses engagements contractuels. Mais elle est bancale si on raisonne du point de vue financier des apporteurs de fonds : on prend en compte le coût de la dette, mais on oublie allègrement le coût des fonds propres. Ce qui veut dire qu’une entreprise qui s’endette peu a un « profit » plus élevé, alors qu’elle ne fait que tirer sur les fonds de ses actionnaires plutôt que sur la dette. Imaginez une banque qui finance tous ses prêts avec des fonds propres : elle aura un profit gigantesque, égal aux intérêts perçus sur ses prêts bancaires. Avec cette drôle de définition, il n’y a plus besoin de dirigeant pour maximiser la valeur d’une entreprise ; il suffit d’un trésorier qui s’abstient de lever de la dette (1).
Le profit économique est donc le résultat d’exploitation, ou EBIT, moins le coût du capital levé, qu’il soit sous forme de dette ou de fonds propres. Pour résumer cela en une formule, l’entreprise a acquis en fin de période t-1 des actifs économiques (capital fixe et capital circulant) pour un montant K. Elle a dû lever des fonds, dette ou fonds propres, pour financer ce montant. Et elle démarre son exploitation en début de période t qui lui donne des revenus en fin de cette période. Ces fonds doivent être rémunérés à un taux de rendement attendu ou coût du capital de w. Ce coût du capital est approché selon l’usage courant par le wacc, ou coût moyen pondéré du capital, qu’on note ici w, et qui est la moyenne pondérée du taux de rendement attendu sur la dette et de celui attendu sur les fonds propres.
Or, ceux qui se rappellent de leurs cours de microéconomie reconnaissent tout à fait la formule du profit : il est dit que l’entrepreneur maximise son profit, sous la contrainte de sa fonction de production. Par profit, on entend bien la valeur ajoutée de l’entreprise, diminuée de ses coûts salariaux (qui sont le coût du facteur travail), moins le coût du facteur capital, qui sera ici 

Remarque : pour lever une imprécision, il est d’usage en microéconomie de présenter le profit d’exploitation en brut, c'est-à-dire en prenant l’excédent brut d’exploitation ou EBITDA, avant amortissement. Le coût du capital doit dans ce cas être un coût du capital qui inclut le coût de l’amortissement, ce qu’on appelle le coût d’usage du capital (2). Si l’amortissement est une fraction constante du capital en place, disons égale à  on peut réécrire le profit ou EVA comme :
on peut réécrire le profit ou EVA comme :
 on peut réécrire le profit ou EVA comme :
on peut réécrire le profit ou EVA comme :
Le profit est dans ce sens proche d’une notion de surprofit : c’est le montant qui reste pour l’entreprise (et donc pour ses actionnaires) quand elle a rémunéré correctement, c'est-à-dire au niveau attendu, ses facteurs de production, travail et capital. Il est utile de rappeler ce résultat simple de la microéconomie : si l’entreprise évolue sur des marchés complètement concurrentiels et travaille à rendements constants (terme qui veut dire que j’obtiens un chiffre d'affaires double quand je double à la fois le nombre des salariés et le montant de capital), le profit au sens de l’EVA est nul. Il n’y a pas de rente ou de surprofit qui ne soit réduit par la compétition. Ceci ne veut pas dire que le profit au sens du bénéfice net sera nul : il sera simplement égal à une rémunération normale des fonds propres, c'est-à-dire correspondant au rendement attendu à l’équilibre par les actionnaires. Pourquoi cela ?
Disons que je m’appelle McDonald’s et que j’explore un nouveau pays. Le coût unitaire d’un restaurant est disons de 10 M€ et gagne 1,5 M€ de bénéfice par an. Si le coût de mon capital est de 10%, le surprofit ou EVA est donc de 1,5 – 10% x 10 = 0,5 M€ l’an. Pour une longue période de temps, on peut dire que je travaille à rendements constants : construire deux restaurants coûtera 20 M€ ; trois restaurants 30 M€, etc. ; et pour cela, j’emploierai deux fois plus de personnel, ou trois fois plus, etc. Je gagnerai 3 M€ l’an, ou 4,5 M€, etc. J’ai dans ce cas intérêt à construire une infinité de restaurants et mon profit sera infini.
Comme il n’y a pas de repas gratuit, surtout chez McDonald’s, ce joli jeu s’arrête parce que la concurrence pousse les prix à la baisse, ou bien la demande est saturée, etc., de sorte qu’à la marge l’ultime restaurant construit rapportera un profit net nul, c'est-à-dire rapportera 1 M€. On retrouve bien notre leçon de microéconomie : l’entreprise qui veut maximiser son profit investira jusqu'à ce que la productivité marginale de son capital soit égale à son coût du capital, c'est-à-dire au wacc. D’ailleurs, si McDonald’s travaille à prix de vente unique sur son territoire, le profit net total sera nul et le rendement du dernier restaurant installé (dit rendement marginal) sera égal au rendement moyen de tous les restaurants. On verra l’importance de cette remarque par la suite. Au total, en concurrence parfaite, l’exploitation des restaurants ne fera que rémunérer les actionnaires (et les obligataires) au niveau du risque pris.
Souvent bien sûr l’entreprise bénéficie d’une position de marché ou d’un avantage concurrentiel particulier ; ou d’une protection réglementaire ou technologique qui barre l’entrée aux concurrents ; ou encore travaille à rendements décroissants. Dans ce cas, elle peut dégager de façon plus durable une rente ou un surprofit. Le mandat donné au dirigeant, c’est de maximiser le profit, c'est-à-dire pour le moins de rémunérer les bailleurs de fonds pour l’argent apporté, et si possible de dégager un surprofit. C’est donc aussi de maximiser l’EVA, puisque l’EVA, c’est le profit au sens économique.
Quelle est alors la valeur de l’entreprise, par exemple à la période t=0 ? C’est pour le moins la valeur de son capital initial, soit K0, à laquelle s’ajoute la somme des profits futurs (au sens EVA), et bien sûr actualisés. Dans le jargon convenu, cette somme des profits futurs s’appelle la Market Value-Added ou MVA. On a donc :
Le ratio 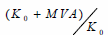 rapporte la valeur « fondamentale » (ou sa valeur boursière si les marchés financiers valorisent l’entreprise sur la base de ses profits futurs) au coût du capital initial (mesuré comme on va le voir à sa valeur de remplacement, qui diffère parfois de sa valeur au bilan comptable). Attention qu’il s’agit d’une valeur additionnant la valeur des fonds propres et de la dette, ou encore la valeur présente des actifs économiques. C’est donc ce qu’on appelle le Value-to-book ou encore le q de Tobin. Encore une fois, à rendements constants et concurrence parfaite, le profit net à chaque période est nul et le q de Tobin est égal à 1. Si ce ratio est supérieur à 1, l’entreprise bénéficie d’un goodwill, précisément égal à son MVA.
rapporte la valeur « fondamentale » (ou sa valeur boursière si les marchés financiers valorisent l’entreprise sur la base de ses profits futurs) au coût du capital initial (mesuré comme on va le voir à sa valeur de remplacement, qui diffère parfois de sa valeur au bilan comptable). Attention qu’il s’agit d’une valeur additionnant la valeur des fonds propres et de la dette, ou encore la valeur présente des actifs économiques. C’est donc ce qu’on appelle le Value-to-book ou encore le q de Tobin. Encore une fois, à rendements constants et concurrence parfaite, le profit net à chaque période est nul et le q de Tobin est égal à 1. Si ce ratio est supérieur à 1, l’entreprise bénéficie d’un goodwill, précisément égal à son MVA.
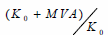 rapporte la valeur « fondamentale » (ou sa valeur boursière si les marchés financiers valorisent l’entreprise sur la base de ses profits futurs) au coût du capital initial (mesuré comme on va le voir à sa valeur de remplacement, qui diffère parfois de sa valeur au bilan comptable). Attention qu’il s’agit d’une valeur additionnant la valeur des fonds propres et de la dette, ou encore la valeur présente des actifs économiques. C’est donc ce qu’on appelle le Value-to-book ou encore le q de Tobin. Encore une fois, à rendements constants et concurrence parfaite, le profit net à chaque période est nul et le q de Tobin est égal à 1. Si ce ratio est supérieur à 1, l’entreprise bénéficie d’un goodwill, précisément égal à son MVA.
rapporte la valeur « fondamentale » (ou sa valeur boursière si les marchés financiers valorisent l’entreprise sur la base de ses profits futurs) au coût du capital initial (mesuré comme on va le voir à sa valeur de remplacement, qui diffère parfois de sa valeur au bilan comptable). Attention qu’il s’agit d’une valeur additionnant la valeur des fonds propres et de la dette, ou encore la valeur présente des actifs économiques. C’est donc ce qu’on appelle le Value-to-book ou encore le q de Tobin. Encore une fois, à rendements constants et concurrence parfaite, le profit net à chaque période est nul et le q de Tobin est égal à 1. Si ce ratio est supérieur à 1, l’entreprise bénéficie d’un goodwill, précisément égal à son MVA.
EVA et DCF
A ce stade, direz-vous, la valeur de l’entreprise selon l’EVA ne peut rien être d’autre que la valeur de l’entreprise obtenue par la DCF, c'est-à-dire en sommant tous les flux nets de trésorerie actualisés. Evidemment, puisqu’on avait enfoncé une porte ouverte ! Mais il est intéressant de passer cette porte.
Rappelons que le flux net de trésorerie est le montant de cash qui peut être remonté aux bailleurs de fonds une fois que l’entreprise a payé ses investissements en capital fixe et en capital circulant (le BFR) pour assurer son chemin de croissance. C’est donc, toujours en absence d’impôts, l’excédent brut d’exploitation dont on retire les dépenses d’investissements.
La dépense d’investissement permet d’assurer le remplacement du capital usagé (l’amortissement) et de faire croître le stock net de capital (3). Soit :
La valeur de l’entreprise est donc, selon la règle de la DCF :
Faites vos calculs, on montre l’égalité des formules (a) et (b). La valeur selon la DCF est égale à la valeur selon l’EVA ! Pas étonnant : si vous maximisez le profit bien calculé de chaque période future, vous maximisez la valeur de l’entreprise.
Une façon intéressante de montrer cette égalité consiste à éliminer le terme commun (en EBIT) dans les deux égalités. Sur cette base (a) = (b) implique :
Autrement dit, la somme (à gauche) des investissements nets de l’entreprise, en capital initial et dans le futur pour le faire croître, est égale à la somme (à droite) des rémunérations attendues sur ce capital. Ce n’est pas étonnant : le coût d’acquisition des biens capitaux, c’est la somme de ce qu’on attend qu’ils rapportent sur le marché. Il n’y a pas de différence pour un actif financier ou un actif matériel (4).
La valeur d’une entreprise peut donc se voir sous deux angles : soit la somme des profits qu’on saura ajouter à la valeur du capital initial, profit calculé avec le bon coût de la dette et des fonds propres ; soit la somme des flux de caisse qu’on peut rendre aux investisseurs, actionnaires ou créanciers ) à chaque période. Ne change que le calendrier des dépenses d’investissement et du revenu moyen qu’elles rapportent. Les défenseurs de l’EVA disent que leur approche est plus commode : souvent un projet d’investissement ou une acquisition d’entreprise signifie un gros cash-out au début, que tout le monde oublie très vite, et des flux de trésorerie très positifs ensuite. Il est donc vrai que grâce à l’EVA, l’investissement initial se rappelle au bon souvenir du manager qui doit prendre en compte son coût récurrent à chaque période dans ses calculs de rentabilité.
Un autre avantage de la présentation en profit plutôt qu’en flux de trésorerie est que souvent les managers des divisions d’une grande entreprise ne connaissent pas immédiatement les données d’investissement et de BFR : il leur est plus simple de maximiser simplement le résultat d’exploitation avec un message simple de la direction générale de ne pas oublier qu’ils consomment des ressources en capital pour un montant donné et que ces ressources sont rares et coûteuses. Il faut les retrancher du résultat d’exploitation. On dispose ainsi au sein de l’entreprise d’un outil décentralisé relativement simple pour juger de la performance des différentes unités de l’entreprise (et des performances des managers). Cet aspect pédagogique de l’indicateur est bien sûr mis en avant par les directions financières qui en font usage et initialement par le cabinet Stern & Stewart (5).
Enfin, la formule ci-dessus nous aide à comprendre que la valeur du capital qui devrait dans l’idéal figurer au bilan de l’entreprise, c’est sa valeur à son coût de remplacement, tel qu’il est évalué sur le marché (par exemple sur le marché des biens d’équipement, neufs ou d’occasion). Les règles comptables ne l’approchent que très imparfaitement.
L’investissement et les coûts d’ajustement du capital
Où en est-on alors avec l’EVA ? La notion est peut-être redondante, mais passer par elle n’est pas complètement inutile. Elle oblige à préciser la notion de profit que l’économiste ou le financier d’entreprise doivent garder à l’esprit. Elle permet aussi de présenter une théorie simple de l’investissement, formulée depuis la nuit des temps, mais plus précisément depuis James Tobin, lauréat du prix Nobel d’économie et celui qui a présenté l’indicateur du q de Tobin. Cette théorie dit que l’entreprise a intérêt à poursuivre ses investissements tant que la rentabilité de l’investissement, mesuré par l’EVA, est positive. Cela semble évident, mais ceci se formule de façon particulièrement simple en regardant la formule (a) plus haut : si l’EVA est positif en moyenne sur la période, alors la MVA sera supérieure à la valeur de l’investissement initial. McDonald’s a intérêt à parsemer le pays de ses restaurants tant que le profit (ou EVA) du dernier restaurant construit est positif. Autrement dit, tant que le q de Tobin reste supérieur ou égal à un :
C’est loin d’être une théorie parfaite. Elle donne des prévisions empiriques assez médiocres, encore qu’elle vient de recevoir une reformulation particulièrement efficace dans un article très remarqué de l’économiste français Thomas Philippon (6), qui extrait la mesure du q de Tobin non pas des taux de rendement sur le marché des actions, mais des taux de rendements d’obligations corporate.
La porte est ouverte aussi, grâce à l’EVA, sur une autre fausse évidence en matière de finance d’entreprise. J’ai écrit dans le premier paragraphe que pour maximiser la valeur de l’entreprise, le manager doit maximiser le profit de l’entreprise à chaque période. C’est sympathique : il lui suffit de s’occuper du profit période après période, sans avoir à s’occuper d’une maximisation intertemporelle sacrément plus compliquée.
Ne risque-t-on pas alors de voir le manager pris de court-termisme, cherchant à maximiser le profit de la période courante au détriment du plan d’affaires de la société sur les années à venir ? La formule de la DCF montre bien le caractère intertemporel de la maximisation, puisque chaque terme dans l’addition fait intervenir, via l’investissement, le capital de la période courante et le capital de la période précédente. La formule de la MVA montre qu’il n’en est rien : chaque terme à maximiser (i.e. le profit de chaque période) ne contient que des termes appartenant à la période. Maximiser la somme revient à maximiser indépendamment chaque terme de la somme. Est-ce à dire que le manager peut se moquer du profit des années suivantes ? Bien sûr que non. Je rappelais plus haut le résultat intuitif de la microéconomie qui dit qu’avec des marchés sont concurrentiels et des rendements constants, le montant de capital est celui qui à chaque période égalise la productivité marginale du capital au coût du capital w (ou encore tel que le rendement marginal de l’investissement – la création de valeur – est nul).
Mais cela donne une théorie de l’investissement particulièrement naïve : l’entreprise détermine son capital optimal et l’investissement est la variable de solde. Un peu comme si McDonald’s pouvait disposer d’un grand restaurant le week-end pour accueillir sa nombreuse clientèle et le revendre en fin de week-end pour un espace plus petit afin d’accueillir la clientèle moins nombreuse de la semaine. Il y a bien sûr des coûts d’ajustement liés à l’investissement et au désinvestissement (coûts de prospection, d’installation, de désinstallation, d’apprentissage, inexistence de marchés d’occasion efficaces, etc.) qui limitent la flexibilité de l’entreprise. Dans un article célèbre, Hayashi (7) a montré qu’en présence de coûts d’ajustements :
• Le q de Tobin est supérieur à un (il y a donc une MVA non nulle de l’entreprise y compris s’il n’y a pas de pur goodwill), ceci même en concurrence parfaite et à rendements constants. Le q intègre le coût de mise en place de l’investissement.
• On en peut plus se contenter de maximiser le profit période après période. On en revient, comme pour la DCF, à une maximisation à travers le temps.
• Le q de Tobin sur le dernier équipement engagé est égal au q de Tobin moyen de l’entreprise (ce qu’on avait déjà vu pour McDonald’s qui connaît, dans sa phase d’expansion, une rentabilité identique pour chacun de ses nouveaux restaurants).
Une fois tout cela bien digéré, comme pour un gros Big Mac, on a donc avec l’EVA un outil commode d’analyse financière.
(1) On peut se demander pourquoi la comptabilité a toujours privilégié la notion de bénéfice net après paiement des intérêts contractuels de la dette ? La raison est historique : la comptabilité se place du point de vue de l’entreprise, et non du point de vue de l’ensemble de ses investisseurs financiers. Or de son point de vue, les frais financiers sont des charges certaines, puisque répondant à des engagements contractuels, alors que la rémunération de l’actionnaire est une charge incertaine. D’où le traitement dual. Mais du point de vue de l’investisseur, il en va autrement : les intérêts ne sont un revenu pour le créancier que si l’entreprise évite le défaut : le rendement de la dette, bancaire ou obligataire, doit prend en compte ce risque ; de la même façon, le rendement de l’actionnaire doit prendre en compte le risque de mauvais résultat de l’entreprise.
(2) Le coût d’usage est analogue à un coût d’opportunité ou coût de location des biens d’équipement. Le loyer demandé par le propriétaire doit être à l’équilibre le coût de l’emprunt pour acheter une unité de capital, plus le coût de l’amortissement économique du bien, soit au total.
(3) On prend ici une définition large de l’investissement qui inclut l’investissement en capital circulant, i.e. la variation du besoin en fonds de roulement, stocks et créances et dettes d’exploitation. En pratique, le BFR varie davantage en proportion du chiffre d'affaires que du capital physique investi, mais l’approximation est bonne dans le cas où la productivité du capital est constante.
(4) La formule est encore plus claire si on suppose que l’entreprise ne connaît pas de croissance. L’investissement net  est nul à chaque période et l’égalité ci-dessus se simplifie
est nul à chaque période et l’égalité ci-dessus se simplifie
en : en utilisant la formule de la rente perpétuelle.
en utilisant la formule de la rente perpétuelle.
 est nul à chaque période et l’égalité ci-dessus se simplifie
est nul à chaque période et l’égalité ci-dessus se simplifieen :
 en utilisant la formule de la rente perpétuelle.
en utilisant la formule de la rente perpétuelle.
(5) Voir Stern, Joel M., G. Bennett Stewart and Donald H. Chew (1995), “The Eva® Financial Management System”, Journal of Applied Corporate Finance, Volume 8, Issue 2, Summer, Pages: 32–46.
(6) Philippon, Thomas, 2009, “The bond market’s Q”, Quarterly Journal of Economics, 2009, Vol. 124, No. 3: 1011–1056.
(7) Hayashi, Fumio, (1982), “Tobin's Marginal q and Average q: A Neoclassical Interpretation”, Econometrica, Vol. 50, No. 1, Jan.., pp. 213-224.
Autre : Nouveau sur le site www.vernimmen.net
Le tableau de bord du financier a été mis à jour. Il vous offre des graphiques sur les variables financières clefs. Pour le consulter, cliquez ici.
*********** SONDAGE ***********
A la question posée « Croyez-vous à un redémarrage de l’inflation au-delà de son niveau actuel de 2 % par an ? », le gros millier d’internautes a apporté une réponse digne d’une élection présidentielle française !
OUI : 52 %
NON : 48 %
Pour notre part, nous faisons partie de la minorité …
Un nouveau sondage est un ligne : Quel coût du capital utiliseriez-vous pour un investissement moyennement risqué réalisé en France ?
. 5 à 6 %
. 6 à 7 %
. 7 à 8 %
. 9 à 10 %
. 10 à 11 %
. 11 à 12 %
. Au-delà de 12 %
cliquez ici pour voter.