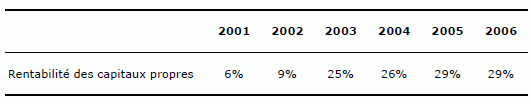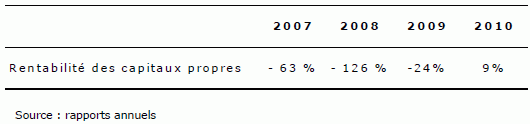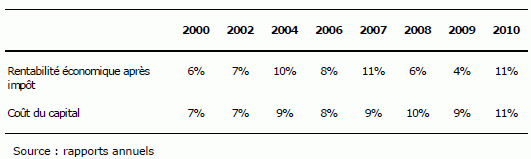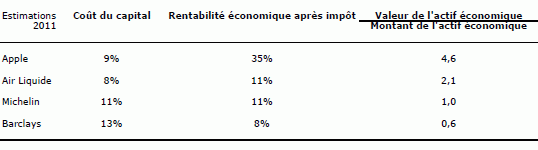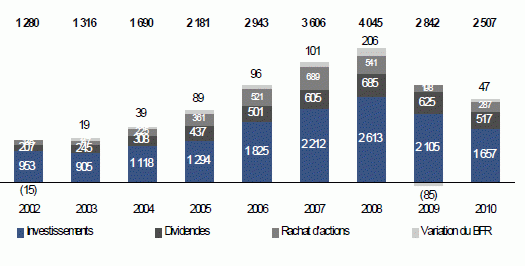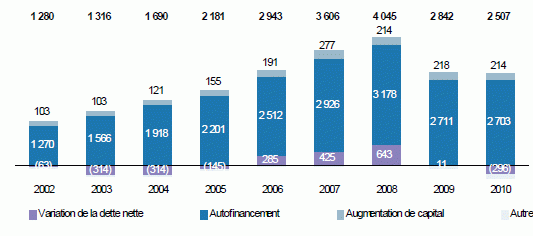La Lettre n°99 de Juillet 2011
Actualités : Les 10 vérités éternelles de la finance (1)
1- Risque et rentabilité ou le mariage sans divorce possible
C’est l’un des meilleurs indicateurs possibles d’une crise à venir que la croyance à un moment donné qu’il est possible d’obtenir un très beau taux de rentabilité pour un risque faible. Il en a été ainsi des CPDO inventés en 2006 par ABN Amro qui, notés AAA par les agences de notations complaisantes ou incompétentes, offraient un taux de rentabilité supérieur de 1 à 2 % au taux des emprunts d’Etat notés AAA. Il s’agissait en fait de credit default swaps (1)repackagés avec un effet de levier qui en 2008 avaient perdu au minimum 30 % de leur valeur.
Le risque doit être rémunéré sinon il n’est pris que par les têtes brûlées ce qui ne suffit pas pour assurer le développement de l’économie. La rémunération du risque provient du mécanisme de l’actualisation qui fait que les flux futurs espérés sont achetés / évalués avec une décote par rapport à leur montant nominal, décote d’autant plus forte que le flux est lointain dans le temps et / ou que l’incertitude sur son montant est forte (2).
De la même façon il ne faut pas se leurrer, de fortes rentabilités ne peuvent provenir que d’un risque élevé. Considérons ainsi à titre d’exemple la rentabilité des capitaux propres de la banque d’investissement d’UBS jusqu’en 2006 :
Si l’on croit que l’on peut durablement gagner deux fois son coût du capital sans prendre plus de risque que la moyenne, sauf à être dans un secteur avec de formidables barrières à l’entrée et sans véritable concurrent (ce qui n’est pas le cas de la banque d’investissement), on se trompe totalement comme l’illustre l’évolution ultérieure de la rentabilité de la division d’UBS :
Il est vrai que ses pertes sur les subprimes ont été d’environ 50 Md$.
Bien évidemment, nous aimerions tous avoir de bonnes rentabilités avec des risques faibles et comme nous les cherchons tous, en investissant dans ces poches de nirvana ou en les achetant, nous faisons baisser les rentabilités futures et rétablissons l’équilibre ….. logique.
2 - Rentabilité demandée et rentabilité obtenue ou la convergence obligatoire
Remarque dérivée de la précédente, il n’est durablement pas possible de gagner une rentabilité sur les capitaux investis (la rentabilité économique) supérieure ou inférieure à la rentabilité demandée compte tenu du risque (le coût moyen pondéré du capital).
Michelin a beau être le leader mondial de son secteur avec une marque à la notoriété établie, avoir inventé des produits révolutionnaires et déposer de nombreux brevets qui constituent autant de barrières à l’entrée, sa rentabilité équivaut, bon an mal an, à son coût du capital :
Ceci est d’autant plus vrai que le secteur de l’entreprise est à maturité. La raison en est la concurrence et dans ce domaine comme le dit l’adage : « Il n’y a pas de forteresses imprenables, il n’y a que des forteresses mal assiégées ».
Il est inévitable qu’un jour la rentabilité de Facebook ressemble à celle de Michelin aujourd’hui comme celle d’IBM, de Microsoft puis de Google en ont pris le chemin.
A l’inverse, si la rentabilité est durablement insuffisante, des acteurs feront faillite, sortiront du secteur et celui-ci sera restructuré par des fusions et acquisitions. Que nos lecteurs se rappellent l’état de la sidérurgie dans les années 1980 (en faillite) et de son rebond dans les années 2000 après les regroupements Sacilor – Usinor – Aceralia - Arbed, British Steel – Hoogovens, etc.
3 - La dette, en elle-même, ne créée pas de valeur ou l’illusion de l’effet de levier
Si la dette pouvait créer de la valeur en abaissant le coût moyen pondéré du capital, comment expliquer que les meilleures sociétés de monde dont les performances opérationnelles sont telles qu’elles ne craignent pas la faillite (Apple, L’Oréal, Hermès, Google, BMW, Nestlé, …) n’aient quasiment pas de dette et que la plupart du temps elles aient au contraire des liquidités nettes ?
Il existe cependant deux exceptions à ce principe :
• lorsque dans l’économie les taux d’intérêt réels sont négatifs car la dette est à taux fixe et que l’inflation monte de façon non anticipée comme dans les années 1960 et 1970 en Europe et aux Etats-Unis. Il y a alors une spoliation des prêteurs remboursés en monnaie de singe qui ne peut pas durer très longtemps. L’invention et la généralisation des emprunts à taux variable rendent douteuse une réédition de ce phénomène dans le futur ;
• dans les LBO où la dette sert d’aiguillon (la dette à rembourser pousse à être plus efficace pour générer des flux de trésorerie disponibles), de bâton (la crainte de la faillite évite le laxisme) et de carotte (l’impact de l’effet de levier de la dette sur la valeur des management packages) (3).
4 - Le cash c’est la vérité
Parce qu’une entreprise fait techniquement faillite quand elle n’arrive plus à un moment donné à trouver des liquidités nécessaires à son activité même si la cause du problème est en amont.
Parce que détenir du cash permet d’acheter des actifs à la valeur bradée quand une crise survient (Peugeot et Citroën, Fiat et Chrysler plus récemment).
Parce que les escrocs sont toujours démasqués par le cash (sinon M. Madoff sévirait probablement toujours vue l’efficacité du régulateur américain), c'est-à-dire une déconnexion entre les chiffres proclamés (performance, actifs sous gestion, …) et la réalité de la caisse le soir ou le matin.
Parce l’analyse financière d’un problème complexe se résout toujours plus aisément en raisonnant cash.
Comme disent les américains, qui n’ont pas que des défauts, cash is king.
5. Les capitaux investis ne peuvent valoir plus que leur montant que si la rentabilité dégagée est supérieure à la rentabilité exigée
Même si il y a peu à espérer de la pérennité d’une sur-rentabilité (voir le point 2), seule une déconnexion temporaire des deux permet de créer de la valeur comme l’illustre ces quelques exemples :
(1) Pour plus de détails, voir chapitre 54 du Vernimmen 2011.
(2) Pour plus de détails, voir chapitre 19 du Vernimmen 2011.
(3) Pour plus de détails, voir le chapitre 50 du Vernimmen 2011.
Tableau : 9 ans de tableau de financement
Calculé sur les 1 200 premières capitalisations boursières mondiales (29 trillions $), soit 55% de la capitalisation boursière totale (53 trillions $), il montre :
• le triomphe de l’autofinancement qui représente, bon an mal an, 94% des ressources des plus grandes entreprises mondiales ;
• la montée des redistributions aux actionnaires passant de 27% à 32% des emplois et l’insignifiance sur cette période des variations du besoins en fonds de roulement.
Les emplois :
et les ressources :
Ce graphique est un des nouveaux graphiques crées pour l’édition 2012 du Vernimmen qui sera disponible en librairie début septembre.
Recherche : De l'intérêt de changer de banque … à court terme !
La recherche en finance consiste souvent à repérer une base de données originale permettant de tester empiriquement des théories. Dans l’article que nous présentons ce mois-ci (1), deux chercheurs de l’Université de Tilburg (Pays-Bas) ont utilisé le registre bolivien des crédits, ou CIRC (Central de Informacion de Riesgos Crediticios) pour tester les hypothèses d’un modèle d’asymétries d’information sur les prêts bancaires. L’objectif est de montrer que les emprunteurs obtiennent généralement des prêts à des taux d’intérêt inférieurs lorsqu’ils changent de banque, et que la banque remonte ensuite progressivement les taux appliqués pour profiter d’une rente informationnelle.
La richesse de cette base de données tient à l’obligation légale qui est faite aux institutions financières boliviennes de transmettre des informations détaillées sur les prêts qu’elles accordent. Les informations portent sur les caractéristiques du prêt accordé, sur l’emprunteur et sur l’historique de ses relations avec la banque. Surtout, le suivi des données est mensuel. Les auteurs de l’article ont donc pu étudier un panel d’emprunteurs et se concentrer sur les conséquences d’un changement de banque sur les conditions de prêt.
Les quatre hypothèses testées sont issues d’un article de Von Thadden de 2004 (2), et les résultats sont les suivants :
1. Les emprunteurs changent régulièrement de banque. Sur la période étudiée (33 084 nouveaux prêts entre mars 1999 et décembre 2003), 22% des entreprises ont changé au moins une fois de banque, soit environ 4,5% chaque année (3).
2. Les entreprises qui changent de banque obtiennent des taux d’intérêt plus faibles auprès de la banque outsider (c’est-à-dire qui n’a pas eu de relation de crédit avec l’emprunteur dans les 12 mois précédents) que ceux qu’elles auraient obtenus auprès des insiders. Les auteurs ont procédé à deux comparaisons :
• à caractéristiques équivalentes, les entreprises obtiennent des prêts 89 points de base (0,89%) moins chers auprès des outsiders qu’auprès des insiders ;
• les prêts accordés par les banques à leurs nouveaux clients sont 87 points de base moins chers que ceux qu’elles accordent aux clients de mêmes caractéristiques et à la même période (4).
Les entreprises qui ont changé de banque voient leurs taux d’intérêts baisser de 36 points de base supplémentaires dans les 18 mois suivants (la nouvelle banque doit faire face à des offres plus agressives des insiders pour conserver le client). Puis, la banque profite progressivement de son nouveau statut d’insider pour relever les taux. Trois ans après le changement, les taux sont 190 points de base plus élevés qu’au moment du changement.
En raison de la sélection adverse, la proportion d’entreprises qui se révéleront défaillantes doit être plus élevée parmi celles qui décident de changer de banque. Cette hypothèse de Von Thadden est contredite par l’échantillon. Les auteurs attribuent ce résultat à la présence du CIRC en Bolivie : les outsiders peuvent consulter les dossiers de leurs prospects, ce qui réduit fortement les asymétries d’information.
La portée de cet article peut être discutée en raison des particularités du système financier bolivien : marchés financiers peu développés, présence du CIRC qui réduit les asymétries d’information. En contrepartie, la taille et la richesse de l’échantillon ont permis aux auteurs une analyse très fine. Pour mesurer la baisse de taux obtenue par les entreprises qui changent de banque « toutes choses égales par ailleurs », les auteurs ont utilisés 19 critères différents (caractéristiques de l’emprunteur, du prêt, de la relation entre l’emprunteur et sa banque…) !
(1) V.IOANNIDOU et S.ONGENA (2010), Time for a change : loan conditions and bank behavior when firms switch banks, Journal of FInance, vol.65, pages 1847-1877.
(2) E.L.VON THADDEN (2004), Asymmetric information, bank lending, and implicit contracts : the winner’s curse, Financial Research Letters, n°1, pages 11-23.
(3) Ce résultat est conforme à des études effectuées sur d’autres échantillons et à d’autres périodes.
(4) Les taux d’intérêts moyens sur l’échantillon sont de 13,56%.
Q&R : Les règles de sous- capitalisation
par Benoît Dambre Chargé d'enseignement à HEC – Taj Société d'Avocats – Membre de Deloitte Touche Tohmatsu
1. Les investissements des sociétés sont financés sur fonds propres et par recours à l’endettement.
Cet « arbitrage » entre fonds propres et endettement est en réalité davantage du ressort des associés - et non des sociétés qui investissent - sous réserve des contraintes juridiques en matière de capitaux propres bien sûr.
Or c’est bien au niveau de ces sociétés - et non de leurs associés - qu’il s’agit dans un premier temps de déterminer la base imposable. D’où parfois un « débat de sourds » entre l’Administration fiscale et les sociétés accusées d’être « sous-capitalisés »… alors même que la décision d’augmenter leurs fonds propres ne leur appartient pas !
Ce débat a tourné court dans de très nombreux Etats (1) par l’adoption de règles visant à lutter contre la « sous-capitalisation » et, pour ainsi dire, à définir une « orthodoxie fiscale » en matière de financement des « entreprises emprunteuses » lorsque l’actionnaire est, directement ou indirectement, également le « prêteur ».
Tel est l’objet de la réglementation fiscale française, qui vise à limiter non seulement le taux d’intérêt admissible fiscalement, mais encore le montant de l’endettement maximum entre sociétés d’un même groupe.
L’objet de cette courte synthèse est de rappeler de manière schématique les principales règles fiscales qui, en France, régissent la déduction des frais financiers (2).
2. Il nous faut au préalable rappeler les enjeux fiscaux : quel avantage fiscal y-a-t-il à arbitrer entre fonds propres et endettement ?
Car il faut bien admettre que, si l’arbitrage entre fonds propres et endettement peut obéir à des logiques purement financières (« augmenter la rentabilité des capitaux propres investis sans modifier, par définition, la rentabilité économique » (3)), en pratique les préoccupations fiscales sont rarement éloignées.
En effet, à la différence des dividendes, les intérêts sont généralement déductibles des résultats imposables. Au sein d’un groupe, il peut dès lors être opportun de rechercher une économie d’impôt procurée par la déduction des intérêts lorsque celle-ci est supérieure à l’impôt dû sur ces mêmes intérêts.
Tel est le cas, pour simplifier, lorsque le taux effectif d’imposition du prêteur est inférieur à celui de l’emprunteur, compte tenu de la législation fiscale à laquelle l’un et l’autre sont soumis.
Bien entendu, cette question trouve toute sa pertinence dans l’ordre international, les groupes ayant intérêt à « localiser » la dette dans les Etats où ils obtiendront un allègement maximal de leur charge fiscale, compte tenu de la fiscalité applicable localement et, corrélativement, à localiser leurs créances dans des Etats où les intérêts seront faiblement fiscalisés (4).
Cette stratégie fiscale est d’autant plus aisée à mettre en place qu’elle ne touche pas, en principe, aux « opérations ». En pratique, sa mise en œuvre aboutit à endetter (ou « leverager ») des sociétés rentables mais lourdement fiscalisées pour acquérir des actifs dont les rendements ne sont pas ou peu fiscalisés (par exemple, des titres de filiales dont les dividendes sont exonérés à hauteur de 95% de leur montant).
3. C’est dans ce contexte que la loi fiscale française vient « encadrer » la déduction des intérêts servis aux associés ou aux entreprises liées, dont la portée varie selon la qualité des prêteurs.
S’agissant en premier lieu des prêts consentis par les associés (5) de la société emprunteuse, sauf exceptions, la loi fiscale (6) soumet leur déduction à deux séries de conditions :
• en premier lieu, le capital social doit avoir été intégralement libéré. En pratique toutefois l'Administration fiscale n’applique pas cette règle en cas d’augmentation de capital si l'acte constatant l'opération prévoit expressément sa libération intégrale dans un délai maximal de trois ans (D. adm. 4 C 552 n° 4, à jour au 30 octobre 1997).
• en second lieu, le taux d’intérêt doit ne pas excéder une limite représentée par le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (TMP à taux variable, égal à 3,82% pour 2010).
Toutefois, ce taux « plafond » autorisé peut être dépassé lorsque les intérêts rémunèrent des avances résultant d'opérations commerciales dans lesquelles les associés interviennent à titre de clients ou de fournisseurs ordinaires, ou bien si la société emprunteuse apporte la preuve que le taux qui lui est appliqué par son associé prêteur, s’il s’agit d’une entreprise qui la contrôle, n’est pas plus élevé que le taux de marché (il s’agit en pratique du taux que l’entreprise liée emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues).
En cas de dépassement du « taux fiscal », la fraction excédentaire des intérêts versés est réintégrée dans les résultats imposables de l’entreprise emprunteuse, et considérée comme un « revenu réputé distribué » (ce qui, dans un cadre international, peut entraîner des frottements liés à des retenues à la source).
Enfin, l’article 212-I du CGI, issu de la loi de finances pour 2006, a étendu l’application de ce taux plafond aux intérêts servis à toutes les « entreprises liées », ce qui suppose l’existence d’un contrôle mais pas nécessairement dans le cadre de relations d’associés.
4. Les choses deviennent plus complexes lorsqu’on aborde la question non plus du « taux » mais du montant de l’endettement maximum autorisé au plan fiscal.
A cet égard, le dispositif instauré par la loi de finances pour 2006 et codifié à l'article 212 du code général des impôts (« CGI ») est, selon les points de vue, une « petit bijou de complexité fiscale » ou bien un « monstre à trois têtes ».
Si l’objectif du législateur fiscal est compréhensible - clairement, il s’agit là encore de « protéger » la base imposable en France en limitant la déductibilité des frais financiers (« base erosion ») - sa mise en œuvre soulève des questions parfois complexes.
Schématiquement, le dispositif consiste à sanctionner les sociétés insuffisamment capitalisées, en réintégrant dans les résultats imposables une fraction des intérêts dus à des sociétés liées (et non plus auprès des seuls associés).
Ce dispositif, largement inspiré de législations étrangères, a connu un certain nombre d’évolutions depuis 2006, visant à renforcer l’efficacité des règles applicables.
La modification récente la plus remarquée a consisté à étendre le dispositif aux prêts contractés auprès d’un établissement de crédit dès lors qu’ils sont garantis par une société du groupe (confer § 5. ci-dessous). On soulignera que cette mesure nouvelle s’est en outre appliquée pour la détermination des résultats des exercices clos dès le 31 décembre 2010, entrainant ainsi par sa rétroactivité de nombreux financements dans le champ du dispositif alors qu’ils étaient déjà bouclés.
4.1. Depuis le 1er janvier 2007, s’agissant de la fraction des intérêts compris dans la « limite en taux » visée ci-dessus, le texte rend non déductible la fraction des intérêts servis à des entreprises liées (7) excédant la plus élevée de trois autres limites, sauf si cette fraction est inférieure à 150.000 €.
Sous réserve de certaines exceptions sectorielles (centrales de trésorerie, crédit bailleurs et banques) pour lesquelles le nouveau texte ne s’applique pas, ces limites, lorsqu’elles sont cumulativement franchies, qualifient une situation de « sous capitalisation » :
• la première limite vise « l’endettement global », à savoir 150% des capitaux propres appréciés au choix de l’entreprise à la clôture ou à l’ouverture de l’exercice. Toutefois, l’entreprise peut substituer à cette limite celle de l’endettement global du groupe auquel elle appartient s’il est supérieur à son propre ratio d’endettement (situation assez rare en France d’après notre expérience). En pratique, il s’agit du « ratio » le plus simple à gérer dans la durée ;
• la seconde limite dite de « couverture des intérêts par le résultat », correspond à 25% du résultat courant avant impôt préalablement majoré de certains éléments dont les intérêts versés à des sociétés liées et les amortissements. Signalons que les amortissements dérogatoires et les provisions ne viennent pas majorer le résultat courant à prendre en compte;
• la dernière limite correspond aux intérêts reçus de sociétés liées. Elle vise le cas des entreprises intermédiaires qui empruntent pour prêter les mêmes sommes à d’autres sociétés du groupe : le dispositif ne s’applique qu’à raison de l’excédent des intérêts servis sur les intérêts reçus d’entreprises liées.
Les intérêts excédant la plus élevée de ces trois limites doivent être réintégrés fiscalement.
La perte de déduction fiscale n’est toutefois pas définitive : la fraction des intérêts non déductible immédiatement (en « n ») peut en effet être « reportée » et déduite au titre de l’exercice suivant (« n+1 ») dans la limite du seuil de 25% du résultat courant avant impôt corrigé, diminué du montant des intérêts admis en déduction au titre de cet exercice (« n+1 »). Le « stock d’intérêts différés » subit ensuite une décote annuelle de 5% à compter de la 2ème année (en « n+2 »).
4.2. Sans qu’il soit ici question de rentrer dans les détails, soulignons que :
• ces intérêts non déductibles ne sont pas considérés comme des « revenus réputés distribués», ce qui permet de simplifier les problématiques de retenues à la source mais s’oppose à l’application du régime des sociétés mères au niveau du bénéficiaire;
• un dispositif spécifique est prévu pour les sociétés fiscalement intégrées, qui sont soumises aux mêmes obligations de réintégrations dans leurs résultats individuels. Très schématiquement, le dispositif conduit en principe à neutraliser l’impact des versements d’intérêts entre sociétés membres du même groupe fiscal intégré « comme si » le groupe fiscal ne formait qu’une seule entité (8), et c'est au niveau de la détermination du résultat d'ensemble que, sous certaines conditions, les réintégrations sont neutralisées en tout ou partie.
5. Afin essentiellement de lutter contre les situations de prêts « back-to-back », le périmètre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation applicable aux prêts intra-groupe a récemment été étendu aux prêts consentis par une entreprise tierce mais garantis par une entreprise liée, à compter du 31 décembre 2010 (et non à compter du 1er janvier 2011 comme l’espéraient de nombreux commentateurs).
Sont ainsi assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement, les intérêts qui rémunèrent des sommes mises à disposition dont le remboursement est garanti :
• directement, par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur ;
• ou indirectement, par une entreprise dont l'engagement est lui-même garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur.
En l’absence de précision, toutes les sûretés personnelles comme réelles sont visées. Mais l’existence d’une telle garantie n’attrait pas systématiquement dans le champ du dispositif la totalité du prêt. Ainsi, lorsque le prêt n’est que partiellement garanti, seule la fraction du remboursement effectivement garantie entre dans le champ de la mesure.
Par ailleurs, en cas de sûreté réelle, pour toute la durée de la convention instituant la sûreté, la fraction du prêt réputée garantie sera égale au rapport entre la valeur du bien à la date où la sureté est constituée et le montant initial des sommes mises à disposition. Cette fraction garantie sera ainsi fixée une fois pour toutes au moment de la constitution de la sureté, tant que les termes de la convention ne sont pas modifiés et quelles que soient les variations de la valeur du bien ou celle des sommes laissées à disposition.
Les intérêts correspondants au montant du prêt garanti seront pris en compte pour l’appréciation du ratio de 1,5 fois les capitaux propres (art. 212 II 1 a). En revanche, on observera qu’en sens inverse, pour la société garante, les intérêts versés par la société débitrice au titre du prêt garanti ne pourront pas être assimilés à des intérêts servis par une entreprise liée pour l’appréciation du critère relatif aux intérêts reçus de sociétés liées (art. 212 II 1 c).
Par exception, cette extension du dispositif ne s’applique pas aux sommes laissées ou mises à disposition :
• à raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public (Code mon et fin., article L 411-1), ou d’une réglementation étrangère équivalente ;
• pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le nantissement des titres du débiteur, ou de créances sur ce débiteur ;
• à la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé et des intérêts échus à cette occasion.
Mais, on relèvera tout particulièrement que les prêts garantis par des titres d’une société détenant directement ou indirectement le débiteur échapperont également à la mesure sous réserve que le détenteur des titres et le débiteur soient membres du même groupe fiscal. En outre, on notera que cette nouvelle mesure anti-abus ne s’appliquera pas aux emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à l’occasion d’une opération d’acquisition de titres ou de son refinancement.
En revanche, on ne peut que déplorer une application générale de la loi nouvelle, hors les exceptions expresses qu’elle prévoit, aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010 et non plus du 1erjanvier 2011 comme le législateur l’avait un temps envisagé (rendant le dispositif nouveau applicable aux financements autres que ceux liés à une acquisition de titres).
Pour la notion même d’entreprises liées, il est dans tous les cas fait référence aux dispositions de l’article 39-12 du CGI, qui vise les entreprises unies entre elles par un lien de dépendance (9).
(1) Confer notamment le paragraphe 168 du rapport OCDE de 1998 intitulé « concurrence fiscale dommageable, un problème mondial ».
(2) Nous n’étudierons pas ici les règles spécifiques applicables lorsque la société emprunteuse est membre d’un groupe fiscal intégré, et nous nous contenterons du cas des sociétés non intégrées fiscalement.
(3) Pour plus de détails, voir le chapitre 39 du Vernimmen 2011.
(4) Tel est le cas, par exemple, de la Belgique où les sociétés peuvent prétendre à une « déduction notionnelle » calculé sur leur capital, ce qui atténue la charge fiscale sur les intérêts des prêts ou avances consenties.
(5) Sont visés ici tous les associés quelle que soit leur qualité : personne physique ou morale, minoritaire ou non.
(6) Article 39-1-3° du code général des impôts.
(7) Les entreprises liées s’entendent de celles unies entre elles par un lien de dépendance au sens de l’article 39-12 du CGI.
(8) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010 toutefois les prêts bancaires garantis par une société membre du groupe fiscal intégré posent problème, le mécanisme de neutralisation ne joue pas, ce qui limite l’intérêt de l’intégration fiscale.
(9) Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprise : (a) lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; (b) lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au (a), sous le contrôle d’une même entreprise tierce.